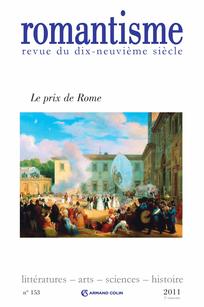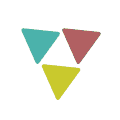1 Fils du peintre Carle Vernet (1758-1836), Horace Vernet (1789-1863) étudia d’abord la peinture chez Jacques Louis David (1748-1825) et passa chez Théodore Géricault (1791-1824). Il se démarqua vite par l’indépendance de son caractère et un relatif mépris pour la tradition académique. Comme son père, Horace tenta en vain le prix de Rome (1810). C’est bien à ses faits d’armes lors de la bataille de la barrière de Clichy (1814), et non à une distinction artistique particulière, qu’il dut cette Légion d’honneur reçue précocement du général Moncey. Mais, associé au projet de Fontainebleau dès 1818, il fut élu sans difficulté membre de l’Académie des beaux-arts (1826). Sa nomination à Rome fut également rapide : classé deuxième dans l’été 1828, Vernet bénéficia du choix ministériel, à la satisfaction de Quatremère de Quincy, secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, et de Guérin, directeur en titre de l’Académie de France. Arrivé le 18 janvier 1829 à Rome, parti en février 1835, Horace Vernet consacra six années à la direction de l’Académie romaine. Sa personnalité artistique et humaine, l’encouragement de ses pensionnaires à l’étude et à l’enrichissement culturel, l’inflexion donnée au règlement qui régissait la vie à la Villa Médicis à l’issue du prix de Rome font de son directorat une période singulière, riche d’expériences et de débats. La récente édition scientifique de sa correspondance de directeur offre des sources renouvelées pour l’étude de la formation romaine, tiraillée entre modernité et tradition, des jeunes artistes français titulaires du prix de Rome, sous le règne de Louis-Philippe [1].
SE FORMER À L’ACADÉMIE DE FRANCE À ROME AU TEMPS D’HORACE VERNET
2 Dans le cadre du règlement de 1821, la formation à Rome durait alors cinq années. Les pensionnaires lauréats dans les cinq disciplines de la peinture (histoire ou paysage), de la sculpture, de l’architecture, de la gravure (taille douce ou pierres fines) et de la composition musicale arrivaient à Rome en janvier de leur première année. Les pensionnaires musiciens n’y passaient que les deux premières. Pour les peintres, les architectes et les sculpteurs, les fondements pédagogiques reposaient en grande part sur l’observation, l’étude et la copie des chefs-d’œuvre de l’art de l’Antiquité et de la Renaissance. L’Académie proposait une « école du modèle », suivie les deux premières années notamment, pour apprendre à peindre ou modeler d’après le modèle vivant. L’école était ouverte sur autorisation à des élèves extérieurs, en particulier les étrangers boursiers. En août 1834, le ministre Thiers demanda ainsi à Vernet d’accueillir cinq artistes pensionnés, originaires d’Anvers, Bruxelles et Liège [2].
Les envois annuels
3 En janvier, les pensionnaires devaient remettre au directeur les travaux imposés pour l’année écoulée. Selon les disciplines, le règlement prévoyait des obligations fixes et une progression dans la difficulté des épreuves et la part d’implication personnelle [tabl. 1]. Ce calendrier pouvait poser problème aux sculpteurs : en janvier, la figure de plâtre due pour la 4e année était souvent « sous les points », puisqu’elle devait être exécutée en marbre au titre de la 5e ; aussi rendaient-ils souvent l’esquisse de leur figure à la place de la figure préparatoire de plâtre. Quant aux obligations annuelles des graveurs, elles furent modifiées à partir de 1830, de la 1re à la 5e année.
4 Ces obligations annuelles étaient appliquées avec souplesse, dans leur teneur et dans la date de leur remise. Les peintres François Bouchot, Auguste Debay et André Giroux et le sculpteur Augustin-Alexandre Dumont, en retard sur leurs envois réglementaires de l’année 1829, purent, grâce à la défense qu’en prit Vernet auprès du ministre de l’Intérieur, échapper à la suspension de leur pension, prévue au règlement [3]. Vernet ne cessa de préciser, dans ses tableaux accompagnant, au printemps, les envois, toutes les exceptions apportées. En 1re et 2e années, alors que les peintres d’histoire devaient rendre, en plus d’une figure peinte d’après nature, de grandeur naturelle, six autres figures, dont quatre dessinées d’après le modèle vivant et deux d’après l’antique, ces six « figures dessinées » n’étaient plus jamais envoyées au cours des années 1830 : « C’est une obligation à laquelle les pensionnaires croient pouvoir se soustraire », « L’obligation de donner des figures dessinées est depuis longtemps tombée en désuétude », écrit Vernet à propos des envois de 1829 à 1834 [4].
Travaux réglementaires dus par les pensionnaires de l’Académie de France à Rome à l’époque du directorat d’Horace Vernet (1829-1834).

Travaux réglementaires dus par les pensionnaires de l’Académie de France à Rome à l’époque du directorat d’Horace Vernet (1829-1834).

5 Ces travaux réglementaires ne revenaient pas tous aux pensionnaires à l’issue de leur formation romaine, à leur retour à Paris. Appartenaient au gouvernement la copie du tableau d’un grand maître ou les fragments peints ou dessinés d’après des fresques ou originaux, dus par les peintres en 4e année, la restauration d’un monument antique de l’Italie, due par les architectes en 4e année, et la copie en marbre d’après une statue antique, pour les sculpteurs de 1re année. À l’initiative de l’Institut, les restaurations des architectes étaient conservées en une collection de planches reliées, publication de qualité qui engagea plusieurs graveurs à adresser, en juillet 1833, la même demande à l’Académie pour leurs propres travaux [5].
De l’exposition romaine aux jugements des académiciens
6 Avant leur départ pour Paris, les travaux des pensionnaires étaient exposés à Rome en avril, près d’un mois durant, à la Villa Médicis. Cette exposition publique était ouverte à la presse locale. Sous Vernet, les Notizie del giorno, le Diario di Roma, Il Tiberino (par ses Notizie artistiche), voire le Giornale arcadico di Scienze, Lettere e Arti, en proposèrent une critique sommaire.
7 L’exposition close, emballées et conditionnées en caisses, les œuvres des pensionnaires quittaient Rome entre fin mai et mi-juin dans ces années 1830, et, par voie de mer, parvenaient à Paris entre mi-juillet et mi-août. Les envois y étaient réexposés, moins longtemps qu’à Rome, à l’Institut et à l’École des beaux-arts, à une date variable, comprise entre mi-août et début septembre, exceptionnellement début octobre (9 octobre 1830, année de fort décalage). Chaque section pouvait les examiner et les critiquer, ces examens s’achevant parfois par une ouverture de l’exposition au public, voire une visite ministérielle. La réunion consécutive des sections, la rédaction de leurs rapports et leur lecture s’échelonnaient durant un mois, avant le rapport général, lu, en octobre, en séance publique de l’Académie des beaux-arts.
8 Le rapport définitif partait pour Rome entre la fin octobre et le 1er décembre. Délai postal compris, les pensionnaires recevaient donc les avis des académiciens de leur section, lus par le directeur de l’Académie de France, un an après l’envoi concerné et souvent quelques semaines, sinon quelques jours, avant la remise des travaux annuels qu’ils étaient en train d’achever ! L’année 1830 fut à cet égard exceptionnelle, avec un envoi à Rome du rapport définitif repoussé au 20 janvier 1831, retard qui put nourrir l’impatience des pensionnaires et expliquer leur réception mitigée aux avis critiques des académiciens.
UN DIRECTEUR AU MILIEU DES PENSIONNAIRES
9 Horace Vernet eut à encadrer à Rome quarante-cinq pensionnaires au total (15 peintres, 11 sculpteurs, 10 architectes, 6 compositeurs, 3 graveurs), avec une moyenne de dix-neuf pensionnaires par an [tabl. 2]. Plusieurs ne résidèrent pas ou peu à l’Académie de France. Pour raisons de santé, le peintre Louis Desprez quitta Rome en 1829 et le graveur Achille-Louis Martinet, en 1833 ; quant au peintre Henri Schopin et aux architectes Victor Baltard, Pierre Garrez et Jean-Arnould Léveil, tous mariés, ils vivaient dans Rome, hors les murs de la Villa. Le peintre Théophile-Auguste Vauchelet, du fait de la santé fragile de sa mère, ne quitta jamais Paris, mais put en février 1831, par autorisation ministérielle, y toucher sa pension romaine, réduite de cinq à trois ans [6].
La vie à la Villa Médicis sous Vernet : atmosphère amicale et société brillante
10 En 1829, Vernet était âgé de 40 ans, vingt ans de moins que Pierre Narcisse Guérin ou Jean Dominique Ingres, qui encadrèrent son directorat. Cette jeunesse relative put encourager les liens tissés avec certains pensionnaires, tels le compositeur Hector Berlioz, arrivé en 1831, les sculpteurs Antoine-Laurent Dantan et Jean-Baptiste Debay, partis en 1833 et 1835, ou les frères Étienne et Louis Gasse, ex-pensionnaires architectes installés à Naples. Le peintre Jean-Louis Bézard et le sculpteur Jean-Baptiste Debay, auteur d’un Buste d’Horace Vernet en 1834 [fig. 1], furent choisis comme témoins de Louise Vernet et de Paul Delaroche, mariés à Rome le 28 janvier 1835. Vernet laissa très libres « ses » pensionnaires, mais sa ténacité et son sens de la justice dans l’affaire Labrouste, sur laquelle on reviendra, les avait profondément touchés : « Jamais nous ne trouverons quelqu’un qui, comme vous, se mette si bien à la portée des pensionnaires, maintenant l’ordre sans empêcher chacun d’étudier à sa guise, ne suivant que l’esprit du règlement sans s’attacher froidement à la lettre, excitant au travail de la manière la plus excitante, c’est-à-dire par l’exemple, et si juste que c’est en soutenant un des noms injustement attaqué que vous en êtes venu au point d’envoyer votre démission », écrit le graveur Joseph-Victor Vibert, en septembre 1830 [7]. Le jeune architecte Léon Vaudoyer, rentré à Paris en août 1832, lui écrivit une autre touchante lettre sur les regrets emportés de Rome : « [...] la peine bien réelle que j’ai ressentie lorsqu’il m’a fallu quitter Rome et que rendaient encore plus sensibles pour moi la bienveillance et l’intérêt flatteur dont j’avais reçu tant de preuve de votre part et de celle de votre aimable famille [8]. » Face au carcan imposé par l’Académie des beaux-arts, symbolisé par la personnalité de son secrétaire perpétuel, Vernet revendiqua l’expression de l’individualité des pensionnaires.
Pensionnaires de l’Académie de France à Rome de 1829 à 1834 [d’après les minutes des tableaux des envois (Arch. Acad. France à Rome, cart. 34 et 46)]. Les numéros d’ordre indiquent les années d’étude.


11 Avec son père, Carle, qui résista au retour en France exigé par sa qualité de membre de la section de peinture de l’Académie des beaux-arts, son épouse et leur fille Louise, Vernet créa une vie à la fois familiale, mondaine et brillante, dans un cadre rénové. Les architectes de l’Académie, Domenico Cacchiatelli, puis Giuseppe Marini, travaillèrent à la réfection des studios des pensionnaires, à la restauration du piazzale, à l’aménagement d’une chambre turque dans l’un des deux belvédères (été 1833) et au projet, jamais réalisé, d’un nouvel ensemble d’ateliers de peinture et de sculpture côté via Pinciana (1834) [9]. Le directeur et les pensionnaires participaient à de nombreuses cérémonies officielles, en particulier à l’église Saint-Louis des Français [10]. La Villa Médicis fut le théâtre de fêtes et réceptions nombreuses [fig. 2] [11] et de visites de personnalités politiques ou militaires, d’artistes ou d’anciens directeurs de l’Académie. Horace et Louise Vernet instituèrent aussi le jeudi une soirée hebdomadaire, souvent dansante, qui devient le rendez-vous de la haute société de Rome.
Louis Dupré et Sébastien Norblin, Chateaubriand recevant la grande-duchesse Hélène de Russie dans la cour d’honneur de la Villa, 29 avril 1829. Le départ des ballons, huile sur toile, 1830, Coll. A.F.R. Cliché A.F.R.

Louis Dupré et Sébastien Norblin, Chateaubriand recevant la grande-duchesse Hélène de Russie dans la cour d’honneur de la Villa, 29 avril 1829. Le départ des ballons, huile sur toile, 1830, Coll. A.F.R. Cliché A.F.R.
12 Les tensions politiques purent contribuer à souder la petite communauté française du Pincio. Durant les troubles de 1831, où l’ambassadeur La Ferronays avait suivi le pape réfugié à la cour de Naples, Horace Vernet demeura le seul représentant de la France à Rome. La situation demeura délicate ensuite : le gouvernement pontifical interdit, en 1832, l’introduction à Rome de journaux français réputés libéraux ; l’ambassadeur de France s’opposa à la mascarade proposée par les pensionnaires pour le carnaval de février 1834 ou à la messe à l’église Saint-Louis-des-Français, voulue par Vernet en juillet 1834, à la mémoire des victimes des journées de juillet 1830.
La valeur de l’exemple
13 « Excitant au travail de la manière la plus excitante, c’est-à-dire par l’exemple », écrivait le jeune graveur Vibert à Vernet en septembre 1830. À la différence de Guérin et d’Ingres, Vernet eut à cœur d’équilibrer gestion de l’Académie de France et pratique de son art. « On me dira que le séjour de Rome ne peut m’être d’une grande utilité, mais je vous dirai que je pense le contraire. L’habitude de vivre au milieu de chefs-d’œuvre [...] vous fait voir comment, avec de belles formes et la noblesse des expressions, il est possible de représenter les grandes actions de tous les temps, ainsi que toutes les passions [12] », écrivit-il au général Atthalin dès janvier 1829. Ancré dans la vie artistique locale, il fut élu, en mai et juillet 1829, membre associé de l’Académie Tibérine, puis académicien di merito à l’Académie de Saint-Luc, et s’attacha la reconnaissance de cette dernière en offrant un Portrait de Guérin de sa main, le 14 avril 1830. Les pensionnaires vantèrent sans contredit la remarquable production de leur directeur durant ses années romaines, tel Schnetz en juillet 1829 [13]. Louise Vernet voit évoluer son mode de travail, au regard de ses œuvres précédentes, plus volontiers destinées à soutenir le train de vie de la famille à Paris. À Rome, déchargé des préoccupations financières, dans un atelier dont Chateaubriand décrivit l’animation extrême [14], Vernet se consacra davantage à l’étude [15].
14 À la première exposition annuelle, au Capitole, en avril 1830, de la Società degli amatori e cultori delle Belle Arti, fondée pour exposer les œuvres des artistes étrangers présents à Rome, Vernet, son conseiller, représenta, avec Victor Schnetz et Léopold Robert, l’école française, et proposa deux tableaux : Le Pape Pie VIII porté dans Saint-Pierre dans sa sedie gestatoria, salué par la presse romaine, et Judith et Holopherne. À Paris, au Salon de 1831, il n’exposa pas moins de quatorze œuvres [16] ! Il répond aux commandes officielles. Forbin, directeur général des Musées royaux, proposa à La Rochefoucauld, directeur général des Beaux-Arts, en juillet 1830, de lui commander un tableau sur la prise d’Alger [17]. Au roi Louis-Philippe, pour compléter le programme iconographique du Palais royal par l’évocation de son ascension au pouvoir, Vernet proposa, le 26 mars 1832, une grande composition, Le duc d’Orléans quitte le Palais-Royal pour se rendre à l’Hôtel de ville (31 juillet 1830), présentée au Salon de 1833 [18]. Pour Forbin encore, Vernet acheva en mai 1832 le Portrait du maréchal Molitor, commandé le 14 juillet 1826 [19]. Pour l’Association des beaux-arts de Copenhague, il peignit en 1833 un portrait du sculpteur et ami Bertel Thorvaldsen [20]. Il exécuta, en juin 1834 à Turin, les portraits de Charles-Albert, roi de Sardaigne (1831-1849), et son épouse Marie-Thérèse de Toscane [21]. C’est alors que son goût naissant pour l’orientalisme trouva à se satisfaire. Le peintre aux sarouels et à la longue pipe, selon son autoportrait de 1829, obtint du comte de Rigny, ministre de la Marine, de pouvoir mener sur la Comète une expédition de reconnaissance dans les territoires de l’Algérie, voyage-charnière dans sa carrière artistique, qui le fit quitter Rome du 5 mai à fin juin 1833. Il rendit compte de ses découvertes en un tableau pour lord Pembroke dès son retour, en 1833, Arabes conversant sous un figuier, exposé au Salon de 1834, et dans une Rébecca à la fontaine, vendue au duc de Rohan en 1833 et exposée au Salon de 1835. Du retour, à l’été 1833, date d’ailleurs le projet d’aménagement d’une camera alla turca dans l’un des deux belvédères de la Villa Médicis.
L’encouragement donné aux travaux préparatoires des pensionnaires
15 Vernet donna aux pensionnaires les moyens de travailler avec sérieux, contribuant à équiper les ateliers [fig. 3] [22]. Il soutint l’accès des pensionnaires aux musées, aux sites archéologiques et aux œuvres de l’art et du patrimoine en général. Luigi Griffi, secrétaire de l’Académie pontificale d’archéologie, ne refusa à aucun pensionnaire architecte l’entrée des sites et monuments antiques de Rome. Les relevés de monuments antiques, comparés à ceux menés sous Guérin de 1822 à 1828 [23], se multiplièrent sous Vernet, à Rome même [24], mais aussi alentour (Albano, Cora, Fiumicino, Palazzuola, Tarquinia) [25]. Certains pensionnaires firent exécuter des fouilles pour compléter leurs relevés : Louis Duc, au Colisée (décembre 1829) ; Marie-Antoine Delannoy sur l’île Tibérine à Rome (automne 1832-printemps 1833) ; Prosper Morey, au temple de Mars vengeur à Rome (été 1832) ; et Victor Baltard, à l’arc de Gallien à Rome (1834).
16 À la demande de Vernet, en juillet 1832, Tommaso Bernetti (1779- 1852), cardinal secrétaire d’État, accepta l’accès des pensionnaires au Vatican, aux Loges et aux Stances [26]. Pour les propriétés Farnèse, notamment la Farnésine, le directeur bénéficia du bon accueil du comte Lodoli, ministre plénipotentiaire de la cour des Deux-Siciles. La copie d’œuvres d’art fut généralement autorisée : Sébastien Norblin put copier la Vierge de Foligno de Raphaël, au Vatican (1829) ; Jean-Louis Bézard, les peintures de Raphaël à la Farnesina (1832) ; Xavier Sigalon, le Jugement dernier de Michel-Ange, à la chapelle Sixtine (1833), sur commande du ministre Thiers, malgré les réticences de Vernet face à l’état sanitaire de l’œuvre [27] ; Joseph Guichard, le Triomphe de Galatée de Raphaël, à la Farnésine ; Eugène Roger, peintre de 1re année, eut accès à tout le décor de Raphaël, en février 1834, puis tous les pensionnaires fin mars 1834 [28].
Giuseppe Marini, architecte, Prospetto dei nuovi studii di pittura e scoltura da erigersi nella Reale Accademia di Francia [Projet des nouveaux ateliers de peinture et sculpture à construire à l’Académie royale de France], lavis polychrome sur papier, 1830, Arch. A.F.R., carton 34, f. 301. Cliché A.F.R.

Giuseppe Marini, architecte, Prospetto dei nuovi studii di pittura e scoltura da erigersi nella Reale Accademia di Francia [Projet des nouveaux ateliers de peinture et sculpture à construire à l’Académie royale de France], lavis polychrome sur papier, 1830, Arch. A.F.R., carton 34, f. 301. Cliché A.F.R.
17 En cinq années, les refus semblent se limiter à deux cas. En 1831, le prince Orsini refusa à Simon-Claude Constant-Dufeu la prise de mesures au théâtre de Marcellus à Rome et aux temples d’Hercule et de Castor et Pollux à Cora, ses propriétés. En 1833, en raison des recherches en cours du tombeau de Raphaël, Prosper Morey ne put effectuer, à Rome, ni mesures ni relevés au Panthéon d’Agrippa.
La bibliothèque de l’Académie de France sous Vernet, un autre enrichissement pour les pensionnaires
18 Vernet contribua sensiblement à développer la bibliothèque de l’Académie, confiée au secrétaire de l’institution. D’après les inventaires conservés, dont les premiers datent des directorats de Guérin et Vernet, les ouvrages acquis à partir de 1829, sous le directorat d’Horace Vernet, s’élèvent à 173, bien distincts de ceux entrés sous Guérin [29]. Sur une idée de Lethière, Vernet obtint du ministre Thiers, en juin 1833, de bénéficier d’une affectation partielle des ouvrages édités et imprimés à Paris, déposés auprès du ministre de l’Intérieur comme garantie du prêt consenti aux libraires et imprimeurs parisiens [30]. De 1829 à 1834, la moyenne des acquisitions représente environ 35 ouvrages par an. Bien que modeste, elle est supérieure à celle des directorats de Guérin et d’Ingres. Pour ceux dont l’année d’édition est précisée, les ouvrages acquis sont, pour moitié, parus depuis 1810, illustrant la volonté de disposer d’une bibliothèque actualisée.
Répartition chronologique des livres acquis sous Vernet (si la date d’édition est précisée)

Répartition chronologique des livres acquis sous Vernet (si la date d’édition est précisée)
19 Le choix des ouvrages acquis sous Vernet répond bien, par la répartition disciplinaire (histoire, littérature, sciences, arts, droit, philosophie ou religion, ouvrages pratiques), aux besoins des pensionnaires, recherchant des sujets pour leurs envois annuels ou désireux de connaître les richesses artistiques et patrimoniales antiques.
20 Outre l’histoire antique, c’est l’histoire de l’Italie (par Montgaillard, par Saint-Réal), des villes (Gênes, Naples, Venise) ou des provinces italiennes (Lombardie, Piémont, Sardaigne), qui est documentée, sous forme de lettres ou de souvenirs de voyages surtout, par Castellani, Dupaty, Lemonnier (Souvenirs d’Italie, 1832), Saint-Non (Voyage de Naples et de Sicile, réédité en 1829) ou Stendhal (Promenades dans Rome, 1829). Sont acquis aussi des livres sur l’histoire de France (de Bodin ou Le Ragois), la Révolution (Norvins) et Napoléon (Gallois, Montgaillard). L’histoire des jeunes États-Unis d’Amérique fascine : souvenirs, lettres de voyage ou essais (Carli, Scheffer, Paw, Pernetty, Ulloa, Wright) remontent au dernier tiers du XVIIIe siècle. La bibliothèque couvre bientôt l’histoire des principaux pays européens [31] et même de l’Empire ottoman (Palla). Le nombre de peintres d’histoire, parmi les pensionnaires de l’Académie, est peut-être à l’origine de la surreprésentation de cette catégorie.
21 Pour les arts et l’histoire de l’art, l’architecture, et singulièrement l’architecture antique, est la discipline la plus représentée dans la bibliothèque constituée sous Vernet : des ouvrages généraux [32] sont complétés par des monographies, liées aux travaux de restauration demandés aux pensionnaires [33]. Les principaux ouvrages de l’avocat Carlo Fea (1753-1836), commissaire des Antiquités de Rome, entrent alors [34]. La construction et l’ornementation sont représentées : Recherches sur la préparation que les Romains donnaient à la chaux, de La Faye (1777) ; Recueil et parallèle des édifices, de Durand (an IX) ; Recueil de décorations intérieures, de Percier et Fontaine (1812) ; Du compas de proportion dans la pratique de la perspective, de Phelippeaux (1819). Viennent ensuite les catalogues du Musée français, du Cabinet du Roi au Louvre et aux Tuileries, pour Paris, du muséum étrusque de Canino, du musée du Capitole, des galeries de Florence et de la collection de vases étrusques de Lucien Bonaparte, pour l’Italie. La sculpture est presque aussi présente [35]. Moins nombreux sont les ouvrages généraux sur les arts (Traité du sublime de Longin, an VII ; Les Arts italiens en Espagne, de Frédérel, 1825) ou autour de la composition musicale (Choix de morceaux, de Robertson ; Francesca da Rimini et Ester d’Engaddei, de Pellier ; Gradus ad Parnassum, éd. 1788). Une seule monographie de peintre est à citer, celle d’Andrea del Sarto, en effet souvent l’objet des travaux des pensionnaires (graveur Vibert en 1830, peintre Signol en 1834).
22 Le troisième grand ensemble concerne la littérature, importante source iconographique, et avant tout la littérature grecque ou latine, traduite en français : la bibliothèque s’enrichit d’ouvrages d’Anacréon, César (Commentaires), Horace, Lucien, Ovide, Pline (Histoire naturelle), Quinte-Curce (Histoire d’Alexandre le Grand), Salluste, Sapho, Tacite (Germanie), Térence (Comédies), Tibulle ou Xénophon. Majeure par ses perspectives de diversification thématique est aussi la littérature française, représentée par des panoramas synthétiques, marqués par la philosophie [36], ou par un choix, relativement hétéroclite, d’œuvres de la littérature essentiellement contemporaine (poésie, théâtre, romans, essais philosophiques), outre quelques héritages des XVIIe-XVIIIe siècles [37]. L’apport en littérature italienne (Costantini, Goldoni, Machiavel, Manzoni, Metastasio, Milizia Soave, Verri), en éditions récentes, est aussi sensible sous Vernet. Quelques jalons littéraires du XVIIIe siècle anglais (Les Saisons de J. Thompson ; Les Nuits de Young), allemand (Les Passions [sic] du jeune Werther de Goethe, éd. 1784), suisse (Bibliothèque pastorale de Gessner, éd. an VI) ou portugais (Lusiade de Camoens, trad. par Laharpe, 1813) parachèvent le tableau européen.
23 Les sciences, dans leur ensemble, sont représentées par une petite dizaine d’ouvrages neufs : histoires naturelles (Castel, Millin) ; manuels de mathématiques (Bossut, Suzanne) et de logique (Bomois) ; Système du mondede Laplace (an IV) ; Le Newton de la jeunesse, de Bertin (1808) ; Uranographie de Francœur (1812)... L’histoire des religions est sous-représentée : quelques ouvrages sur le théisme, l’athéisme, les vies de Jésus Christ et de la Vierge, le Sermone sopra l’elemosina de S. Cipriano (1812) et l’Abrégé de l’origine des cultes de Dupuis (1821) forment toutes les entrées de 1829 à 1834.
24 L’Académie romaine reçoit les publications de l’Institut de France (rapports sur les prix de l’Institut de France, Concours décennal, la collection gravée des ouvrages mentionnés par l’Institut, Séances publiques de la classe des beaux-arts de l’Institut, rapports sur les travaux des pensionnaires, notices historiques sur divers académiciens). Et la dégradation des relations entre Vernet et le secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts n’empêche pas l’inscription des principales œuvres de Quatremère de Quincy à l’inventaire : Destination des ouvrages de l’art (1815), œuvres plus poétiques de 1827-1828 (Char funéraire d’Alexandre, Bûcher d’Ephestion, Démos de Parrhasius) ou le Dictionnaire d’architecture (1832) !
25 La bibliothèque s’enrichit enfin d’ouvrages pratiques (dictionnaires, grammaires, atlas, guides de voyage en Italie, à Florence et à Rome), permettant de profiter d’un séjour romain [38], complétés par quelques ouvrages plus généraux : Voyage autour du monde de Bougainville (1772), Itinéraire des routes de Dutens (1777), Atlas de géographie universelle de Malte-Brun (1812), Voyage de Polyclète de Theis (1828). Enfin, il n’est pas impossible que l’acquisition, entre 1829 et 1834, de deux manuels pédagogiques – l’Abrégé du Traité des études de Rollin (an VIII) et la Conduite des études de Fleury (1803) – réponde à un intérêt de Vernet même.
26 L’étude un peu longue de cette bibliothèque touche à la formation culturelle et intellectuelle des jeunes pensionnaires, pour autant que d’autres preuves viennent attester qu’ils en firent usage. À compter de janvier 1834, l’instauration d’un registre annuel de prêts aux pensionnaires donne un éclairage précis, au moins pour la dernière année du directorat de Vernet. La quasi-totalité des pensionnaires (treize sur dix-huit) empruntèrent au moins un ouvrage, mais dans de très rares cas seulement – et surtout pour les architectes –, leurs emprunts sont directement liés aux travaux d’envois en cours, sauf à penser que les livres d’histoire ou de littérature empruntés aient un lien avec la recherche d’un sujet annuel.
27 Deux s’imposent comme les plus fréquents usagers de la bibliothèque de l’Académie en 1834. L’architecte Victor Baltard, arrivé à Rome cette année-là, emprunta la Monarchie de Napoléon de Montgaillard, les Souvenirs d’Italie de Lemonnier, l’Abrégé de l’origine des cultes de Dupuis, le Tableau chronologique pour l’histoire ancienne de Poisson et Caix, les Nuits de Young et le Traité du sublime de Longin. Le peintre Jean-Louis Bézard, à Rome depuis 1830, emprunta huit volumes de l’Histoire littéraire d’Italie de Ginguené, les trois volumes d’I promessi sposi, storia milanese, de Manzoni, la Poétique de Voltaire, l’Uranographie de Francœur, les œuvres complètes de Machiavel et, fin novembre 1834, les Rapports sur les travaux des pensionnaires.
28 Le sculpteur François Jouffroy, à Rome depuis 1833, emprunta la Lusiade de Camoens de Laharpe, les Nuits de Young, comme Baltard, Le Duc de Guise à Naples de Pastoret et les Morceaux choisis de Mirabeau. L’architecte Jean-Arnould Léveil, arrivé en 1833, emprunta trois ouvrages sur sa discipline, qu’il conserva toute l’année : Les Ruines de Volney, le Palazzo dei Cesari de Thon et Ballanti et l’Anfiteatro campano d’Alvino ; son envoi de 2e année, en 1834, n’était-il pas une restauration du Colisée (amphithéâtre Flavius) ? Le peintre Eugène Roger, arrivé en 1834, se tourna, pour son divertissement, semble-t-il, vers les Commedie scelte de Goldoni, l’Histoire des États-Unis d’Amérique de Scheffer et les Commentaires de César. Le sculpteur Debay, en 5e année en 1834, emprunta un Résumé de l’histoire de Suisse de Chasles et les Drammi scelti de Métastase. L’architecte Morey, arrivé en 1832, emprunta en octobre 1834 les Œuvres de Salluste, et, comme Léveil juste avant lui, le Palazzo dei Cesari de Thon et Ballanti. Le peintre Prieur, arrivé en 1834, privilégia la Germanie de Tacite et le Voyage de Naples et de Sicile de Saint-Non, que le sculpteur Simart, également arrivé en 1834, venait de restituer à la bibliothèque, après avoir lu I promessi sposi, de Manzoni, comme le peintre Bézard avant lui.
29 Une demi-douzaine de pensionnaires, enfin, ne furent que des usagers très épisodiques : le sculpteur Brian pour l’Histoire littéraire d’Italie, de Ginguené (partagée avec le peintre Bézard), l’architecte Constant-Dufeux, pour le Recueil et parallèle des édifices de Durand, le sculpteur Husson, pour la Passion du jeune Werther de Goethe ; le peintre Schopin pour le Résumé de l’histoire d’Angleterre, de Bodin, ou encore le compositeur Thomas, pour les Drammi scelti de Métastase. Horace Vernet lui-même fut un faible usager de la bibliothèque : le registre de 1834 ne signale que son emprunt de l’Abrégé de l’origine des cultes de Dupuis, restitué par Baltard.
L’intervention de l’Académie dans la formation romaine
30 Il est difficile de mesurer, sauf par la correspondance d’ordre amical, la part de Vernet dans le choix et l’exécution des sujets traités par les pensionnaires pour leurs envois annuels. Contre eux, il ne prit jamais de mesures sévères, ni dans le bordereau d’accompagnement des envois annuels, ni par une retenue de leur pension quand ils ne s’étaient pas acquittés de leurs travaux. Les rapports par section de l’Académie des beaux-arts demeurent une meilleure source pour confronter la réalité de la production des pensionnaires et l’enjeu artistique du séjour pour ces lauréats du prix de Rome [39].
31 À l’exception des jugements sur les envois de 1834, les avis de la section de peinture, discipline du directeur, furent extrêmement durs ; l’Académie voyait les jeunes artistes choisir des sujets trop grands, négliger les têtes d’étude, s’enthousiasmer pour des sujets compliqués ou « bizarres » ou pour des tons gris et ternes : « les [peintres] ne doivent pas perdre de vue que le but de leurs travaux en Italie est d’y étudier la nature si belle, si forte et si variée dans ce pays ; ils doivent s’y affranchir de la mode et n’en reconnaître d’autre que celle qui ne change pas plus que la nature dont ils sont et doivent tendre constamment à être des fidèles imitateurs » (rapport de 1834). Les envois de sculpture suscitèrent souvent des critiques sévères et constantes ; pour la section, les figures d’études imposées étaient bâclées et les statues envoyées à Paris, inachevées : « dans beaucoup de modèles envoyés comme simples travaux d’années [...], ces ouvrages [...], donnés seulement pour faire connaître le résultat des efforts faits en Italie, sont d’une négligence de fini et de soins, qui éloigne du but que semble prescrire ce voyage, celui de s’y perfectionner, en s’y livrant sévèrement à la science de l’art » (rapport de 1831). Les pensionnaires architectes, tels Théodore Labrouste, Léon Vaudoyer, Pierre Garrez, Louis Duc, Victor Baltard et Prosper Morey, furent davantage épargnés par leur section, qui louait leur sérieux, leurs recherches, la qualité de leurs travaux de restauration, mais bien moins leur projet de monument public de 5e année, souvent peu réaliste. Comme dans le cas des graveurs, la section de composition musicale fut en général indulgente pour les pensionnaires, déjà peu nombreux, relevant de sa discipline.
32 Outre les critiques formelles sur le non-respect absolu du règlement (nombre de figures d’une composition, taille des statues, etc.), les appréciations peuvent pointer le « caractère non romain » d’une composition ou approuver, au contraire, la recherche des « formes adoptées par les Anciens » ou une identification « avec les beaux modèles de l’Antiquité ». L’apprentissage de ce goût classique et académique passait pour partie par la copie, encouragée dans toutes les disciplines, sauf en composition musicale. De 1829 à 1834, les choix des pensionnaires furent toujours loués par l’Académie : Raphaël, pour Norblin en 1829 (Madone de Foligno) et Vibert en 1829 et 1832-1833 (Dispute du Saint Sacrement, Jugement de Salomon de la salle de la Signature, Vierge à l’œillet de la collection Camuccini) ; Paul Véronèse, pour Féron (1830) ; fra Bartolomeo, pour Dupré en 1831 (La Piété) ; Le Dominiquin, pour Bézard en 1833 (Le Possédé, fresque de Grotta Ferrata) ; Andrea del Sarto, pour Vibert en 1830 et Signol en 1834 (fresque du couvent de l’Annunziata de Florence) ; Phydias, pour Dantan en 1829 (L’Amour).
33 Pour les peintres, les sculpteurs et les graveurs, le choix des sujets est encore circonscrit, sous Vernet, à des épisodes de l’Ancien ou du Nouveau Testament, à la mythologie grecque ou romaine, à l’histoire ancienne. Toutefois, plus nettement que sous Guérin, des sujets neufs apparaissent, tirés de l’histoire de l’Italie, de l’histoire médiévale... Pour la section de peinture, ces essais de renouvellement iconographique provoquent une réception mitigée. La Peste de Rome sous le pontificat de Nicolas V, de Charles-Philippe Larivière, est jugée un « sujet intéressant » (rapport de 1830), mais le Mouvement populaire des habitants de Venise en faveur de Pisani, d’Éloi Féron, paraît d’un sujet mal choisi : « l’Académie aurait préféré que M. Féron eut fait choix d’un sujet qui, en place de simarres et de pantalons mi-partis à plusieurs couleurs, lui aurait donné de développer en grand l’étude du nu » (rapport de 1832). L’incohérence apparaît clairement à la lecture de l’avis, exactement inverse, rendu à l’examen de la Mort d’Ugolin, œuvre de Sébastien Norblin, l’année précédente : « On regrette que le désir de peindre du nu lui ait fait totalement négliger le costume du temps, qui ne se retrouve nulle part, ce qui nuit à l’intelligence du sujet » (rapport de 1831) ! L’œuvre de Jean-Louis Bézard pour 1831 (La Sorcière accroupie et murmurant des paroles de sang lave pour le sabbat la jeune fille nue) est jugée une « scène sans intérêt, dont le titre même tel qu’il l’indique ne pouvait rien lui inspirer pour la composition ni pour l’étude » (rapport de 1833). Même rejet pour le Portrait de Charles IX d’Henri Schopin : « ce sujet n’est point de ceux dont il peut être le plus utile à un jeune artiste de s’occuper pendant son séjour à Rome » (rapport de 1834). La production des peintres pour 1834 est en revanche saluée plus largement ; Vernet n’eut guère de peine à en deviner la raison, dans le bilan de son directorat, qu’il adresse en décembre 1834 à Quatremère : « La tendance qui se manifeste serait plutôt un retour vers le goût primitif du Giotto et d’un Beato Angelico. Si elle n’est pas poussée jusqu’à l’imitation servile, cette tendance ne peut que garantir des erreurs qu’on reproche au romantisme [40]. »
MODERNITÉ ET TRADITIONS DE LA FORMATION ROMAINE : HORACE VERNET VERSUS L’ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
34 Les relations de Vernet avec les ministres de tutelle successifs de l’Académie de France (Intérieur jusqu’au 16 mars 1831 ; Commerce et Travaux publics jusqu’au 5 avril 1834 ; de nouveau Intérieur) furent courtoises durant tout le directorat. Pour motifs surtout personnels, il put ainsi effectuer trois voyages à Paris (mars 1829, juin-sept. 1831, janv.- mars 1833), un en Algérie (mai-juin 1833) et un à Turin (juin 1834). Mais le perpétuel changement d’autorité – Vernet connut onze ministres différents ! – put engendrer des contradictions dans les réponses apportées à l’Académie de France à Rome et à celle des Beaux-Arts à Paris. Dès l’origine s’éleva, au sein de l’Académie des beaux-arts, une opposition quasi systématique aux inflexions données par Vernet aux conditions de formation des pensionnaires. Proposant deux fois sa démission, Vernet cessa toute correspondance avec l’Académie des beaux-arts, plus exactement avec Antoine-Chrysostôme Quatremère de Quincy (1755-1849), secrétaire perpétuel, qui entretenait pourtant pour lui, et de longue date, une grande affection, comme d’ailleurs de nombreux confrères, parmi la cinquantaine de membres qui, outre une dizaine d’académiciens libres, composaient l’Académie des beaux-arts en 1829.
Une succession de divergences concrètes
35 Grand voyageur, convaincu de l’intérêt culturel des voyages pour la formation des artistes, Vernet soutint les projets d’excursions des pensionnaires [41]... D’agrément ou d’étude, ces déplacements, nécessitant son accord, étaient de leur initiative et à leur charge, ne relevant pas des règlements. Seuls les voyages des architectes en 3e année, à jour de leurs travaux annuels obligatoires, étaient autorisés et reconnus par l’Académie des beaux-arts. Mais ils devaient voyager l’hiver, s’ils voulaient avoir achevé lesdits travaux ; aussi, Vernet demanda à l’Académie, dès mai 1829, de les autoriser à voyager les trois premières années et de consacrer la quatrième aux travaux de restauration [42]. L’article 19 du règlement s’y voyant remis en cause, la section d’architecture refusa cette demande le 6 juin, prétextant l’immaturité de jugement de jeunes architectes, trop tôt exposés à des sites et monuments qu’ils analyseraient mal, et la crainte d’un « grand nombre d’abus [43] ». Devant l’insistance renouvelée de Vernet, Quatremère de Quincy laissa le directeur juger de la pertinence des voyages des pensionnaires et les autoriser au cas par cas, mais sans modifier le règlement pour autant [44]. La situation demeura donc inchangée.
36 Le rapport envoyé de Paris, fin novembre 1829, sur les travaux de 1828 ouvrit un autre débat sur le statut des pensionnaires. Il critiquait sévèrement le sculpteur Charles-Émile Seurre pour son esquisse (Anacréon réchauffant l’Amour) et surtout l’architecte Henri Labrouste pour sa Restauration des temples de Paestum, dont l’Académie, se fiant à un ancien ouvrage de Delagardette, reprochait plusieurs détails inexacts. Le travail avait été mené sous Guérin, mais Vernet prit leur défense [45]. L’Académie argua du « danger qu’il y aurait d’autoriser des répliques et des controverses à l’égard des critiques qu’elle consigne dans son rapport annuel [46] ». Vernet poussa Labrouste à présenter « un simple exposé des faits matériels qu’il a pu recueillir à l’aide des moyens que le ministère de l’Intérieur lui a fournis [47] », qui réfutait chacune des erreurs de Delagardette, insistant sur l’injustice d’un jugement qui suivrait indéfiniment le jeune architecte et lui interdirait de voir son travail publié dans la collection officielle des restaurations des pensionnaires. Malgré l’intervention de Charles Thévenin, son prédécesseur (1816-1822), appelant à la relativité au lieu de l’entêtement [48], Vernet et Labrouste se déplacèrent à Paestum, au printemps 1830, pour étayer leur argumentaire, adressé le 29 mai 1830 à l’Académie [49]. La confrontation avec Quatremère de Quincy prit un nouveau tour. Balayant ce rapport technique, le secrétaire perpétuel ramenait les pensionnaires à leur place présumée :
Sans doute, telle est la position respective du pensionnaire et du directeur de l’École de Rome, qu’il ne saurait plus être question entre eux de cette autorité active qui, dans les rapports d’un enseignement pratique, subordonne l’écolier à son professeur et, sans doute aussi, l’Académie à Paris n’a ni moralement ni physiquement vis-à-vis des pensionnaires la faculté d’influer par des leçons journalières, actives et directes sur l’exercice de leur art, sur leur talent, sur leur manière et sur leurs progrès. De ceci, toutefois, il serait abusif de conclure que celui qui arrive à Rome comme pensionnaire a dépouillé entièrement tout caractère d’élève, qu’il a le droit de se regarder comme un artiste indépendant de toute direction. [...] Faire des études commandées par les règlements et soumises aux observations critiques de l’Académie d’après les mêmes règlements, n’est-ce pas être, vis-à-vis de l’Académie, en cette sorte d’état qu’on pourrait dire libre avec soumission et soumis avec liberté, qui dans tous les degrés supérieurs de tous les grands genres d’enseignements constitue la position d’élève [50] ?
38 Vernet était invité à cesser de revenir sur cette question de principe. Labrouste, de retour à Paris, puis Guérin, dédouanant le secrétaire perpétuel [51], voulurent refermer l’abcès, mais Vernet avertit Quatremère, en septembre 1830, qu’il présentait sa démission au ministre de l’Intérieur. Guizot l’ayant déclinée [52], Vernet cessa dès lors toute correspondance avec le secrétaire perpétuel.
39 L’encouragement du mérite des pensionnaires par des récompenses honorifiques constitua un troisième point d’achoppement. Début avril 1830, alors que l’exposition romaine des travaux était accueillie avec satisfaction par l’ambassadeur de France, Vernet, soumettant les noms des peintres Auguste Debay, François Bouchot et Charles-Philippe Larivière, du sculpteur Augustin-Alexandre Dumont et de l’architecte Henri Labrouste, imagina qu’un pensionnaire de 5e année, « le plus digne d’une marque de [la] munificence » du roi de France, pourrait être récompensé de la Légion d’honneur [53]. En demandant à l’ambassadeur Ferronays d’intercéder auprès du roi, pensait-il échapper à la résistance de l’Académie et compenser l’impact des fameux jugements critiques évoqués ? Grande fut sa contrariété devant le refus du ministre Montbel, qui renvoyait l’analyse qualitative des travaux au jugement de l’Académie après l’exposition parisienne de ces travaux (« Récompenser prématurément et dès leur entrée dans la carrière de jeunes talents, dignes sans doute de beaucoup d’intérêt, ce serait en arrêter l’élan et anéantir toute émulation [54] »), puis de Quatremère de Quincy, pour lequel l’Académie n’avait pas à délivrer des décorations, à juger du mérite de tel pensionnaire ou à récompenser un peintre plutôt qu’un sculpteur, un graveur ou un architecte, – ce que Vernet n’avait du reste jamais proposé [55].
40 Les décisions contradictoires du ministère et de l’Académie des beaux-arts face aux problèmes de santé des pensionnaires entretinrent aussi le mécontentement de Vernet. Ayant plaidé, en décembre 1829, auprès du ministre La Bourdonnais, le maintien de la pension du sculpteur Louis Desprez, après son retour à Paris pour raison médicale, Vernet se vit opposer, par l’Académie, un risque de « spéculation [56] ». Aussi, après le changement ministériel de mars 1831, et Desprez déjà parti, Vernet réitéra sa demande à Argout [57]. En vain. Son insistance, pourtant, pointait une contradiction foncière : le ministre Montalivet venait d’autoriser, en février 1831, le peintre Théophile Vauchelet, grand prix de 1829, à ne pas gagner Rome en raison de la maladie de sa mère et à toucher sa pension en France [58] ! Puis Thiers accordait en février 1833 au graveur Achille Martinet un congé illimité pour cause de santé, sans perdre le bénéfice de sa pension [59].
41 Au sujet des pensionnaires mariés, enfin, les derniers mois du directorat furent marqués par une ultime tension. Sans interdire ce statut aux lauréats du prix de Rome, le règlement s’opposait à la présence de couples ou d’étrangers au sein de l’Académie, mais, dans le même temps, au logement des pensionnaires hors de la Villa. Apprenant l’arrivée de deux pensionnaires mariés, Vernet pointa ce paradoxe au ministre Argout, dès décembre 1831, qui l’engagea à « tenir rigoureusement la main à l’exécution du règlement [60] », tâche justement impossible sans exclure les intéressés. En juillet 1832, le même autorisa le peintre Henri Schopin à résider en ville avec son épouse, alors qu’il s’y était opposé pour le musicien Eugène Prévost, aussi grand prix de 1831 ; Thiers fit de même pour l’architecte Victor Baltard, en décembre 1833 [61], poussant Vernet à accepter, pour l’architecte Jean-Arnould Léveil, marié au printemps 1834, une résidence hors de la Villa [62]. Excédé, Vernet exposa à Thiers les atteintes portées à l’accomplissement des études par ces entorses multipliées au règlement, suggérant radicalement de réformer le concours (âge limité à 24 ans, exclusion du prix de Rome pour tout candidat marié, privation de la pension en cas d’alliance ultérieure) : « si on n’y met pas bon ordre, mon successeur n’aura plus à diriger à l’Académie que des nourrices et des bonnes d’enfants [63] ». Installée par Thiers, la commission ad hoc créée par l’Académie des beaux-arts le 3 juillet 1834 rappela que des pensionnaires mariés avaient existé par le passé, sans poser de tels obstacles, et que le Code civil ne permettait pas d’interdire le mariage ou d’exclure de concours des candidats mariés. Reprochant à Vernet les concessions accordées, quand elles avaient pour origine les ministres successifs (Argout, Thiers), elle l’invitait à rétablir l’ordre [64]. Thiers imposa à Vernet de faire rentrer dans la Villa, avant le 31 décembre 1834, P. Garrez, V. Baltard et J.-A. Léveil, logés dans Rome, déclenchant une pétition immédiate des trois intéressés [65]. Le départ de Vernet, début 1835, laissa pendante cette affaire ; Ingres, sans pouvoir revenir sur les autorisations accordées, dut accepter la prolongation des séjours en ville.
Vernet dans le vent des réformes des années 1830
42 De ces interventions, pointant ici les incohérences du règlement de l’Académie romaine ou le manque de rigueur dans son application, suggérant là l’introduction de dispositions nouvelles, souvent en vue d’élargir l’horizon culturel des pensionnaires, transparaît une réalité plus forte, qui s’impose avec les années 1830 et l’avènement d’une nouvelle équipe dirigeante, celle de la nécessité de faire évoluer le mode de fonctionnement des grandes institutions de formation ou d’émulation artistique : Académie des beaux-arts de l’Institut, École des beaux-arts, Académie de France à Rome.
43 En janvier 1831 surgit un projet global de réforme, confié à une commission mandatée par le comte de Montalivet, ministre de l’Intérieur. Les raisons qui le poussèrent à engager la réforme des trois institutions contrôlées par l’Académie des beaux-arts (École des beaux-arts, prix de Rome, Académie de France à Rome) sont peu connues. Au-delà de l’insurrection de l’École des beaux-arts et de la suspension des études, fin 1830, sans doute la question était-elle dans l’air : au rédacteur du Journal des débats politiques et littéraires, qui révèle que Vernet a transmis un mémoire au gouvernement sur l’Académie de Rome, le directeur répond en réfutant son existence, mais reconnaît souhaiter « que l’Académie de France à Rome reçoive, à l’aide d’une révision de ses règlements, une réorganisation qui la mette en harmonie avec la marche du temps et la dégage surtout de l’influence de préjugés invétérés [66] ». Montalivet nomme Quatremère, le 24 janvier 1831, à la tête d’une commission de quinze académiciens et de seize membres étrangers, pour étudier « les réformes dont seraient susceptibles l’enseignement des Beaux-Arts, les écoles de Paris et de Rome, ainsi que les concours des grands prix [67] », mais pour Quatremère, l’Académie ne pouvait modifier les règlements qu’en corps et non du fait d’éléments isolés. Une nouvelle commission fut donc réinstallée par Montalivet, constituée de seize membres extérieurs à l’Institut ou frais émoulus de l’Académie de France à Rome [68] ; son rapport fut achevé le 25 mai 1831 [69].
44 La sélection et la formation des pensionnaires à Rome sont évoquées dans la deuxième partie, sur les Grands Prix de l’Institut, et dans la troisième, sur l’Académie de France à Rome. Chaque établissement devait jouir d’une autonomie plus grande vis-à-vis de l’Académie des beaux-arts : « L’Institut de France ne correspondra avec le directeur de l’Académie de France à Rome que par l’intermédiaire du ministre du Commerce et des Travaux publics » (art. 109). Comme pour les concours préparatoires et les grands prix, les travaux annuels des pensionnaires de Rome devaient être jugés, non plus par l’Institut tout entier, mais par la section correspondant à la discipline examinée et, en nombre égal, par des « agrégés », membres de l’Institut âgés d’au moins 30 ans, ayant exposé au moins une fois au Salon et recrutés hors de l’Académie des beaux-arts (art. 113). Les articles sur les voyages des pensionnaires (art. 110-112, 117, 120, 125 et 129) sont aussi significatifs. Sans contester l’obligation d’un travail annuel, sanctionné le cas échéant par l’interruption de la pension, ni l’exposition romaine des travaux, avancée au 1er janvier, les pensionnaires gagnaient le droit de voyager, en Italie et partout ailleurs, sous réserve d’en prévenir le directeur :
- peintres d’histoire : 1re année à Rome, villes importantes du nord de l’Italie en 2e année, voyages libres de la 3e à la 5e année, 5e année possible à Paris ;
- peintres de paysage : 1re année à Rome, voyages libres de la 2e à la 5e année, 5e année possible à Paris ;
- sculpteurs : 1re année à Rome, voyages libres de la 2e à la 5e année, 6 derniers mois possibles à Paris ;
- graveurs : voyages libres de la 1re à la 3e année, 4e année à Rome, 5e année dans la ville d’exécution de son dessin préparatoire ou à Paris ;
- architectes : 1re année à Rome, 2e et 3e année en Italie, voyages libres (encouragés en Grèce) en 4e et 5e année, retour à Paris seulement à l’échéance de la 5e année ;
- compositeurs : sur les 5 années, 1 en Italie et 1 en Allemagne ; les 3 autres en voyages libres ou à Paris.
46 Les autres articles concernent notamment la modification de la nature des travaux annuels à rendre à l’Académie. Rien en revanche sur la question des pensionnaires mariés.
47 Achevé fin mai 1831, ce rapport ne fut transmis par le ministre du Commerce et des Travaux publics (tutelle des Beaux-Arts depuis le 17 mars 1831), à l’Académie des beaux-arts et à l’École des beaux-arts, pour observation, que le 31 octobre 1831 [70]. De multiples contributions d’académiciens (Berton, Castellan, Desnoyers, Garnier, Granet, Guérin, Huyot, Le Bas, Vaudoyer...), face à la sollicitation ministérielle, vinrent ajouter ou retrancher, jusqu’en février 1832, des arguments à ce projet [71]. En juillet 1832, l’Académie n’avait pas encore formalisé sa réponse ; le ministre rappela son devoir de conseil [72]. Mais, s’exprimant enfin le 11 août 1832 sur les évolutions possibles des études à Rome, l’Académie adopta une position absolument fermée, craignant que les modifications suggérées n’aillent détruire l’union nécessaire de trois institutions : l’École des beaux-arts, les grands prix et l’Académie de France à Rome. Constituer des jurys mixtes d’académiciens et d’artistes extérieurs ouvrait le danger d’affirmer l’insuffisance, voire l’inutilité, des premiers ; autoriser les pensionnaires à voyager une grande partie de leurs années à Rome risquait de faire apparaître coûteux l’entretien de la Villa Médicis et superflue, la présence d’un directeur pour les quelques artistes demeurés à Rome, tandis qu’un retour trop précoce à Paris pouvait les faire négliger leurs travaux obligatoires au profit d’œuvres plus rentables. Pas un des 130 articles du projet de la commission ministérielle de mai 1831 ne fut retenu [73].
48 Membre de l’Académie, Vernet ne signa pas le texte de mai 1831, pas plus qu’il n’adressa, d’après les archives conservées, de contribution à Quatremère durant l’hiver 1831-1832. Pour autant, il comptait plusieurs amis proches parmi les membres de la seconde commission (Sigalon, Picot, Debay père, Henri Labrouste...) et il fut constamment associé aux travaux par certains académiciens amis, tel Gérard, qui lui écrivit en juillet 1831 :
pour entrer dans vos idées, je vous soumettrai deux mesures qui me paraîtraient devoir donner à la fois plus d’importance à l’Académie de France à Rome et plus de force aux élèves qui aspirent à y arriver. [...] La seconde serait de changer la donnée du concours pour le grand prix de peinture et au lieu des éternels tableaux de chevalet, d’adopter des figures de grandeur naturelle en ne donnant les sujets que de deux ou trois personnages au plus [74].
50 Plusieurs idées personnelles de Vernet, exprimées dans sa correspondance avec le ministre ou avec le secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, figurent manifestement dans le projet de mai 1831 et dans les contributions suivantes.
51 Malgré la résistance de l’Académie à toute réforme, Argout souhaitait poursuivre la réflexion : « [...] le ministre s’est déclaré favorable à tous les changements demandés et reconnus indispensables », écrit Léon Vaudoyer à Vernet en août 1832 :
On s’occupe très sérieusement aujourd’hui d’une réorganisation générale des écoles, de l’Académie de Rome et des Travaux publics. L’Institut est définitivement battu et, certes, c’est bien de sa faute puisqu’au lieu de prendre honorablement l’initiative dans une question de réforme, il s’est obstiné à faire une opposition rétrograde de mauvaise foi. Si vous voulez contribuer à la grande crise qui se prépare, je vous engage à ne pas perdre de temps et à envoyer vos propositions au ministre [75].
53 De fait, contrairement aux allégations de Vernet au directeur du Journal des débats, en novembre 1830, ou au secrétaire de l’Institut, en février 1833, lors du troisième et dernier séjour parisien de son directorat [76], l’hypothèse selon laquelle il a pu profiter de l’un de ses séjours à Paris, soit fin juillet-début août 1831 soit en février 1833, pour faire tenir directement au ministre ses desseins de réforme, est confortée par plusieurs éléments : Cavé, chef de la division des Beaux-Arts au ministère du Commerce, chercha, en janvier 1833, à récupérer auprès de Quatremère un « rapport de M.H. Vernet sur l’École de Rome » que lui aurait transmis Argout en octobre 1831 [77] ; l’enregistrement de la correspondance à l’arrivée du ministère de l’Intérieur cite une lettre de Vernet du 21 février 1833, arrivée le 4 mars et ainsi analysée : « Renseignemens donnés sur l’École de Rome, 6 p. [78] ». Ses réflexions personnelles sur le sort de l’institution romaine se poursuivent en effet après la consultation ministérielle de 1831 : « Je pense que la base fondamentale des nouveaux règlements devrait s’appuyer sur une liberté pondérée, en rapport avec les âges différents de MM. les pensionnaires, écrit Vernet, le 8 mars 1833, à son ami, le comte de Rambuteau, conseiller d’État. Pour atteindre ce but, le seul moyen selon mon opinion, serait, tout en laissant la faculté de concourir jusqu’à 30 ans, de décider que, passé 25 ans, les lauréats touchassent une pension de 3 000 francs, dont les deux premières années leur seraient payées à Rome [79]. »
54 Concentrées sur la révision des conditions de formation en Italie, à l’issue du prix de Rome, les idées de Vernet parviennent à maturité dans l’été 1834 [80]. Les archives Delaroche-Vernet conservent un précieux brouillon autographe du projet adressé par Vernet au ministre Thiers, en juillet 1834, après six années d’encadrement des travaux des pensionnaires [81]. Reprenant la question des voyages des pensionnaires, par crainte avouée de rendre inutile l’entretien d’un établissement romain vide de ses étudiants, il propose de maintenir à Rome les quatre premières années des pensionnaires peintre et des sculpteurs, et de supprimer la discipline de la peinture de paysage : « la nécessité de s’éloigner de Rome pour peindre d’après nature dérange constamment les habitudes de la maison ». Invités à effectuer un grand voyage durant leurs deux premières années, les architectes devaient revenir à Rome en 3e année. Les graveurs en taille douce seraient invités à conduire leurs travaux en Italie, en Allemagne ou en Angleterre, durant leurs deux premières années, mais sans habiter la Villa Médicis lors de leurs passages à Rome : « la régularité qui doit exister dans l’établissement ne saurait s’arranger avec le passage momentané d’un ou de plusieurs pensionnaires » ; les pensionnaires compositeurs ne sont pas davantage retenus, « Rome étant la ville d’Italie où on entend le moins de musique ». Sa réflexion était moins poussée sur le contenu des ouvrages obligatoires, mais pour les peintres d’histoire, inspiré par les épreuves exigées des graveurs, des compositions complètes pourraient leur être demandées chaque année, et plus seulement des figures ou des têtes d’étude, afin que l’ouvrage de 5e année ne constitue pas un « coup d’essai ». Si, sollicitée pour avis et réponse au ministre, l’Académie évoqua ce projet lors de ses séances des 26 juillet, 2 et 16 août 1834, autant dire que la nomination d’un nouveau directeur quelques mois plus tard, après le choix d’Ingres le 31 mai 1834, n’encouragea certes pas les académiciens, Quatremère de Quincy en tête, à modifier en rien les règlements en vigueur !
55 Parvenu au terme de ses six années de mandat, Vernet voulut expliquer à Quatremère de Quincy ce qui l’avait amené à rompre toutes relations avec l’Académie des beaux-arts. En une longue lettre, le 5 décembre 1834, il exprime une dernière fois les grands principes de sa gestion :
Persuadé que des hommes d’un âge mûr ne pouvaient être soumis au joug des principes absolus, j’ai cru devoir laisser l’École jouir d’une ultime liberté. Si chacun, de retour à ses goûts particuliers, est rentré dans la voie où la nature de son génie devait l’entraîner, si des productions d’un genre trop familier ont mérité de justes reproches, je ne crois pas devoir les attribuer à cette liberté, mais bien à l’assignation où se trouvent quelques-uns de MM. les pensionnaires de satisfaire à la mode pour subvenir à des besoins impérieux [82] .
57 Sans conteste, il souhaita faire flotter un vent de liberté sur son établissement, insuffler chez les pensionnaires le sens du travail et de l’étude, la curiosité et l’indépendance de goût et d’esprit, et, sans les cantonner au rang d’élèves soumis au jugement des académiciens, encourager leur autonomie et leur personnalité artistique. Si Vernet, de retour à Paris, retrouva, au sein de l’Académie des beaux-arts, la considération dont il jouissait avant son séjour romain, ses idées développées autour de l’administration des études ou de l’évolution du règlement de l’Académie de France à Rome mirent bien des années pour certaines – telle l’importance des voyages dans la formation de ces jeunes artistes –, à connaître une officialisation.
Notes
-
[1]
Isabelle Chave, François Fossier, Jacques Kuhnmunch (éd.), Correspondance des directeurs de l’Académie de France à Rome. Vernet (1829-1834), Paris/Rome, Société d’histoire de l’art français/Académie de France à Rome, 2010 ; désormais, Vernet...
-
[2]
Vernet..., n° 579.
-
[3]
Lettre de Martignac à Vernet, Paris, 23 avril 1829 [Vernet..., n° 39].
-
[4]
Vernet..., p. 357 (tabl. des envois de 1829), p. 381 (tabl. 1831), p. 398 (tabl. 1833), p. 407 (tabl. 1834).
-
[5]
Requête d’Émile Ollivier à Quatremère de Quincy, [fin juil. 1833] [Arch. Acad. des beaux-arts (désormais, A.B.A.), 5 E 23].
-
[6]
Lettres du ministre de l’Intérieur à Vernet, 19 févr. 1831 ; de Vauchelet au président de l’Institut, 3 mars 1831 ; de Vernet au ministre de l’Intérieur, 17 mars 1831 ; de Vauchelet à Quatremère de Quincy, 31 juil. 1831 [Vernet..., n° 228, 237, 240 et 278].
-
[7]
Lettre de Vibert à Vernet, 20 sept. 1830 [Vernet..., n° 172].
-
[8]
Lettre de Léon Vaudoyer à Vernet, 3 août 1832 [Vernet..., n° 352].
-
[9]
Académie de France à Rome (désormais, A.F.R.), carton 34, f. 301 [reprod. : Vernet..., p. 339].
-
[10]
Service funèbre à l’église St-Louis des Français pour Louis XVI et la reine (21 janv. 1829), bal de l’ambassadeur d’Espagne (21 avril 1829), fête de Charles X à St-Louis des Français (4 nov. 1829), anniversaire de la naissance d’Henri IV à Saint-Jean de Latran (14 déc. 1829), réceptions à l’ambassade pour l’arrivée de La Ferronays (14 mars 1830) et de La Tour-Maubourg (24 mars 1833), Te Deum pour la prise d’Alger à St-Louis des Français (21 juil. 1830), puis à St-Jean de Latran (8 août 1830), fête de la Saint-Louis à St-Louis des Français (le 25 août), fête du roi Louis-Philippe à St-Louis des Français (12 mai 1832, 4 mai 1833, 1er mai 1834), fête de la Saint-Philippe à St-Louis des Français (1er mai 1833), mariage de Louise Vernet et Paul Delaroche à St-Louis des Français (28 janv. 1834), banquet d’adieu à Vernet, présidé par le sculpteur Thorvaldsen, au palais Ruspoli (janv. 1835).
-
[11]
Fête pour la grande-duchesse de Russie (29 avril 1829), grand dîner pour Charles X (4 nov. 1829), feu d’artifice pour la prise d’Alger (26 juil. 1830), illuminations pour la fête du roi Louis-Philippe (1er mai 1834).
-
[12]
Lettre de Vernet à Atthalin, [début janv.] 1829 [Vernet..., n° 18].
-
[13]
Schnetz à Navez, 22 juil. 1829 : « Horace pond des tableaux ici avec la même facilité qu’à Paris. Il a fait une Judith qui se dispose à couper la tête à Goliath. Elle retrousse sa manche. Il fait une quantité de têtes pour apprendre à les faire d’après nature. Il fait dans ce moment-ci le Pape porté dans Saint-Pierre, mais les hommes qui portent sont coupés au milieu du corps » [Bruxelles, Bibl. royale, Dép. des Mss, II/70, vol. III, n° 527, fol. 376 ; Laurence Chesneau-Dupin (éd.), Lettres inédites de Jean-Victor Schnetz à François-Joseph Navez : une amitié italienne, Flers, Flers promotion, 2000, p. 88].
-
[14]
Lettre du 25 juil. 1829 : « Horace travaille du matin au soir ; il défait à mesure ; il vise à une perfection qui lui fera perdre bien du temps et qu’il n’atteindra pas, puisqu’il ne peut se satisfaire. Les finances se ressentent un peu des études qui ne sont pas des tableaux » [Paris, coll. part. ; voir Horace Vernet (1789-1863), op. cit.].
-
[15]
Mendelssohn, visitant l’atelier de Vernet en février 1831, découvrit « partout sur les murs des tableaux achevés ou à moitié faits, [...] des portraits commencés de Thorwaldsen, Eynard, Latour-Maubourg » [lettre à sa mère, 1er mars 1831, citée par Amédée Durande (éd.), Joseph, Carle et Horace Vernet, correspondance et biographies, Paris, J. Hetzel, 1864, p. 87].
-
[16]
Voir Pierre Sanchez et Xavier Seydoux, Les Catalogues des Salons, II : 1819-1834, Paris, L’Échelle de Jacob, 2000 [Vernet au Salon de 1831 : La Bataille de Valmy, La Bataille de Jemmapes, L’Arrestation du prince de Condé, du prince de Conti et du duc de Longueville, au Palais Royal, par ordre d’Anne d’Autriche, en 1650, Le Pape Pie VIII porté dans la basilique Saint-Pierre à Rome, Judith et Holopherne, Portrait de Victoria d’Albano, Paysanne d’Aricia, La Confession d’un brigand, Combat entre les dragons du Pape et des brigands, Départ pour la chasse dans les marais Pontins, Portrait de Mme I., Un calvacatore conduisant des bœufs, Portrait de Mlle Vernet et Études de forêt].
-
[17]
Lettre de Forbin à La Rochefoucauld, 15 juil. 1830 [Vernet..., n° 146].
-
[18]
Vernet..., p. 28. L’œuvre fut exposée au Salon de 1833 avec deux autres compositions (Raphaël au Vatican, d’après la Vie de Raphaël, de Q. de Quincy ; Les Trois Amis) et plusieurs portraits : Louis-Philippe, Le maréchal Molitor, Dame romaine et son enfant, Mme Fould, Le marquis de La Tour-Maubourg, Un homme [Pierre Sanchez et Xavier Seydoux, ouvr. cité].
-
[19]
Aujourd’hui au Musée du château de Versailles. Lettre de Forbin à Vernet, 10 juin 1830, et à Schonen, 28 mai 1832 [Vernet..., n° 132, n° 328].
-
[20]
Œuvre exposée par la Società degli amatori et cultori di Belle Arti en 1835 [Vernet..., p. 30].
-
[21]
Vernet..., p. 32-33.
-
[22]
Un métronome fut acheté début nov. 1829 pour les pensionnaires compositeurs ; une boussole, en mai 1830 ; une tête d’athlète de plâtre, en févr. 1832 ; un « diagraphe de 20 pouces à double chariot pour le géométral et la perspective », en févr. 1833 [Arch. A.F.R., carton 35/1, fol. 236 et 439, carton 35/3, fol. 417. Vernet..., n° 305 : quittance d’Ewing à Vernet, 6 févr. 1832].
-
[23]
Voir Antoinette Lenormant-Romain, François Fossier, Mehdi Korchane, avec la coll. d’I. Chave, Correspondance des directeurs de l’Académie de France à Rome. Guérin (1823-1828), Paris/Rome, Société d’histoire de l’art français/Académie de France à Rome, 2005, p. 343-344.
-
[24]
En 1829 : temple de Jupiter tonnant (Delannoy), amphithéâtre Flavius ou Colisée (Duc), arc de Constantin au Campo vacccino, porte Majeure et porte San Lorenzo (Vaudoyer) ; en 1830 : Tabularium et temple de la Concorde (Constant-Dufeu), arc de Titus et temple d’Antonin et de Faustine (Corbin), temple de Vénus (Vaudoyer) ; en 1831 : tombeau de Caius Cestius et temples antiques de San Nicolo in Carcere (Garrez) et temple de la Concorde (Vaudoyer) ; en 1832 : temple de la Fortune virile et temples d’Antonin et Faustine et de Jupiter stator (Constant-Dufeu), île Tibérine (Delannoy), porte San Lorenzo (Garrez) et temple de Mars vengeur (Morey) ; en 1833 : porte San Paolo et temple de la Fortune virile (Garrez) ; en 1834 : arc de Gallien et frises du baptistère de Constantin au Latran (Baltard) [Vernet..., p. 429-431].
-
[25]
En 1829 : tombeaux étrusques de Tarquinia (Duc, frères Labrouste, Vaudoyer) ; en 1830 : tombeau des Horaces et des Curiaces à Albano et tombeau consulaire à Palazzuola (Th. Labrouste), monuments antiques de Cora (Constant-Dufeu, Th. Labrouste) ; en 1834 : ruines du port de Trajan et Claude à Fiumicino (Garrez) [Vernet..., p. 429-431].
-
[26]
Vernet..., n° 345 et 347.
-
[27]
Lettres de Thiers à Vernet, 28 août 1833, et de Vernet à Thiers, [début sept.] 1833 [Vernet..., n° 463 et 465].
-
[28]
Lettres de Lodoli à Vernet, 22 févr. et 26 mars 1834 [Vernet..., n° 512 et 517].
-
[29]
Ces inventaires de 1828-1832 et le registre de prêts de 1834 ont été édités intégralement dans Vernet..., p. 449-457.
-
[30]
Lettre de Thiers à Vernet, 25 juin 1833 [Vernet..., n° 449].
-
[31]
Russie (Rabbe), Allemagne (Staël), Pologne (Thiesse), Suisse (Chasles), Suède (Coquerel), Espagne (Bodin), Angleterre, Écosse.
-
[32]
Saggio d’archittetura civile de Milizia, 1827 ; Antiquités romaines, d’Adam, 1818 ; Raccolta di maestri antichi, de Piroli ; Monumenti antichi inediti, de Guattani, 1784-1789 ; Viaggio antiquario da Livorno a Roma, de Pifferi et Welson, 1832.
-
[33]
Mausolée consulaire de Palazzuola, thermes de Titus à Rome ; Palazzi di Roma di più celebri architetti, de Ferriero, v. 1660 ; Palazzo dei Cesari, de Thon et Ballanti, 1828 ; Anfiteatro Campano, d’Alvino, 1833.
-
[34]
Miscellanea antiquaria, 1790 ; Anfiteatro Flavio, 1813 ; Varieta di notizie sopra Castel Gandolfo, Albano, ecc., 1820.
-
[35]
Recueils sur les statues antiques et sur la sculpture de Modène, Antiquae statuae de F. Perrier (1638), Fragments de sculpture antique en terre cuite d’Agincourt (1814).
-
[36]
L’Esprit des monarques philosophes (1764) et L’Esprit des anciens philosophes (1795), de Mably ; Les Belles-Lettres et la philosophie (1796) ; Essai sur l’entendement humain de Locke (1689) ; Tableau de la littérature française de Chénier (1821) ; Éléments de littérature de Marmontel (1822) ; Esprit et génie des écrivains célèbres du 18e siècle de Robertson.
-
[37]
Œuvres morales de Saint-Évremont (XVIIe s.), Œuvres avec éclaircissements historiques de Despréaux (1718), Entretiens de Phocion de Mably (1763), Poétique de Voltaire (1766), Traité sur l’éloquence de Fénelon (éd. 1780), Morceaux choisis de Mirabeau, Œuvres de Gresset (1785), Phédon de Mendelssohn (1787), Testament du publiciste patriote de Mably (1789), L’Antiquité dévoilée de Boulanger (1791), Œuvres de Reyrac (an VII), Daphnis et Chloé d’Amyot (1805), Œuvres diverses de Radonvillers (1807), Œuvres de Lebrun (1821), Les Ruines, ou méditation sur les révolutions des Empires de Volney (éd. 1821), Bayard de La Malle (1824), Le Duc de Guise à Naples de Pastoret (1825), L’Explication universelle d’Azaïs (1826).
-
[38]
Grammaire générale de Sacy (1822), Grammaire italienne de Vergani (1828), Dictionnaire latin-français, Dictionnaire portatif de la langue italienne de Lamonière, Itinerario istruttivo di Roma de Vasi, Guida di Roma de Melchierri, Itinéraire ou Guide du voyageur en Italie de Barzelay, Cartes des routes de postes de l’Italie et de la confédération du Rhin de Tardieu.
-
[39]
Voir l’édition intégrale des jugements reçus à Rome de 1829 à 1835 dans Vernet..., p. 359- 416.
-
[40]
Vernet à Quatremère de Quincy, 5 déc. 1834 [Vernet..., n° 603].
-
[41]
Par exemple, voyage des peintres Dupré, Féron et Giroux et du compositeur Ross-Despréaux, accompagnés du copiste Guichard, non pensionnaire, à Cori et Sonnino (23 mai 1829) ; voyage du peintre Larivière et des architectes Vaudoyer et Th. Labrouste à Naples (début juil. 1830) ; séjour du graveur Martinet à Florence (oct.-déc. 1832) [Vernet..., p. 24, 26 et 29].
-
[42]
Lettre de Vernet à Quatremère de Quincy, 12 mai 1829 [Vernet..., n° 41].
-
[43]
Rapport de la section d’architecture de l’Académie des beaux-arts, 6 juin 1829 [Vernet..., n° 48].
-
[44]
Lettre de Vernet à Quatremère de Quincy, 27 juin 1829, et réponse de Quatremère, 16 juil. 1829 [Vernet..., n° 58 et 63].
-
[45]
Lettre de Vernet à Quatremère de Quincy, 26 déc. 1829 [Vernet..., n° 94].
-
[46]
Lettre de Quatremère de Quincy à Vernet, 23 janv. 1830 [Vernet..., n° 99] : sur le travail de Labrouste : « l’espèce de sévérité dont ce travail a été l’objet doit prouver avant tout à son auteur le très grand intérêt avec lequel il a été examiné. [...] Plus un travail a d’étendue, plus il donne matière aux développements de la critique » ; sur celui de Seurre : « M. Seurre a pu être un peu blessé de la petite remarque faite sur son groupe, tout agréable qu’il puisse être. »
-
[47]
Réponse de Vernet à Quatremère de Quincy, 8 févr. 1830 [Vernet..., n° 103].
-
[48]
Lettre de Thévenin à Vernet, 28 févr. 1830 [Vernet..., n° 108].
-
[49]
Lettre de Vernet à Quatremère de Quincy, accompagnée d’une adresse de Labrouste à la section d’architecture de l’Académie, d’une note technique sur les temples de Paestum, 29 mai 1830 [Vernet..., n° 126 à 129].
-
[50]
Lettre de Quatremère de Quincy à Vernet, 26 juin 1830 [Vernet..., n° 136].
-
[51]
Lettres d’H. Labrouste à Vernet, 8 juil. 1830, et de Guérin à Vernet, 19 août 1830 [Vernet..., n° 142 et 165].
-
[52]
Guizot à Vernet, 5 oct. 1830 [Vernet..., n° 176].
-
[53]
Lettre de Vernet à La Ferronays, 2 avril 1830 [Vernet..., n° 112].
-
[54]
Lettres de Montbel à La Ferronays et Vernet, 7 mai 1830 [Vernet..., n° 120 et 121].
-
[55]
Lettre de Quatremère de Quincy à Vernet, 26 juin 1830 [Vernet..., n° 136].
-
[56]
Lettre de Vernet à La Bourdonnais, 19 déc. 1829 [Vernet..., n° 91] ; séances des 16 et 23 janvier 1830 [Procès-verbaux de l’Académie des beaux-arts (1830-1834), éd. François Naud, Paris, École des chartes, 2004, p. 15-16] ; lettre de Montbel à Vernet, 19 févr. 1830 [Vernet..., n° 105].
-
[57]
Lettre de Vernet à Périer, 17 mars 1831 [Vernet..., n° 240], et réponse d’Argout, 30 avr. 1831 [ibid., n° 257].
-
[58]
Lettre de Montalivet à Vernet, 19 févr. 1831 [Vernet..., n° 228].
-
[59]
Lettre de Thiers à Vernet, 11 févr. 1833 [Vernet..., n° 408].
-
[60]
Lettre de Vernet à Argout, 10 déc. 1831, et réponse, 21 déc. 1831 [Vernet..., n° 288 et 291].
-
[61]
Lettre de Thiers à Vernet, 31 déc. 1833 [Vernet..., n° 498].
-
[62]
Lettre de Verrnet à Thiers, 16 mai 1834 [Vernet..., n° 529].
-
[63]
Lettres de Vernet à Thiers, 16 et 20 mai 1834 [Vernet..., n° 529 et 534]. Comme pour lui donner raison, un fils de Joseph Garrez naquit à Rome le 20 août, puis une fille de Victor Baltard, le 27 août 1834 !
-
[64]
Vernet..., n° 571 et 572, et p. 526-529.
-
[65]
Lettre de Thiers à Vernet, 11 oct. 1834, et pétition de Garrez, Baltard et Léveil, 27 oct. 1834 [Vernet..., n° 588 et 595].
-
[66]
Article du Journal des débats politiques et littéraires, 22 oct. 1830, et demande de droit de réponse de Vernet à Bertin, directeur du journal, 3 nov. 1830 [Vernet..., n° 180 et 182].
-
[67]
Sur la composition de cette commission, voir le Moniteur universel, 27 janv. 1831 [éd. : Procès-verbaux, ouvr. cité, p. 355-356]. Sans y figurer, Vernet y comptait plusieurs amis parmi les neuf peintres académiciens nommés (Gérard, Gros, Ingres, Hersent, Schnetz, Paul Delaroche, Delacroix, Cogniet, Scheffer).
-
[68]
Lettre de Quatremère de Quincy à Montalivet, 31 janv. 1831, et réponse de ce dernier à Lethière, président de l’Académie, 4 févr. 1831 [Vernet..., n° 212 et 217]. Sur la composition de la seconde commission, voir le Moniteur universel, 5 févr. 1831 [éd. : Procès-verbaux..., ouvr. cité, p. 357].
-
[69]
Pour l’édition intégrale de ce rapport, voir Vernet..., p. 472-485.
-
[70]
Lettre d’Argout à Quatremère de Quincy, 31 oct. 1831 [Vernet..., n° 285].
-
[71]
Pour l’édition intégrale de cette réponse de l’Académie des beaux-arts et de divers rapports individuels d’académiciens jusqu’en févr. 1832, voir Vernet..., p. 487-526.
-
[72]
Lettre d’Argout à Quatremère de Quincy, 11 juil. 1832, et réponse de ce dernier, [vers le 15 juil.] [Vernet..., n° 340 et 341].
-
[73]
Lettre de Quatremère de Quincy à Argout, 11 août 1832 [Vernet..., n° 356].
-
[74]
Lettre de Gérard à Vernet, 12 juil. 1831 [Vernet..., n° 275].
-
[75]
Vernet..., n° 352.
-
[76]
Lettre de Pingard à Thiers, [févr. 1833] : « J’ai fait de vaines recherches pour trouver le rapport de Vernet sur l’École de Rome que vous me demandez par votre dernière lettre [22 janvier 1833]. [...] M. Vernet en personne se présenta samedi dernier à la séance de l’Académie. Je lui fis part de votre demande. Sa réponse fut qu’il n’avait jamais écrit un mot, ni jamais fait ni pensé à faire un rapport sur l’École de Rome » [Vernet..., n° 410].
-
[77]
Lettre de Cavé à Quatremère de Quincy, 22 janv. 1833 [Vernet..., n° 398].
-
[78]
Vernet..., n° 409.
-
[79]
Arch. A.B.A., 5 E 24 [éd. : Vernet..., n° 413].
-
[80]
Le projet de réforme de l’Académie de France que, de son propre chef, le secrétaire de l’Académie de France, Mauduit, adressa le 28 juillet 1834 à Quatremère de Quincy ( !) [Vernet..., n° 567 et 568], laisse transparaître sans doute, en se démarquant en plusieurs points des idées de Vernet, la vigueur et l’actualité de ces débats au sein de la Villa Médicis.
-
[81]
Projet d’amélioration des travaux obligatoires des pensionnaires, adressé à Thiers [Arch. Musées nationaux, fonds Delaroche-Vernet, P 30 Vernet (H.), dossier 8 ; éd. : Vernet..., n° 557].
-
[82]
Vernet à Quatremère de Quincy, 5 déc. 1834 [Vernet..., n° 603].