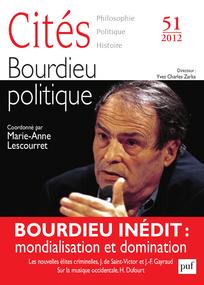1Jusqu’à la chute du Mur, la pensée libérale considérait que la principale menace pour la démocratie venait du totalitarisme [1]. Aujourd’hui il est facile de comprendre que la démocratie n’est plus – tout au moins pour le moment et en Occident – menacée par des systèmes politiques qui lui sont entièrement extérieurs, comme cela a pu l’être à l’époque de la Guerre froide. Elle nourrit en revanche en son propre sein des forces qui la corrodent et peuvent la rendre vide de sens. Sans céder à la « théorie du complot », le grand philosophe et juriste italien Norberto Bobbio avait déjà perçu cette menace avant même la chute du Mur et il désignait ces forces sous le terme de « pouvoirs obscurs » ou « invisibles », qui allaient, selon lui, à l’encontre de ce qui était l’esprit même de la démocratie, à savoir le « pouvoir visible [2] ». Bobbio citait, parmi ces « pouvoirs invisibles », les « mafia, camorra, loges maçonniques déviantes, services secrets incontrôlés qui protègent une subversion contre laquelle ils sont censés lutter », etc. Les « années de plomb » avaient dévoilé une partie de ces forces obscures dans la Péninsule et Norberto Bobbio pouvait ajouter, non sans humour, que sa réflexion sur les Arcana Imperii modernes avait une longueur d’avance sur les autres penseurs européens de la Démocratie, comme Raymond Aron, puisqu’il était influencé par « la situation italienne où, si l’on me passe l’expression, rien n’est plus visible que la présence de pouvoirs invisibles [3] ». C’est donc encore à partir du cadre italien, où la réflexion criminologique est la plus avancée, qu’il est possible de réfléchir à un phénomène nouveau, qui se développe amplement avec une mondialisation fragilisant les cadres juridiques nationaux, à savoir la tendance à la criminalisation de franges toujours plus grandes de l’élite locale ou globalisée.
2La montée en puissance de « pouvoirs obscurs » – économiques, financiers, médiatiques en liens avec les réseaux criminels – est un trait majeur de la mondialisation qui affaiblit le pouvoir d’État traditionnel [4]. C’est ce qui a conduit certains juges antimafia à parler d’une « ère postcriminelle » (De Cataldo), dans la mesure où ce ne sont plus seulement les acteurs criminels traditionnels qui ont recours à l’arme du crime. Mais comment rendre compte de ces mutations insensibles ? Peut-on espérer sortir du discours abstrait pour donner un coup de projecteur sur ces « zones grises » qui se développent au cœur du pouvoir de nos démocraties avancées ? Le « laboratoire italien », selon la formule consacrée, offre depuis les années 1990 un cadre juridique qui permet de saisir de manière substantielle, et le moins polémique possible, les liens qu’entretiennent certaines élites en place avec les organisations criminelles lato sensu [5].
De la bourgeoisie mafieuse et criminelle…
3Depuis les années 1980, le juge Giovanni Falcone, influencé par les travaux du baron Franchetti, au xixe siècle [6], s’était convaincu que la véritable puissance de ce qu’on appelait la « mafia » reposait, non sur sa force intrinsèque mais sur les liens qu’elle avait su tisser avec le monde des élites sans scrupule, prêtes à passer des « pactes scélérats » (pactum sceleris) avec elle. Après l’assassinat du juge Falcone, la cour de cassation italienne reprit son idée et créa, en 1994, le concept de « concours externe en association mafieuse » (sur la base des articles 416 bis et 110 du code pénal italien) qui devint la base juridique du concept de « bourgeoisie mafieuse », notion floue qui avait été élaborée dans les années 1980 par l’historien Umberto Santino pour désigner toutes les élites qui profitent de la « main invisible » du crime pour conduire leurs propres affaires. L’expression est aujourd’hui reprise par tous les magistrats antimafia [7]. Grâce à l’introduction de ce concept de « concours externe », le droit pénal italien a pu pousser beaucoup plus loin que toutes les autres législations d’Europe l’analyse des mécanismes liant le monde des élites politiques, économiques, financières, médiatiques, sportives, etc. avec ce que la criminologue Alessandra Dino appelle le « noyau dur » (nucleo duro) de la mafia [8]. C’est ce qui permet de comprendre, comme a pu l’écrire récemment un des meilleurs historiens de la Camorra, que « la question mafieuse ne concerne plus seulement l’histoire criminelle, elle est devenue une part essentielle de l’histoire du pouvoir [9] ».
4Il serait évidemment trop long d’évoquer ici dans le détail cette production jurisprudentielle qui a d’ailleurs inspiré une sociologie criminelle particulièrement raffinée [10]. Bornons-nous à évoquer rapidement quelques cas typiques de cette nouvelle « bourgeoisie mafieuse », beaucoup plus discrète – et donc efficace – que le « noyau dur » de la mafia militaire. L’expression « bourgeoisie mafieuse » est suffisamment vague pour se concevoir comme un escalier à double révolution : elle désigne non seulement des élites peu scrupuleuses frayant de manière structurelle avec le crime organisé, sans pour autant appartenir structurellement à l’organisation mafieuse (n’en ayant pas l’affectio sociétatis), mais elle vise aussi des dirigeants de la mafia qui, grâce à leurs richesses et à leurs protections, sont parvenus à sortir de leur ghetto criminel pour devenir, à l’instar de certains oligarques de l’Europe de l’Est, des personnalités « respectables » et très influentes, liant parfois des liens (économiques ou familiaux) avec d’autres « bourgeoisies mafieuses » dans le monde. On se limitera, ici, à évoquer le champ économique car il illustre parfaitement le poids pris par cette nouvelle élite criminelle. Les forces patronales admettent aujourd’hui cette triste réalité. En septembre 2007, Luca Cordero di Montezemolo, alors président de la Confindustria (le Medef italien) avait même proposé d’exclure de son organisation tous ceux qui seraient considérés « collaborateurs » de la mafia [11]. Encore faut-il s’entendre sur ce que signifie, pour un patron, être « collaborateur » des puissances criminelles ?
5On ne peut pas mettre dans le même sac l’industriel contraint de travailler avec la mafia et celui qui, de son propre chef, accepte de passer un « pacte scélérat » avec elle. Beaucoup d’acteurs économiques « honnêtes » sont placés devant un choix cornélien : travailler avec l’organisation qui contrôle leur territoire ou risquer de perdre la vie, tel Libero Grassi, un entrepreneur de Palerme qui, en 1991, refusa de payer le pizzo (racket). Il fut assassiné en représailles par la mafia. Dans les zones mafieuses, « le libre marché n’existe pas, avait-il déclaré avant de mourir, et il n’existe pas parce que les victimes ne parlent pas et parce que l’Association des patrons ne bouge pas le petit doigt [12]. » Par peur, le président de l’Assindustria de Palerme refusa en effet à l’époque de lui apporter son soutien [13]. Pour autant, de tels entrepreneurs, même s’ils ne font rien contre la mafia, ne peuvent pas être classés dans la même catégorie que des hommes d’affaires sans scrupule qui pactisent sciemment avec le monde du crime et relèvent de la véritable « bourgeoisie mafieuse ». La justice italienne est habituée à faire le tri au sein des élites économiques – mais on pourrait en dire autant des élites politiques nationales ou locales – parce qu’elle sait que, sur un territoire contrôlé par la mafia, il n’existe pour ainsi dire aucun acteur vraiment « libre ». Utilisant les travaux de la sociologie criminelle, la jurisprudence pénale établit une sorte de distinction entre ceux qu’elle désigne comme des « entrepreneurs soumis » – ou « subordonnés » (subordinati) – des entrepreneurs « complices » (collusi) et des entrepreneurs « mafieux » [14].
6Seuls les entrepreneurs « complices » peuvent être raisonnablement associés à la véritable « bourgeoisie mafieuse ». Encore faut-il distinguer. Les plus typiques de la « bourgeoisie mafieuse » sont ceux que la sociologie criminelle appelle les entrepreneurs « clients » (clienti) de la mafia pour les distinguer des chefs d’entreprise « instrumentaux » (strumentali). Les « clients » sont généralement des entrepreneurs locaux, siciliens, calabrais, napolitains, etc., ayant décidé de proposer leurs services à la mafia, entrant de la sorte en « relation de clientèle » avec l’organisation criminelle. Le cas d’école est celui des « chevaliers du travail » (Cavalieri del Lavoro) de Catane, ces riches promoteurs de l’est de la Sicile qui, dans les années 1980, passèrent un pacte criminel avec la mafia palermitaine pour étendre leurs affaires à l’ouest de l’île, tout en offrant leurs réseaux de relations politiques à la mafia à l’est de l’île [15]. L’entrepreneur va continuer à payer le « pizzo », tout en tirant de cette relation d’affaires de formidables avantages. L’offre de service de l’homme d’affaires peut être très variée : elle va du « bon tuyau » que l’entrepreneur procure au mafieux jusqu’au faux témoignage dans un procès pénal, en passant par le blanchiment d’argent ou l’usure, une des conséquences de la faiblesse du système financier du Mezzogiorno [16].
7Les magistrats distinguent bien l’entrepreneur-client des entrepreneurs purement « instrumentaux » qui pactisent avec la mafia, en particulier dans le cadre des gros contrats d’appels d’offres. Ces hommes d’affaires restent totalement extérieurs à l’affectio sociétatis de l’organisation criminelle. Et pourtant la justice considère à juste titre que la responsabilité de ces grands entrepreneurs est supérieure à celle d’un chef d’entreprise local, « client » de la mafia. Car ces grandes multinationales ont favorisé et favorisent encore, par leur indifférence, la permanence voire l’essor du phénomène mafieux dans une proportion bien supérieure au simple patron local. En effet, ces grandes entreprises nationales ou multinationales se considèrent comme des partners de la mafia. Elles signent avec celle-ci des accords limités dans le temps qui précisent de manière stricte leurs obligations réciproques. Le modèle de ce genre de pacte est celui qui prit le surnom en Sicile dans les années 1980 de tavolino (petite table de jeu). Il était conçu par un riche entrepreneur mafieux, Angelo Siino, surnommé le « ministre des Travaux publics de Cosa Nostra [17]. » De l’aveu de son concepteur, qui devint collaborateur de justice, les avantages offerts par le tavolino étaient considérables. Les entrepreneurs étaient assurés, pendant cinq ans, de gagner les appels publics qui les intéressaient en Sicile, alors un des marchés les plus florissants d’Europe. En outre, le pacte avec la mafia assurait aux entrepreneurs une sécurité absolue sur les chantiers, en particulier en cas de conflit social, de grève ou de catastrophe naturelle. En contrepartie d’une implantation sans histoires, les industriels devaient verser à la mafia un pourcentage fixé selon des barèmes très stricts : 2,5 % de la valeur de l’appel d’offres pour entretenir les bons rapports de Cosa Nostra avec la classe politique, 2,5 % pour la sécurité sur les chantiers et 0,8 % versé directement à Toto Riina et Bernardo Provenzano, les chefs de la mafia qui assuraient la garantie générale du pacte [18]. Ce tavolino sicilien n’avait rien hélas d’une spécialité locale, même s’il ne fut jamais autant centralisé qu’en Sicile, et on en retrouva des cas exemplaires à Naples, avec le scandale Parmalat, ou en Calabre, avec la construction de l’autoroute Salerne-Reggio ou du port de Gioia Tauro, contrôlé par un des clans les plus puissants de la mafia calabraise, les Piromali-Pelle [19]. À chaque fois, les holdings du nord préférèrent passer un « pacte » avec la mafia plutôt que de prendre le risque de faire respecter la légalité.
8Ces « entrepreneurs instrumentaux » n’appartiennent pas, comme les « entrepreneurs complices », à la bourgeoisie mafieuse à proprement parler, mais la profonde « irresponsabilité sociale » des dirigeants des grandes firmes, qui avaient pourtant tous la capacité de résister à la mafia, nourrit un phénomène d’acceptation du crime qui contamine ensuite les pratiques des affaires. Le pacte qu’une société multinationale passe avec une mafia renforce l’aura de cette dernière en soulignant sa puissance et en lançant un message terrible aux autres acteurs locaux. L’indifférence revendiquée par la science économique et managériale aux questions éthiques prend aujourd’hui une dimension critique dans les zones à forte dimension mafieuse. La situation paraît passablement désespérée. Le président de la Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo, n’a pas hésité à admettre en 2007 que, dans certaines zones du Mezzogiorno, être un chef d’entreprise « honnête », relève, selon lui, de « l’héroïsme » [20]… On ne saurait être plus clair. La chercheuse Felia Allum a pu soutenir que cette confusion croissante entre l’économie licite et l’économie illicite, a constitué, dans les années 1990, un des moteurs importants (et souvent ignorés) de la fatale privatisation de la sphère publique en Italie, précédant puis favorisant l’apparition d’un parti-entreprise comme Forza Italia [21].
9On ne peut évidemment tirer de l’exemple italien des généralités applicables à tous les pays. En effet, l’émergence de « bourgeoisies criminelles » dépend beaucoup de circonstances historiques, politiques, juridiques, culturelles, etc., qui divergent selon les latitudes. Par exemple, l’essor des oligarques russes relève pour l’essentiel de la gestion inconséquente de la phase de privatisation de masse des années 1990, inspirée par les experts occidentaux, en particulier américains (USAID) [22]. Mais, quoi qu’il en soit, le phénomène de la « bourgeoisie criminelle » est devenu aujourd’hui une figure non négligeable, pour ne pas dire stratégique, de l’économie globale [23]. Mais sa composante « mafieuse » n’en est peut-être plus qu’une des facettes, voire une facette périphérique, comme en témoignent les dérives récentes de l’économie financiarisée.
… à la criminalité organisée en col blanc ?
10En effet, l’univers criminel décrit jusqu’à présent relève à titre principal d’un underworld familier, celui que l’argot français désigne sous les vocables pittoresques de « Milieu » ou de « Mitan » et la criminologie nord américaine de « crime organisé » (organized crime) [24]. Cette représentation traditionnelle et confortable du crime – dominante dans la médiasphère et la fiction – s’est développée en opposition avec celle de « criminalité en col blanc » (white collar crime) [25]. Depuis un siècle, notre regard sur le monde criminel s’est structuré à titre principal autour de ces deux concepts. Mais cette double grille analytique est-elle encore utile ? Osons même une question plus dérangeante encore : a-t-elle jamais été totalement pertinente ? Ne faut-il pas aujourd’hui dépasser cette approche un peu myope ? Afin d’y voir plus clair, il est nécessaire de revenir aux fondamentaux.
11Longtemps, les criminels dits d’habitude au xixe siècle, ceux ayant fait du crime un mode de vie et une carrière, ont été perçus à tort comme fonctionnant plutôt de manière isolée, inorganisée, ne s’associant que ponctuellement. Une vision erronée du crime puisque le Moyen Âge européen avait déjà vu œuvrer des groupes de criminels pérennes et structurés. Jusqu’au jour où la criminologie nord américaine a développé le concept d’organized crime, à la suite des travaux de la Chicago Crime Commission (1919). Cette commission indépendante avait sous le regard un sujet d’études incomparable : les puissants gangs irlandais et italo-américains. Une réalité criminelle nouvelle faisait naître un concept nouveau. Le concept de crime organisé s’est ensuite défini à partir de quatre caractéristiques : l’origine sociale modeste de ses membres (les bas-fonds sociaux) ; la nature violente et acquisitive de ses crimes (drogue, vols, homicides, etc.) ; sa capacité organisationnelle, associative et entrepreneuriale dans une perspective de stabilité et de durée ; enfin une conscience de soi en tant que groupe à partir d’une identité spécifique. Le concept a été souvent critiqué, au point de lui dénier parfois toute solidité empirique et théorique [26]. Il se confond parfois avec celui « d’organisation criminelle », un glissement sémantique qui permet de déporter l’analyse vers la dimension institutionnelle du crime. Bien que tautologique, la meilleure définition du crime organisé est en fait celle du « crime commis par des organisations criminelles [27] ».
12La notion de crime organisé est relativement ambiguë. C’est pourquoi la distinction, telle que proposée par James O. Finckenauer [28], entre le « crime organisé » stricto sensu ou « organisation criminelle » et « le crime s’organisant » (crime that is organized) ou « réseau » (network) permet de rendre compte avec finesse de la totalité des comportements criminels d’habitude. Encore que la frontière soit plus temporelle et psychologique que matérielle. Un réseau impuni dans la durée aura naturellement tendance à s’institutionnaliser et à formaliser les rapports de ses membres. Le réseau n’est alors qu’une étape sur le chemin de l’enracinement. De même, un réseau devient une organisation formelle autant par ce qu’il réalise dans la durée que par l’idée qu’il se fait de ce qu’il est ou n’est pas de manière subjective.
13Jusque-là cependant, le monde du crime n’est encore compris que comme un sous-bois social. Le socialement dangereux est un homme du peuple, issu des couches laborieuses. Les classes dangereuses sont des classes laborieuses [29], à titre principal des « cols bleus ». Jusqu’au jour où, dans l’entre-deux-guerres mondiales, le sociologue américain Edwin S. Sutherland propose un changement radical de perspective modifiant notre perception du monde du crime [30]. Il montre que les élites politiques, économiques et financières – les « cols blancs » – peuvent elles aussi commettre des crimes. La criminalité en col blanc – par opposition donc aux « cols bleus » du crime organisé – présente trois caractéristiques : principalement l’origine sociale supérieure de ses auteurs (l’upperworld des élites) ; la nature non violente des crimes, commis à l’occasion de l’exercice de leurs professions légitimes ; la très faible visibilité sociale et judiciaire de ces crimes (peu ou pas réprimés, ni perçus comme socialement dangereux). Il critique durement le fait que ses prédécesseurs se soient surtout préoccupé de la criminalité des rues (street crimes) et par là aux seuls criminels arrêtés et condamnés, donc traités par le système judiciaire. Sa perspective est doublement révolutionnaire : d’une part en changeant le regard porté sur des élites ; d’autre part, et on a souvent oublié ou occulté cet aspect de sa pensée, en ôtant un argument aux partisans de l’explication socio-économique du crime [31].
14Malgré ses avancées, le concept de criminalité en col blanc, tel qu’il a été développé par les criminologues, comporte une faille car il induit une vision biaisée du crime par les élites. En insistant sur ses origines sociales (en « haut »), elle en gomme ses caractéristiques parfois centrales, celles que l’on observe dans l’univers du crime organisé et/ou des organisations criminelles : l’habitude et/ou le professionnalisme ; la préméditation jusque dans sa perspective stratégique ; la capacité d’entente et d’association dans le temps. Le white collar criminal semble un simple opportuniste isolé, ayant cédé aux tentations offertes par sa profession.
15Cependant, quelques rares auteurs ont eu le pressentiment d’une dimension organisée du crime en col blanc. Cette notion est latente par exemple chez William K. Black, criminologue ayant analysé la crise des caisses d’épargne américaines dans les années 1980 [32]. En Europe, certains manuels de criminologie proposent aussi une typologie des variétés du crime organisé comprenant le white collar crime [33]. Le célèbre criminologue Jean Pinatel proposait en 1975 une distinction curieuse entre deux types principaux de crime organisé : d’une part « le crime organisé dans le monde criminel » défini comme « l’activité des criminels professionnels (…) qui peut revêtir, dans un but acquisitif, les formes de la violence, de la ruse et du vice » [34] ; d’autre part « le crime organisé en dehors du monde criminel » identifié exactement à « l’activité du white collar criminal ». Mieux encore, et il semble que les commentateurs aient à nouveau oublié cet aspect corrosif de sa pensée, Edwin H. Sutherland faisait de la criminalité en col blanc une forme de criminalité organisée : « White collar crimes are not only deliberate ; they are also organized [35] ». Pour ce sociologue, il n’existe pas de différence fondamentale entre certains criminels d’en haut et certains criminels d’en bas. Auparavant, le hollandais William Bonger évoquait déjà en 1905 dans sa thèse Criminalité et conditions économiques une criminalité des possédants pouvant être durable, systématique et organisée [36].
16Mais les travaux contemporains sur la criminalité des élites passent généralement à côté de cette dimension organisée alors même que le contexte post-guerre froide, celui de la globalisation, procure à cette forme de criminalité – et aux autres d’ailleurs – un effet de souffle historique. Les crimes économiques et financiers sont étudiés mais la question cruciale des transformations radicales de leurs auteurs est ignorée [37]. Or les initiateurs de ces crimes ont muté profondément.
17D’ailleurs, on ne voit pas pourquoi le monde des managers économiques et financiers serait moins capable de s’associer et de s’organiser, y compris dans la durée, dans le cadre d’activités criminelles, que les « simples » criminels des bas-fonds. À l’examen en effet, le monde des affaires offre en permanence des exemples de cette capacité organisatrice dans le champ de l’entrepreneuriat criminel. Dans les limites de cet article, nous rappellerons deux exemples. Le premier renvoie à une situation pré- ou infrapénale de prédation [38] financière. La spéculation contre la dette souveraine grecque et l’euro est déclenchée en 2010 par un groupe de dirigeants de grands fonds spéculatifs (hedge funds) américains lors d’un dîner formel, passé à la postérité sous le nom de idea dinner, dont l’existence n’a pas été démentie [39]. La prédation des marchés a été moins spontanée qu’imaginée.
18Le second relève explicitement de la fraude pénale systémique : le scandale de la BCCI [40]. Pendant une génération, une banque globalisée a mené, dès ses origines, une gamme large de crimes (blanchiment d’argent sale, notamment du trafic de drogues, prêts fictifs, faux, etc.), faisant d’une institution bancaire internationale une vaste « pyramide » financière. Les sommes détournées se chiffrèrent en milliards de dollars et ne furent pour l’essentiel pas retrouvées.
19Du point de vue de l’analyse criminologique, il est désormais indispensable de sortir des ornières empruntées par les concepts d’organized crime et de white collar crime. Il faut les dépasser et franchir une étape. Avec la globalisation et la financiarisation de l’économie, nous observons dans le monde des affaires une forme insoupçonnée de ce que nous proposons d’appeler une « criminalité organisée en col blanc » (COCB) [41]. Cet univers voit fonctionner aussi bien des « criminels qui s’organisent » au sens du réseau professionnel, que probablement des « organisations criminelles en cols blancs ». Il existe ainsi en Italie ce que les criminologues appellent des « comités d’affaires », réunissant des dirigeants politiques ou économiques, des intermédiaires douteux (faccendiere) et des représentants plus ou moins affichés de la mafia. Ces « comités » dominent le Mezzogiorno depuis la crise de l’État providence, dans les années 1970, mais ils ont pris aujourd’hui leur essor au niveau national. En témoignent par exemple les « affaires » qu’on désigne en Italie sous le nom de « P 3 » ou « P 4 », appellations rappelant la fameuse « loge P 2 [42] ». La présence des clans mafieux dans ces « comités d’affaires » a pour objet principal d’évincer toute forme de concurrence, créant des « barrières invisibles », tout en professant officiellement un discours néolibéral, voire ultralibéral.
20Si le détour théorique et démonstratif peut laisser sceptique, l’évolution des pratiques policières devrait faire réfléchir. Aux États-Unis, depuis l’éclosion de la crise des subprimes et l’échec de la répression des fraudes massives qui l’ont provoquée, le FBI utilise désormais les techniques de lutte jusque-là réservées au « crime organisé » pour démasquer les fraudeurs de Wall Street : écoutes, surveillances, indicateurs [43].
21Cependant, le périmètre du concept de « criminalité en col blanc » dépasse de beaucoup le seul monde des affaires. Ses applications sont plus larges. Nous n’esquisserons ici que celle de la criminalité acquisitive d’État, menée par des hauts fonctionnaires et des politiciens. La forme la plus aboutie de cette prédation de haut niveau provient des régimes politiques de type kleptocrate, une forme d’organisation institutionnelle aujourd’hui largement répandue dans le monde, notamment dans les États affaiblis ou carrément « faillis » (failed States), sur le modèle de la Somalie. La structure étatique y est neutralisée de l’intérieur, rendue captive par une criminalité – exogène ou endogène – faisant système, œuvrant en concurrence ou en collaboration avec l’univers du crime organisé traditionnel/en col bleu [44].
22La définition que l’on donne du crime organisé est une question cruciale car elle conditionne le degré d’attention qui lui sera accordée par l’opinion et les médias, le niveau de la mobilisation politique et répressive. Le travail de qualification est toujours primordial et fondateur [45] ; car la caractéristique essentielle des phénomènes criminels (de droit commun) est leur clandestinité, en particulier quand il s’agit de crimes par essence invisibles (trafics ; crimes économiques et financiers) et/ou commis par des entités pérennes recherchant naturellement la discrétion pour échapper à la répression. Seul un concept juste peut faire émerger une réalité car les mots précèdent les choses. Le public et les décideurs ne peuvent découvrir la puissance nouvelle des phénomènes de criminalité en col blanc – jusqu’au stade de leur criminalité organisée – que si, au préalable, une analyse les révèle, au sens photographique du terme. Tant que le concept exact n’émerge pas, une réalité criminelle peut aisément rester dissimulée à l’intelligence du public et, plus grave, des organes de répression. L’invisibilité intellectuelle précède l’invisibilité matérielle. La visibilité intellectuelle est le premier pas vers l’action. La qualité du regard détermine la précision et la justesse de la répression. Quand la pensée ne s’aveugle plus, l’action cesse de s’égarer.
Notes
-
[1]
Voir par exemple Jean-François Revel, Comment les démocraties finissent, Paris, Grasset, 1983.
-
[2]
Le futur de la démocratie, Paris, Le Seuil, 2007, 186.
-
[3]
Ibid., p. 120.
-
[4]
Le thème controversé de l’effacement de l’État serait ici trop long à développer. On peut en trouver un bon résumé dans André-Jean Arnaud, Entre modernité et mondialisation. Leçons d’histoire de la philosophie du droit et de l’État, Paris, LGDJ, 2004.
-
[5]
Sur les différences entre « mafia », « cartel », gangs et bandes, je renvoie à mon article, « Criminalité organisée », in Michela Marzano (dir.), Dictionnaire de la violence, Paris, Puf, 2011, p. 313-318.
-
[6]
L’œuvre majeure de Leopoldo Franchetti n’est malheureusement pas traduite en français ; voir Conditizioni politiche e amministrative della Sicilia (1877), Rome, Donzelli, 2000, préface de Paolo Pezzino.
-
[7]
La cour, dans l’arrêt Demitry, déduisit le concept de « concours externe » de l’articulation entre l’article 110 du Code pénal (sur la complicité) et l’article 416 bis sur l’association mafieuse (voir Cass. Pen. Sez Un., 5 octobre 1994, arrêt Demitry, in Foro It., 1995, II, 422). De nombreux arrêts ultérieurs sont venus compléter cette infraction ; je renvoie à mon article « Une nouvelle élite en gestion : la “bourgeoisie mafieuse” », Cités, 2008, no 33, p. 151 sq.
-
[8]
L’ouvrage de référence sur ce concept est celui du conseiller à la Cour de cassation Giuliano Turone, Il delitto di associazione mafiosa, Milan, Giuffrè, 2008, p. 398 sq.
-
[9]
Francesco Barbagallo, Storia della Camorra, Rome-Bari, Laterza, 2010, p. 234.
-
[10]
Voir par exemple Rocco Sciarrone, Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamente e espansione, Rome, Donzelli, 2009.
-
[11]
La Repubblica, 1er septembre 2007.
-
[12]
Cité par E. Ciconte, Storia criminale, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, p. 156.
-
[13]
Umberto Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile, Rome, Ed. Riuniti, 2000, p. 276.
-
[14]
Pour tout ce qui suit, voir G. Turone, Il delitto di associazione mafiosa, op. cit., p. 458 sq.
-
[15]
S. Lupo, Histoire de la mafia, Paris, Flammarion, 1999, p. 283 sq.
-
[16]
Voir Tano Grasso, « Usura », in Nuovo Dizionario di mafia, p. 562 sq.
-
[17]
Sur ce célèbre accord mafieux, révélé par Siino, voir Alfio Caruso, Da Cosa nasce cosa. Storia della mafia dal 1943 a oggi, Milan, Longanesi, 2000, p. 441 sq.
-
[18]
Ibidem.
-
[19]
Voir l’enquête de R. Sciarrone, « mafia e società civile in un area di radicamento originario: essere impreditori nella piena di Gioia Tauro », in Mafie vecchie, mafie nuove, op. cit., p. 55 sq.
-
[20]
La Repubblica, 3 septembre 2007.
-
[21]
Felia Allum et Renate Siebert, Organized Crime and the Challenge to Democracy, Londres et New York, Routledge Taylor & Francis Group/ECPR, 2003.
-
[22]
Voir Gilles Favarel-Garrigues, « Violence mafieuse et pouvoir politique en Russie », Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l’État, Paris, Karthala, p. 187 sq.
-
[23]
Jean-François Gayraud et François Thual, Géostratégie du crime, Paris, Odile Jacob, 2012.
-
[24]
Sur ce concept, un ouvrage de criminologie didactique et pertinent : James O ; Finckenauer, Mafia and Organized Crime, Oneworld Book, 2007. ; également : Martin O’Brien and Majid Yar, Criminology. The Key Concepts, Routledge, 2008. Pour une approche plus juridique : Jean-Paul Laborde, État de droit et crime organisé, Paris, Dalloz, 2005.
-
[25]
L’ouvrage essentiel : Edwin H. Sutherland, White collar Crime. The Uncut Version, Yale University Press, 1983. La première édition date de 1949 mais la version non expurgée (en raison de la peur des procès venant des industriels mis en cause dans le livre) ne fut publiée qu’en 1983. Edwin H. Sutherland utilise l’expression dès 1937. Ce sociologue a eu de clairvoyants prédécesseurs tels Charles R. Henderson et Albert Morris. Il fut aussi très influencé par un contemporain, Thorstein Veblen avec The Theory of the leisure class en 1912 ; traduction française : Théorie de la classe de loisir, Gallimard, 1970.
-
[26]
Toute une sociologie influencée par les travaux de Michel Foucault a beaucoup écrit sur ce thème : il fallait « déconstruire » une vision paranoïaque et policière du crime.
-
[27]
Sur ce point, James O. Finckenauer, op. cit.
-
[28]
Op. cit. Sur cette distinction, lire également : Ko-lin Chin, Heijin. Organized Crime, Business, and Politics in Taiwan, Easr Gate Book, 2003.
-
[29]
Nous empruntons évidemment l’expression au grand livre de Louis Chevallier, Classes laborieuses et Classes dangereuses, Paris, Hachette, 1984.
-
[30]
Op. cit.
-
[31]
Si même les riches et les puissants commettent des crimes, cela signifie que l’explication principale des origines du crime ne peut être la précarité, le dénuement, la pauvreté, le chômage. Si la situation socio-économique n’explique pas le crime pour les riches, pourquoi l’expliquerait-elle pour les pauvres ?
-
[32]
The Best Way To Rob a Bank Is to Own One, Austin, University of Texas Press, 2005.
-
[33]
Par exemple : Raymond Gassin, Criminologie, Paris, Dalloz, 2007.
-
[34]
Traité de droit pénal et de criminologie, Tome III Criminologie, par Jean Pinatel, Paris, Dalloz, 1975. Et pour les citations suivantes.
-
[35]
Op. cit.
-
[36]
William Adrian Bonger, Henry P. Horton, Criminality and Economic conditions, Whitefish (Montana), Kessinger Publishing, 2008.
-
[37]
Parmi les travaux récents et myopes : Vincenzo Ruggiero et Paul Ponsaers (dir.), La criminalité économique et financière en Europe, Paris, L’Harmattan, 2003.
-
[38]
Sur cette notion et ses rapports avec l’économie : Michel Volle, Prédation et prédateurs, Paris, Économica, 2008.
-
[39]
Susan Pulliam, Kate Kelly et Carrick Mollenkamp, « Hedge Funds Try Career Trade Against Euro », Wall Street Journal, 26 février 2010.
-
[40]
« Un loup déguisé en agneau. Une banque criminelle : la BCCI », Histoires ordinaires de fraudes, Paris, Eyrolles, Éditions d’Organisation, 2011.
-
[41]
L’un des auteurs a proposé ce concept, en l’appliquant à la crise des subprimes : Jean-François Gayraud, La Grande Fraude. Crime, subprimes et crises financières, Paris, Odile Jacob, 2011.
-
[42]
Voir par exemple Roberto Scarpinato, « Un programma contro i poteri criminali », Micromega, no 7, 2011, p. 92-118.
-
[43]
Patricia Hurtado, « FBI Pulls Off Perfect Hedge to Nab New Insider Trading Class », Bloomberg, 20 décembre 2011.
-
[44]
Il suffit de songer au basculement de certains pays de l’Afrique subsaharienne, confrontés à l’infiltration des « narcos » sud-américains (voir Le trafic de cocaïne en Afrique de l’Ouest, rapport de l’Onudc, octobre 2007).
-
[45]
Cette question de la qualification est bien connue des spécialistes de la mafia. Depuis le xixe siècle, elle explique pourquoi certaines organisations mafieuses ont pu échapper à toute forme de répression, renforçant ainsi leur force de cette impunité liée aux limites de l’état de droit libéral. Pour une question plus large de la qualification en droit, voir Alain Papaux, Essai philosophique sur la qualification juridique : de la subsomption à l’abduction, Bruxelles, Bryulant, 2003.