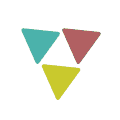Ainsi, c’est dans un monde presque inconnu qu’il faut guider le lecteur, sur des voies nombreuses dont certaines sont mal dégagées encore, mais dont la plupart sont faciles et largement ouvertes sur de vastes panoramas.
Rien ne m’appartient
Au Sud, je reviens
1On peut se demander ce que Houari Boumédiene [1] entendait par « Nord » et « Sud » lorsqu’il prophétisa la montée fertilisante et vindicative des peuples du Sud contre les peuples du Nord ? Quelle fonction cardinale accordait-il aux pôles qui lui évitait d’employer les mots « riches » et « pauvres », « Noir » ou « Blanc », « vainqueurs » et « vaincus » ou « Haut » et « Bas » ? En d’autres termes, de quelle nature est la pente que les pauvres sont supposés remonter et qui relie le Nord au Sud ? Dans quel sens penche le monde, pour opérer une telle décantation sur les sociétés humaines et n’offrir, pour sortir de la pauvreté que la montée vers le Nord ou la montée vers le ciel ?
2Les notions de Nord et de Sud ont perdu, en Géographie, toute valeur positive et sont le plus souvent dissociées des pôles qui les fondent. Pourtant, la pulsation magnétique qui les unit informe encore les usages métaphoriques [2] qui en sont faits.C’est en tous cas ce que suggèrent certaines cultures anciennes qui envisagent la circulation de l’énergie et de la matière sur Terre comme un facteur de localisation essentiel [3] des phénomènes géographiques naturels ou humains, à quelque échelle de temps ou d’espace que l’on se situe. Certaines positions scientifiques concernant le géomagnétisme semblent étrangement proches de ces idées traditionnelles.
3Afin de jalonner ces premières pistes de recherche, nous relèverons, dans un premier temps, l’abondance des références au géomagnétisme dans les cultures dites « amérindiennes ». Puis nous comparerons ces propositions concernant la « circulation de l’énergie » au rôle croissant que les scientifiques attribuent au géomagnétisme dans la construction et le fonctionnement de la planète. Enfin, nous observerons, à l’intersection de l’Équateur et du méridien magnétique, la façon dont les Incas ont su mettre en valeur l’un des centres du monde et organiser, autour de cet axe central « les quatre parties du monde », le Tawantinsuyu.
Le magnétisme est-il soluble dans l’identité amérindienne ?
4Contre toute attente, le vingtième siècle est mort avant les « dernières tribus » [4]amérindiennes. Celles-ci refusent de disparaître physiquement ou culturellement et font entendre des voix, des langues et des principes oubliés auquel il est chaque jour plus difficile de refuser une certaine modernité.
Le surgissement d’une géographie « amérindienne » ?
5Le terme « Amérindien » peut-il désigner autre chose qu’une construction européenne et coloniale ? Antoinette Molinié parle des « néo Indiens » comme d’une « religion du troisième millénaire » répondant plus à une demande de « New Age » [5] propre au XXIe siècle qu’à une époque précolombienne mythifiée. Pour Philippe Descola [2005], il est vain de chercher à réunir les sociétés urbaines de Méso-Amérique ou des Andes et celles des chasseurs-cueilleurs des grandes plaines de l’Amazonie, de Patagonie ou d’Amérique du Nord sous une même bannière culturelle. Il propose d’associer les premières aux autres cultures « analogiques » [6], africaines, européennes, indiennes ou asiatiques. Les secondes relèveraient d’un « animisme » [7] tout aussi ubiquiste.
6Quel que soit le nom qu’on leur donne, ces sociétés et ces cultures ne sont pas mortes. Elles font montre, au contraire, d’une réjouissante vigueur et d’une grande créativité. Leur nombre exact n’est pas connu. Selon les gouvernements et les époques, il est régulièrement minoré, plus rarement majoré. Selon les sources officielles gouvernementales [8], les Amérindiens représentaient, en 2003, 43 millions de personnes soit environ 8% de la population totale de l’Amérique latine (590 millions) [Baby Colin, 2005]. Le chiffre réel est sans doute beaucoup plus important, mais il dépend surtout de l’image sociale de l’Indien à l’intérieur du pays qui valorise ou discrédite l’identification personnelle et la revendication [Ribeiro, 1991 ; Théry, 1999]. Cette croissance démographique s’accompagne d’un essor culturel et politique inégal mais indéniable.
7Les Amérindiens bénéficient par ailleurs d’une image plus précise et plus respectueuse de leur rôle dans la construction des paysages qu’au vingtième siècle qui les décrivit souvent comme « merveilleusement adaptés » à un milieu rendu tout puissant par la lourdeur des contraintes qu’il imposait aux sociétés. Longtemps simple figurant de l’Histoire et de la Géographie européenne, l’ « Indien » est surtout devenu auteur d’une partie des ouvrages qui le construisent. Une production bibliographique abondante est aujourd’hui proposée par des auteurs non académiques se déclarant, à des degrés divers, initiés à des savoirs traditionnels [9].
8Chercher à identifier une géographie amérindienne ne peut se limiter à localiser, sur une carte, la présence des groupes reconnus par les gouvernements nationaux et les territoires ou les « réserves » qui leur sont concédées. Il est aussi important de reconnaître le rôle des cultures amérindiennes dans la construction des villes, des routes, des campagnes et des identités collectives. Il est essentiel surtout de reconnaître leur compétence à produire une « conscience géographique » originale et à identifier, dans l’espace et dans le temps, des lignes d’interfluves reliant les « hauts lieux » et des thalwegs unissant les jours et les lieux profanes. Traçons, sans préjuger de la valeur scientifique de son contenu, les contours de la « Nouvelle géographie amérindienne », telle qu’elle apparaît lorsqu’on fait la somme des informations aujourd’hui disponibles. Comme la découverte de l’Amérique fit voler en éclats la belle trinité des cartes dites « en TO », cette Géographie « amérindienne » exige, pour être entendue, un changement d’échelle et d’orientation, et l’intégration de la dimension temporelle (représentée par le ciel et par le calendrier) dans la lecture du paysage.
Une géographie magnétique ?
Le géomagnétisme : une autre lecture du Monde

Le géomagnétisme : une autre lecture du Monde
9C’est un univers en quatre dimensions, dans lequel le ciel est l’élément essentiel. Étalonné en treize sections par le calendrier Maya, il est parsemé d’étoiles dont les constellations, au revers, offrent les formes reconnues par les Incas et les Aborigènes. Il est zébré par les étoiles filantes annonciatrices de grands changements et peuplé par une myriade de formes plus extraterrestres et moins identifiables les unes que les autres.
10Les hommes qui peuplent cette terre vivent donc le nez au ciel, dans la Lune ou dans les étoiles. Ils sont astronomes, chasseurs, cueilleurs, planteurs, artistes, guerriers et magiciens et martèlent le sol au rythme et dans la direction que leur indique le ciel. Ils participent à des œuvres géantes qu’on ne peux voir que de très haut ou sur une échelle de temps imaginaire. Ils traversent des forêts grouillantes d’esprits autant que de vies avec lesquelles ils vivent en étroites communications et parentés.
11En dessous de ces « bois sacrés » [10], sous les rêves d’âge d’or, de virginité ou d’El Dorado, que les géologues appellent Rodinia et les Indiens la « Terre sans mal » circulent les cénotes [11] de l’Infra monde. Dans le grand chaudron de laCuca [12] mijotent tous les Hadès américains. Réceptacle des désastres annoncés de l’histoire ancienne, l’inframonde amérindien procède de la sédimentation des apocalypses. L’idée de fin du monde constitue, en effet, un des pôles fondateurs de cette géographie amérindienne [13], liée à son complémentaire, le mythe de l’origine.
12Du Ciel à l’Inframonde, de l’origine à la fin du monde, l’énergie et la matière qui composent la terre indienne, circulent selon des axes qui unissent les pôles magnétiques du globe. La référence à la « circulation des énergies » est omniprésente dans la géographie amérindienne [14].
13Les pôles, que la Géographie universelle associe généralement sous la commune appellation de « milieux extrêmes » [Sorre, 1961] pour mieux les retrancher de l’écoumène, sont au contraire centraux. L’axe qui les unit est souvent représenté comme le tronc d’un arbre, dont les pieds s’enfoncent dans l’inframonde et les branches dans les étoiles. Le sol, qui sépare le visible de l’invisible, le vivant du mort et le solide du gazeux, ou l’axe de l’écliptique fonctionnent comme un équateur et transforment l’arbre de vie en une croix, la Chacana Inca ou la Wakah ChanMaya [Freidel et Schele, 1993, p. 86]. Entre les pôles, l’énergie circule sous la forme souvent décrite de deux serpents. Pour les Indiens Hopis, « il y a deuxserpents d’eau, un à chaque pôle avec un guerrier assis sur sa tête et un autre sur sa queue » [Mails, 1997]. La complémentarité conflictuelle des pôles se retrouve dans la définition de leurs divinités tutélaires. Pour les Mayas, « Makujutaj, qui représente le Nord, tire son énergie de l’air, sa manifestation est la subtilité, il est l’aliment de la vie, le générateur des idées et sa couleur est le Blanc », alors que Ik’i B’alam, qui représente le Sud, « tire son énergie de l’eau, sa manifestation est la Nature. Elle est l’eau de la planète, la végétation, don de vie dont la couleur est le jaune ».
14À toutes les échelles, les courants énergétiques sont invoqués pour expliquer la forme ou l’attraction de tel ou tel lieu [15]. Le magnétisme, loin d’être un phénomène anecdotique est présenté, dans ce contexte, comme un mouvement universel et sacré [16] fondé sur la complémentarité entre le blanc et le jaune.
15De façon plus générale, la perception magnétique du monde est une perception rythmique, alternant des phases de vie et des temps morts et identifiant dans la fin du monde, non le mal que le progrès prétend avoir vaincu, mais le battement nécessaire au renouvellement. Le monde se définit selon ses coordonnées spatiales mais aussi temporelles. Comme le monde qu’ils composent, les jours Maya sont organisés en sphères successives séparées par les goulets d’étranglement des débuts et des fins. Il s’articule autour de grandes phases de bouleversement ouvrant et clôturant les « Mondes », les « Âges » ou les « Soleils [17] ». Ils forment ainsi quatre « Soleils » [Soustelle, 1967] dont la période d’apogée forme un équateur et les limites historiques des pôles. Historiquement comme géographiquement, un des pôles inspire et l’autre expire [18].
16Qu’ils soient « anciens » ou « néo », les « Indiens » sont, une nouvelle fois, chargés d’ouvrir la porte d’un Nouveau Monde. La géographie sans se renier elle-même peut-elle épouser, aimer, reproduire les traits de ce monde nouveau ? Il faudrait pour cela reconnaître la convergence des points de vue scientifiques et traditionnels à propos du géomagnétisme.
Le géomagnétisme : science du New age ou nouvel âge de la science ?
17La superposition des axes traditionnellement reconnus comme « énergétiques » et des cartes du géomagnétisme peut-elle permettre de traduire de façon scientifique des concepts qui nous échappent encore largement ? J’ai appelé à mon secours Pierre Andrieu, Physicien à l’Institut de physique du globe de Paris, afin qu’il m’oriente dans mes recherches. Il me conseilla de me familiariser avec les notions de base [Levy, 2000 ; Thellier, 2004], puis de prendre connaissance de la somme de Jean Goguel [Goguel, 1971]. Il me recommanda, enfin la lecture d’unarticle de son collègue bordelais, André Rousseau [Rousseau, 2005]. C’est avec humilité que je dois reconnaître que tout ce que je lus alors était absolument neuf pour moi.
De la terre à la magnétosphère, un changement de point de vue géographique
18Les premières lignes de Jean Goguel datant de 1971 me rassurèrent : pour les scientifiques aussi, le géomagnétisme est encore « un monde presque inconnu » [19]. En géographie, les allusions au phénomène sont rares. En 1848, Benoist de Matougues, dans un Dictionnaire de Géographie sacrée et ecclésiastique affirmait le rôle essentiel du Géomagnétisme dans la compréhension des facteurs de localisation pris en compte par les bâtisseurs de cathédrales, d’églises, voire sans doute, de pyramides ou de mégalithes :
Le magnétisme terrestre embrasse à lui seul des centaines de phénomènes qui demanderont des siècles d’observations pour être éclaircis, pour être mesurés avec toute la précision requise, pour découvrir enfin les lois qui les régissent. S’agit-il de la déviation par rapport au méridien, de l’aiguille magnétique horizontale, de la déclinaison ? (…) Mais sur la question si complexe du magnétisme du globe, il nous faudra encore, pendant bien des années, nous en tenir aux faits sans comprendre la théorie » [Benoist de Matougues, 1848, p. 279].
20Ce faisant, il enfermait durablement l’étude du phénomène du côté d’une géographie « sacrée », providentialiste et finaliste avec laquelle la Géographie « Universelle » de Vidal de la Blache et toute la troisième République s’engageait à rompre. Le chapitre « géomagnétisme » disparut des manuels de géographie.
21C’est donc avec enthousiasme et surprise que je découvris les images scientifiques de la magnétosphère et les cartes du géomagnétisme [20]. Il m’apparut que la forme ultime de la Terre n’était pas visible au niveau de la surface des océans et des continents dans la mince couche que nous nommons la « biosphère », mais à celui de la magnétosphère, dix fois plus loin du centre de la Terre. Avec son auréole dorée et sa longue traîne bleue nuit parsemée d’étoiles [21], elle évoquait un grand serpent ou une silhouette humaine, dont le visage m’étaient familier. Les deux ouvertures polaires, enrubannées par les aurores boréales fonctionnaient comme lespôles d’un aimant et induisaient, entre elles, de vastes courants de circulation magnétique dont les plus rapides et les plus denses passaient par le centre de la terre et suivaient, au niveau du sol l’axe du méridien.
Le Magnétosphère : un lien commun indigène ?

Le Magnétosphère : un lien commun indigène ?
22Cette circulation énergétique pouvait-elle avoir un lien avec les formes observables sur le sol ? La dimension géographique de la circulation magnétique constitue justement le cœur de l’article d’André Rousseau [Rousseau, 2005] qui voit dans le géomagnétisme la « cause unique de tous les phénomènes géophysiques et géologiques ».
23Le champ magnétique terrestre résulte, dans son hypothèse, de la différence entre les vitesses angulaires du manteau et du noyau solide. L’élévation des températures qui découle du frottement entre les deux expliquerait le dégagement de chaleur et la fusion conséquente du noyau externe, ainsi que la production d’un champ magnétique.
24Ce mécanisme simple lui permet de proposer une explication cohérente et unique à l’ensemble des mouvements de la Terre. Ainsi, les plaques du manteau [22], en se déplaçant, absorbent une partie de son énergie de rotation, comme un frein le ferait sur une roue. Lorsqu’elles s’immobilisent, à l’issue d’un cycle tectonique de Wilson [23], sous forme d’un « super continent », leur action de freinage disparaît, et la vitesse angulaire du manteau augmente à nouveau. Lorsque les vitesses de rotation du noyau et du manteau s’équivalent, le champ magnétique produit tombe à zéro. La vitesse du manteau se met alors à nouveau à décroître, grâce à la dislocation du super continent et à la reprise de mobilité des plaques. Un nouveau champ magnétique apparaît, d’abord très fort, puis en lente décroissance, dans le sens inverse. « Les variations du champ magnétique sont donc la conséquence directe des variations de la vitesse angulaire du manteau par rapport à celle du noyau interne » [Rousseau, 2005].
Histoire géologique et pulsations magnétiques
25Les propositions de Rousseau sont tout aussi éclairantes à propos de l’histoire géologique. Au lieu d’une évolution linéaire sur 4,5 milliards d’années ponctuée « d’accidents » fortuits ayant provoqué, à intervalles variables, des crises majeures, on découvre une histoire dotée d’une forme globale, avec des phases de naissance, de maturité et de mort qui n’est pas sans évoquer celle des soleils mayas. Pour Rousseau, les événements qui rythment la vie de notre planète ne sont pas absolument aléatoires. Ils suivent un tempo, une cadence fournie par la pulsation magnétique. Lorsque le champ magnétique s’inverse, ce qu’il fait régulièrement [24], les vents cosmiques solaires frappent la Magnétopause plus près de la surface du sol. La tendance climatique est alors au réchauffement. La protection étant moindre, la multiplication des impacts météoriques est possible. Dans le même temps (géologique) et pour les mêmes raisons, les mouvements des plaques du manteau s’installant dans un nouveau cycle provoquent tremblements de terre, tsunamis, volcanisme. Le début du cycle nouveau repousse la Magnétosphère haut dans le ciel et se caractérisepar une explosion de la biomasse (taille, variété, rythme des mutations) et par un climat plus froid.
26À quatre reprises majeures, la vie a changé radicalement de forme, tout en conservant en mémoire les acquisitions antérieures :
Ces cas correspondent, en fait, à chaque changement d’ère géologique. D’un côté la disparition des poissons cuirassés, des Graptolites, des Brachiopodes, du grand Pteridophytas… , à la transition Paleozoïque-Mezozoïque ; des Dinosaures, Ammonoides… à celle du Mezozoique-Kainozoïque, des grands Mammifères à la transition du Kenozoïque-Quaternaire, et de l’autre côté, l’apparition de nouveaux taxons comme les Reptiles à la transition Paleozoïque-Mezozoïque, des Mammifères et des Angiospermes à la transition Mezozoïque-Kainozoïque, les Primates à la transition Kainozoique-Quaternaire. En bref, les limites des ères qui furent déterminées empiriquement, représentent en fait le moment où le champ magnétique est passé par zéro [Rousseau, 2005].
28Le magnétisme ne concerne pas seulement des événements géologiques ou climatiques passés. Il agit à chaque instant sur la croissance et le déplacement de tous les êtres vivants.
29Le mouvement de croissance verticale qui caractérise de nombreuses formes de vie [25] sur Terre peut se réduire à une tension entre le centre de la planète (le pôle Nord de ma boussole) et le centre de l’univers (le pôle Sud). Une coquille de noix, d’escargot, de coquillage ou d’œuf, un crâne ou une carapace de tortue constituent à des échelles de taille et de rythme variés, des circuits clos de l’énergie [26]. On retrouve les mêmes modes d’organisation au niveau du corps social (banc, troupeau, essaim), et de son déplacement dans l’espace. Des études [27] réalisées sur les baleines, les tortues, les dauphins, les fourmis, les hirondelles ou les pigeons montrent combien les animaux migrateurs profitent avec opportunisme des ressources offertes par ces axes en termes de motricité, de nourriture, de rencontres ou de plaisir.
30Et l’homme ? Dès 1960, l’observation de la baguette d’un sourcier pousse Yves Rocard [28], à reconnaître l’existence du phénomène et à envisager celle d’organes sensoriels magnétiques [29]. En 1983, un biologiste de Manchester R. R. Baker [1983] découvrit que l’arcade sourcilière humaine contenait des petits cristaux de magnétite.Il semble donc que le corps humain soit aussi naturellement [30] apte à percevoir les variations du champ magnétique ambiant qu’un autre mammifère évolué, comme le dauphin, ou la baleine. Selon Lawlor [Lawlor, 1991], les Aborigènes australiens affirment suivre leurs song lines comme des “tubes d’énergie” et prétendent que les Européens n’ont perdu cette capacité qu’en inventant le compas [31], ce qui revient à « externaliser » la sensibilité magnétique.
Le géomagnétisme : un facteur essentiel de localisation

médio - atlantique
Cholula
Tenochtitlan
Palenque Santa Martha
Santarem Koush
Teotihuca Mojos
Le géomagnétisme : un facteur essentiel de localisation
La circulation magnétique sur terre
31L’hypothèse n’est guère flatteuse pour notre civilisation. Elle transforme la découverte de l’objet en une perte de l’être et nous invite, pour flairer la pisted’éventuels champs magnétiques, à nous retourner et à suivre la part considérée comme la moins développée de l’humanité, voire de formes de vie encore plus ouvertement méprisées comme les végétaux, les animaux et les minéraux. Cette piste existe-t-elle seulement ? Peut-on identifier, en l’état actuel de la cartographie, des axes de circulation de l’énergie et de la matière sur et dans la Terre ?
32La superposition des cartes de la déclinaison et de l’inclinaison magnétique révèle l’existence de couloirs de circulation énergétique relativement stables séparés par des zones de circulation plus lente voire nulle. La terre fonctionnant comme un dipôle, la circulation la plus rapide se situe le long du Méridien magnétique, où elle n’est freinée par aucune déclinaison, vers l’Ouest ou l’Est. À l’inverse, elle est minimale le long de l’Équateur magnétique, là où les attractions respectives des pôles Nord et Sud s’équilibrent. Le tracé du méridien magnétique (déclinaison comprise entre 0 et 5°) entre les pôles forme, en longeant l’axe des montagnes les plus jeunes du globe, un chapelet de lieux reconnus par différentes civilisations pour leur centralité et pour leur dynamisme. Ces sociétés présentent des similitudes culturelles telles que Philippe Descola n’hésite pas à les regrouper sous le terme « d’analogiques ». Les Andes, la Méso-Amérique, le Japon, la Sibérie, le Tibet, l’Himalaya, la Mésopotamie et le Nil, l’Italie, la Grèce et la Scandinavie partagent le privilège d’être des « hauts lieux » au triple point de vue « naturel » (conditions topographiques et climatiques), « culturel » (temples, villes, cultures, habitat dense) et « énergétique » (circulation rapide de l’énergie, horizontalement ou verticalement).
33L’itinéraire du méridien magnétique se superpose exactement à ce que certains, dans la culture Maya appellent les couloirs énergétiques [32].
34Tout porte à croire que ces lieux possèdent une « valeur » ou un « rythme » particuliers qu’ils héritent de leur position dans le circuit énergétique terrestre. Il semble d’autre part que de nombreuses sociétés aient rencontré dans ces lieux un bénéfice suffisant pour affronter l’ensemble de ce que la géographie traditionnelle envisage comme des « handicaps naturels » (la pente, la sécheresse, les volcans). On peut s’interroger sur la nature de tels bénéfices ainsi que sur celle du lien que ces sociétés « analogiques », et parmi elles celles dites aujourd’hui « amérin-diennes » entretinrent et entretiennent toujours avec ces axes de circulation énergétiques.
Du géomagnétisme à la géopolitique : Le Tawantinsuyu, au cœur magnétique du monde
35Puisque l’on nous promet bientôt de luxueuses vacances dans l’espace et que je peux dès aujourd’hui « zoomer » sur Google earth pour me les offrir, descendonsen piqué de la Magnétopause vers la Troposphère en suivant le canal défini par l’intersection entre le méridien et l’équateur magnétiques, entre les quatre grands circuits énergétiques de la Terre. La Terre se rapproche d’autant plus vite qu’elle est, le long du grand couloir méridien, comme plissée [33] à notre rencontre. Au 13° degré sud par rapport à l’Équateur géographique, la cordillère des Andes forme deux bourrelets orientés parallèlement au méridien magnétique (NNO-SSE). Le Nevado Salcantay (13,20, 72,33) culmine à 6246 mètres.
36En nous rapprochant du sol, ce qui apparaissait comme une lande sèche déchirée par des glaciers inaccessibles se révèle profondément humanisé. Les pentes des montagnes sont couvertes de terrasses cultivées dont le dessin, parfois géométrique, parfois sinueux, trace sur le sol des motifs identifiables.
37Ne nous laissons pas éblouir par ce spectacle et reprenons contact avec le sol et notre problématique. Quel lien pouvons-nous établir entre l’organisation de l’espace Inca, tel qu’il apparaît sous nos yeux et sa situation magnétique ?
La fondation de l’Empire Inca : un geste de sourcier
38La vallée de l’Urubamba n’a pas attendu le quatorzième siècle et l’expansion Inca pour tisser le paysage qui se referme à présent sur nous, dans les effets conjugués de la soroche (le mal des montagnes) et de la coca. L’agriculture est attestée depuis au moins huit mille ans [34] et les villes se sont succédé depuis au moins deux mille ans dans la région. L’Empire Inca naît, en 1438, de l’ambition de l’Inca Pachacutec, le « réformateur » ou « le révolutionnaire », de fournir au monde une centralité incontestable : Cuzco. À mi-distance entre le pôle Nord et le pôle Sud, cette centralité s’enracine dans la pulsation magnétique du globe. C’est sur ce rythme que l’Empire Inca fonde son origine, son fonctionnement et ses limites. L’Inca Garcilaso, après Pedro Ciezas de Leon, décrit la fondation de Cuzco de la façon suivante :
Avec cet ordre, le Soleil notre père mit ces deux enfants près du lac Titicaca qui est à quatre vingt dix lieues d’ici, et leur dit de s’en aller où bon leur semblerait, et que partout où ils s’arrêteraient pour manger ou dormir ils essayassent de ficher en terre une verge d’or d’une demie vara [35] de long et deux doigts de grosseur ; il leur signala que là où cette verge s’enfoncerait dans le sol, d’un seul coup qu’ils lui donneraient, là même le Soleil notre père voulait qu’ils s’arrêtassent pour qu’ils s’y établissent et tenir cour. (…) Le premier lieu où ils s’arrêtèrent dans cette vallée, continua l’Inca, fut sur la colline appelée Huanacauri, qui regarde cette ville du côté du midi. Là, l’homme essaya de ficher en terre la barre d’or, qui s’enfonça si facilement du premier coup que jamais plus ils ne la virent. Notre Inca dit alors à sa sœur et femme : c’est sur cette vallée que le Soleil, notre père, veut que nous nous arrêtions [Garcilaso de la Vega, 2000, p. 118].
40C’est un geste de laboureur qui fonda Rome. Un geste de magnétiseur établit Cuzco dans ce qui topographiquement est une fondrière [36]. Armé d’une baguette en or, Manco Capac situe sa ville à l’intersection de deux axes. Le premier est parallèle au sol, selon une orientation Sud-Est-Nord-Ouest et relie la ville au lac Titicaca et au-delà, le pôle Sud au Nord. Le second est vertical, et place Cuzco, le nombril, entre le centre de la Terre et celui de l’Univers. Trois mondes sont alignés.
41Au-delà de la légende, la préoccupation géomagnétique inca est attestée par l’invention, l’orientation de la pierre d’angle de tout l’édifice [Machicado Figueroa, 2002] : l’outil cosmographique et architectural de la Chacana [37], ou croix andine. La croix andine est utilisée comme pierre d’angle, comme appui au levier et comme table de la loi. Elle façonne les briques et scande la loi [38]. Elle fournit à tout l’Empire son orientation étalon.
42Pachacutec, le « Réformateur », le « Révolutionnaire » ou « Celui qui fait tourner le Monde », porte en son nom l’annonce des catastrophes et des tremblements de terre qui accompagnent les grandes révolutions. La sienne compte parmi les plus radicales. C’est une révolte contre le père, le vieil Inca Viracocha, paniqué par l’invasion des Chancas dont il a cru lire la victoire dans les étoiles. C’est, du coup, une révolte contre le sens de l’histoire qui transforme un petit royaume, vassal orphelin de la solaire Tihuanaco et menacé par les Chancas (eux-mêmes héritiers de la sombre puissance littorale de Huari), en bâtisseurs d’un monde uni. Comme la Renaissance européenne sur les textes grecs et latins, le « Réformateur », s’appuie, pour légitimer sa lutte contre son père, sur une relecture des principes astronomiques et mathématiques de l’ordre ancien, ceux de la mythique Tihuanaco.
43Il s’agit, enfin, d’une révolte contre l’ordre cosmique. À l’heure où Copernic [39]peine, en Europe, à installer le Soleil sur le trône de la terre, Pachacutec l’en chasse pour installer une puissance théorique : Viracocha. Le centre du monde n’est plus occupé par le soleil qui tourne lui-même, avec tout son système, autour du centre de l’Univers. Cuzco, le « nombril » est, sur Terre, le centre du dispositif. Il obéit aux mêmes règles que l’ensemble et lui fournit un modèle. Comme d’autres villes andines, et comme les cathédrales gothiques, Cuzco hérite une partie de sa beauté et de son mystère de cette dynamique verticale proche de la lévitation, qui lui permet de projeter les pierres les plus lourdes aux altitudes les plus incroyables.
44La vallée sacrée des Incas, de Cuzco au Machu Pichu, et à plus petite échelle, de Tihuanaco à Quito connaît, à partir de Pachacutec, un aménagement planifié qui tend à en faire la partie matérielle, terrestre, d’un cercle dont la dimension céleste est fournie par la Voie Lactée.
La congruence des formes spatiales
45Grâce à l’alignement de la Chacana sur le Méridien magnétique, l’Inca avait les moyens de construire à des échelles infinies un objet dont la cohérence évoque celle des fractales. On peut la retrouver aux différentes dimensions de l’objet géographique.
• Le point
Ollantaytambo, entre Voie Lactée et Voie Sacrée

Ollantaytambo, entre Voie Lactée et Voie Sacrée
46Chaque ville de la vallée est construite à l’image de la constellation dont il célèbre, chaque année, le cycle. Ollantaytambo, est la ville du lama, la Yacana [40]. Le matin du 21 juin, le soleil allume, au centre du temple du soleil, « l’œil du lama », selon une mécanique aussi précise que celle qui opère à Chartres. Toute la ville constitue l’enluminure merveilleuse d’un gradient précis d’une horloge qui met en association, chaque jour, un trou de la voie lactée [41] avec un lieu de la vallée.
47À Cuzco, le palais central, le Qoricancha est orienté [42] au Nord-Est et s’articule sur la Chacana. À partir du Qoricancha, tous les points cardinaux sont rejoints par 41 lignes imaginaires (quatre fois dix plus une verticale au centre) qui permettent de relier l’Univers tout entier. À partir de ce point central couvert d’or, l’axe principal Nord-Ouest Sud-Est, aligné sur le méridien magnétique, fixe l’axe fondateur de la ville. Le site historique de Huanacauri, au Sud-Est, est ainsi réuni par le Qoricancha à la future forteresse de Sacsayhuaman que construira Yupanqui. Ensemble, ils forment la « ville Lion » décrite par les chroniqueurs, dont la colonne vertébrale est parcourue par le Méridien magnétique. Elle est partagée par cet axe majeur en une ville haute (Hanan) et une ville basse (Urin). Chacune étant à son tour partagée en deux, il en résulte un plan divisé en quatre quartiers principaux.
48Au-delà des limites de la ville, la vallée entière de Cuzco est découpée, selon les mêmes axes, en quarante et un districts d’irrigation (quatre fois dix plus un pour le centre, la ville de Cuzco) : les Ceques, chargés de l’approvisionnement en eau et de la production agricole [Zuidema, 1986].
• Le trait
49Les sentiers Incas, comme d’autres sentiers amérindiens, sont les vecteurs de la centralité et un véhicule énergétique.
50L’absence de roues et donc de routes chez les Amérindiens a longtemps fait apparaître leurs sentiers dans les rubriques les plus rudimentaires des modes de transport. En Amérique, les sentiers indiens étaient les vecteurs de la fuite, de la sédition et de la révolte. Leur accés fut fermé, chaque fois qu’on le pût et leur entretien interdit [43]. La stabilité, jusqu’à nos jours, des Asanda du Rupununi des SaqbeMaya ou des peabirus brésiliens [Budweig, 2000] prouve pourtant la solidité de leur construction [44].
51Les sentiers Incas comptent parmi les plus belles réussites du génie civil amérindien. Ils permettent, le plus souvent, le passage de la civière de l’Inca, et de nombreux tronçons sont éclairés la nuit par des torches. Tous les 20 ou 21 kilomètres, un relai est aménagé où hommes et bêtes peuvent se restaurer. De ces tambos ou tampupartent des voies secondaires transversales qui permettent, en empruntant les vallées principales, de relier deux à deux les villes de la montagne et celles de la plaine. Les huit mille kilomètres du réseau Inca se divisent en deux segments équivalents de quatre mille kilomètres, l’un empruntant la montagne et l’autre longeant la côte. Les deux se croisant à Cuzco et à leurs extrémités (Quito et Potosi) forment un huit gigantesque de huit mille kilomètres, divisés par l’altitude et par la latitude en quatre tronçons sensiblement égaux.
52L’ensemble du réseau constitue une structure extrêmement cohérente que font vibrer, à leurs rythmes, différents types de démarches pédestres. Les Chasquis transmettent les informations du centre à la périphérie. Les pèlerins trouvent dans cet exercice leur principale initiation. Les victimes des sacrifices, les coureurs de la course sacrée de fin de saison des pluies, les momies portées en grand cortège par leurs familles, l’Inca, lui-même, font circuler dans les artères et les veines de ce corps géant son bien le plus précieux, le sang [Zuidema, 2003]. La circulation au sein du Tawantinsuyu est organisée comme dans le corps de l’Homme ou dans celui de la Terre.
• La surface, le volume ?
53La forme globale du Tawantinsuyu [45], qu’on l’observe dans l’espace ou dans le temps contribue à donner une autre dimension à cette construction magnétique.
54L’Empire Inca présente deux types de frontières. Les limites extérieures sont contingentes et dépendent du point d’intersection occupé par l’année 1531, entre les dynamiques territoriales de l’Inca et celles de la couronne espagnole. Les limites intérieures, individualisant les quatre régions principales sont nécessaires et forment une croix dont les branches s’appuient sur le Méridien et sur l’Équateur magnétiques et se coupent à Cuzco.
55Cette forme ultime du Tawantinsuyu, telle que la figea l’invasion espagnole (voir croquis), ne peut se concevoir qu’en adéquation avec cette intersection magnétique. Le partage en quatre provinces inégales, (absurde à ce niveau) repose sur sa capacité géomagnétique à embrasser le Monde.
56Paradoxalement, les limites temporelles de la construction apparaissent plus fixes, et, du coup, plus éclairantes de la notion de forme dont on cherche à souligner la dimension magnétique. À toutes les échelles, elles se calent sur les mêmes axes qui dirigent son découpage régional.
57Comme chez les Mayas, l’histoire du monde est divisée en quatre soleils [46] dont l’Inca Viracocha, le père de Pachacutec, aurait prophétisé la fin [Sullivan 2000]. L’effondrement de l’Empire, ressemble à sa création comme un jumeau à son frère. Une nouvelle fois, l’ennemi arrive du Nord-Est et rencontre un monde Inca divisé. Huascar combat Atahualpa, comme autrefois, le fils s’est opposé au père. Lemouvement cyclique de reflux, provoquant le retour des morts, des Chancas ou des Espagnols est perçu avec le même fatalisme qu’un retournement magnétique.
Le Tawantinsuyu : une structure magnétique ?

Le Tawantinsuyu : une structure magnétique ?
58Que reste-t-il aujourd’hui de la centralité magnétique de Cuzco ?
Les varayoq (autorités traditionnelles) et autres représentants des communautés indiennes de la Vallée sacrée des Incas, le Mouvement indien péruvien conjointement avec la délégation du Pérou à la Rencontre des Mouvements indiens de toutes les régions du globe, réuni à, Ollantaytambo, capitale mondiale de l’indianité de droit, nous nous adressons aux peuples du monde [47].
60Dans cette déclaration officielle de 1980, les autorités culturelles traditionnelles Inca, les Varayoq affirment d’une part leur existence, ainsi que celle de l’ « Indien », dont ils font un synonyme d’ « indigène ». Cette universalisation de « l’indianité » leur permet de proposer leur ville comme centre d’un monde amérindien subitement globalisé. Les limites de cette indianité mondiale sont fournies par la connaissance et l’obéissance de ses membres des lois naturelles et en particulier du géomagnétisme, la première et la dernière de toutes.
61Affirmer la dimension géomagnétique de cette centralité ne revient pas à proposer un nouveau déterminisme aux études andines, après le règne de la « verticalité » [48]. L’originalité et la brièveté de l’entreprise Inca, dans l’Histoire et la géographie andine souligne bien que les modes d’investissement d’un carrefour magnétique, fut-il aussi important que celui de Cuzco, sont infinis. De même, si les grandes civilisations semblent souvent avoir cherché à se rapprocher du méridien magnétique, de brillantes constructions en sont aussi fort éloignées.
62Il semble pourtant incontestable que la géographie peut tirer parti de la prise en compte d’une donnée physique longtemps négligée et reconnaître, une fois n’est pas coutume, l’avance scientifique de cultures longtemps considérées comme « primitives ».
Notes
-
[*]
Maître de Conférence à l’Université Paris X Nanterre – Laboratoire Gecko.
-
[1]
« Un jour, des millions d’hommes quitteront l’hémisphère sud pour aller dans l’hémisphère nord. Et ils n’iront pas là-bas en tant qu’amis. Parce qu’ils iront là-bas pour le conquérir. Et ils le conquerront en le peuplant avec leurs fils. C’est le ventre de nos femmes qui nous donnera la victoire ». (1974, Houari Boumediène dans un discours à l’ONU).
-
[2]
Dans les sociétés dites « occidentales » ou « Nords » ainsi que dans toute la partie des « Suds » intégrée à ce qu’on appelle « la mondialisation », le Nord est apparenté à la richesse, à la raison (alors qu’on « passe à l’Ouest » pour rencontrer la folie) à l’ordre, à la loi, au Père, à la Terre à la distanciation de la carte. Le Sud, à l’inverse fonde son attractivité sur les idées de vacances, de soleil, de dénuement plus que de pauvreté, de plaisir, de retour à la mère, à la mer, de fusion avec le réel, de sens du rythme, de pulsion plus que de raison.
-
[3]
Puisque, à première vue, seul le libre arbitre humain permet d’échapper à son implacable déterminisme.
-
[4]
L’annonce de leur imminente disparition a longtemps scandé la description des sociétés amérindiennes et des autres sociétés traditionnelles [Held, 1988].
-
[5]
« Dans la région de Cuzco, saisie par un néo-incaïsme de type New Age, les communautés traditionnelles se voient peu à peu impliquées, plus ou moins à leur insu, dans des ensembles “ethniques” dont elles ignorent les limites, celles-ci étant tracées sur Internet par des agents externes jusqu’aux confins d’une indianité pan-américaine sur laquelle il faut apprendre à surfer » [Molinié, 2006].
-
[6]
La pensée analogique reposerait, selon lui sur une irréductible altérité des êtres et des choses tant sur le plan de l’intériorité que sur celui de la physicalité.
-
[7]
La pensée « animiste » pour Descola, affirme une identité d’intériorité, et une différence sur le plan de la physicalité.
-
[8]
Au Brésil, seul 0,22 % de la population est reconnu comme « amérindienne », (ce qui plombe lourdement le mythe de la triple origine du peuple brésilien). En Bolivie, les statistiques officielles hésitent entre 50 et 70 % de la population nationale.
-
[9]
Voir, par exemple, Menchu [1987], Cognat [1987 et 1990], Purinquichu [1994], Galvez Borrell [1997], Machicado Figueroa [2002], Kopenawa [2003], Barrios [2004], Elorrieta Salazar [2003].
-
[10]
« L’utilisation des ressources alimentaires, par le biais de la Nature et de la Culture, aboutit à une diversité remarquable de l’habitat que constituent les forêts tropicales – une diversité maintenue notamment par les accès limités aux “forêts sacrées”, qui sont des refuges où la faune peut se reproduire » [Hladik, 1996, p. 35].
-
[11]
Les galeries karstiques du Yucatan, connues par les Maya sous le nom de cenotes dessinent une géographie sacrée reliant point par point les accés à l’inframonde et au nôtre.
-
[12]
Dans la mythologie métisse du Brésil, la Cuca est la sorcière à tête de Crocodile qui vit dans une grotte et touille le hideux contenu de son chaudron (Monteiro Lobato).
-
[13]
Les rayonnages des librairies ésotériques ploient sous les prédictions amérindiennes : Prophétie des Andes ou Chilam Balam, guide de survie Hopi ou prédiction astrologiques de l’Inca Viracocha. L’Apocalypse scande les histoires amérindiennes, de disparition en disparition jusqu’à celle que l’Europe lui imposa durant toute la période de ce que les Maya nomment le Bolon Tiku, les neuf fois cinquante deux ans qui construisent l’inframonde [Sharer, 1994 ; Barrios, 2005].
-
[14]
La référence directe au géomagnétisme est rare et relève plutôt de la réappropriation de type « New age » des savoirs traditionnels [Arguiles, 1996, p. 188].
-
[15]
Le Machu Pichu est un de ces lieux réputés pour sa « charge énergétique », liée à l’opposition des sommets jumeaux (Huayna et Machu Pichu) autour du pivot du mont Putucusi [Elorietta Salazar, 2003].
-
[16]
Dans l’état de Oaxaca de population fortement Zapothèque et Miztèques, on vénère le Santo Emanresponsable de toutes les attractions physiques et sentimentales.
-
[17]
Le terme Maya est Bacab.
-
[18]
L’actuelle localisation des quatre dieux cardinaux est décrite comme postérieure au dernier « déluge ».
-
[19]
« Dans l’ensemble, si varié, des sciences géophysiques, le champ magnétique terrestre tient une grande place, tant par son importance propre que par les relations qu’il présente avec beaucoup de phénomènes physiques du globe, intérieur et extérieur, et du Soleil. Pourtant, ce géant est presque ignoré du public cultivé qui ne connaît de lui et, encore, assez mal, que son action directrice sur la boussole ; ce manque de considération va d’ailleurs jusqu’aux physiciens du magnétisme eux-mêmes, qui ne lui accordent le plus souvent qu’une place de pauvre dans leurs cours ou dans leurs traités. Ainsi, c’est dans un monde presque inconnu qu’il faut guider le lecteur, sur des voies nombreuses dont certaines sont mal dégagées encore – et après tout c’est heureux – mais dont la plupart sont faciles et largement ouvertes sur de vastes panoramas » [Goguel, 1971, p. 235].
-
[20]
Cartes de 1965 : carte allégée de l’inclinaison magnétique I sur le globe, à l’époque 1965,0 (d’après la carte publiée par l’U. S. Naval Hydrographic Office. « Annu. du Bur. des long. », 1968), citée dans Goguel [1971] ou Thellier [2004], actualisation de 2005 disponible, par exemple, sur http://www.ngdc.noaa.gov/seg/ WMM/data/wmm-D05.pdf.
-
[21]
« le champ magnétique terrestre, sensiblement dipolaire, est déformé par le vent solaire, comprimé sur le côté jour et étiré du côté nuit » [Thellier, 2004].
-
[22]
Doutant de l’existence de « plaques lithologiques », Rousseau nous invite à penser à des plaques de 3000 km d’épaisseur, taillées dans l’épaisseur du manteau et mues, essentiellement par les forces de Coriolis.
-
[23]
Bien que l’hypothèse de Rousseau renouvelle sérieusement celle de la « tectonique des plaques », elle ne remet pas en question, au contraire, l’existence de phases d’ouverture et de fermeture continentale, comme une respiration tectonique.
-
[24]
« Il y a trente mille ans, le champ magnétique terrestre était l’opposé du champ actuel » [Levy, 2000, p. 114].
-
[25]
Le grain de maïs, par exemple, est polarisé. De son pôle Sud va sortir un germe qui va s’enfoncer dans le sol pour y établir des racines, du Nord surgira une tige qui s’élèvera vers le ciel.
-
[26]
Toutes ces « coquilles » sont reconnues, dans de nombreuses sociétés traditionnelles, comme des représentations naturelles du monde, des petits globes « autogéographiques ». Sur la géographie de la carapace de tortue, voir Lezy [2005].
-
[27]
Deux biologistes américains, Gould [1981] et Kirschvink [1992], mirent en évidence l’existence de petits cristaux de magnétite et de silicium dans le cerveau et le cou des pigeons, dans la tête des baleines, des orques, des dauphins, sur le ventre des abeilles et de la plupart des insectes [Rocard, 1991].
-
[28]
Directeur du laboratoire de physique de l’École normale supérieure et « père de la bombe atomique française ».
-
[29]
« Concentrée en des zones ponctuelles, situées deux par deux au même niveau du corps, à droite et à gauche, à savoir les arcades sourcilières, l’arrière du crâne où les attaches cartilagineuses du cou maintiennent la tête, les extrémités hautes des deux muscles lombaires attachés au squelette (vers les omoplates), le creux des coudes, le creux des genoux, les talons, enfin l’articulation au pied de chacun des deux gros orteils » [Rocard, 1991].
-
[30]
Le sang est sans doute le vecteur le plus sensible du magnétisme dans le corps humain. Dans le sang, les molécules de fer s’alignent lors d’un passage dans un champ magnétique. Les sociétés traditionnelles reconnaissent souvent au sang la capacité de « vibrer » au rythme de la Terre [Lawler, 1991, p. 103]. Chez les Incas, les Mayas comme chez les Aborigènes, les offrandes de sang, les menstruations donnent aussi à lire les orientations énergétiques, à l’échelle du corps ou à celle du territoire.
-
[31]
En Chine, la première mention avérée de la boussole se situe au Xe siècle de notre ère. En Occident : Alexander Neckam vers 1190.
-
[32]
Dans Ch’umilal Wuj, el libro del destino, de Carlos Barrios (Huéhuétenango) don Isidro un ancien, indique le « chemin de l’énergie », à partir du Tibet : « De là, viendront et d’ici sortiront les énergies passant par cette série de montagnes, il suivait du doigt le chemin qui passait par la Chine, montait par la partie orientale de l’ancienne Union soviétique et se dirigea vers l’Alaska. De là, il descendit son doigt par les Montagnes Rocheuses du Pacifique Nord Américain, descendit vers le Mexique, continua vers le Guatémala et le reste de l’Amérique centrale jusqu’à s’arrêter au Panama. C’est là qu’ils firent leur tranchée, dit-il, là qu’ils coupèrent la Terre-Mère, et c’est à cause de cela que l’énergie ne peut plus continuer et qu’elle rebrousse chemin, à présent » [Barrios, 2004, p. 82-83].
-
[33]
Les Andes résultent, sur le plan géologique d’un jaillissement d’une brutalité inouïe qui, en 250 millions d’années, a propulsé à plus de 6 000 mètres d’altitude des jades ou des serpentines formées à plus de 6 000 mètres de profondeur.
-
[34]
Mazoyer et Roudart [2002, p. 114].
-
[35]
835 mm et 9 dixièmes.
-
[36]
Cuzco est aujourd’hui une ville de 255 300 habitants, perchée à 3 400 m quasiment dans le vide, puisque ses fondations s’enfoncent dans un marécage.
-
[37]
La polysémie du terme participe de sa richesse. Il dérive peut-être de la combinaison des termeschaka qui signifie union des points (la croix) et hanan, qui signifie noble haut ou du terme chakana, l’escalier.
-
[38]
« Ama llulla, ama sua, ama k’ella » : « ne jamais mentir, ne jamais voler, ne jamais paresser ».
-
[39]
Nicolas Copernic (1473-1543).
-
[40]
Patrice Lecoq retrouve la même correspondance entre la forme de la ville et la constellation du Lama à Choquek’iraw [Lecoq, 2006].
-
[41]
Comme les Aborigènes australiens, les Incas identifient leurs constellations non en reliant les étoiles les plus remarquables, les pleins, mais en nommant les espaces les plus sombres de la voie lactée.
-
[42]
Les premiers aménagements sont l’œuvre de Pachacutec (1438-1471) qui y consacra plus de vingt ans et cinquante mille hommes. Son successeur Yupanqui (1471-1493) poursuivit son œuvre.
-
[43]
Le 15 juin 1533, le gouverneur général du Brésil, Tomé de Souza, interdit l’utilisation des peabirussous peine de mort.
-
[44]
Les Asanda du Guyana sont alignées sur les constellations [Roth, 1924 ; Whitehead, 2002], de même que les Saqbe Maya : « tenian conocimiento de la latitud. Los Mayas eran grandes viajeros, en especial viajaban hacia el sur sin instrumento alguno. Les bastaba corroborar el paso del sol por el cenit. Esta técnica les permitia saber en que ciudades se efectuaba este fenoméno el mismo día y así determinar su posición, hecho que comprobaban con el trazo de caminos de Este a Oeste. A este caminos les llamaron Saqb’e, Camino Blanco, mismo nombre con que se designa a laVía Láctea » [Barrios, 2004 p. 40].
-
[45]
Le nom signifie, littéralement « l’empire des quatre soleils » (Tawa=quatre Inti= Soleil Suyu= Lieu). Il est partagé en quatre « soleil » ou « région » : Chinchaysuyu, Kuntisuyu, Antisuyu et Qollasuyu [Pärssinen, 1992].
-
[46]
L’année est aussi divisée en quatre par le Khapaj Raymi (21-25 décembre-solstice d’été), le Pawkar Raymi (21 mars-équinoxe d’automne), l’Inti Raymi (21 juin- solstice d’hiver) et le Q’oya Raymi(21 septembre, équinoxe du printemps).
-
[47]
« Déclaration de Ollantaytambo à tous les peuples du monde » [Métraux, 1980, p. 178 et suiv.].
-
[48]
John Murra donne le premier un nom à ce particularisme andin : « l’archipel vertical » ou « verticalité » (1960-65-1975). « Les ressources naturelles sont distribuées le long d’un gradient longitudinal et l’occupation de cet espace vertical par des populations humaines a été perçu par Murra et par les chercheurs qui ont suivi, comme une réponse adaptative aux contraintes spécifiques de l’environnement » [Lussier, 1997].