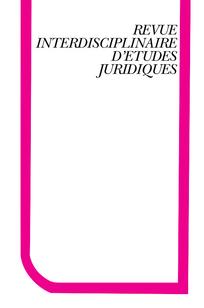Introduction
1Le terme de gouvernance est à la mode. Et pourquoi s’en étonner ? La gouvernance désigne un concept commode. Une idée descriptive de la réalité, mais aussi un idéal normatif associé à la transparence, à l’éthique, à l’efficacité de l’action publique. La gouvernance devient dès lors un mot-talisman paré de tous les fantasmes associés à l’action publique, tout en revêtant le vocabulaire rassurant de l’objectivité technique. Le mot « gouvernance » fait sérieux tout en promettant des lendemains qui chantent aux théoriciens de l’action publique. Ce faisant, le discours de la gouvernance fait l’objet d’une double confusion. La première tient aux vertus qui lui sont associées, la seconde aux défauts qui lui sont imputés.
2D’une part, la gouvernance est associée à tout et n’importe quoi. La gouvernance recouvre à la fois l’éthique en politique, le contrôle des représentants politiques, la réforme des institutions internationales, les accords public-privé, la réforme du management des entreprises publiques, etc. Le terme de « bonne gouvernance » – ou ailleurs, de « goed bestuur » – désigne une pierre philosophale miraculeusement plastique sur laquelle peuvent se plaquer les idéaux les plus contradictoires.
3D’autre part, les critiques du discours de la gouvernance souffrent également de l’inflation du concept. La gouvernance devient une sorte de bibendum sur lequel se projettent toutes les critiques possibles du « système » – quelle que soit la nature du système en question. Elle est le symbole de l’anti-étatisme néo-libéral – « plus de gouvernement, mais de la gouvernance » –, d’une pensée managériale insidieuse, du capitalisme techniciste.
4Certaines de ces critiques ne sont pas sans fondement, et il est vrai que la gouvernance représente davantage une manière de penser l’action publique qu’un dispositif précis. Nous voulions néanmoins consacrer ces quelques pages à approcher les conditions d’émergence du concept et ses caractéristiques générales. La première partie de cette courte analyse décrira les raisons pour lesquelles la gouvernance est apparue comme une idée nécessaire pour répondre aux insuffisances de la théorie moderne de l’État. La seconde partie de cette analyse définira quant à elle la gouvernance comme une technique de gestion sociale visant à produire des règles collectives à partir de l’orientation des conduites des acteurs plutôt que par des normes commandant et sanctionnant directement leurs comporte-ments. Nous terminerons cette note en suggérant le rapport qu’entretiennent les concepts de gouvernance et de transparence, dont un examen plus approfondi pourra faire l’objet d’un prochain texte. Les pages qui suivent se donnent donc une fonction bien modeste. Elles visent seulement, avant tout commentaire normatif ou politique, à clarifier le concept de gouvernance.
1 – Les transformations de l’État moderne
5La légitimité de l’État moderne repose sur la théorie de la volonté générale et l’idée qu’il est possible d’atteindre rationnellement le bien commun. L’État tire, d’une part, son titre à gouverner de l’expression de la souveraineté du peuple. De l’autre, il agit pour le compte du peuple lorsque ses décisions reflètent l’intérêt général, qui est rationnel.
6Il ne s’agit pas ici de retracer l’ensemble du débat complexe portant sur les rapports entre démocratie et État de droit [2]. Soulignons néanmoins que, si c’est l’octroi de droits fondamentaux qui permet aux citoyens de se concevoir comme étant à la fois égaux et autonomes politiquement, ce sont bien la représentation parlemen-taire, ainsi que la primauté du législatif sur les autres pouvoirs, qui permettent d’allier conceptuellement les principes de rationalité et de volonté générale. Malgré la dimension aristocratique de sélection des élites qu’il revêt historiquement [3], le parlement est en effet le lieu où la souveraineté du peuple s’exerce de manière déléguée.
7Dans ce cadre, l’État parlementaire est aussi un État « législateur parlementaire », c’est-à-dire un espace de discussion et de décision politique dont la caractéristique réside en ce qu’une instance, le « Parlement » ou le corps législatif, élabore des normes « impersonnelles, générales, déterminées d’avance, et pensées pour la durée » [4]. Pour la modernité politique, le droit permet d’articuler le lien politique sur la reconnaissance des subjectivités individuelles plutôt que sur un principe extérieur transcendant. La loi confirme par sa forme conventionnelle que les individus acceptent de constituer une communauté politique spécifique [5]. Cette forme est supposée assurer que les règles de vie en commun résultent d’un accord collectif. La loi, de par son caractère général et abstrait, maintient les citoyens égaux devant le pouvoir. Enfin, l’obligation collective de se soumettre à la loi repose sur un principe moral et méthodologique de rationalité du législateur.
8Comme le souligne la fameuse maxime positiviste, le droit, c’est l’État ; et la norme juridique s’assimile à la loi [6]. La rationalité du droit s’exprime prioritairement dans la structure de la loi et les sources dont elle procède. En retour, la modernité libérale assoit le caractère juridique de ses outils de contrainte sur les instruments de la puissance d’État. La rationalité de la norme est étroitement liée à l’existence d’un corps administratif qui en assure l’application effective. L’évaluation de sa légitimité repose, dans les régimes démocratiques, sur les organes représentatifs de l’État. Il y a donc continuité conceptuelle et pratique entre la suprématie de l’État et le rôle central qui est dévolu à la loi. Conforme à la fois aux prescriptions de la Nature et de la volonté générale, le droit se définit par son formalisme et prend pour modèle la rationalité du discours mathématique [7] ou l’objectivité du discours moral [8].
9L’émergence de l’État social rompt apparemment avec la modernité libérale. L’État social cesse de considérer l’espace public comme un ensemble unifié de subjectivités individuelles, éventuellement médiatisé par l’expression de la société civile. Il se structure autour d’une perception à la fois plus collective et matérialisée du social. Le sujet n’est plus roi, mais la part constituante de différents groupes et classes sociaux. En retour, le peuple n’est plus perçu comme une entité naturellement homogène, mais comme un ensemble parcouru par de tensions et conflits sociaux. Dès lors que les sciences sociales découvrent l’objet « société » comme un ensemble dynamique parcouru de tensions collectives, il devient difficile de définir ce que recouvre la volonté « générale », en quoi la norme représente le peuple dans son intégralité, et ce qui différencie au juste une décision rationnelle de l’agrégat d’intérêts bien compris. Dans ce cadre, le droit devient l’outil des forces sociales travaillant la communauté : un instrument travaillé et utilisé du dehors par les différents groupes et acteurs de l’espace social, et la main qui pétrit ce même espace social [9].
10Toutefois, l’esprit des lois de l’État social conserve l’essentiel des traits de l’État libéral moderne, en ce compris sa quête de rationalité.
11Premièrement, la raison de l’expert maintient intact le crédit de la raison juridique : la rationalité de la loi se justifie désormais par sa dimension technique, la connaissance scientifique qu’elle mobilise, la foi qu’elle entretient sur sa capacité à ordonner le monde social.
12Deuxièmement, l’émergence des mouvements sociaux et d’appareils massifs de mobilisation coexiste plutôt harmonieusement avec le vote individuel et le mandat formel [10]. En effet, la prise de conscience de la dimension collective du social sert une conception organique du rapport entre espace social et espace politique. La société est un corps aux pulsations duquel le gouvernement doit s’identifier. Dans ce cadre, il revient aux partis et aux mouvements d’assurer une représentation enfin réelle, concrète, presque charnelle, du social. À défaut de relation personnelle entre l’électeur et le représentant, le parti doit servir de courroie de transmission entre l’état des opinions publiques et l’espace politique : les représentants affichent leur proximité et leur similarité avec les classes qu’ils prétendent représenter [11]. Or, cette relation de similarité s’exprime particulière-ment bien dans le cadre du système parlementaire, qui y trouve une deuxième source de légitimation : l’élection n’est plus un système de sélection des élites, mais une manière d’offrir un miroir à la société.
13Troisièmement, le schéma linéaire de la loi se maintient : les règles restent générales et abstraites, bien qu’elles se définissent autant à travers leurs objectifs matériels – à savoir l’organisation des systèmes de production et de redistribution de richesses – qu’à travers la consistance interne du système juridique. L’État social poursuit en ce sens l’idéal politique de la modernité dans la manière dont il articule rationalité et prise en compte des préférences des citoyens autour de la figure de la règle juridique.
14Et pourtant : l’idéal-type du régime rationnel légal a progressive-ment été remis en cause au cours de la seconde moitié du vingtième siècle. La figure de l’État semble en crise. Les partis de masse et les mouvements sociaux ne parviennent plus à fédérer. Le fondement épistémologique de la double délégation du pouvoir aux représentants et aux scientifiques – aux « professionnels » donc - se trouve affaibli par l’avènement de nouveaux types de risques économiques, écologiques et sociaux [12]. La complexité actuelle des problèmes collectifs crée chez le citoyen un sentiment d’impuissance. Par ailleurs, elle oblige l’État à intervenir de manière de plus en plus ponctuelle, dans des domaines de plus en plus diversifiés, en faisant intervenir un nombre toujours plus grand de parties et d’intérêts. Comme l’écrit Pierre Rosanvallon, « le temps de la démocratie apparaît ainsi susceptible d’un double déphasage : trop immédiat pour le souci du long terme, trop long pour la question de l’urgence. Dans les deux cas, la pertinence de la volonté générale se trouve interrogée » [13]. Or, l’État éprouve d’autant plus de difficultés à prendre en charge ces contraintes que sa suprématie est contestée sous la double pression de la mondialisation et du localisme [14]. Devant exercer des missions de plus en plus larges, l’État n’apparaît plus que comme un producteur de droit parmi d’autres et ne peut plus imposer par lui-même son caractère indivisible et irrésistible [15].
15Derrière la remise en question du rôle de l’État, c’est par ailleurs l’affaiblissement du modèle moderne du droit qu’il s’agit de souligner, et plus particulièrement les outils qu’il mobilise traditionnellement – la loi, le décret. Pour l’État moderne, le pouvoir doit être exercé sous la forme du droit par des dirigeants juridiquement désignés sur des dirigés juridiquement définis. Qu’il s’agisse de la première modernité formaliste ou qu’il s’agisse de l’État social, une conviction semblait jusqu’alors inébranlable – si on excepte dans une certaine mesure la tradition contractualiste : l’idée que la raison est apte a priori à découvrir les lois du réel présentes dans la nature, dans les rapports sociaux ou dans la subjectivité. Or, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, on assiste à une double déconstruction conceptuelle et pratique de ce présupposé.
16Conceptuellement, le principe d’un cadre cognitif commun apte à organiser stratégiquement la connaissance du social ne parvient plus à s’imposer [16]. L’espace social ne se présente plus comme un bloc compréhensible a priori, dont les battements du cœur puissent être anticipés et identifiés à l’aide de principes transcendants. Un contrôle direct de l’espace social n’est désormais ni possible ni désiré. Pratiquement, l’espace politique doit faire face à la montée de problèmes pour lesquels il n’existe pas de perception commune, et ce, même si la société devait partager un fonds commun de valeurs et de perceptions [17]. L’environnement dans lequel les règles collectives prennent place est perçu comme de plus en plus imprévisible. Les niveaux d’application et de réception de la norme se multiplient et représentent des réalités à la fois plus mouvantes et fragmentées. Caractérisé par la séparation des pouvoirs, la règle de la majorité et le règne des droits, le constitutionnalisme moderne représente par conséquent une manière de gouverner trop détachée des circonstances d’application de la décision publique. L’action de l’État doit s’assouplir, tout en devant paradoxalement s’investir de plus en plus précisément, ponctuellement mais en profondeur, dans l’espace social. L’État est obligé de se muer en animateur et en médiateur, substituant « une action publique co-construite » avec d’autres partenaires [18] à l’exercice du pouvoir suprême de commande. L’État transformant ses missions, il doit aussi repenser les techniques de gouvernement qu’il utilise. La direction des affaires humaines requiert davantage de flexibilité et de compréhension pour les mécanismes d’interaction entre les acteurs [19].
2 – De l’art de gouverner au thème de la « gouvernance »
A – L’émergence du concept
17Petit à petit, le terme de « gouvernance » a commencé à réunir les différents horizons de réflexion sur les transformations de la régulation publique.
18La gouvernance évoque le plus souvent une définition plus flexible de l’exercice du pouvoir, reposant sur une plus grande ouverture du processus de décision, sa décentralisation, la mise en présence simultanée de plusieurs statuts d’acteurs. Touchant à la fois à la direction d’entreprise, au contrôle de l’administration, à la mise sur pied de budgets participatifs ou à la consultation publique urbaine, la gouvernance recouvre aujourd’hui les types d’organisation et les intuitions politiques les plus divers, superposés aux formes plus traditionnelles d’action publique. Définir la gouvernance revient la plupart du temps à s’engager dans un inventaire à la Prévert désignant par exemple « toutes les activités des agents ou de groupes sociaux, politiques, économiques, administratifs, qui contribuent par des efforts ciblés à orienter, guider ou contrôler certains aspects ou certaines dimensions particulières d’un système ou d’une socio-économie » [20]. La gouvernance semble ne traduire aucune sorte de paradigme unifié, sinon une technique de guidance caractérisée par la grande diversité de ses techniques et de ses acteurs [21].
19En réalité, le mot gouvernance fut d’abord utilisé en France, entre le XIIIe siècle et le XIVe siècle, et renvoyait à l’idée de « gouvernement » entendu au sens d’art de gouverner. La gouvernance désignait l’ensemble des techniques permettant de disposer et d’entretenir le bien public. La langue française identifia progressivement cet art de gouverner à l’action administrative de l’État, jusqu’à ce que le mot refasse surface à partir des années septante dans la littérature managériale.
20La good corporate governance permit dans un premier temps de refaçonner la gestion humaine des entreprises. À partir des années septante, le langage du management s’inspire des sciences humaines et considère l’entreprise comme une institution sociale davantage qu’un organisme mécanique. Pour ce nouveau langage du management, les structures tayloriennes centralisées représentent un handicap stratégique [22] : elles négligent à la fois la nécessité d’investir les travailleurs dans un projet collectif assumé comme tel, et l’utilité de se saisir des ressources créatives de chacun pour gérer les problèmes de terrain. L’entreprise doit se concevoir sous un modèle biologique : sa condition de survie est le développement permanent ; ce développement exige à la fois une grande cohérence interne dans l’action et « une mobilité, une fluidité, une flexibilité maximale aux conditions de l’environnement extérieur » [23]. Dans ce but, l’entreprise doit offrir une instance de reconnaissance individuelle et collective au travailleur. Afin de combiner les exigences de cohérence interne et de réactivité décentralisée, elle doit favoriser l’autonomie de ses unités de production sans renoncer à une certaine guidance. Le surcroît de flexibilité doit par ailleurs être encadré par une véritable adhésion de fond aux objectifs et à la culture de l’entreprise, qui repose elle-même sur l’établissement d’une relation de confiance entre les différents membres et cellules de l’entreprise.
21C’est dans un second temps seulement, mais dans le cadre d’un curieux retour aux sources du concept, que les institutions publiques s’inspireront du modèle entrepreneurial. Il s’agit, pour les institutions publiques et politiques, de répondre aux exigences du consommateur et à la méfiance du citoyen vis-à-vis de l’administration. Une littérature abondante tente de rendre compte – mais aussi de mettre en place et de valoriser – d’un mode de direction « moins lourd et plus souple, moins directif et plus participatif, plus diffus et moins technocratique » [24]. Dans ce cadre, la gouvernance vise d’abord à améliorer la gestion des administrations plutôt que de proposer un nouveau mode de gestion démocratique. Cependant, le vocabulaire des institutions monétaires internationales et des agences de développement nord-américaines va progressivement charger la gouvernance d’une mission collective dont elle était dépourvue depuis le XIVe siècle [25]. La gouvernance porte non seulement sur le bon fonctionnement de l’institution mais aussi sur la qualité de l’action de ces institutions dans l’espace social. Elle fait l’objet d’une réflexion spécifique sur la manière de mieux associer les acteurs au processus de décision. Elle se charge en outre de poser les critères du bon fonctionnement de la société, « a predictable, open, and enlightened policymaking (that is, transparent process) ; a bureaucracy imbued with a professional ethos ; an executive arm of government accountable for its actions ; and a strong civil society participating in public affairs ; and all behaving under the rule of law » [26].
22Dans un troisième temps, les partisans de la « bonne gouvernance » associent le terme à l’élaboration de nouvelles techniques de gouvernement et à la substitution de l’action unilatérale de l’État par un mode plus consensuel et pluraliste de formulation de la norme. Ces dernières années ont vu l’émergence d’une large littérature consacrée à la gouvernance urbaine, environnementale ou informatique [27]. S’appuyant sur les théories délibératives ou participatives de la démocratie, la théorie de la gouvernance s’érige aussi à l’occasion comme contre-discours adressé au manque de démocratie et de soutien des droits de l’homme des institutions internationales. À cet égard, la gouvernance n’est pas seulement un terme descriptif, dont le contenu vise à examiner les transformations contemporaines des modes de gouvernement, et qui varie en fonction des acteurs et des contextes institutionnels. Elle propose également un discours normatif entendant soutenir et faire advenir des transformations perçues comme positives parce qu’elles produisent des décisions à la fois plus fonctionnelles et plus démocratiques.
B – La contrainte par la confiance : la confiance par le contexte
23La gouvernance se définit avant tout comme une technique de gestion. Les normes sociales tirent leur valeur des représentations collectives qu’elles reflètent et dont elles sont issues. La loi, de sa fonction médiatrice. La gouvernance, elle, se définit par ses missions. L’usage de la gouvernance ne dépend pas de la position qu’elle occupe dans la hiérarchie des normes, mais du résultat ponctuel qu’elle est susceptible d’obtenir. Elle ne bénéficie « d’aucune rente de position » [28] ni d’aucune autorité symbolique qui parvienne à la faire s’imposer d’elle-même. La règle n’accorde au passé que l’attention que réclame une bonne stratégie. La gouvernance ne se définit pas à partir du type de procédure qu’elle mobilise mais par sa capacité à former une décision. Par exemple, « que la sécurité des citoyens soit assurée et le respect de la loi garanti (État de droit) ; que les organismes publics gèrent de façon correcte et équitable les deniers publics (bonne administration) ; que les dirigeants rendent compte de leurs actions (responsabilité et imputabilité) ; que l’information soit disponible et accessible à tous » [29]. Dans ce cadre, le droit est un moyen parmi d’autres d’organiser la complexité sociale autour d’un certain nombre d’objectifs, qui trouve moins sa justification dans la légitimité de ses formes que « dans la justice, l’efficacité ou dans quelque autre vertu actuelle que possède la décision coercitive » [30]. La sphère juridique perd la capacité d’auto-définition qu’elle estimait classiquement détenir. L’efficience de la norme n’institue plus seulement une réalité sociale : l’impact qu’elle exerce baptise aussi, de l’extérieur, sa propre juridicité [31].
24La gouvernance désigne alors, de manière plus spécifique, une technique de gestion sociale. Le thème de la gouvernance évoque un modèle d’entreprise s’inspirant du modèle biologique, et dont le fonctionnement doit poursuivre la transparence et la fluidité des relations qui s’y nouent [32]. Il appelle plus généralement une direction par projets. Mais il s’inscrit surtout dans un vocabulaire proprement politique. Pour d’aucuns, le thème de la gouvernance s’insère dans le lexique administratif en inscrivant en son sein des langages qui lui étaient étrangers jusqu’ici. En réalité, c’est l’inverse ; la gouvernance fait pénétrer la logique de l’administration au sein même des champs sociaux auxquels elle s’applique. Comme le montre Napoli, l’administration ne s’entend pas ici comme le pouvoir d’application des normes exercé par l’État mais par une forme de pouvoir originale, remontant au droit romain et au droit canon, par laquelle le pouvoir public, plutôt que d’imposer un ordre de l’extérieur, tente au contraire de tenir l’objet de la norme dans la plus grande proximité, de le « faire venir à sa main » [33]. La loi commande aux choses de l’extérieur ; l’administration les tient à sa portée.
25L’administration se présente comme un dispositif complet de pouvoir qui porte à la fois sur le public et le privé ; la monnaie et la gestion des biens, mais aussi l’orientation des âmes et des intentions. Le développement au dix-neuvième siècle des sciences adminis-tratives favorise l’apparition de techniques comptables et scientifiques de gestion, qui accréditeront l’idée que l’administration représente une tentative de direction scientifique du social. La séparation progressive du pouvoir spirituel et de l’administration légale dissocie l’activité administrative du droit et de la morale, et s’assimile au simple exercice du pouvoir public. Toutefois, l’administration ne renonce pas à constituer un « instrument de connaissance, d’instruction, de contrôle, de correction » des acteurs, dont les procédures constituent à la fois un fondement de légitimité et d’efficacité des conduites [34]. La gouvernance réactive cette fonction de guidance, tout en la réarrimant à un discours sur la légitimité morale des décisions prises.
26Comment les dispositifs de gouvernance procèdent-ils ? Premièrement, la gouvernance intègre les dimensions symboliques et légales de la norme dans une perspective centrée autour de la question de la confiance.
27S’inscrivant dans la ligne de Locke [35], Tocqueville estimait déjà que la notion de confiance était centrale pour le gouvernement représentatif. La critique tocquevillienne de la centralisation ne porte en effet pas tant sur l’éloignement excessif du pouvoir ou sur la nature abusive de l’État que sur l’incapacité de l’administration centralisée à susciter la coopération du citoyen [36]. Une décision politique ne saurait être efficace sans s’appuyer sur l’approbation du citoyen. C’est ce qui permet à Tocqueville de penser, tout en restant fixé sur un idéal de « bonne administration », que la question de l’efficacité de la norme ne peut être séparée de sa légitimité. L’efficacité et la légitimité d’une action collective sont pour l’auteur d’autant plus liées que la participation des acteurs est un critère relevant pour l’un et l’autre séparément ; et que la démocratie s’affirme dans cette optique comme le régime le plus à même de réunir les conditions de cette légitimité et de cette confiance.
28Ce que Tocqueville n’a toutefois pas directement aperçu, c’est que la décentralisation ne suffit pas à susciter la participation des acteurs. La participation des acteurs présuppose leur confiance mais ne l’entraîne pas forcément. C’est précisément ce problème que le discours de la gouvernance entend résoudre. La question de la gouvernance émerge quand l’autorité publique éprouve des difficultés à imposer de soi la légitimité d’un espace de décision, et à en administrer d’elle-même la police. Le fonctionnement des différentes institutions de la société – l’État et l’administration, bien sûr, l’expertise administrative – risque de ne plus reposer que sur une foi autistique en elles-mêmes. L’affaissement du crédit porté à la raison accompagnant la remise en question des institutions publiques issues de la modernité, il s’agit dès lors de reconnecter les systèmes de décision à la vie sociale [37]. C’est dans ce cadre que la question de la confiance émerge parallèlement à celle de la gouvernance.
29Le droit classique impose une contrainte extérieure à l’individu. La gouvernance entend orienter de l’intérieur son comportement : susciter des réflexes souhaitables, obtenir les régularités attendues, inciter à l’adoption d’une conduite jugée « correcte ». Pour ce faire, le discours de la gouvernance glisse d’une dynamique de représentation à une dynamique d’inclusion politique. L’autorité publique tente, d’une part, de pénétrer la complexité du champ social via l’ajustement des intérêts des acteurs : son action s’exercera sous forme modulaire, à l’aide de structures plus légères et/ou plus informelles. De l’autre, elle donne place à des processus plus négociés, impliquant le plus largement possible les parties en cause. Les politiques publiques ne cessent certes pas de se définir à partir des textes officiels, des lois, des orientations identifiables institutionnellement. Toutefois, la gouvernance ne se contente pas d’associer les différentes parties prenantes à la décision. Elle modifie le rôle qu’ils jouent dans la décision publique. La gouvernance substitue à la coercition un cadre général de « self-directed human interaction » [38]. L’acteur n’est plus seulement le destinataire de la norme ni sa docile cheville ouvrière. Il s’agit maintenant de l’associer d’une manière ou d’une autre à la formation de la norme, le convaincre de participer à l’élaboration de celle-ci parce qu’il peut contribuer à la rendre plus désirable et efficace.
30Deuxièmement, la gouvernance n’opère plus comme un synonyme de gouvernement mais comme un terme alternatif, qui situe le pouvoir dans un lieu d’échange à l’intersection de la sphère économique, la sphère publique et la sphère associative.
31Il reste difficile de trancher si l’émergence du gouvernement à distance entérine le dégraissage de l’autorité publique face à ses nouvelles missions, ou si elle lui permet au contraire d’investir de nouveaux domaines de la vie sociale. Pour d’aucuns, l’émergence du paradigme de la gouvernance représente, en l’appréciant ou en le critiquant, le triomphe d’une rationalité anti-étatiste puisqu’elle puise son effectivité du côté des individus, des communautés locales et des marchés : la gouvernance disqualifie l’État tout en privatisant la délibération politique [39]. Mais d’autres acteurs, suivant en cela les théoriciens du management Osborne et Gaebler, soutiennent que les tendances actuelles renforcent l’autorité publique en ce qu’elles l’amènent à affiner et restructurer ses fonctions [40]. Le rétrécissement apparent de l’autorité publique, loin de l’affaiblir, lui permettrait d’infiltrer plus finement de nouveaux domaines d’action. La gouvernance ne renonce pas aux ambitions régulatrices de l’État social, mais supporte au contraire une planification douce et profonde du social, alliant principes directeurs et normes extrêmement détaillées. L’État ne disparaît pas. Il n’est pas un acteur comme les autres mais devient le lieu de coordination et d’animation de la norme. De nombreux auteurs ont ainsi souligné, pour s’en réjouir ou pour le déplorer de nouveau, la contractualisation progressive de l’action administrative, l’efflorescence des partenariats public/privé, et l’irruption d’un nombre croissant d’entremetteurs non étatiques dans l’application de la norme collective [41]. Parmi les expressions possibles de ce nouvel art de l’efficience politique, deux perspectives méritent à ce titre une mention particulière. La première est une régulation d’inspiration welfariste – à savoir une conception de l’État-providence basée sur la négociation entre les différents intérêts sociaux – articulée, d’une part, autour de l’existence de conflits portant sur l’idéologie, les buts et les intérêts des acteurs, et, de l’autre, autour de relations de pouvoir différenciées selon les partenaires. En somme, on mélange le modèle de la concertation sociale et civile avec un échelonnage de procédures de consultation plus ou moins intégrées au processus décisionnel et plus ou moins contraignantes pour l’autorité centralisatrice. La seconde s’inspire des idées du NPM (New Public Management) et développe plutôt une régulation « par objectif » ou « par qualité » : le développement des techniques d’audit, d’inspections, de création d’agences administratives et d’étalonnage de performance trace alors les contours d’une nouvelle grille d’intelligibilité de la rationalité gestionnaire.
32Dans ces différents cas – auto-régulation, régulation corporatiste, New Public Management – la difficulté de situer la gouvernance par rapport aux espaces publics institutionnalisés tient aux instruments qu’elle mobilise, à savoir remplacer les mécanismes d’autorité par des processus visant à construire des relations de confiance – et par conséquent des engagements communs à agir – entre les acteurs. La gouvernance étend la palette de ses outils normatifs au dehors du champ juridique proprement dit, et s’affirme comme une sorte de méta-droit qui fait interagir des logiques qui, autrement, seraient jugées irréconciliables. La gouvernance s’analyse ainsi comme une « loi en contexte » [42], utilisant les théories et les modes d’analyse propres aux sciences sociales, parmi lesquelles la science politique, la statistique, l’économie ou la sociologie [43]. « La spécificité de la norme juridique par rapport à d’autres dispositifs normatifs devient moins évidente ; les standards techniques se juridicisent, tandis que l’efficience de la norme juridique demande une technicisation croissante et un rapport plus étroit avec les différentes sphères du social » [44]. Par ailleurs, les sciences humaines et sociales investissent le champ du droit, et élaborent des « rapports d’autorité et de force qui créent, modifient, appliquent les normes juridiques sans s’identifier à elles » [45]. Elles se mettent au service du législateur dans la mesure où elles offrent la possibilité d’une maîtrise dans la connaissance des faits sociaux [46]. D’une part, le droit se sert du social pour assurer une certaine prescriptivité. De l’autre, le social pénètre au sein même du champ juridique – les sciences statistiques ou managériales proposant presque de nouvelles manières de rédiger et concevoir la loi.
33Le discours de la gouvernance va accompagner – parmi d’autres facteurs – l’émergence d’une nouvelle définition, plus opérationnelle, de la société civile. Le libéralisme politique considère la société civile comme un ordre émergeant de l’association des individus et indépendant de l’État, chargé de faire contrepoids à l’autorité publique : la société libérale se concevrait ainsi à travers le face-à-face entre une société civile expurgée des strates intermédiaires – tels que les syndicats, les cultes ou les corporations, par exemple – qui divisent les individus, et un État exerçant son mandat « à l’abri des puissances occultes qui font écran entre le peuple et les mandataires officiels » [47]. Le discours de la gouvernance, lui, conçoit la société civile comme une instance médiatrice entre l’État, le marché et les citoyens. La littérature consacrée à la gouvernance porte soit une critique radicale de la société libérale, dans la mesure où la gouvernance est censée prendre à la fois distance avec le marché et avec les canons de la démocratie libérale représentative ; soit une tentative de trouver une voie alternative entre conception étatiste et volonté de « moins d’État », limitant les intrusions du gouvernement sans laisser les biens publics se faire coloniser par la sphère privée [48]. La différence entre ces deux approches est accentuée par le fait qu’elles sous-tendent des conceptions divergentes de la justice sociale et du rôle du marché. Néanmoins, elles tendent toutes deux à vouloir créer un espace-tampon se caractérisant par sa sensibilité à l’intérêt commun, autant que par son fonctionnement autonome par rapport à l’État. Cet espace, la société civile, ne constitue plus le refuge des activités privées, mais au contraire une place publique affranchie des systèmes productifs et administratifs. La société civile doit faire face à la pression exercée par l’État, mais aussi également par le système économique. Elle dépasse les liens verticaux et hiérarchiques de l’État et les liens horizontaux du marché. Par ailleurs, elle joue un rôle actif dans le processus de décision politique [49]. La société civile ne désigne plus un mode de contrôle public ou l’espace de formation de l’opinion. Elle devient partie intégrante de la représentation politique et du processus de décision.
34Une telle redéfinition présente un triple avantage pour la réflexion normative. Elle permet de distinguer société civile et marché tout en rendant compte de leur interpénétration [50]. Elle relégitime l’action publique là où elle se trouvait la plus décrédibilisée – tout en remettant en question les frontières de l’activité étatique [51]. Mais surtout, elle permet de penser les conditions de création de cette confiance qui est au principe du discours de la gouvernance. Si la notion de décentralisation est aussi centrale pour la gouvernance, c’est précisément parce que celle-ci repose sur l’insertion de la société civile et la redéfinition de son rôle dans le processus de décision publique. Une telle redéfinition procède d’une réflexion sur la nécessité et les conditions d’émergence de l’assentiment des acteurs.
C – Gestion sociale : l’introduction des concepts de procédure et de transparence
35La gouvernance désigne donc une technique de gestion sociale reposant sur la création d’une relation de confiance entre les différents partenaires du processus de décision politique. Cette relation de confiance doit faciliter la coopération entre les acteurs, simplifier leurs transactions, et rendre plus disponibles l’accès aux connaissances et expériences des autres acteurs. Elle permet dès lors de produire une norme plus efficace, mais aussi plus effective puisque les acteurs y consentiraient plus facilement.
36Plus le droit est à la fois contesté et sollicité en tant que moyen de régulation politique et de structuration sociale, « plus s’accroît aussi la charge de légitimation que doit supporter la genèse démocratique du droit » [52]. Le discours de la gouvernance entend surmonter cette difficulté. Ce faisant, il doit affronter une tension « entre deux pôles idéal-typiques que seraient le règne de l’expert manipulant l’opinion et l’auto-déploiement d’un espace public régi par la raison communicationnelle » [53]. Cette tension est d’autant plus difficile à appréhender que la participation des acteurs représente elle-même une stratégie de connaissance et de contrôle continu de l’espace social. Comment produire une norme effective sans aliéner les acteurs du processus de décision ? Comment articuler ensemble création de confiance et autonomie des acteurs ?
37Dans ce cadre, le nouveau discours de la régulation publique opère un glissement dans la manière dont la norme se fonde, s’applique et se légitime, dans la mesure où la légitimation de celle-ci ne provient plus ni d’un principe substantiel – le droit naturel par exemple – ni d’une source formelle clairement identifiée – la loi, la coutume – mais d’une procédure.
38L’introduction de la notion de procédure doit permettre de gérer la complexité sociale mieux que ne le ferait une source normative fixe. La conception procédurale du droit permet en effet d’intégrer plus facilement les attentes des acteurs puisque le contenu de la norme est supposé dériver de leurs interactions. Le droit crée des attentes sociales par rapport à la norme, mais en retour son contenu et son effectivité sont également influencés par ces attentes [54]. Dans ce cadre, la conception procédurale du droit est supposée contribuer plus finement à l’intégration de ces attentes au sein de la sphère juridique. À un premier niveau, elle agit comme une procédure légitimatrice permettant de fonder les systèmes normatifs sur une autre base que leur simple positivité. À un deuxième niveau, elle permet dès lors de stabiliser les attentes des acteurs ; d’une part, les interactions entre acteurs finissent par être intégrées socialement sous la forme d’une norme juridique positive [55] ; d’autre part, la procédure est supposée maintenir la connexion entre la norme juridique et la manière dont celle-ci est vécue, interprétée, appliquée et appréciée par la communauté juridique [56]. Dans ce cadre, le caractère discursif du processus de formation de la norme, loin de présenter une conception faible de la norme juridique, est censé l’ancrer plus profondément dans l’espace social et reposer sur un consensus social plus large – ou du moins aménager des conditions de réception de la norme plus finement adaptées au contexte d’application de celle-ci.
39Le discours de la gouvernance s’inscrit précisément dans cette perspective procédurale. La gouvernance s’affirme comme un système articulant d’autres systèmes dans la formation de la norme. Mais elle se présente surtout comme un mode de gestion et de légitimation sociale de la norme, puisque la confiance des acteurs dans le processus dépend du sentiment que celui-ci est justifié, ou du moins qu’il n’est pas contraire à leurs intérêts. Par conséquent, le discours de la gouvernance publique se présente à la fois comme une conception alternative de la démocratie et de la délibération publique, mais aussi comme une grille d’analyse globale permettant de combiner les principes de légitimité et d’efficacité. La mise en rapport, à travers l’idée générale d’une procéduralisation progressive du droit, de l’idée de délibération publique et de l’idée de gouvernance laisse donc espérer que les problèmes de légitimité puissent être considérés autrement que « comme une variable aléatoire des problèmes de régulation » [57]. Elle permet à l’inverse d’imaginer la mise en place d’un « droit délibératif » comme un objectif raisonnable et compatible avec une action publique efficace.
40C’est le principe de transparence qui va permettre de coaguler ces différents impératifs. De manière générale, le principe de transparence désigne l’ensemble des circonstances qui doivent rendre la décision publique accessible à ceux qu’elle concerne, au niveau de son contenu et à celui de son processus de formation. Il recouvre ici pour la gouvernance deux types de champs lexicaux.
41Entendue en son sens restreint, la transparence vise la transmission d’un certain nombre d’informations objectives destinées à aider le citoyen dans son choix politique. Elle est destinée à fournir un environnement d’information permettant à l’acteur de se déterminer en toute rationalité. Elle doit à ces fins rendre visible le fonctionnement des différentes organisations et parties en charge de l’action publique. Elle se traduit le plus couramment, mais pas uniquement, par le droit d’accéder aux documents issus de ces institutions. À cet égard, la transparence obéit, d’une part, à une logique de service. Le citoyen contrôle la gestion des organismes en charge de l’action publique : c’est par exemple la tâche que se fixe l’organisation Transparency International, pour laquelle le principe de transparence représente avant tout un outil pour améliorer les services publics et lutter contre la corruption. Elle correspond, d’autre part, à une logique de légitimation politique, qui assimile la gouvernance à une forme de gouvernement parmi d’autres et la soumet à ce titre à un principe de publicité.
42Entendue néanmoins dans un sens plus large, la transparence désigne une logique de fonctionnement à laquelle les organisations devraient idéalement toujours se plier. D’un point de vue descriptif, la transparence recouvre ainsi la traçabilité interne du fonctionnement des organisations en charge de l’action publique. Elle permet aux différents niveaux et modules d’action de communiquer entre eux. Elle se confond – parfois au prix d’un abus de vocabulaire – avec les techniques de participation et de responsabilisation des acteurs. Et, d’un point de vue normatif, la transparence implique de rendre le processus accessible à tous, disponible, immédiat, plein et entier au regard. Elle doit également, plus largement, faire coïncider la décision avec l’expression de l’ensemble des cellules d’action impliquées dans le processus normatif.
43Le principe de transparence occupe à ce titre une double place dans le discours de la gouvernance et son tournant procédural [58].
44D’une part, la communication de l’information politique est nécessaire pour assurer les fonctions cognitives, légitimantes et instituantes de la procédure. La transparence doit orienter le comportement des acteurs et favoriser leur adhésion aux critères de ce qui est jugé une procédure « correcte » – c’est-à-dire produisant un résultat juste, effectif ou efficace en fonction des objectifs qui lui sont assignés. La visibilité des institutions est une condition nécessaire à la création de la confiance qui joint par leurs bouts une défiance nécessaire et une confiance espérée. À défaut de visibilité directe, seule la confiance aveugle ou le regard direct crée, d’une part l’adhésion du citoyen [59] : l’organisation de la défiance permet alors, paradoxalement, aux institutions publiques d’acheter au citoyen un mandat assez large pour gérer les tâches complexes qui sont les leurs.
45D’autre part, la gouvernance se présente elle-même comme un facteur de transparence. En effet, les procédures de décision mises en place par la gouvernance représentent d’elles-mêmes un travail de sélection et d’interprétation de sens, et organise la manière dont les acteurs entrent en interaction et organisent donc leur communication intersubjective. La procédure elle-même participe à la circulation de l’information politique, dans la mesure où elle met en place des lieux d’interaction entre les acteurs, et doit créer une situation de confiance suffisante pour qu’ils acceptent de mettre en commun – et donc de communiquer – leurs expériences, leurs attentes, leurs intérêts. Si le principe de transparence conserve donc une dimension de publicité politique comprise comme visibilisation de l’information, il recouvre donc aussi une dimension procédurale. L’échange, la compréhension, la comparaison, l’évaluation et – dans le meilleur des cas – la délibération entre les acteurs contribuent eux-mêmes au processus de visibilisation et de compréhension de l’information politique. Le principe moderne de publicité offrait au citoyen un siège de spectateur critique : le discours de la gouvernance l’inclut au sein même du processus de décision. La transparence n’est plus l’outil de la distinction État/société mais le moyen de les reconnecter l’un à l’autre.
Notes
-
[1]
John Pitseys est docteur en philosophie de la Chaire Hoover d’éthique économique et sociale, Université Catholique de Louvain (UCL). Ses intérêts de recherche portent sur la philosophie politique et la philosophie du droit. Sa thèse, intitulée « transparence et démocratie : analyse d’un principe de gouvernement », porte sur l’étude du principe politique de transparence, l’analyse de ses conditions de désirabilité et son influence sur la définition d’un régime politique légitime.
-
[2]
Voir J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad. C. Bouchindhomme, R. Rochlitz, Paris, Gallimard, 1997 (1992), chapitres III et IV, pp. 97-213.
-
[3]
B. Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, 1996, pp. 191-200.
-
[4]
C. Schmitt, Du politique. « Légalité et légitimité » et autres essais, Puiseaux, Pardès, 1990 (1932), p. 46.
-
[5]
S. Goyard-Fabre, L’éternelle querelle du contrat social, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1984, pp. 193-201.
-
[6]
« Le législateur (…) est dans l’État législateur toujours le seul et l’unique législateur (…) Dans un état législateur conséquent, le législateur doit conserver entre ses mains le monopole de la légalité » (C. Schmitt, Du politique, op.cit., p. 53).
-
[7]
Voir J. De Munck, J. Lenoble, « Les mutations de l’art de gouverner. Approche généalogique et historique des transformations de la gouvernance dans les sociétés démocratiques », in O. De Schutter, N. Lebessis, J. Paterson (eds.), La gouvernance dans l’Union européenne, Les Cahiers de la Cellule de Prospective, Commission européenne, 2001, p. 34.
-
[8]
La règle de droit civil se définissant aux États-Unis comme « a rule of civil conduct prescribed by a state commanding what is right and prohibiting what is wrong » (G.S. Tucker, Blackstone’s Commentaries with notes of reference to the Constitution and Laws of the Federal Government of the United States of America and the Commonwealth, W. Y. Birch and A. Small, Philadelphia, 1803, p. 2).
-
[9]
J. De Munck, J. Lenoble, « Les mutations de l’art de gouverner », op.cit., p. 37.
-
[10]
L’exercice politique est pris en charge par le parti lui-même, à travers la discipline de vote qu’il impose aux représentants. Bernard Manin montre par ailleurs que l’émergence de partis de masse n’est pas contradictoire avec le maintien d’une conception élitaire de la représentation, qu’il s’agisse de la domination des grands partis sociaux-démocrates par une élite « déprolétarisée », ou la mise en avant des figures du militant et du technocrate d’appareil. Voir B. Manin, Principes du gouvernement représentatif, op.cit., p. 266-267.
-
[11]
Ibidem, p. 264-277.
-
[12]
U. Beck, Risk Society. Towards a New Modernity, London, Sage, 1992.
-
[13]
P. Rosanvallon, Pour une histoire conceptuelle du politique, Paris, Seuil, 2003, p. 35.
-
[14]
Sur la déterritorialisation des pouvoirs de l’État, A.A. Aman, « Globalization, Democracy and the Need for a New Administrative Law », in Indiana Journal of Global Studies, vol. 10, 125, pp. 125-155 ; R.A.W. Rhodes, « The hollowing out of the state : the changing nature of the public service in Britain », in Political Quarterly review, n° 65, p. 137-151, cité par A. Crawford, « Vers une reconfiguration des pouvoirs ? Le niveau local et les perspectives de la gouvernance », in Déviance et Société, 2001, vol. 25, n° 1, p. 4.
-
[15]
J. Commaille, L’esprit sociologique des lois. Essai de sociologie politique du droit, Paris, Presses universitaires de France, 1995, p. 14.
-
[16]
Voir par exemple F. Ost, M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour un théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, p. 18.
-
[17]
K.H. Ladeur, « La procéduralisation et son utilisation dans une théorie juridique post-moderne », in O. De Schutter, N. Lebessis, J. Paterson (eds.), La gouvernance dans l’Union européenne,op.cit., p. 57.
-
[18]
J. Commaille, « De la “sociologie juridique” à une sociologie politique du droit », in J. Commaille, L. Dumoulin, C. Robert, La juridicisation du politique. Leçons scienti-fiques, Librairie générale de jurisprudence, 2000, p. 38.
-
[19]
F. Herzberg, Work and the Nature of Man, New York, World Publishing Times Mirror, 1966 ; D. McGregor, The Human Side of Entreprise, New York, McGraw- Hill, 1960.
-
[20]
G. Paquet, « La gouvernance en tant que manière de voir : le paradigme de l’apprentissage collectif », in L. Cardinal, C. Andrew (dir.), La démocratie à l’épreuve de la gouvernance, Presses de l’Université d’Ottawa, 2000, p. 9.
-
[21]
L. Juillet, « Pouvoir, démocratie et gouvernance en réseau : commentaires sur “La gouvernance en tant que manière de voir” de Gilles Paquet », in L. Cardinal, C. Andrew (dir.), ibidem, p. 107.
-
[22]
J.B. Stewart, « Whales and Sharks », in The New Yorker, 15 février 1993, p. 37-43, cité par G. Paquet, op.cit., p. 21 ; P. Calame, A. Talmant, L’État au cœur. Le meccano de la gouvernance, Paris, Desclée de Brouwer, 1997.
-
[23]
J. B. Stewart, op. cit.
-
[24]
G. Paquet, op.cit., p. 24.
-
[25]
Voir J. Norton, « International Financial Institutions and the Movement Toward Greater Accountability and Transparency : The Case of Legal Reform Programmes and the Problem of Evaluation », in International Lawyer, 2001, pp. 1443-1474.
-
[26]
World Bank, Development in practice : Governance – the World’s Bank experience, Report n° 13134, 1994, p. vii.
-
[27]
C. Lafaye, « Gouvernance et démocratie : quelles reconfigurations ? », in L. Cardinal, C. Andrew (dir.), La démocratie à l’épreuve de la gouvernance, op.cit., p. 57-87.
-
[28]
M. Vogliotti, « La “rhapsodie” : fécondité d’une métaphore littéraire pour repenser l’écriture juridique contemporaine. Une hypothèse de travail pour le champ pénal », in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n° 46, 2001, p. 176.
-
[29]
J. Chevallier, « Mondialisation du droit ou droit de la mondialisation ? », in C.A. Morand (dir.), Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 43.
-
[30]
R. Dworkin, L’empire du droit, Paris, Presses Universitaires de France, 1994 (1986), p. 169.
-
[31]
J. Pitseys, « Le processus de Bologne », in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n° 52, 2004, p. 163.
-
[32]
L. Caillot, « Le nouvel opium managérial : sur Jean-Pierre Le Goff, Le mythe de l’entreprise. Critique de l’idéologie managériale », in Le Banquet, 1e semestre 1993, n° 2.
-
[33]
P. Napoli, « Administrare et curare. Les origines gestionnaires de la traçabilité », in P. Pedrot, Traçabilité et responsabilité, Paris, Economica, 2003, pp. 46-47.
-
[34]
Ibidem, pp. 13-14.
-
[35]
B. Manin, Principes du gouvernement représentatif, op.cit., pp. 282-283.
-
[36]
« Il arrive parfois que la centralisation essaie (…) d’appeler les citoyens à son aide ; mais elle leur dit : vous agirez comme je le voudrai, autant que le voudrai, et précisément dans le sens que je voudrai. Vous vous chargerez de ces détails sans aspirer à diriger l’ensemble (…) Ce n’est point à des pareilles conditions qu’on obtient le concours de la volonté humaine », in A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard (1835-1840), p. 155.
-
[37]
A. Giddens, Modernity and Self-Identity, Stanford University Press, Stanford, 1991, p. 23.
-
[38]
R. Wolfe, « Decision-making and Transparency in the “Medieval” WTO : Does the Sutherland Report have the Right Prescription ? », in Journal of Economic Law, vol. 8, n° 3, septembre 2005, p. 633 ; voir également C. Plançon, « La gouver-nance et la diversité des cultures dans la régulation juridique. Illustration au Sénégal et en France », in C. Eberhard, Droit, gouvernance et développement durable, Cahiers d’anthropologie du droit, 2005, pp. 223-240.
-
[39]
C. Hewitt de Alcandara, « Du bon usage du concept de gouvernance », in Revue internationale de sciences sociales, 1998, n° 155, p. 109-118.
-
[40]
D. Osborne, T. Gaebler, Re-inventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Reading, Massachussets, Addison-Weasley, 1992, p. 32 ; J. Commaille, « De la “sociologie juridique” à une sociologie politique du droit », in J. Commaille, L. Dumoulin, C. Robert, La juridicisation du politique. Leçons scientifiques, Librairie générale de jurisprudence, 2000, p. 40.
-
[41]
F. Ost, M. Van De Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op.cit., p. 144.
-
[42]
Voir M. Van Hoecke, Law as Communication, Oxford, Hart Publishing, 2002.
-
[43]
Voir F. Snyder, « The Effectiveness of European Community Law : Institutions, Processes, Tools and Techniques », in Modern Law Review, n° 56, 1993, pp. 19-54.
-
[44]
J. Pitseys, « Le processus de Bologne », op.cit., p. 158.
-
[45]
J. Chevallier, « L’ordre juridique », in J. Chevallier, D. Loschak, R. Draï, A. Kremer-Marietti, P. Dupire, D. Bourcier, S. Bruxelles, T. Ivainier, A. Fenet, C. Thuan, D. Rasy (éds.), Le droit en procès, sous la direction des Presses Universitaires de France, 1983, p. 38.
-
[46]
Et ce à la fois en amont – dans la phase de préparation – et en aval – lors de la phase d’application et d’évaluation d’impact – de la prise de décision.
-
[47]
J.G. Belley, « Gouvernance et démocratie dans la société neuronale », in L. Cardinal, C. Andrew (dir.), op.cit., p. 153.
-
[48]
B.R. Barber, « Three Challenges to reinvent Democracy », in P. Hirst, S. Khilnani (eds.), Reinventing Democracy, Cambridge, Blackwell Publishers, 1996, p. 153.
-
[49]
Ibidem, p. 151.
-
[50]
Ce faisant, nous nous distançons de la définition que Jean Cohen donne de la société civile comme étant « l’ensemble des associations et des réseaux auxquels les individus adhèrent librement dans le but de se consacrer à une activité qui a sa fin en soi : revendication de droits, culture, religion, famille ». Nous éprouvons quelques difficultés à voir en quoi des revendications de type religieux ont davantage une fin en soi que la revendication de droits ou d’avantages socio-économiques – à moins d’assimiler cette fin en soi à la dimension « existentielle » des premières, et refuser simultanément cette dimension aux secondes. Nous éprouvons des réticences plus générales à tracer une frontière entre les revendications « pures » de la société civile et l’affirmation de simples intérêts par la société économique. Voir P. Constantineau, « L’évolution de la société civile dans le contexte de la mondialisation », in P-Y. Bonin, Mondialisation. Perspectives philosophiques, Paris, L’Harmattan, Presses de l’Université Laval, pp. 59-72.
-
[51]
« Les états-nations souverains ont revendiqué comme leur trait distinctif le droit de déterminer le mode de direction s’appliquant sur leur territoire à chaque activité, que ce soit pour l’assumer eux-mêmes ou pour fixer les limites à l’intérieur desquelles d’autres instances l’exerceraient. Ils revendiquaient ainsi le monopole de la fonction de gouvernance (…) Mais la gouvernance ne se réduit pas à une province de l’État. C’est une fonction qui peut être exercée par toute une gamme d’institutions et de pratiques publiques ou privées, étatiques ou non, nationales ou internationales » (P. Hirst, G. Thompson, « Globalisation and the future of the Nation State », in Economy and Society, 1995, n° 24, 3, p. 422).
-
[52]
J. Habermas, Droit et démocratie, op.cit., p. 457.
-
[53]
J.M. Fourniaux, « Les figures de concertation à la française », in M. Cariepy, M. Moue (dir.), Ces réseaux qui nous gouvernent, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 381.
-
[54]
L. Fuller, « Law as an instrument of social control and law as a facilitation of human interaction », in Legaz y Lacambra (ed.), Die Funktionen des Rechts, ARSP Beiheft, Frans Steiner Verlag, Wiesbaden, 1974, pp. 99-105.
-
[55]
N. Luhmann, A sociological Theory of Law, London & Boston, Routledge, 1985.
-
[56]
M. Van Hoecke, Law as Communication, op.cit., pp. 64-66 et pp. 176-178.
-
[57]
J. Habermas, Droit et démocratie, op.cit., p. 458.
-
[58]
M. Senellart, « Secret », in Id., Les arts de gouverner, Paris, Seuil, 1995. Michel Senellart analyse la manière dont l’activité administrative se définissait originairement en rapport avec la notion de Raison d’État, et se déclinait à ce titre sous le mode de la discrétion : l’action du souverain doit être spectaculaire mais ses ressorts doivent rester secrets.
-
[59]
A. Giddens, op.cit. p. 19.