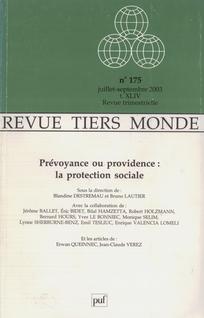1 Sitôt élu président du Brésil, Luis Ignacio « Lula » da Silva déclara à plusieurs reprises que le « combat contre la faim » était l'œuvre majeure de son mandat à venir, et qu'il s'estimerait satisfait si, à l'issue de ce dernier, chaque Brésilien pourrait faire trois repas par jour.
2 Pourtant, la question sociale ne se réduit pas à celle de la faim, ni à celle de la pauvreté. Dans son programme électoral [1], Lula a intitulé un chapitre : « Le social, axe du développement » ; il y est question de politique de création d'emplois, de réforme fiscale et de hausse du salaire minimum, et des « droits inaliénables du citoyen contemporain » à l'accès aux services publics. La politique sociale y apparaît non comme résiduelle et compensatrice, mais comme le véritable socle d'un nouveau régime d'accumulation.
3 L'écart entre les deux ambitions pose la question même de la nature des politiques sociales. Sont-elles vouées à être graduelles et progressives, à ne s'attaquer pour commencer qu'aux situations les plus insoutenables d'un point de vue moral ou politique (misère, exclusion, faim) ? Ou doivent-elles d'emblée affirmer l'existence de droits sociaux généraux et universels ? Le risque, dans le premier cas, est de réduire ces politiques à un catalogue de mesures d'assistance, toujours en retard sur les effets sociaux de l'évolution d'une économie sur laquelle on n'a pas de prise. Dans le second, le risque est que l'écart entre les droits affirmés et les possibilités économiques de leur mise en œuvre tourne, politiques d'alliance avec les catégories clés de salariés aidant, à la caricature corporatiste de l'État-providence. Le Brésil semble, durant les soixante dernières années, n'avoir évité aucun de ces deux écueils.
I – LA PROTECTION SOCIALE BRÉSILIENNE : UN ÉTAT-PROVIDENCE « AVORTÉ », OU TOUJOURS EN GESTATION ?
4 La protection sociale de type bismarckien a été instaurée au Brésil en 1944-1945, comme une sorte de complément aux lois connues sous le nom de CLT [1]. Très rapidement, l'objectif affirmé d'universalité des droits a été confronté à l'émergence d'un « syndicalisme d'État » [2], dans lequel la protection sociale apparaît comme un privilège, favorisant les salariés déjà favorisés (fonction publique, énergie, transports, industries de base, banque et finance, et plus tard biens d'équipement et biens de consommation durables). Par ailleurs, le taux de salarisation de la main-d'œuvre a crû très lentement, malgré la vigueur de l'industrialisation et de l'urbanisation, et la part du salariat informel ou semi-formel [1] est restée importante, pour croître vigoureusement après 1983.
5 Les politiques assistantielles, comme partout, ont une longue histoire ; l'Église catholique, puis les municipalités, y jouent un rôle central, jusqu'aux années 1940 où elles sont explicitement incorporées aux politiques publiques, avec un statut un peu particulier (l'institution jouant le rôle majeur, la « Légion brésilienne d'assistance », est une agence fédérale financée par des fonds publics [2]). Les politiques d'assistance, au Brésil, ont toujours été le vecteur majeur du clientélisme, à tel point que de nombreux analystes n'hésitent pas à passer d'une interprétation en termes de fonctionalité politique de la misère et des inégalités (elles favorisent les relations de faveur et de clientèle) à une explication téléonomique (la misère et les inégalités, même irrationnelles d'un point de vue économique, sont sans cesse recréées pour servir de support au clientélisme). Si l'on met de côté les débats sur les origines historiques de ce système de faveur (en particulier le « coronélisme »), sa principale caractéristique est son caractère hyperpersonnalisé et « vertical » qui en a fait un cas d'école : le clientélisme de parti y est beaucoup moins prégnant qu'au Mexique ou en Argentine par exemple, et bien des règles fiscales et constitutionnelles [3] semblent avoir été inventées dans le seul but de reproduire les relations de faveur.
6 Toutes ces caractéristiques du système de protection sociale brésilien sont connues de longue date. La particularité du Brésil tient à la façon dont ont été posés les termes du débat politique à ce propos. Dans une courte période (les cinq années qui vont du départ des militaires du pouvoir en 1985 à l'élection de Collor en 1990) dont l'apogée fut le vote de la Constitution de 1988, le Brésil fut animé par un grand débat sur le thème de la démocratie et de la citoyenneté, où les questions de la pauvreté et des inégalités, du système de faveur et des privilèges des assurés, de la dégradation des services publics et de la collusion d'intérêts autour de la non-effectivité du droit social, formèrent l'essentiel du débat politique. L'omniprésence du thème de la citoyenneté et son indéfinition imprimèrent à la Constitution de 1988 un ton très volontariste, dont on peut penser qu'il est en grande partie à l'origine de ce que de nombreuses dispositions de cette constitution sont restées lettre morte.
7 L'élection de Fernando Collor de Mello, et le demi-mandat d'Itamar Franco, ont semblé ramener ce débat sur la citoyenneté à sa place : une de ces effervescences rhétoriques que les Brésiliens affectionnent, alors même que l'« ouverture libérale » commençait à produire ses ravages sociaux. Les deux gouvernements de Fernando Henrique Cardoso qui ont suivi (1995-1998 et 1999-2002) ont été largement dénoncés comme « néo-libéraux » par l'opposition (le Parti des Travailleurs principalement), et ont souvent été assimilés à d'autres gouvernements latino-américains, celui de l'Argentine en particulier. Certes, d'un point de vue macro-économique, l'analogie est tentante (alignement de la monnaie nationale sur le dollar en 1994, surévaluation, déficit commercial, privatisations, taux d'intérêt exagérément élevés et croissance de la dette publique, etc.). Mais, sans entrer dans le détail de l'analyse macro-économique, qui montre bien la spécificité brésilienne [1], il y a un domaine où le qualificatif de « néo-libéral » doit être nuancé et spécifié : celui des politiques sociales.
8 En effet, au contraire de tous les autres pays d'Amérique latine, le Brésil a connu dans cette période 1995-2002 une étonnante multiplication des mesures et plans d'intervention publique en matière sociale et, grosso modo, une légère augmentation des dépenses sociales en termes de part du PIB ou per capita. Dans certains domaines (l'enseignement primaire par ex.), la croissance des dépenses a été forte (dépenses d'enseignement proprement dit, mais aussi bourses, distributions alimentaires en milieu scolaire, etc.), et cela s'est traduit rapidement sur l'évolution de certains indicateurs (taux de scolarisation en hausse, pourcentage des enfants d'âge scolaire au travail en baisse). Dans d'autres domaines, sans qu'il y ait de forte croissance des dépenses, il a pu y avoir l'amorce d'une réforme institutionnelle de grande ampleur, comme dans le cas du « Système unifié de santé » – SUS. Celui-ci, institué en 1990 (mais réellement mis en œuvre à partir de lois de 1993, 1996 et 2001) instaure un véritable système beveridgien de santé gratuite, avec « médecin référent » et décentralisation de la gestion au niveau des États fédérés et des municipalités. Mais, comme souvent, les moyens n'ayant pas suivi les mesures législatives, l'extrême hétérogénéité qualitative des services de santé a fait que « la grande majorité de la classe moyenne brésilienne s'est mise à souscrire des plans d'assurance santé complémentaires » [1]. Dans un autre domaine, celui des pensions minimales au titre de l'assistance sociale, la croissance du nombre de bénéficiaires est spectaculaire [2], pour atteindre 13 millions en août 2001.
9 Les huit années de gouvernement Cardoso ne peuvent donc, de ce point de vue, être qualifiées d'« ultra-libérales » ; elles ont été le moment de la mise en œuvre lente, imparfaite et insuffisante, certes, de nombreuses mesures qui étaient inscrites dans la Constitution de 1988, allant cependant dans leur grande majorité dans le sens de l'universalisme et non de la « focalisation ». Et pourtant, le tableau d'ensemble de la situation sociale au Brésil est resté globalement sans changement : la hiérarchie et la concentration des revenus restent identiques [3]. Après avoir brutalement diminué (de 41,7 % en 1993 à 33,9 % en 1995), la proportion de « pauvres », en termes de part de la population au-dessous de la ligne de pauvreté, varie peu (33,6 % en 2001), et reste très insensible aux variations de la conjoncture économique. Il en va de même pour la proportion d'« indigents » (respectivement 19,5 %, 14,6 % et 14,6 %) [4]. Même si l'accès à certains services publics (l'enseignement et l'eau potable en particulier) s'améliore, on a une impression première un peu paradoxale : malgré la multiplication des plans d'assistance et de mesures tendant vers l'universalisme, la seule mesure efficace et mesurable en matière de lutte contre la pauvreté n'a pas été une mesure « sociale », mais un plan de stabilisation monétaire réussi. Pourtant certaines de ces mesures sociales, comme celles qui concernent les retraites rurales, ont eu des effets indéniables, ce qui signifie qu'elles ont servi à pallier certaines conséquences néfastes de la gestion macro-économiques à partir de 1996.
10 La mise en place d'un système « bismarckien » de protection sociale, telle qu'on l'a connue au Brésil dans les années 1945-1960 (à la même époque qu'en France), repose sur une triple condition, ou plutôt un triple pari : le plein emploi, une rapide progression de la salarisation, l'intégration progressive de la population non salariée dans le système contributif mutualiste. Un tel « pari » n'a rien d'utopique par essence ; il a été totalement gagné dans la plus grande partie de l'Europe occidentale, même quand il a été fait beaucoup plus tardivement qu'au Brésil (comme en Espagne).
11 L'« avortement » de l'État-providence au Brésil [1] est évidemment dû à la perte de ce triple pari. Mais, plutôt que de décréter ex abrupto qu'un système de protection mutualiste à prétention universaliste est définitivement « irréaliste » (comme la plus grande partie des commentateurs, néo-libéraux autorevendiqués ou inavoués), il semble plus productif d'examiner en détail les principales causes de cet « avortement » avant de préciser les conditions politiques d'un renversement de tendance, conditions politiques qui peuvent être remplies à l'occasion d'un éventuel changement d'orientation dans les circonstances du début de la présidence de Lula.
12 Il y a alors deux angles d'attaque possibles de la question des politiques sociales dans le « Brésil de Lula ». Le premier est de partir, assez classiquement, de l'évolution des dépenses sociales et, sur la base d'une analyse critique, de proposer leur accroissement et surtout leur réorientation. Dans le programme de Lula, cela s'exprime par le constat que les dépenses sociales ne bénéficient pas prioritairement aux plus pauvres (en grande partie à cause du poids écrasant des retraites de la fonction publique), alors que les dépenses d'assistance, insuffisantes et éclatées, jouent surtout le rôle de pivot des mécanismes clientélistes. Inévitablement (et cela a été fait à de multiples reprises depuis l'élection d'octobre 2002), on en vient à faire le constat de l'étroitesse des marges de manœuvre et, au moins dans un premier temps, à modérer les ambitions et à les limiter à l'objectif de « trois repas par jour pour chaque Brésilien ».
13 Le second angle d'attaque, qui sera adopté ici, est de partir de la question des recettes. Il apparaît vite que la question centrale à long terme est celle de la faiblesse des rentrées des cotisations. L'analyse de l'origine de cette faiblesse implique l'examen des situations de travail, des statuts des travailleurs et de leur rémunération. Le débat est ici triple : il porte d'une part sur le niveau et les formes d'emploi, centrés sur les questions du chômage, et de la déstabilisation et l'informalisation du salariat ; d'autre part sur la hiérarchie des revenus et la faible contribution à la sécurité sociale des très basses rémunérations ; enfin sur l'évolution de la productivité et le partage des gains de productivité.
II – CHÔMAGE ET FORMES D'EMPLOI : LA PREMIÈRE ORIGINE DES CONTRAINTES SUR LA PROTECTION SOCIALE [1]
14 La population « économiquement active » au Brésil croît vite ; pour les seules régions métropolitaines, elle a crû en onze ans (mi- 1991 - mi-2002) de 3,2 M (1,2 M d'hommes, 2 M de femmes) pour atteindre 19 millions (et, dans cette décennie, la croissance des villes moyennes a été supérieure à celle de régions métropolitaines). De plus, le niveau moyen d'éducation de la population active augmente rapidement : par exemple, pour les mêmes régions métropolitaines, le nombre des actifs comptant moins de quatre ans d'éducation est passé de 6 à 4 millions, et celui des plus de 12 ans d'éducation est passé de 2,2 à 3,7 millions, dans la même période. Face à cette croissance, l'emploi (la population active occupée) a augmenté beaucoup moins vite : + 0,9 million pour les hommes et + 1,3 million pour les femmes. Il baisse même pour certaines catégories : les moins de 18 ans (-0,350 million, soit une baisse de moitié) et les travailleurs ayant moins de quatre ans d'études (-2,1 millions).
15 Le Brésil se trouve alors dans une situation inédite de fort chômage. Malgré les difficultés de sa mesure sur l'ensemble du territoire [2], on peut – à l'instar du candidat Lula – admettre comme raisonnables les estimations officielles d'un taux moyen de 8,5 % en 2002 (l'IPEA estime le taux de chômage à 12,4% en avril 2003 dans les RM) [1]. Le chômage est un peu plus élevé (1 à 2% selon les mois) pour les hommes que pour les femmes, et surtout chez les jeunes de moins de 25 ans (le double de la moyenne), et il est particulièrement fort aux niveaux « moyens » d'éducation (9 à 11 ans) [2]. Ces chiffres indiquent que la politique éducative n'a en rien contribué à la diminution du chômage ; elle semble plutôt l'avoir déplacé « vers le haut », vers les niveaux d'éducation correspondant à la fin du secondaire, ce qui est sans doute le signe que la politique éducative a été « en avance » sur les besoins des entreprises, ce qui mène à cette situation paradoxale au regard des théories du capital humain et de la croissance endogène.
16 Devant cette situation de chômage de masse, les politiques d'emploi utilisées dans le passé ou proposées par Lula risquent d'être des gouttes d'eau dans la mer : les « fronts d'urgence » – travaux publics subventionnés très pratiqués dans les années 1980 – n'ont eu un impact sensible que dans des zones rurales et auprès d'une main-d'œuvre très peu qualifiée. L'aide aux micro-entreprises et aux coopératives, particulièrement le micro-crédit, si elle fait l'objet d'évaluations souvent positives et contribue à l'élévation des revenus [3], n'a aucun impact mesurable sur le chômage.
17 La question du chômage (et, indirectement, de la déperdition de cotisations sociales) est au Brésil d'abord une question macro-économique : la croissance du PIB est faible, et le PIB par tête à peine croissant depuis 1997 [4] ; l'investissement étranger est en baisse, et le redémarrage des exportations depuis 2001 se fait sur la base de branches peu créatrices d'emplois. Il est tentant, comme le fait le programme de Lula, de proposer une politique d'emploi fondée sur le développement des branches peu soumises à la concurrence internationale et fortement créatrices d'emploi : bâtiment, services publics, services personnels. Mais se pose alors immédiatement le problème que ces branches sont celles qui présentent le plus fort degré d'informalité [5].
18 Ce qui nous mène à la question de l'informalité. Celle-ci est administrativement définie par le fait, pour un travailleur, de posséder une carteira assinada, carte de travail signée par l'employeur, ce qui implique que celui-ci paye les cotisations sociales. L'emploi informel réunit donc des emplois indépendants (sans contribution), des emplois salariés dans des firmes non déclarées (généralement petites) et des emplois non déclarés dans des firmes déclarées (moyennes ou grandes). L'informalité croît tout au long des années 1990 : elle passe, de 1991 à 2001, de 40,9 à 50,0%. Cela est dû à un double phénomène : la chute relative de l'emploi dans les activités les plus formalisées (particulièrement l'industrie de transformation) [1] et l'« informalisation » de l'emploi industriel (le degré d'informalité y passe de 16,5 % à 28,1 %, avec un pic à 32 % début 2000). Contrairement à une idée reçue, l'informalité dans les services baisse légèrement (55,9% en 1991, 54,3 % en 2001), et est semble-t-il stable (mais avec un fort degré d'incertitude) dans le commerce. Le plus inquiétant est que l'informalité croît surtout dans les firmes formelles : de 1990 à 1999 (selon l'OIT), la proportion de salariés qui contribuent à la Sécurité sociale passe de 74 % à 67 % dans les firmes de plus de dix salariés, contre 45 et 41 % pour les firmes de moins de 10 salariés. Ce qui fait que, de 1995 à 1999, l'emploi salarié formel baisse de façon absolue, pour croître à nouveau (+ 600 000 emplois par an) en 2001 et 2002 (le taux de formalité croît dans tous les grands secteurs depuis juin 2001).
19 L'emploi indépendant, lui, varie très peu : il passe (pour les régions métropolitaines) de 20,1 à 22,8% de 1991 à 1996, pour rester stable ensuite (22,8 % en décembre 2002), ce qui infirme totalement l'idée selon laquelle la libéralisation, les privatisations, etc. provoqueraient une hausse massive de ce type, le plus visible, d'informalité. Le phénomène le plus massif est bien la croissance du salariat informel : pour les seules régions métropolitaines, le salariat sem carteira passe de 20,8 % en 1991 à 27,2 % fin 2002, et cette croissance est quasi linéaire (et donc relativement indépendante de la conjoncture). Mais on peut trouver une raison d'être optimiste dans le fait que, depuis 2001, on assiste à un mouvement de « reformalisation » du salariat dans les zones rurales (ce qui explique la croissance de l'emploi formel notée plus haut).
20 Ces quelques données issues de l'analyse de l'emploi montrent à quel point le financement de la protection sociale est affecté par l'évolution du nombre et de la qualité des emplois : une faible croissance de l'emploi total, et un fort accroissement du chômage ; une baisse du salariat formel au profit du salariat non déclaré (et non du travail indépendant). Ce dernier point est lié à une désindustrialisation relative au profit des segments les plus « informalisés » du tertiaire, mais aussi à une accélération de la « rotativité » des travailleurs, enchaînant de façon accélérée emploi salarié précaire – largement non déclaré – emploi indépendant et chômage intermédiaire. Le gouvernement brésilien n'a pas agi comme le gouvernement argentin, qui a modifié considérablement le droit du travail au début des années 1990 en créant des statuts précarisés n'ouvrant pas de droits assurantiels qui, dès 1997, concernaient un tiers de la main-d'œuvre salariée. Il a tout simplement accentué la tolérance par rapport au non-respect du droit du travail et du droit social, cédé aux pressions des entrepreneurs en réduisant encore les contrôles sur les entreprises et en entamant très peu de poursuites judiciaires.
21 C'est là un des défis politiques majeurs auquel est confronté le nouveau gouvernement. Il y va bien sûr des finances de la protection sociale assurantielle, mais aussi de la nature même des rapports des citoyens à l'État. Faire que le non-paiement des cotisations sociales et, plus largement, le non-respect du droit social soient désormais considérés comme des délits, et parfois des crimes (et pas seulement un mode parmi d'autres de « gestion des ressources humaines »), n'est pas chose aisée. D'un côté, sans qu'on puisse prouver l'existence d'un marchandage explicite entre le patronat et Lula pour que le premier apporte son soutien au second lors de la campagne de fin 2002, il est clair que le chantage à l'emploi, au demeurant fort classique, a porté ses fruits. D'un autre côté, il est vrai qu'il existe au Brésil une « culture de l'informalité » et de la tolérance à son endroit qui marque tout les acteurs sociaux, y compris les syndicats. Mais il n'y a pas là que la conséquence d'une idiosyncrasie tropicale : le fait, par exemple, qu'un travailleur salarié considère – vu le développement de la précarité – comme très peu probable d'avoir une « carrière » dans le salariat formel lui permettant d'acquérir des droits pleins à la retraite, ou encore le fait que les prestations de base (santé de base et retraite de base) ne sont pas conditionnées par des contributions, font que la possession de la carteira assinada n'apparaît pas comme un enjeu majeur à nombre de travailleurs peu qualifiés. On entre alors dans un cercle vicieux, puisque la diminution des recettes produites par cette forte informalité est une des causes principales de la mauvaise qualité des prestations, qui vient légitimer en retour la faible pression sociale pour un meilleur recouvrement des cotisations.
III – SALAIRES ET HIÉRARCHIE DES SALAIRES
22 La discussion sur les salaires est, au Brésil, très polarisée sur le salaire minimum. L'enjeu politique et symbolique de cette question est grand [1], mais l'enjeu économique aussi. En particulier, les retraites de base (qui correspondent plus à un « minimum vieillesse » à la française qu'à des retraites) sont égales au salaire minimum, et cela a toujours été le principal argument avancé pour ralentir la hausse, voire légitimer la baisse, du salaire minimum. Or le salaire minimum est un peu l'arbre qui cache la forêt : le Brésil est un pays de bas salaires, et plus généralement de bas revenus du travail ; bref, un pays de working poor. C'est aussi un pays très inégal, non seulement en termes de revenus, mais aussi de salaires proprement dits, avec une hiérarchie intercatégorielle des salaires allant de 1 à 100 quand on isole une catégorie de cadres supérieurs de direction [2]. En dehors de l'informalisation croissante du travail, la deuxième origine de la crise financière de la protection sociale réside dans cette très faible capacité contributive des salariés du « Brésil d'en bas ».
23 Le salaire minimum a augmenté durant la période Cardoso, passant de 112 reais [3] en mai 1994 à 169 reais en juillet 2002. Mais, durant toute cette période, cette hausse est beaucoup plus faible pour les salariés situés un peu au-dessus du salaire minimum. La hausse du salaire minimum a eu des effets très amortis, et même nuls depuis 1998, sur les salaires moyens [4]. Elle a par ailleurs eu un effet nul sur la structure des revenus : les différentes hiérarchies, selon les genres (les revenus du travail des femmes représentent 70 % de ceux des hommes), selon le degré d'instruction (les « plus de 12 ans » gagnent quatre fois plus que les « moins de 5 ans ») et selon les régions sont strictement stables de 1991 à 2002. De ce point de vue, il s'agit bien d'une décennie perdue. Le pays le plus inégalitaire du monde le reste, du moins en ce qui concerne les salaires, malgré la croissance du salaire minimum.
24 Le seul critère selon lequel la hiérarchie des revenus s'est réduite est le critère de la formalité. En effet, le salaire moyen des salariés com carteira a un peu augmenté (de 685 à 758 R.) de 1994 à 1998 (après trois ans de stagnation) pour baisser ensuite (à 663 R. en avril 2002). Les salariés sem carteira, eux, ont des revenus qui se rapprochent petit à petit de ceux des salariés déclarés, à la hausse jusqu'en 1998 (491 R. en 1994, 603 en 1998), à la baisse ensuite (581 R. en avril 2002). Enfin, les indépendants (conta propria) ont des revenus étonnamment proches de ceux des salariés non déclarés (526 R. en 1994, 650 en 1998, 557 en avril 2002). En résumé, le différentiel de revenus entre les deux catégories d'informels (indépendants et salariés) se réduit très fortement, jusqu'à ne plus représenter que 4 % ; et la différence entre les salariés formels et l'ensemble des salariés et non-salariés informels également, qui n'est plus que de 14 % (du salaire des « informels ») en 2002. Cela a une conséquence majeure : la formalité n'est pas « intéressante » pour les salariés : elle n'est pas associée à des revenus significativement supérieurs (pour les catégories basses) et offre peu d'avantages (en termes de santé et de retraite). Les salariés peu qualifiés et non couverts par un « plan de santé » d'entreprise sont donc fortement incités à négocier avec leur employeur une non-déclaration, quitte à « partager » avec ce dernier le montant des cotisations. Le « cercle vicieux » évoqué plus haut ne s'en trouve que renforcé.
25 Si l'on tient compte d'autres facteurs qu'il serait trop long de développer ici [1], le tableau se confirme : d'une part, les revenus du travail n'ont à peu près pas augmenté en sept ans (1996-2003), une fois passée la forte hausse des très bas revenus issue mécaniquement du plan de stabilisation monétaire de 1994. Ceci obère toute possibilité de développer un système de protection sociale de type contributif, d'autant plus que la part des contributeurs baisse dans la population occupée. D'autre part, l'avantage relatif de la formalité devient quasi nul pour les salariés peu qualifiés. Les working poor, qu'ils soient formels ou informels, sont « trop riches » pour avoir accès aux mesures assistantielles, et pas assez pour accéder aux « plans de santé » et aux « plans de retraite », assurances privées collectives bâties sur le modèle états-unien et qui se sont énormément développées dans les années 1990. La majorité de la population brésilienne se trouve doublement exclue [1] : exclue de l'assurance réellement protectrice, et exclue de l'assistance. Ceci engendre un problème politique majeur : comment imposer aux salariés qui perçoivent plus que le salaire moyen de contribuer (par une hausse des cotisations) à une meilleure protection des working poor alors même qu'ils ont tout intérêt, vue la faible capacité contributive de ces derniers, à laisser « pourrir » la situation de la protection sociale universelle et à développer des plans d'assurance catégoriels ?
IV – PARTAGE DES GAINS DE PRODUCTIVITÉ ET CAPACITÉ CONTRIBUTIVE DE L'ÉCONOMIE
26 L'obstacle majeur que représente la faible capacité contributive de l'économie brésilienne se précise si l'on se penche sur l'évolution et le partage des gains de productivité. En dix ans (début 1991 - début 2001), la productivité a fortement augmenté dans l'industrie manufacturière : +7,19% l'an entre 1990 et 1995 et + 8,31% entre 1995 et 2000 [2]. Mais ce tableau flatteur [3] doit être tout de suite relativisé ; non pas par l'évolution de l'agriculture, qui se modernise très vite (+ 3,01 % de croissance annuelle de la productivité par tête de 1990 à 2000), mais par l'évolution du commerce (- 0,17 % l'an), des services aux entreprises (–0,10%), et des services aux ménages (-0,45%). Comme la part dans l'emploi du commerce (13,01 % en 1990, 15,10% en 2000) et surtout des services (22,32% en 1990, 28,02 % en 2000) a augmenté, alors que celle de l'industrie manufacturière a baissé (de 15,50% à 12,35%), la productivité globale par tête n'a ainsi augmenté que de 1,53 % par an de 1990 à 2000.
27 La question de l'évolution de la productivité apparaît alors comme un déterminant central de l'évolution de la pauvreté : la productivité industrielle croît, effectivement fortement dans les années 1990, surtout jusqu'en 1997 ; mais la répartition des gains de productivité est assez rarement favorable aux salariés de l'industrie [1], dont le nombre baisse relativement et dont le statut se dégrade en moyenne. Dans la grande majorité des cas, selon les branches et les conditions de la concurrence, interne ou externe [2], la hausse de la productivité se traduit soit par une baisse des prix relatifs, soit par une hausse des taux de marge des entreprises, mais pas par une hausse des salaires réels. Mais le plus important, en termes d'emplois concernés, est l'évolution des activités peu productives, dont la productivité baisse (essentiellement : les services et le commerce) : les prix relatifs baissent, les salaires et les profits également. En d'autres termes, ces secteurs ont effectivement servi d'« éponge à emplois », en créant des emplois nombreux, peu productifs et mal rémunérés. Si l'on rapproche de ce modèle certaines branches à hausse très faible de la productivité et fortement pourvoyeuses d'emplois [3], on n'est pas étonné que dans 33 des 42 « secteurs », les salaires de 2000 soient inférieurs à ceux de 1990, dans 4 des 42 à peu près identiques, et dans 5 seulement supérieurs.
28 La montée de la part d'un emploi tertiaire peu productif et du chômage contribue – malgré l'effet répartiteur de certaines politiques sociales, à cette situation remarquable : la stabilité absolue de la proportion de pauvres et indigents, et de la part du revenu national appropriée par les plus pauvres (et par les plus riches) durant la période Cardoso. Le revenu des 50 % les plus pauvres représente 16,5 % du revenu national en 1989, 13,3 % en 1999. La croissance économique, lente et irrégulière, et fondée sur une forte croissance de la productivité industrielle, mais pas du tertiaire, produit donc indéniablement une stabilité de la grande pauvreté et une augmentation des inégalités.
29 Lula insiste sur la question du rôle de la croissance dans la lutte contre la pauvreté dans son programme (p. 29). Mais, quand quelques pages plus loin (p. 34), dans le chapitre intitulé « La dynamique du nouveau modèle », il écrit que ce dernier (fondé sur la relance de la demande intérieure) « est porteur d'une injection (injeção) de hausse de productivité dans la structure existante » et que, « à partir de ces gains de productivité, pourra se mettre en place le cercle vertueux suivant : hausse des revenus des familles des travailleurs, amenant une hausse de la consommation populaire, qui renforce à son tour les investissements, avec une nouvelle hausse de la productivité, le cercle se fermant par une élévation du revenu des familles de travailleurs », on peut souligner que le postulat du lien : hausse de la productivité - hausse des salaires n'a rien de fondé, sauf à en préciser les conditions politiques. Comme une hausse graduelle du salaire minimum est totalement inopérante, ne reste qu'une solution : une hausse très forte et très brutale du salaire minimum, avec une action volontariste sur les bas salaires, doublée d'une contrainte à la formalisation. La capacité politique de Lula à tenir une de ses promesses électorales essentielles (le doublement du salaire minimum durant son mandat) sera le test permettant d'augurer de la « réussite » de son gouvernement, non pas tant d'un point de vue rhétorique et spectaculaire (comme le plan « faim zéro ») que du point de vue du financement de la protection sociale et de l'inflexion du modèle d'accumulation vers le développement du marché intérieur.
V – QUELLES MARGES DE MANŒUVRE ?
30 Les discours les plus divers entourent la question de l'état des finances de la protection sociale au Brésil. En général, des déficits catastrophiques sont avancés, pour clore le débat aussitôt ouvert : dès lors que Lula s'est engagé à honorer les échéances de la dette publique, les marges de manœuvre sont presque nulles. Or, le débat mérite d'être affiné, ce qui suppose une analyse relativement « serrée » sur le plan technique. Sans la mener ici, on peut illustrer la complexité de ce débat en soulevant trois points.
- Les budgets de la protection sociale sont totalement « éclatés », particulièrement en ce qui concerne les dépenses assistantielles. Par exemple, le programme « Bolsa Escola » [1], programme de subsides aux familles pauvres (percevant un revenu par tête inférieur à un demi-salaire minimum) sous condition d'assistance scolaire de leurs enfants de 7 à 14 ans, relève d'un « Fonds de combat et d'éradication de la pauvreté » du ministère de l'Éducation et de la Culture. Il concerne (en 2002) 10,7 millions d'enfants. Un autre programme, touchant une partie du même public (700 000 enfants de 7 à 14 ans effectuant des travaux insalubres ou pénibles), le « Programme d'éradication du travail infantile », dépend du « ministère de la Prévoyance et de l'Assistance sociale » (MPAS). Un troisième programme (Auxilio-Gas) n'a en apparence rien à voir : il est géré par le ministère des Mines et de l'Énergie, est financé par une taxe sur les carburants, et est censé contribuer à l'achat de « gaz de cuisine » par les familles pauvres (4,8 millions de familles en 2001, 9,3 en 2002). En fait, il s'agit d'une allocation [2] versée à toutes les familles percevant la Bolsa Escola. On a donc trois sources de financement, trois canaux de distribution pour des allocations destinées aux mêmes bénéficiaires. La rationalisation de ces mesures d'assistance est en cours depuis la mi-2002, à travers l'établissement d'un Cadastro Único [3], censé limiter les dérives clientélistes.
- Il peut y avoir des différences énormes entre les dépenses votées et celles qui sont effectivement réalisées. Dans l'exemple cité de la « Bolsa Escola », en 2001, seulement 34,7% des fonds votés ont été effectivement dépensés « à cause des difficultés initiales de mise en place du programme » [4], ce qui fait que le budget de l'ensemble de l'éducation n'a été exécuté qu'à 86,5 %. L'examen fastidieux de l'« exécution budgétaire des dépenses sociales fédérales » [5], qui comporte près de 300 lignes, révèle des choses surprenantes ; si les trois quarts environ des lignes de crédit sont « exécutées » à au moins 95 %, d'autres semblent avoir un rôle essentiellement cosmétique [6]. Cependant, il ne semble pas y avoir de logique unique à ces écarts, et une enquête au cas par cas serait nécessaire.
- Les crédits, les dépenses et les éventuels déficits sont relativement bien connus au niveau fédéral ; par contre l'information est très parcellaire au niveau des États fédérés et des municipalités. Si la décentralisation de la gestion des programmes sociaux ne s'est pas toujours accompagnée du report sur l'instance locale de la charge du financement, il n'en demeure pas moins qu'elle a accru les inégalités géographiques (« il vaut mieux être pauvre dans une ville riche ») sans qu'on puisse préciser exactement dans quelle mesure.
32 Ce « brouillard » comptable qui entoure les dépenses et les recettes de protection sociale redouble le flou idéologique et politique entourant la notion de « droits sociaux » au Brésil. Depuis la constitution de 1988 et la loi sur l'assistance de fin 1993 (« LOAS »), celle-ci mêle, de façon très confuse, des droits fondés sur une base contributive et d'autres qui ne le sont pas ; et ces derniers regroupent eux-mêmes des droits purement assistantiels (conditionnels et personnalisés), et d'autres qui sont très proches de la conception beveridgienne : attachés à la citoyenneté, non personnalisés, et dont la conditionnalité ne repose que sur le revenu ou le lieu de résidence. Cela a pour conséquence que la notion de déficit ou d'excédent de la Sécurité sociale en général n'a guère de sens ; de multiples dépenses, liées non seulement aux politiques scolaires, mais aussi aux politiques urbaines (les dépenses d'assainissement des eaux et des égouts par exemple), aux politiques culturelles ou agricoles (des crédits aux petites exploitations) sont rangées dans les « dépenses sociales ». Il n'est dès lors pas étonnant que le budget fédéral ou local finance une grande part des dépenses sociales.
33 Cela est vrai même si l'on se limite aux risques sociaux qui, dans la tradition « bismarckienne » sont financés par des cotisations (santé, retraite, chômage [1]). Un déficit ne signifie alors qu'une dotation budgétaire insuffisante, qui ramène elle-même à une double difficulté politique : celle d'accroître la part contributive dans le total des recettes ; et celle d'accroître la part des dépenses sociales dans le total des dépenses budgétaires.
34 Globalement, les marges de manœuvre dépendent donc de choix politiques, et non comptables. Il convient de differencier deux niveaux d'analyse. D'un côté, il existe un problème que l'on peut cerner et identifier, objet de nombreux débats au Brésil : le problème des retraites. De l'autre, il y a le problème général des autres dépenses sociales, des choix des modes de financement (cotisations ou dotations budgétaires) et de la possibilité de, simultanément, augmenter les recettes et les dépenses, et développer l'idée que les droits sociaux sont fondés sur le caractère de salaire mutualisé des ressources. Ce deuxième aspect formera le dernier point de cet article ; mais une brève réflexion sur les retraites est tout d'abord nécessaire.
VI – LA QUESTION DES RETRAITES
1. Le secteur privé
35 La question des retraites est, au Brésil comme ailleurs, une question qui pèse sur tout le débat entourant la protection sociale ; pas plus qu'ailleurs, le gouvernement brésilien n'a été inconséquent à ce propos. Mais, contrairement à la plupart des pays latino-américains, le Brésil a refusé de passer d'un système de retraites par répartition à un système par capitalisation, non pas tant pour des raisons de principe (idéologico-politiques) qu'à cause du coût de la transition [1]. Le problème majeur est que les recettes diminuent (depuis 1998), alors que les dépenses augmentent légèrement. La « probabilité de contribution aux régimes de retraite de l'INSS [secteur privé] ou aux retraites de la fonction publique » a baissé de 55,4 % en 1992 à 46,4 % en 1999 pour les hommes, et reste stable à un bas niveau (26,4 et 26,6) pour les femmes [2]. Autrement dit, les trois quarts des femmes et plus d'un homme sur deux – parmi les actifs occupés -, ne cotisent pas, et n'auront pas de droits « contributifs » à la retraite.
36 Le déficit de la « Prévoyance sociale publique » (Previdência) [3] ne devient significatif (0,10% du PIB) qu'en 1996, ce qui est tout à fait étonnant, étant donné d'une part que l'emploi salarié formel et les salaires stagnent depuis 1991, et que la population commence à vieillir dès le milieu des années 1980 [1]. En 2001, ce déficit atteint 1,08% du PIB ; ce déficit est dû d'une part au vieillissement de la population, d'autre part à l'augmentation de la part de la population âgée bénéficiaire de retraites ou pensions [2]. En d'autres termes, le déficit des retraites privées a été contenu jusqu'en 1996 grâce au niveau très bas du salaire minimum et à la baisse de la proportion des urbains jouissant d'une retraite contributive, et ceci malgré la hausse du nombre des retraités ruraux et du niveau de leurs retraites, et la réduction de la part de la population occupée contribuant aux retraites. Mais cette situation atteint en 1997 ses limites (le rapport : contributeurs/bénéficiaires passe de 2,4 en 1991 à 1,7 en 1997). Face à cela, le gouvernement Cardoso a fait voter, en 1998 et 1999, des lois portant essentiellement sur trois points. Tout d'abord le remplacement de la « retraite pour temps de service » (35 ans pour les hommes, 30 pour les femmes) par une « retraite pour temps de contribution » (mêmes durées) ; en fait, le « temps de service » incluant le travail informel, était absolument invérifiable, et reposait sur des déclarations sur l'honneur. Ensuite la modification de la période de référence pour le calcul des retraites [3]. Enfin l'introduction, pour le calcul de la retraite, d'un fator previdenciario qui tient compte non seulement du niveau des cotisations passées, mais de l'espérance de vie au moment de la retraite.
37 Passons sur le deuxième point (qui pénalise surtout les salariés ayant des carrières progressives) et même sur le troisième (pour l'instant, la différence d'espérance de vie prise en compte est la différence hommes-femmes). Le premier point, lui, est d'une importance majeure : il s'agit de passer d'un système mi-beveridgien (les retraites égales au salaire minimum pour tous ceux qui ont eu des carrières informelles, ou alternant travail formel et travail informel) mi-bismarckien, à un système totalement contributif (bismarckien). Au regard de l'« équité », on peut s'en féliciter : les cotisations serviront à financer les retraites de ceux qui cotisent. Au regard de l'« éthique », le nouveau système tend à pénaliser ceux qui, alternant volontairement ou non formalité et informalité, n'auront pas de droit à la retraite. Le problème est une fois de plus ramené sur la scène politique, à la capacité de l'État à faire valoir le droit du travail, c'est-à-dire à le faire prévaloir sur la tolérance étatique complice d'un patronat cynique, qui continue à argumenter qu'un taux de cotisation de 21 % du salaire (taux des cotisations de la Previdência en 2002) sur un salaire minimum d'environ 60 $ est « insupportable ».
38 Cependant, l'essentiel du débat éthique et politique ne se situe pas dans le domaine des retraites contributives, en particulier en milieu rural. Les retraites de base (un salaire minimum) sont le plus efficace moyen de lutte contre la pauvreté au Brésil ; H. Schwartzer et A.C. Querino estiment que, si l'on supprimait ces retraites de base, la proportion de la population sous la ligne d'indigence passerait de 10,4% à 19,8%, et celle qui est située sous la ligne de pauvreté de 26,7 % à 37,2 % [1]. Mais on se heurte au fait que tous les gouvernements depuis quinze ans tirent argument de ce rôle « antipauvreté » essentiel des retraites de base, alignées sur le salaire minimum, pour refuser une forte hausse de ce dernier. Or, il paraît difficile de faire contribuer les catégories qui fournissent les plus gros contingents de bénéficiaires de ces retraites minimales (en particulier la petite paysannerie) à leur financement [2]. Ce type d'argumentation ne peut mener qu'à une conclusion : il devient nécessaire de dissocier les pensions de base du salaire minimum si l'on veut élever sensiblement ce dernier. Or, le principe de l'égalité entre les deux est affirmé dans la Constitution de 1988, et cette dissociation « aurait une forte visibilité, et un prix politique élevé que devrait payer le gouvernement, car dans le passé l'inflation a implacablement érodé les prestations » [3]. C'est donc un défi politique majeur du gouvernement de Lula : faire admettre une moindre augmentation des retraites de base que du salaire minimum, au nom du fait qu'il s'agit d'une des conditions pour accroître les recettes contributives (avec la « reformalisation » du salariat). Bien sûr, cela suppose un climat de confiance politique tel que « une moindre augmentation » ne soit pas prise pour « une diminution ».
39 Mais le débat politique semble polarisé sur les aspects comptables du problème des retraites. D'un côté, sur la question de l'évasion parafiscale, d'une façon quelque peu ritualisée [1] ; d'un autre côté, le gouvernement Lula a mis en débat au Parlement, le 25 avril 2003, une série de mesures visant à augmenter les recettes et diminuer les dépenses, dont les principales sont [2] : soumettre les retraites des pensionnés imposables à cotisation (11 %) ; mettre en place un plafond des retraites (10 salaires minimums, pour le privé comme le public) ; mettre en place une « décote » de 5 %, par année manquante pour tous ceux qui prennent leur retraite avant l'âge légal ; réduire les pensions de réversion des veuves de 100 % à 70 %. Ce type de mesures, assez classique, est finalement assez proche de ce qu'a connu l'Europe occidentale il y a quinze ou dix ans. Les défenseurs de la réforme font valoir que ces mesures feraient « gagner » 61 milliards de reais dans les dix prochaines années [3]. Mais pas un mot n'est dit (hormis le paiement des dettes à l'INSS des grandes entreprises) des deux principaux problèmes : comment stopper la spirale de l'informalisation du salariat, et du consensus opportuniste entre employeurs et salariés sur la non-déclaration des salariés ; et comment faire retrouver au salaire minimum son rôle originel de salaire, partiellement socialisé (et donc soumis à cotisation), permettant effectivement à un adulte actif de vivre dans des conditions acceptables, et non d'indicateur limite de survie servant de base à l'établissement de prestations minimales. Les discours parfois ironiques, parfois énervés, de Lula [4] passent à côté du principal problème : que signifie un système de retraites contributives dans une situation de déstabilisation accélérée du salariat, de rotation rapide entre formalité et informalité, et de tolérance accrue des institutions face au délit d'évasion parafiscale (au nom de la compétitivité). À poser le problème des retraites sans poser celui qui le fonde, le problème du bouleversement des formes du salariat, le gouvernement de Lula risque de s'enfermer dans un échec bien plus grave que celui qui polarise actuellement l'attention : celui de la réforme des retraites du secteur public.
2. Le secteur public
40 La question du déficit des retraites publiques est souvent annoncée comme le « talon d'Achille » de la politique sociale brésilienne, et leur réforme comme « la principale tâche du gouvernement Lula en 2003 » [1]. Ceci n'est pas exagéré : avec seulement 909 000 cotisants (contre 18,8 millions pour le secteur privé), le régime des retraites de la fonction publique connaît en 2001 un déficit de 4,2% du PIB [2] (contre 1,08% pour le privé) ; les dépenses sont huit fois supérieures aux cotisations [3] !
41 On peut, évidemment, avoir face à cette situation des positions « de principe », c'est-à-dire rappeler [4] que « l'origine du traitement octroyé aux fonctionnaires publics est qu'ils le restent durant toute leur vie, comme actifs aussi bien que comme inactifs », que la retraite « constitue un revenu différé », et que « l'idée d'égalité de traitement [avec le privé] est inadéquate, et (...) qu'il n'y a pas lieu de traiter de façon égalitaire des situations inégales ». Mais ces positions apparaissent vite comme étroitement corporatistes [5]. Le gouvernement précédent a remis en cause les cas les plus scandaleux, dont la presse a fait ses choux gras (les « maharadjas »), de retraites de hauts fonctionnaires qui, après quelques années d'activité, touchaient plusieurs milliers de dollars mensuels, et a éliminé des régimes spéciaux (comme celui des professeurs d'université) assez indéfendables [1]. Mais le problème est plus ample. D'un côté, depuis une quinzaine d'années, les gouvernements brésiliens se sont refusés à faire apparaître comme coût de la fonction publique des cotisations réalistes de retraite. Cela a permis de quasiment maintenir l'emploi public [2] pour des raisons en partie clientélistes, et de reporter – au niveau comptable – cette charge sur le budget général. D'un autre côté, un gouvernement (Cardoso) soutenu par une coalition hétéroclite a utilisé cette méthode pour se concilier les bonnes grâces d'une haute fonction publique parmi les mieux payées du monde, et d'une fonction publique de niveau moyen ou bas très peu efficace, peu soucieuse du bien public et mal payée, mais utilisant sa position statutaire pour avoir accès à des avantages sociaux minimaux, mais sûrs.
42 Ce débat sur la fonction centrale de l'emploi public dans la reproduction des mécanismes clientélistes est difficile à lancer, pour un gouvernement politiquement fragile, qui préfère focaliser l'attention sur un programme « faim zéro » dont le budget est vingt-deux fois inférieur au déficit des retraites publiques.
43 Pour synthétiser sur cette question des retraites en deux points, on peut dire :
- D'une part, que la marge de manœuvre est potentiellement très élevée en ce qui concerne les retraites privées. Un forte hausse du salaire minimum aurait des effets importants sur le potentiel contributif des bas salaires (jusqu'à deux salaires minimum environ, voire trois). Et, surtout, un renversement de la tendance à l'informalisation du salariat permettrait, à elle seule, d'éliminer le déficit des retraites du secteur privé. Tout le problème est un problème de rapports de force à ce niveau : des mesures – et surtout des pratiques – coercitives et volontaristes allant dans le sens de l'effectivité du droit peuvent aussi bien pousser à une forte pression (syndicale en particulier) en direction de la formalisation et la continuité des contributions, qu'à l'exclusion de toute retraite de la majorité de la population travailleuse (puisque seul le temps effectif de contribution sera, à terme, pris en compte) si cette pression est insuffisante.
- D'autre part, la question des retraites publiques ne peut être résolue sans un débat politique de fond sur la rhétorique des « droits acquis », et sur le rôle qu'elle a historiquement joué – avec le suremploi dans la fonction publique – dans les alliances politiques à base corporative et clientéliste. Si chacun en est convaincu, reste à trouver les contreparties pour alimenter la « négociation » annoncée par Lula. Et là, plus que l'argent, c'est l'imagination politique qui semble faire défaut. S'il semble politiquement possible d'augmenter, par exemple, les recettes du système de santé par une augmentation des taxes sur les entreprises [1], on imagine mal que de telles hausses puissent être légitimées par la situation des retraites du secteur public. L'allongement et l'homogénéisation des durées de cotisation, la création d'un budget séparé de la protection sociale de fonctionnaires publics et l'augmentation des dotations ex ante à ce budget, l'interdiction du cumul des retraites publiques et d'une activité salariée, sont des mesures qui semblent urgentes, et éthiquement pertinentes. Elles sont politiquement extrêmement difficiles, et le gouvernement Lula, s'il les prend, sera immédiatement taxé par l'opposition interne au PT de donner des gages au FMI, au patronat brésilien, etc. [2]. Ne pas les prendre (selon un calendrier planifié sur plusieurs années) serait pourtant un suicide politique [3].
VERS UNE PROTECTION SOCIALE MUTUALISTE ET UNIVERSELLE ?
45 L'affirmation selon laquelle les droits sociaux sont constitutifs de la citoyenneté est claire et forte dans la Constitution brésilienne de 1988. Et, pour le pouvoir politique, respecter ce qui apparaît comme un contrat avec la société peut légitimement représenter un impératif catégorique, plus fort même que le paiement de la dette extérieure. Cependant, cette affirmation reste bien vague, si l'on ne précise pas le contenu de la notion de « droits sociaux ». Or, les droits sociaux sont de trois types, bien différents :
46 Droits 1 : Droit à l'accès à des services collectifs (sous condition d'affiliation et de cotisation), soit complètement gratuits, soit assortis d'un « ticket modérateur » (à l'image des soins de santé non vitaux dans la plupart des pays européens). Ceci peut concerner la santé, mais aussi d'autres biens et services (liés en particulier à l'enfance).
47 Droits 2 : Droit à un revenu de remplacement (maladie, maternité, retraite) proportionné non pas à la contribution effective, mais à l'assiette de cette contribution.
48 Droits 3 : Droit à des biens ou services délivrés sans condition de contribution, mais sous condition de ressources (c'est-à-dire qu'ils sont délivrés à bas prix, ou gratuitement, au-dessous d'un plafond de ressources) et droit à des allocations également sous condition de ressources (par ex. des bourses scolaires, des allocations familiales).
49 Ces trois types de droits entraînent indirectement une redistribution des revenus. Les « Droits 1 » parce que la consommation de ces biens et services, même si elle n'est pas strictement la même dans toutes les catégories de population, croît moins que proportionnellement aux revenus. Les « Droits 2 » parce que les cotisations sont proportionnellement plus basses pour les bas revenus. Les « Droits 3 » parce que leur vocation redistributrice est immédiate : les hauts revenus en sont exclus.
50 Le problème actuel de la politique sociale brésilienne est d'abord de clarifier le statut de chacune des prestations par rapport à cette typologie simple. Le « système unifié de santé » (SUS), prévu par la Constitution de 1988 mais très lent à se mettre en place, en est un exemple. D'un côté, il s'apparente à des « droits 1 », mais des droits sans contrepartie claire. Calqué sur le National Health Service anglais, et financé principalement par des ressources fiscales (taxes sur les mouvements de capitaux, taxes sur les bénéfices des entreprises et budget général), il est fondé uniquement sur un principe de solidarité « verticale » (les hauts revenus payent pour les titulaires de bas revenus) et non sur un principe de solidarité « horizontale » (la mutualisation des risques). La lenteur de l'extension du SUS, le fait qu'il soit régulièrement « sacrifié » lors des arbitrages budgétaires, la mauvaise qualité des soins qui en découle, font que le SUS s'apparente de plus en plus à des « droits 3 », c'est-à-dire à un droit social, certes (et non à une faveur), mais de fait réservé à la population qui n'est pas en mesure de bénéficier de plans de santé complémentaires, lesquels, qu'ils soient individuels ou à mutualisme professionnel restreint, concernent 40 millions de personnes (23 % de la population [1]), les plus stables, formels et mieux rémunérés des salariés. La mise en place d'un « droit du citoyen » (le droit à la santé) s'accompagne d'un renforcement des clivages sociaux, et ce d'autant plus que le revenu de remplacement (indemnités de maladie, de type : « droits 2 ») ne concerne que la partie stabilisée et formalisée du salariat.
51 On pourrait faire le même raisonnement pour la retraite ; même si certaines avancées significatives ont pu avoir lieu pour certaines retraites de type « droits 3 », comme les retraites rurales, les retraites sont « à cheval » entre des droits sociaux de type « droits 2 » (bismarckiens) et de type « droits 3 » (beveridgiens). La réforme récente, en restreignant les retraites à ceux qui ont effectivement cotisé de façon continue sans se donner la possibilité d'une forte contrainte à la formalisation et au paiement des cotisations par les employeurs, risque d'accroître les aspects corporatistes du système de retraites.
52 L'action du gouvernement Lula ira certainement dans le sens d'un élargissement, d'une clarification et d'une dépersonnalisation des « droits 3 » ; c'est-à-dire que les multiples allocations de type assistantiel, disséminées dans des dizaines de budgets, dont les conditions d'attribution sont souvent obscures et discrétionnaires et qui restent le principal vecteur du clientélisme, seront sans doute « mises à plat », rationalisées et deviendront en partie des droits (du citoyen) et non des faveurs. Ceci constituerait la mise en œuvre du principe du « droit à l'assistance » instauré par la loi de décembre 1993, dont les dispositions sont jusqu'à présent très restrictives. Peut-être tout cela fera-t-il que très peu de Brésiliens mourront désormais de faim. Mais limiter à cet aspect ce que Lula a énoncé comme son ambition politique essentielle (« faire du social l'axe du développement ») serait pour le moins décevant.
53 Les problèmes auxquels est confrontée la politique sociale du gouvernement Lula sont des problèmes majeurs, et la conjoncture politique qui pourrait permettre de les résoudre ne peut être qu'exceptionnelle. La question est donc de savoir si une telle conjoncture de très forte autonomie de l'État et de volontarisme dans l'expression d'un « pari » social peut être produite dans les mois ou les une ou deux années à venir.
54 En effet, comme cela a été suggéré plus haut, les problèmes se situent à deux niveaux : celui de la macro-économie et celui de la citoyenneté.
55 En termes de macro-économie, la hausse des bas salaires, à partir d'une augmentation forte et répétée du salaire minimum, est une étape indispensable à la restauration de l'équilibre des comptes de la protection sociale ; comme nous l'avons vu plus haut, elle aurait des effets amortis sur les bas salaires formels (jusqu'à environ trois salaires minimums), mais aurait paradoxalement des effets plus importants sur les salaires informels et les revenus des indépendants (qui sont les plus « indexés informellement » sur le salaire minimum) que sur les salaires formels. Cette mesure n'atteindrait donc sa pleine efficacité, en matière d'élargissement de la base contributive, que si elle s'accompagnait d'une forte hausse du « taux de formalisation ». Par ailleurs, les branches et secteurs qui seraient le plus affectés sont faciles à identifier : services personnels, commerce, industrie de la construction, certains services aux entreprises, et des branches manufacturières comme l'habillement et certaines industries agricoles et alimentaires. Très probablement, il s'ensuivra une certaine distorsion des prix relatifs (par ex. une augmentation des salaires relatifs des cinq millions de domestiques). Mais les effets sur la compétitivité externe devraient être faibles, les branches exportatrices employant très peu de salariés autour de un ou deux salaires minimum. On peut penser, à l'inverse, que cette hausse des coûts salariaux serait un puissant facteur d'incitation aux hausses de productivité dans ces branches, dont on a vu que la productivité était stagnante. Et, globalement, la forte hausse de la demande intérieure engendrée par les hausses des bas salaires devrait être très largement supérieure à la demande induite de produits importés. Tout ceci devrait faire l'objet d'une modélisation fine [1], dont on peut s'étonner qu'elle tarde tant.
56 En termes de citoyenneté, la question est, on l'a vu plus haut, une question politique, certes, mais beaucoup plus top-down que bottom up. Il est devenu commun, en effet, ces dix dernières années, de penser la question de la citoyenneté à partir de l'auto-organisation de la « société civile », qui, forte de son empowerment [2], viendrait définir et revendiquer ses droits sur la scène publique. Or, la question est, dans le Brésil actuel, d'abord du côté de l'État : faire prévaloir l'idée selon laquelle l'évasion fiscale et parafiscale est un délit, et non un droit des employeurs ou la base d'un compromis avec eux, faire comprendre que des droits des travailleurs sans aucune contrepartie de leur part sont éminemment précaires et constituent la porte ouverte à toutes les formes de clientélisme, tout cela suppose un discours politique clair et fort qui aille au-delà de la rhétorique générale et « consensuelle » du programme électoral de Lula. On sait les mesures immédiates à prendre : séparer radicalement les comptes de l'État et ceux de la protection sociale, et créer un compte spécial d'amortissement de la dette représentée par les droits à la retraite dans la fonction publique ; créer un système d'évaluation de l'assiette de la contribution des « non-salariés informels » et négocier un taux de cotisation ; mettre en place un système de contrôle et de contrainte réelle à la cotisation dans les entreprises « formelles ». Et, enfin, repenser toutes les mesures assistantielles comme résiduelles, par rapport à une stratégie de protection sociale universaliste, et non au coup par coup. Mais ceci suppose un débat politique d'ensemble qui, pour l'instant, n'existe pas, tans les problèmes sont fractionnés (la « lutte pour la faim zéro » d'un côté, les retraites de la fonction publique de l'autre). Ce débat est urgent, car les « états de grâce » sont rarement pérennes.
Notes
-
[*]
Professeur, IEDES - Université de Paris I.
-
[1]
Intitulé : Programa de Governo 2002, São Paulo, 2002, 72 p. ; la Comissão de Programa de Governo a été coordonnée par Antônio Palocci Filho, devenu en janvier 2003 ministre de l'Économie.
-
[1]
« Consolidation des lois du travail », de 1943 ; ces lois, votées sous le premier gouvernement Vargas, ont été fortement influencées par la législation fascite italienne. Elles définissent, entre autres, les règles de la représentativité syndicale (unicité du syndicat et nécessité de l'agrément des représentants par l'administration), le rôle « arbitral » de la justice du travail, et instaurent la carteira assinada, sorte de livret de travail qui sera à la base de la définition de la formalité du travail (les salariés com carteira) et du paiement des cotisations sociales. La loi créant la Sécurité sociale (Loi organique des services sociaux) fut promulguée par Vargas le 1er mai 1945 ; on y lit que « tout Brésilien ou étranger légalement domicilié au Brésil, âgé d'au moins 14 ans, qui exerce une activité rémunérée ou perçoit des revenus de quelque source que ce soit, sera assuré obligatoirement par la prévoyance sociale, dans la forme que déterminera la loi ». Cette loi fut abrogée après le départ de Vargas, rediscutée, etc. jusqu'en 1960, date de la promulgation de la LOPS (Loi organique de la prévoyance sociale), qui fixe les grandes orientations (population couverte, institutions, modes de financement...) qui régissent encore la Sécurité sociale. Sur tous les débats, politiques et parlementaires, à ce propos (des années 1930 aux années 1960), cf. Luciana de Barros Jaccoud, Pauvreté, démocratie et protection sociale au Brésil, thèse de doctorat de sociologie, Paris, EHESS, 2001.
-
[2]
Cf. Armando Boito Jr., O sindicalismo de Estado no Brasil, Editora da Unicamp, 1991.
-
[1]
J'entends par là les salariés com carteira pour lesquels l'employeur ne paie que les cotisations minimales (calculées sur la base du salaire minimum), et qui donnent droit à des prestations elles–mêmes minimales (retraite, santé de base). Le reste du salaire est payé « au noir ».
-
[2]
Et, pour la petite histoire, la LBA a, jusqu'à sa disparition en 1995, toujours été présidée par l'épouse du président de la République ; le Brésil n'a pas connu de présidente, ni de président célibataire.
-
[3]
Par exemple le fait que chaque député fédéral disposait jusqu'en 2001 d'un budget personnel, via des « emendas parlementares », financé par des fonds fédéraux, qu'il pouvait utiliser à sa guise, et bien sûr particulièrement à des dépenses « sociales » dans sa circonscription d'origine. L'opacité dans l'usage de ces fonds est telle que les documents statistiques officiels, pourtant très détaillés, renoncent à les recenser. Cf. à ce propos : Políticas sociais – Acompanhamento e análise, Brasilia, IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), n° 5, août 2002, p. 26.
-
[1]
Par exemple, les taux d'intérêt réels très élevés ont été un instrument privilégié par rapport à l'ancrage sur le dollar.
-
[1]
Helmut Schwartzer et Ana Carolina Querino, Non-contributory pensions in Brazil : The impact on poverty reduction, Extension of Social Security Papers, n° 11, Genève, ILO, 2002, p. 3 ; ces auteurs estiment que, en 2000, 40 millions de Brésiliens avaient recours aux plans de santé privés, 90 millions au SUS et 35 millions « ne disposaient, semble-t-il d'aucune couverture en matière de santé ». Selon les premiers résultats des PNAD de 2002 parus en juin 2003, le nombre des contributeurs aux plans de santé aurait baissé de 4 millions en quatre ans, du fait de l'appauvrissement des classes moyennes. Cf. la Folha de São Paulo du 15 juin 2003.
-
[2]
Particulièrement en milieu rural où, de plus, les pensions minimales sont passées de 0,5 à 1 salaire minimum, à la suite de la loi de décembre 1993.
-
[3]
Selon les années, l'indice de Gini fluctue autour de 0,59, ce qui fait que le Brésil (à part certaines années) reste le pays le plus inégalitaire du monde.
-
[4]
Ces chiffres ont été relevés sur la base de données de l'IPEA : www.ipeadata.gov.br ; la ligne de pauvreté est définie comme étant égale à 1/2 salaire minimum per capita ; et la ligne d'indigence comme 1/4 de salaire minimum.
-
[1]
Cf. B. Lautier, L'État-providence en Amérique latine : utopie légitimatrice ou moteur du développement ?, in B. Marques Pereira (coord.), L'Amérique latine : vers la démocratie ? (Bruxelles, Éditions Complexe, oct. 1993).
-
[1]
J'utilise ici principalement les données issues des publications de l'IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, dépendant du ministère de la Planification). D'une part un ensemble de Textos para discussâo (disponibles ainsi que les séries statistiques utilisées, sur le site de l'IPEA : www.ipea.gov.br) ; et d'autre part la revue : Mercado de Trabalho – Conjuntura e análise (particulièrement le n° 21, février 2003). Les données primaires utilisées sont généralement issues de l'IBGE (enquêtes-emplois mensuelles – PME – et enquêtes-ménages – PNAD) ; le défaut de ces dernières est de n'être menées que dans les grandes agglomérations, les « Régions métropolitaines – RM ». Il s'agit là des sept plus grosses agglomérations (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, District fédéral). Si certaines tendances repérées dans les régions métropolitaines peuvent être extrapolées, il n'en va pas de même des niveaux absolus. Le niveau du chômage ouvert, en particulier, est beaucoup plus élevé dans ces « RM ». D'autres données proviennent du DIEESE, organisme d'études regroupant des syndicats et des experts issus du monde académique.
-
[2]
La mesure d'un taux de chômage n'a aucun sens dans les zones rurales, ni dans les villes petites et moyennes. D'une part l'indemnisation est très rare, d'autre part les chômeurs de fait « n'ont pas les moyens » de se déclarer chômeur ; un « petit boulot » de quelques heures par semaine les fait exclure des statistiques du chômage.
-
[1]
Le DIEESE fait des enquêtes très précises à São Paulo, et inclut le « chômage occulte pour cause de découragement » (desalento) et le « chômage occulte pour précarité », pour arriver à 20% en 2002.
-
[2]
9,87 % en mai 2002, contre 5,52 % pour les « moins de 4 ans », 8,01 % pour les « 5-8 ans », et 3,94% pour les « 12 ans ou plus ».
-
[3]
Cf. par exemple, de Luis Henrique Paiva et de Marcelo Galiza, deux articles dans Mercado de Trabalho : Focalização, sustentabilidade e marco legal : uma revisão da literature de microfinanças (n° 18), et Microcrédito : alternativas em evidência no pais (n° 19).
-
[4]
Si l'on se limite à la période Cardoso, le PIB par tête (base 100 en 1994 en reais aux prix de 2001) commence par croître assez vite (103 en 1995, 106 en 1997), baisse avec les contrecoups de la crise asiatique (104 en 1999) pour se stabiliser à 107 en 2000 et 2001.
-
[5]
Sauf les services publics ; mais en ce cas, les cotisations proviennent également des comptes publics.
-
[1]
Qui passe de 22,2 % en 1991 à 16,1 % en 2001 dans les seules régions métropolitaines selon Lauro Ramos : A evoluçâo da informalidade no Brasil Metropolitano : 1991-2001, Texto para Discussâo, n° 914, Rio de Janeiro, IPEA, nov. 2002, résumé dans Mercado de Trabalho, n° 19, p. 51. Selon le même auteur, 26,7 % de la croissance de l'informalité sont dus au déplacement de l'emploi de l'industrie vers le tertiaire, déplacement en partie dû à l'extériorisation juridique de certaines activités de services auparavant comptées comme industrielles (la terceirização).
-
[1]
Lula, dans son programme, évoque (p. 31) un « programme de réajustement progressif du pouvoir d'achat du salaire minimum ». Dans ses déclarations ultérieures, il a parlé d'un doublement (sans préciser l'étalement de la mesure ; les quatre années de son mandat, semble-t-il), puis d'une augmentation de 40 % en deux ans.
-
[2]
Ceci est mesuré précisément à São Paulo. Cf. B. Lautier, L'entreprise brésilienne : une dépolitisation impossible, in R. Cabanes et B. Lautier (dir.), Profils d'entreprise au sud, Paris, Éditions Karthala, 1996.
-
[3]
Les données qui suivent sur les salaires sont extraites de Mercado de Trabalho, n° 21, févr. 2003, déjà cité (p. 43 sq.) et sont toutes exprimées en reais constants à la valeur de janvier 2000 ; le taux de change était alors de 1,80 real pour 1 dollar US (3,00 en mai 2003). Les montants des revenus moyens concernent les « régions métropolitaines ».
-
[4]
On trouvera une discussion très fine des effets d'une hausse du salaire minimum dans Sergei Suarez Dillon Soares, O impacto distributivo do salário mínimo : a distribuiçâo dos rendimentos do trabalho, Texto para Discussâo, n° 873, Rio de Janeiro, IPEA, avril 2002. L'élasticité des revenus par rapport aux variations du salaire minimum baisse tout au long des années 1995-1999. Elle demeure positive pour les tranches de revenus (l'auteur raisonne au niveau du centile) immédiatement au-dessus, mais surtout immédiatement au-dessous du salaire minimum. Ce sont les salariés non déclarés qui sont les plus nombreux à percevoir le salaire minimum (17% en moyenne sur 1995-1999) devant les salariés déclarés (8%) et les indépendants (4 %). Ces chiffres tendent à montrer, en apparence de façon paradoxale, que les variations du salaire minimum déterminent plus les salaires et les revenus informels que les salaires formels.
-
[1]
Comme la diminution progressive de l'écart des revenus entre les régions métropolitaines et les autres parties du territoire, et celle du rapport du salaire moyen au salaire médian.
-
[1]
Cf. B. Lautier, Les politiques sociales au Mexique et au Brésil : l'assurance, l'assistance, l'absence, in B. Lautier et J. Marques Pereira (org.), Brésil, Mexique : deux trajectoires dans la mondialisation, Paris, Karthala, 2003.
-
[2]
Quand la productivité manufacturière est calculée sur la base des enquêtes-industrie mensuelles de l'IBGE (PIM). L'IBGE a récemment changé son mode de calcul de la productivité, et fonde désormais ses données sur les PME – enquêtes emploi mensuelles. D'après l'IPEA, qui se fonde sur ces sources, l'indice de la productivité par tête dans l'industrie de transformation (en moyenne annuelle) est de 147 en 2002 sur une base 100 en 1991. De façon générale, les statistiques concernant la productivité doivent être maniées avec précaution, en particulier parce qu'on peut avoir des variations de 20% d'un mois sur l'autre. J'utiliserai dans tout ce passage les résultats de Regis Bonelli, Labor Productivity in Brazil during the 1990s, Texto Para discussão, n° 906, Rio de Janeiro, IPEA, sept. 2002. Ce texte consacre un long passage (p. 8-9) à la question de la fiabilité des sources.
-
[3]
Les seules branches industrielles qui voient leur productivité baisser sont l'habillement (-0,82 % l'an) et la transformation des plastiques (-1,03 %). Cf. R. Bonelli, texte cité, p. 10.
-
[1]
Dans 12 seulement des 42 branches de l'économie, selon l'analyse très détaillée de Regis Bonelli (texte cité, p. 14-24), dont les plus importantes font partie de la chimie, de la construction de véhicules et des « communications ».
-
[2]
Notons au passage que « aucune corrélation n'a été trouvée entre la croissance de la productivité et plusieurs indicateurs de libéralisation du commerce et/ou les ratios de pénétration commerciale, ou avec leurs taux de change respectifs » (R. Bonelli, texte cité, p. 32) ce qui jette un léger doute sur un des postulats essentiels du néo-libéralisme.
-
[3]
Comme la construction (1,26% de croissance annuelle de la productivité et 6,31 % de l'emploi en 2000) et les transports (respectivement 0,80 % et 3,83 %).
-
[1]
Qui consiste en l'extension à tout le pays de l'expérience (alors qualifiée de « gauchiste » et depuis devenue la coqueluche de la Banque mondiale) lancée par le gouverneur (PT) du district fédéral à partir de 1994.
-
[2]
Faible, puisqu'elle correspond mensuellement au quart du prix d'une bonbonne de gaz ; mais rien n'impose qu'elle soit dépensée à cela.
-
[3]
Dénommé « passeport pour la citoyenneté », établi par les autorités municipales, les versements étant centralisés et effectués par la Caixa Economica Federal.
-
[4]
Políticas Sociais – Acompanhamento e análise, Brasilia, IPEA, août 2002, p. 49.
-
[5]
Ibid., annexe statistique, p. 31-47.
-
[6]
Par exemple, les crédits votés pour l'assurance chômage générale ont bien été dépensés (à 100,2 % en 2001), mais ceux de l'assurance chômage spécifique pour les domestiques l'ont été à raison seulement de 2,4 %.
-
[1]
Plus de 40 % (41,43 % en 2001) des recettes de la protection sociale – dont le total est de 147 milliards de reais courants en 2001 – ont une origine non contributive. Elles proviennent du Cofins (Contribuição Financiamento da Seguridade Social) pour 17,5 % du total des recettes, et 39 % pour la seule santé, ou de multiples taxes affectées, comme la « Contribuição sobre a Movimentação Financiera », qui finance 28 % des dépenses de santé en 2001, ou une partie de l'impôt sur les sociétés. Source : calculs propres d'après Políticas Sociais – Acompanhamento e análise, Brasilia, IPEA, août 2002, annexe statistique, p. 42-47.
-
[1]
Selon V.C. Pinheiro et S.P. Vieira, Reforma da Previdência no Brasil : A Nova Regra de Cálculos dos Benefícios, Conjuntura Social, vol. 10, n° 4, oct.-déc. 1999, p. 51-67, qui synthétisent des études de la CEPAL, de la Banque mondiale, de l'IPEA, et de la Fondation Getulio Vargas, le coût de la transition vers un régime de capitalisation « oscillerait entre 188 % et 250 % du PIB ».
-
[2]
Selon Enid Rocha da Silva et Helmut Schwarzer, Proteção social, aposentadorias, pensões e gênero no Brasil, Texto para Discussão, n° 934, Brasilia, déc. 2002, p. 20.
-
[3]
Les retraites forment environ 86 % des dépenses de « prévoyance », le reste étant lié aux accidents et maladies du travail et à diverses mesures d'assistance.
-
[1]
Les plus de 60 ans forment 7,7 % de la population en 2000, contre 6,1 % en 1980, et cette tendance va s'accélérer. L'IBGE prévoit 21,9 % en 2050, à cause de la hausse de l'espérance de vie, qui est de 64,8 ans pour les hommes, 72,6 ans pour les femmes en 2000, et de la chute de la fécondité, proche actuellement de 2,2 enfants par femme.
-
[2]
Qui passe de 68,8% en 1992 à 76,0 % en 1995, mais « plafonne » à 77,3% en 1999, d'après Rocha da Silva et Schwarzer, texte cité, p. 31. L'augmentation des années 1991-1994 est essentiellement due à la mise en application de l'article de la Constitution généralisant les retraites rurales (on passe de 3,6 en 1991 à 5,8 millions de retraités ruraux en 1994, et 6,6 millions en 2001) et doublant le « plancher » de celles-ci (de 1/2 à 1 salaire minimum). En 2001, d'après le texte cité note 8 de A.C. Querino et H. Schwarzer (p. 7), les retraites minimales (au titre de l'assistance, et égales au salaire minimum) concernent 64,9 % des retraités : 48,3 % en milieu urbain et 98,4 % en milieu rural.
-
[3]
La moyenne des 80 % meilleurs salaires de la période de contribution au lieu de celle des trente-six derniers mois. Cette mesure est la plupart du temps défavorable aux retraités.
-
[1]
Cf. Helmut Schwartzer et Ana Carolina Querino : Non-contributory pensions in Brazil : The impact on poverty reduction, Extension of Social Security Papers, n° 11, Genève, ILO, 2002, p. 37. Ces auteurs montrent également que les retraites « non contributives » jouent un rôle essentiel dans la réduction de l'indigence et de la pauvreté chez les personnes âgées (les indigents sont trois fois plus nombreux chez ceux qui ne les perçoivent pas), mais aussi qu'elles jouent un rôle important dans la réduction des différences interrégionales ; par ailleurs, les « Afrobrésiliens » (38,6 % des plus de 60 ans) ne constituent que 24,3 % des titulaires de retraites contributives. Le fait qu'ils soient « surreprésentés » parmi les bénéficiaires de retraites de base (48,8 %) n'empêche pas que le système de retraites accentue les différences « interraciales » ; comme l'écrivent ces auteurs (p. 32) « ceci est certainement une conséquence de la discrimination économique généralisée pratiquée à l'encontre des personnes de couleur au Brésil ».
-
[2]
Cf. ibid., p. 40 : « Il est absolument nécessaire d'éviter les contributions monétaires en milieu rural. Cela est dû au manque absolu de revenu monétaire de l'économie paysanne, qui, par définition, ne dispose que d'un surplus faible ou nul. » La contribution prend actuellement la forme d'une taxe de 2,2 % sur la première commercialisation des produits agricoles.
-
[3]
Ibid., p. 45.
-
[1]
Ainsi, selon la Folha de São Paulo du 15 mai 2003, l'Institut national de Sécurité sociale (INSS) a publié une liste de 176 000 entreprises qui ont des arriérés impayés de cotisations, pour 64 milliards de reais (153 milliards de reais si l'on ajoute toutes les amendes, intérêts de retard, etc.). Parmi les entreprises débitrices (la première est la Transbrasil, compagnie aérienne en faillite) se trouvent d'importantes banques, la Petrobras, des administrations locales, etc. Le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne se sont pas aussitôt, accablées par la honte, acquittées de leur dette. Elles ont fait pression au Congrès pour obtenir (ce qui fut fait le 29 avril 2003) un abandon des poursuites sous condition d'entrer dans un processus de renégociation des dettes fiscales et parafiscales, le « Refis ».
-
[2]
Cf. « As propostas de Lula para a reforma da Previdência », Vejaonline.com.br du 25 avril 2003.
-
[3]
Cf. Mauricio Lima, « Dez anos em poucos meses », Vejaonline.com.br du 16 avril 2003.
-
[4]
Par exemple, à propos des critiques émanant de son propre parti concernant ses propositions du 25 avril, il déclarait à Aracaju : « Tout le monde a le droit d'être contre, mais, s'il vous plaît, dites-moi où on va trouver l'argent. Si quelqu'un a une formule magique, cachée dans la poche ou le tiroir du président d'un quelconque parti ou député, pour l'amour de dieu, qu'il me la donne (...) Tout le monde aimerait présider un pays avec la population de l'Uruguay et le PIB des États-Unis. Mais ce n'est pas possible ; on doit gérer avec l'argent qu'on a » (Fabio Zanini et Fabio Guibu, Lula pede « fórmula mágica » aos críticos des reformas, Folha de São Paulo, 7 mai 2003).
-
[1]
Titre d'un article d'André Lahóz dans Exame du 14 janvier 2003.
-
[2]
Pour l'ensemble des « trois niveaux de gouvernement », État fédéral, États fédérés et municipalités ; en termes relatifs, c'est au niveau des États fédérés que ce poids est le plus important. En 1998, cinq États consacraient déjà plus de 30 % de leur budget aux retraites de leurs fonctionnaires. Cf. S. Draibe, 2002, p. 47. Pour 2002, des chiffres provisoires (même source que la note précédente) font état d'un déficit du régime des retraites de 72 milliards de reais, soit 6 % du PIB, dont 54 imputables au secteur public. Par comparaison, le budget fédéral de l'éducation est de 18 milliards de reais en 2002, et le programme « faim zéro » de Lula est évalué à 2,5 milliards pour 2003.
-
[3]
Cf. E. Rocha da Silva et H. Schwarzer, texte cité, p. 14.
-
[4]
Comme Rosa Maria Marques, A Previdência Social no governo Lula – os desafios de um governo democrático popular, disponible auprès du Département d'économie de la PUC - São Paulo et de la Faculté de sciences économiques de l'Université Pierre-Mendès-France de Grenoble, mars 2003, p. 14-15, dont sont extraites les citations qui suivent.
-
[5]
Ce qui n'est pas sans poser d'énormes problèmes politiques, puisque les syndicats les plus importants et les plus intransigeants de la CUT (les « chiistes ») – la base militante du PT – regroupent principalement des fonctionnaires publics.
-
[1]
Malgré tout le « battage » médiatique fait sur cette question, le nombre des personnes qui touchent des retraites supérieures au « plafond » proposé par le gouvernement de Lula (17 000 reais annuels) en avril 2003 est infime : 279 retraités ou pensionnés de la fonction publique sur 1,3 million. Le problème est à l'évidence ailleurs (cf. Julianna Sofia, Só 279 ganham mais que teto da reforma, Folha de São Paulo, 12 mai 2003).
-
[2]
5,713 millions en 1990, 5,672 en 2000, selon Regis Bonelli, texte cité, p. 11.
-
[1]
Comme le gouvernement l'a fait en mai 2003 à travers la hausse des taxes du « Cofins » pour les banques, et de la « contribution sociale sur le bénéfice net » des entreprises de services.
-
[2]
L'appel à la grève générale de la fonction publique à partir du 8 juillet 2003 en témoigne.
-
[3]
Le programme électoral de Lula (p. 20) est pour le moins évasif sur cette question. Il dit « respecter le principe du droit acquis et combattre les privilèges » et devoir « rechercher la négociation d'un contrat collectif du secteur public, où les aspects de droit du travail et de protection sociale devront être l'objet d'une négociation ample et démocratique ». Rien de plus précis.
-
[1]
Selon la « PNAD » de 1998, cf. note 1, p. 531.
-
[1]
Ce qui n'a pas été fait depuis l'étude de l'IPEA de 1987 : J.M. Camargo, R. Maia et R. Saldanha, Elevação do salário mínimo : uma quetão economica ou politica ?, Brasilia, IPEA, sept. 1987, qui concluait qu'un doublement du salaire minimum entraînerait une hausse de 15,3 % de la masse salariale totale et de 4 % de la part des salaires dans le PIB.
-
[2]
Empowerment : voir note 1, p. 503.