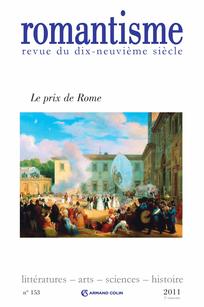1 La relation de Charles Gounod (1818-1893) avec le prix de Rome n’est pas seulement celle de toute une carrière, ni même de toute une vie puisqu’elle a commencé dès avant sa naissance... Son père, François Gounod (1758-1823), peintre de talent, condisciple de Carle Vernet dans l’atelier de Lépicié, tenta deux fois le concours et n’obtint qu’un second grand prix en 1782 (il n’y eut pas de premier). Trois années de suite il se vit décerner le prix d’expression Caylus sans parvenir à la consécration suprême. C’est le sort qui joua en sa faveur : la mort de Jean-Germain Drouais (1763-1788), le lauréat de 1784, avant la fin de son séjour à la Villa Médicis, ayant laissé une place vide, le comte d’Angiviller obtint d’y envoyer François Gounod. Il y resta quatre ans. Bien longtemps après, en avril 1862, quand son fils visita l’église de Saint-Paul-hors-les-murs où Raphaël a son tombeau, il eut la surprise de lire, gravé sur la colonne gauche : « François Gounod, 1791 [1] ».
2 Le décès de François Gounod en 1823, explique peut-être que son fils aîné, Urbain (1807-1850), n’ait pas tenté le prix de Rome d’architecture afin de ne pas laisser à sa mère la charge de Charles encore adolescent. En compensation (?) il se verra décerner, lors de la séance publique de l’Académie royale des beaux-arts du 7 octobre 1837 (qui couronnait les lauréats du prix de Rome), la Grande médaille d’émulation destinée au plus grand nombre de succès dans l’École d’architecture. Coïncidence (?), cette même année 1837, son frère Charles avait tenté pour la première fois le concours de Rome après quelques mois seulement passés dans les classes d’Halévy pour l’harmonie et de Lesueur pour la composition. Il y avait été bien préparé auparavant par l’enseignement d’Antonin Reicha (1770-1836).
LA CANTATE DE ROME : CANALISER L’INVENTION
3 À la veille de ses dix-neuf ans, il remporta d’emblée un second grand prix pour la cantate Marie Stuart et Rizzio. La lecture de cette partition inédite suffit à se convaincre de la qualité de l’invention. Mais on comprend que le premier grand prix ait été attribué à Louis-Désiré Besozzi (1814-1879), son condisciple dans la classe de Lesueur. La comparaison entre les deux partitions est frappante, en effet. Chez Besozzi tout est en place, aisé à lire et à suivre, efficace ; les idées sont nettes, la musique respire et fait valoir les voix sans les fatiguer. La cantate de Gounod est beaucoup plus ambitieuse, la matière plus serrée avec plusieurs idées par page. L’écriture, volontiers complexe, tonalement et rythmiquement, se ressent de l’influence de Reicha. La partie orchestrale est assez chargée, le style très romantique avec un souci du drame plus que des interprètes. L’influence de Lesueur (aussi bien que de Berlioz ou d’Halévy) est sensible dans le rôle expressif des interventions instrumentales. On doit en conclure que le prix de Rome n’est pas tant un laminoire esthétique qu’une école d’efficacité : il prépare à la composition lyrique, domaine où il faut écrire vite des partitions aussi aisées à maîtriser pour les interprètes qu’agréablement efficaces pour le public.
4 La seconde tentative, en avril 1838, ne sera pas plus fructueuse. Le sujet de La Vendetta, dû à la plume du comte Amédée de Pastoret (1791-1857), un académicien ami de la famille Gounod, aurait pu être un fait divers contemporain : un homme a été assassiné et sa veuve demande à l’enfant de venger son père. C’est Georges Bousquet (1818-1854) qui remporta le premier grand prix. Si l’on ne peut exclure que la mort de Lesueur ait joué en la faveur d’un élève de Berton, la clarté des idées, sinon des formules, conduites jusqu’au bout, la netteté du plan, avaient de quoi séduire un jury. À défaut d’originalité, sa cantate faisait preuve d’un talent artisanal qui méritait d’être distingué. Gounod, de son côté, a fait de nets progrès : il traite bien les voix, même si l’écriture reste un peu tendue vers l’aigu, ne surcharge plus, maîtrise la forme et l’on peut concevoir sa déception de ne pas l’avoir emporté, tant il est clair que la qualité d’invention est bien supérieure chez lui. Mais, cette fois encore, son souci de singularité et de dramatisme l’a rendu suspect. On lui demandait un devoir, il a rendu une scène d’opéra naturaliste avant la lettre. Curieusement, quarante ans plus tard, en écrivant la musique de l’opéra Le Tribut de Zamora, Gounod semble s’être proposé pour but de montrer à la jeune génération qu’on pouvait traiter un sujet naturaliste en n’employant que des moyens classiques... Et il y échoua pour la raison inverse. Pour atténuer son dépit, sa mère lui proposa une excursion en Suisse. Il y avait sans doute un autre but : recueillir des chants traditionnels (ces ranz des vaches si admirés alors) car les cantates de Rome comportaient souvent un élément populaire. C’était le cas de La Vendetta. Ils en furent quittes pour se contenter d’admirer les glaciers et les vallées car ils n’entendirent, en fait de couleur locale, que des airs de Norma et du Domino noir... « Paris veut entrer partout » écrivit Madame Gounod à son fils Urbain [2].
5 La troisième mise en loge, en mars 1839, fut la bonne : Gounod remporta le premier grand prix avec la cantate Fernand. Sa mère, après avoir attendu le résultat dans des affres dont elle se souviendra longtemps, lui offrira la partition d’orchestre de Don Giovanni. Gounod le rappelle avec émotion dans ses Mémoires. C’est cette partition qu’il serrera contre sa poitrine dans le tableau d’Élie Delaunay (1828-1891) quarante ans plus tard. Quand on sait que Gounod devait sa vocation de compositeur à une représentation de Don Giovanni et que cet ouvrage restera le plus proche de son cœur jusqu’à ses derniers jours, il n’est pas sans signification de le voir ainsi associé de si près au prix de Rome. La cantate, qui mettait cette fois trois personnages en scène, était également due au comte de Pastoret. Devant Grenade assiégée par les Espagnols, deux Maures fugitifs, Zelmire et Alamir se trouvent confrontés à Don Fernand qui, tel Zurga dans Les Pêcheurs de perles, sacrifiera son amour et sa vie en faveur des amants. À l’instar de Berlioz traitant Sardanapale en douceur, en 1830, après l’échec de sa dramatique Cléopâtre, Gounod laissa de côté son originalité (celle qu’il avait mise dans le bref Agnus Dei à la mémoire de Lesueur exécuté à Saint-Roch en octobre 1838) pour offrir à ses juges la partition qu’ils attendaient. Peut-être a-t-il profité des leçons de son nouveau maître, Fernando Paër (1771-1839), qui succéda à Lesueur : le style est plus italien, et l’écriture des voix mieux centrée. Fernand est plus conventionnel que La Vendetta, moins senti, moins uni, mais sa belle réalisation et ses idées avenantes ne dépareraient pas les succès du jour à l’Opéra ou aux Italiens dont on perçoit l’écho. Ce qui n’empêcha pas Delécluze, chroniqueur du Journal des débats, d’écrire au lendemain de l’exécution publique, le 5 octobre :
Ces divers morceaux ont été écoutés avec beaucoup d’attention, sans que rien cependant ait pu faire juger que le public ait été vivement ému. Cette composition est sagement, trop sagement conçue peut-être ; et si, comme je n’en doute pas, elle remplit toutes les conditions matérielles de l’art, puisqu’elle a fait couronner son auteur, je crois qu’un bon nombre d’auditeurs auraient préféré qu’il s’y trouvât un peu moins de science et plus d’invention et de verve [3].
LE SÉJOUR À ROME : L’ÉMANCIPATION
7 Le 5 décembre 1839, Gounod quitta Paris par la malle-poste en compagnie d’un ami de son frère, l’architecte Hector Lefuel (1810-1881). Au terme d’un voyage touristique en Provence et en Italie du nord, l’arrivée à Rome, le 27 janvier, fut une déception : « Au lieu de la ville que je m’étais figurée, d’un caractère majestueux, d’une physionomie saisissante, d’un aspect grandiose, pleine de temples, de monuments antiques, de ruines pittoresques, je me trouvais dans une vraie ville de province, vulgaire, incolore, sale presque partout [4] » écrira Gounod dans ses Mémoires d’un artiste avant d’ajouter : « J’étais trop enfant pour saisir et comprendre, au premier coup d’œil, le sens profond de cette ville grave, austère, qui ne me parut que froide, sèche, triste et maussade, et qui parle si bas qu’on ne l’entend qu’avec des oreilles préparées par le silence et initiées par le recueillement [5]. »
8 À Rome, où il laisse pousser ses cheveux et sa barbe, Gounod s’émancipe – cela se voit dans l’évolution de sa signature, mais aussi dans sa correspondance avec sa mère où, tantôt pour ne pas l’inquiéter, tantôt pour agir à sa guise, il distingue l’amour filial de la franchise absolue. C’est qu’il a découvert à Rome d’autres amours : celui de Dieu et celui des femmes.
9 Émancipation musicale également car, dès l’arrivée, le souci d’abandonner le style convenu, italianisant, se manifeste à travers la composition (le 4 février) d’un romantique Poco presto e appassionato pour piano dédié à Lefuel. On penserait à Schumann, qu’il ne connaît pas. À peu de jours d’intervalle, il mettra en musique deux poèmes de Lamartine, Le Vallon et Le Soir tout à fait représentatifs de son propre style qu’il vient de trouver, cette éloquence large et intime à la fois. La campagne romaine l’inspire aussi : il y note sur un carnet la future musette de Mireille [6]. Cette conquête d’un style moderne, personnel, se double d’un vif intérêt pour la musique ancienne qui nourrira ce qu’on appellera bientôt le « style rétrospectif » qu’il intégrera, pour l’élargir, à son propre langage. Suivant avec dévotion les offices de la Semaine sainte à la chapelle Sixtine, il a été saisi par l’âpreté des musiques d’Allegri et de Palestrina ; il devait y trouver un écho de l’ascèse des catacombes. Son premier envoi de Rome, sera un Te Deum sans accompagnement pour 8 et 10 voix « dans le style de Palestrina » qui lui vaudra de vigoureuses critiques des membres de l’Institut, critiques sans doute justifiées car on peut supposer que Gounod a contribué à la disparition ultérieure de cette partition.
10 Gounod fera plusieurs rencontres décisives à Rome. Dès son arrivée, celle du directeur de la Villa Médicis, Jean-Dominique Ingres (1780-1867), qui avait bien connu son père et pour qui il éprouvera une tendresse filiale. Mais pas seulement, ainsi qu’il ressort de la lettre qu’il lui adressera le 19 janvier 1854 :
Votre personne et votre art ont jeté plus de lumière dans mon intelligence que bien des partitions célèbres, et si j’ai le bonheur d’en aimer passionnément et d’en comprendre un peu quelques-unes de celles [de Mozart et de Beethoven] que nous aimons tous deux, c’est peut-être encore à ce lumineux contact de mes années de Rome passées auprès de vous que j’en suis redevable [7].
12 L’autre rencontre sera celle de la sœur de Felix Mendelssohn, Fanny Hensel (1805-1847) qui, séjournant en Italie avec son mari et leur fils, était l’hôte des soirées musicales de la Villa Médicis. À travers son interprétation du Concerto italien, elle révélera à Gounod un visage moins austère de Bach et lui fera connaître, outre les sonates de Beethoven (notamment celles Au clair de lune et À Thérèse), ses propres compositions ainsi que celles de son frère. Bientôt cependant, elle constatera à regret dans son journal : « La connaissance de la musique allemande lui tombe dessus comme une bombe sur sa maison, il est possible qu’elle y fasse pas mal de dégâts ». Quand ils se reverront à Berlin, en 1843, elle notera avec soulagement dans son journal :
Nous avons trouvé qu’il s’était beaucoup développé depuis Rome, il est tout à fait doué, d’une intelligence musicale, d’une précision et d’une justesse de jugement qui ne pourrait aller plus loin ; avec cela, ses sentiments sont demeurés fins et tendres. Cette intelligence vivante lui est personnelle, même en dehors de la musique ; c’est ainsi que je ne pouvais sans un réel plaisir l’entendre lire l’allemand et devais m’étonner du talent grâce auquel il avait su s’approprier l’essence du langage. Ainsi, il a lu quelques scènes d’Antigone, et à mon grand étonnement, il a compris [8].
14 C’est qu’entre-temps, après son départ de Rome au printemps 1842, Gounod avait séjourné plus de six mois à Vienne où il avait pu approfondir et mûrir sa connaissance de la musique germanique.
15 Mais il faut revenir un peu en arrière. Le 3 octobre 1840 la cantate Héloïse de Montfort de son camarade François Bazin (1816-1878), qui venait de remporter le premier grand prix de Rome, est exécutée à l’Institut avec un énorme succès. Plus entreprenant, sans doute, que Gounod, il eut la chance de voir sa cantate donnée le même jour sur la scène de l’Opéra, avec l’illustre ténor Duprez ; elle y sera reprise plusieurs fois comme un ouvrage en un acte. Gounod apprendra par sa mère que Richault a acheté la partition pour l’éditer. Mais Mme Gounod, tout en faisant l’éloge de Bazin (« organisé, travailleur »), reste très critique :
Aucune phrase ne m’a paru neuve, ni sensible, ni touchante ; les récitatifs n’ont pas de caractère, ils sont dans le genre des récitatifs italiens dans les maîtres faibles ; il y a dans les chants, dans un duo, dans un trio de grandes réminiscences de La Juive et de Guido. L’orchestre a assez de force, mais une force qui tient du bruit : on devine toujours à l’avance sur quelle note du ton vont aboutir les repos. Bazin a eu de plus l’avantage de conduire son orchestre lui-même [9].
17 Durant leur séjour à la Villa Médicis, les compositeurs lauréats du prix de Rome devaient envoyer une composition religieuse la première année puis, la seconde, des actes d’opéra sur des paroles italiennes. Prenant de haut ce petit exercice de style, Gounod annonça à sa mère qu’il aurait fini en quelques semaines ; il avait choisi des scènes de Romeo e Giulietta ; il y ajoutera, après les vacances, la scène en sextuor des Cantatrici villane quand il apprendra que le règlement exige aussi du buffa. En octobre 1841, le rapport de l’Institut se montrera sévère pour ces pages dont ne subsistent que quelques fragments [10]. Ils suffisent à nous convaincre qu’il y a un monde entre ces pages écrites à la sauvette pour respecter le règlement et la partition du Requiem à laquelle Gounod songe déjà pour la faire exécuter à Berlin. Elle le sera finalement à Vienne à la Carlskirche le 2 novembre 1842.
LE GÉNIE DE ROME : UN ENSEIGNEMENT
18 Mais si l’Allemagne attire Gounod, il repoussera de six mois le moment de quitter la ville éternelle et n’aura de cesse d’y retourner se ressourcer ou en recommandera les bienfaits à ses amis. Car si le prix de Rome est une institution académique, Rome est un enseignement esthétique qui permet aux arts de s’enrichir en se croisant. En témoigne cette lettre du 7 octobre 1846 à son ami le peintre Jules Richomme (1818-1902) :
Ainsi, quand tu seras à Rome, t’engagerai-je fort à ne te point priver de la Capella Papale, où tu trouveras de la musique à fresque tant que tu en voudras : il y a dans les productions de tous ces maîtres une identité merveilleuse qui atteste à quel degré les mêmes idées et les mêmes sentiments les dominaient tous : et il fallait que l’influence de ces idées-là fût bien puissante pour avoir absorbé tant d’individualités, dont la vie, prise isolément, en était si loin. Il n’y a, je le crois bien, cher ami, que les grandes époques pour faire de grandes choses : c’est ce qui nous explique, ce me semble, pourquoi de fort bons chrétiens font aujourd’hui de si mauvaise peinture chrétienne, et pourquoi aussi dans ces temps-là, de fort vilains drôles, emportés par le courant de leur époque, ont fait de l’art catholique admirable, parce qu’ils n’étaient plus guère que les instruments d’une idée universelle qui les entraînait malgré eux [11].
20 Le 26 avril 1847, toujours à Jules Richomme, Gounod adresse une véritable profession de foi à la lumière de laquelle toute sa démarche artistique s’éclaire, qu’il s’agisse du néoclassicisme qu’il pratiquera ou de ce souci, dans ses messes, de parvenir à un style dépersonnalisé :
Il m’a semblé, pour ma part, quand j’étais à Rome, que l’effet propre de ce séjour était précisément celui-là, d’activer et de développer presque à vue d’œil le sentiment et l’amour d’un beau fixe qui ne vous quitte plus quand une fois il vous a saisi et comme investi de toutes parts ; de sorte qu’on a incessamment le besoin de boire à cette source intarissable, de vivre de cette vie des grands ancêtres qui porte avec elle-même toute sa garantie, et se concilie si parfaitement avec ce qu’il y a de propre et d’individuel dans le génie et dans le talent : c’est le mélange incessant des qualités personnelles et de cet impersonnel, de cet absolu, qui éclaire et domine toutes les intelligences des maîtres : en un mot, j’y ai clairement senti qu’en fait d’art il faut avoir des parents, et qu’on ne se donne pas la vie soi-même dans l’art, pas plus que pour venir au monde.
22 Gounod retournera à Rome avec sa femme en 1862 ; il y cueillera pour elle des cyclamens « sous ces mêmes chênes verts où, 22 ans avant, je cueillis des violettes que j’envoyais dans mes lettres à ma pauvre chère mère [12] ». Ils rendront visite aux pensionnaires, notamment à Émile Paladilhe (1844- 1926). Quand les tensions conjugales deviendront intolérables, Gounod viendra passer l’hiver 1868/1869 à la Villa Médicis dont son ami le peintre Ernest Hébert (1817-1908) est à présent directeur. C’est à lui que l’on doit ce souvenir du 14 février :
Gounod, de lui-même, déclara qu’il chanterait et jouerait tout ce qu’on voudrait au prochain dimanche, dans le salon de l’Académie, où il n’avait pas paru une seule fois pendant ce dernier séjour... Cette bonne nouvelle fut bientôt répandue dans Rome, et, au jour fixé, le salon et la salle à manger attenante étaient combles. Gounod, aimable comme toujours et souriant, se mit à ce bon piano d’Érard qu’il connaissait bien, et joua, chanta de dix heures à une heure du matin [13].
24 Gounod ne devait plus retourner à la Villa Médicis, mais il obtint facilement de son ami Hébert que son fils Jean puisse y passer quelques jours en avril 1888. Jean ne possédait qu’un talent médiocre comme peintre et comme musicien ; mais son père ne désespérait pas qu’il s’améliore quand il lui écrivait :
Comme on sait où l’on est, quand on est là, à Rome ! Comme rien ne s’y bat, et comme tout s’y harmonise dans une paix qui enveloppe et réconcilie les choses les plus extrêmes du passé ! Le Forum et le Vatican, l’Antique et la Nature, tout s’embrasse dans les hauteurs d’une éducation suprême [14].
LE CONCOURS DE ROME : AU FIL DES GÉNÉRATIONS
26 Gounod qui n’a jamais enseigné au Conservatoire, a formé quelques élèves particuliers et, au-delà, semble avoir toujours éprouvé le besoin d’entretenir des amitiés artistiques avec des musiciens beaucoup plus jeunes. Bizet fut l’un des premiers par l’intermédiaire de son maître, Pierre Zimmerman, qui se déchargeait parfois de ses leçons sur son gendre Charles Gounod. Bizet n’a pas quinze ans en 1852 et, quand il tentera le concours de Rome, en 1856, Gounod lui prodiguera, le 18 mai, des conseils de vieux routier :
Dès le premier jour une cantate semble un opéra en cinq actes, et on croit qu’on n’aura jamais assez de ses jours et de ses nuits pour en venir à bout. J’en sais quelque chose, j’y ai passé, et pourtant j’avais fini, et mes camarades aussi, et le temps donné suffisait bien à la besogne. Ne te presse pas ! Tout viendra à son moment. Ne te hâte pas d’adopter une idée sous prétexte que tu ne pourras peut-être pas en trouver une autre ; il t’en viendra dix pour une. – Sois sévère. Je suis enchanté de votre sujet pour la seule raison que ce sont des figures caractérisées. [...] Bon courage ; du calme surtout, car la précipitation étouffe toute chose : si j’ai un conseil à te donner, ne travaille pas la nuit. L’esprit se crispe, se contracte, et cette fièvre n’amène la plupart du temps qu’une chose, un mécontentement du lendemain qui force à recommencer le travail de la veille [15].
28 L’année suivante, une nouvelle lettre de Gounod à Bizet entré en loge le 16 mai nous intéresse par le regard qu’il porte sur l’épreuve :
Je suis enchanté du sujet qui vous est échu pour le concours de cette année [Clovis et Clotilde] : il est tout simplement admirable. Les trois figures du tableau sont aussi belles l’une que l’autre, et je ne vois aucun remplissage dans la série des scènes qui toutes me semblent remarquables. Voilà un sujet à caractères ; à la bonne heure ! J’ai le plus vif désir de savoir comment tu t’en seras tiré : je regrette de n’être pas des concurrents, je rentrerais volontiers en loge pour traiter ce sujet-là. La couleur en est superbe et le style digne de la grande peinture d’histoire [16].
30 À défaut, Gounod viendra se joindre au dîner des concurrents. Ce qui donne lieu à un incident dont il s’expliquera le lendemain dans une lettre adressée au chef du secrétariat de l’Institut :
Mon cher Pingard, Je n’entends rien du tout aux inquiétudes qu’a pu éveiller ma présence, hier jeudi 21, dans les couloirs des loges de l’Institut. Arrivé à 5h1/4 environ pour dîner avec ces MM, ainsi que je l’avais annoncé par une lettre trois jours avant, et ne trouvant personne pour me guider, je suis monté par le chemin (que je connaissais d’ailleurs) jusqu’au couloir circulaire des loges que j’ai parcouru presque en entier, en trouvant les portes des loges fermées, jusqu’au moment où j’ai rencontré presque simultanément le gardien Toullotte, et M. Cherouvrier l’un des concurrents. C’est dans ces conditions, et en présence des deux personnes ci-desssus mentionnées, que j’ai eu ensuite communication dans le couloir avec M. Bizet. Le gardien m’a alors donné l’avis de descendre, ce que j’ai fait immédiatement en compagnie de M. Cherouvrier, lequel ne m’a pas quitté un instant depuis mon arrivée et peut attester qu’une communication secrète entre M. Bizet et moi a été de toute improbabilité [17].
32 Gounod n’a pas entretenu des relations aussi étroites avec tous les grand prix de Rome mais, outre Émile Paladilhe (1844-1926), qu’il semble avoir bien connu, on citera Gabriel Pierné (1863-1937) qu’il aurait, selon plusieurs témoignages oraux invérifiables, félicité en ces termes, en 1882 « vous êtes trop imberbe pour aller à Rome » remarque piquante quand on sait que Gounod s’était précisément laissé pousser la barbe à Rome. Pour la première fois, cette année-là, le sujet de la fugue d’entrée était de Gounod ; son classicisme militant contrastait avec le modernisme des précédents. On verra plus loin pourquoi.
33 Gounod a davantage connu Claude Debussy (1862-1918) qui, comme Pierné, accompagnait souvent les chœurs de « La Concordia ». Chaque semaine, selon Paul Vidal (1863-1931), Gounod et Debussy s’entretenaient longuement et, sans doute, fructueusement malgré le reproche de pontifier outre mesure qu’on lit sous la plume du second [18]. On a crédité Gounod, qui faisait partie du jury, d’avoir favorisé le premier grand prix de Rome de Debussy en 1884 avec L’Enfant prodigue. Néanmoins, selon les Annales du Théâtre et de la Musique : « De l’avis unanime [...] la partition de M. Debussy passait pour une des plus intéressantes qui aient été entendues à l’Institut depuis plusieurs années [19] ».
34 Il n’est pas moins intéressant de relever que, l’été suivant, Gounod travaillera à une symphonie avec chœurs inachevée, Régénération dont le sujet est, précisément, l’enfant prodigue, comme si, une fois encore, il rêvait de repasser l’épreuve ! À l’automne il répondra à la demande de Debussy qui souhaitait rien moins que la grande soprano dramatique Gabrielle Krauss (1842-1906) pour interpréter sa cantate : « Difficile... Enfin je ferai la demande, mais je ne réponds de rien, ou plutôt je réponds de l’échec !... [20] »
35 Le 15 novembre 1889, Gounod enverra à Gustave Charpentier (prix de Rome 1887) le rapport de la section musique de l’Institut avec un mot qui le résume :
Il y a là des qualités si saillantes de pensée et de sentiment, de conception et de poésie, d’intelligence et de couleur, que c’est pour moi une joie sincère et très vive de vous dire combien nous avons été heureux pour vous et satisfaits pour l’académie. [...] et je compte sur le temps et sur votre conscience pour dissiper les quelques nuages qui obscurcissent encore, çà et là, les dons brillants de votre sincère et généreuse nature [21].
37 Dans le rapport, on lit encore : « L’envoi de Mr Charpentier est, sans contredit, un des plus intéressants que l’Académie ait reçus depuis plusieurs années [22]. » Une lettre de la veille, écrite à Charpentier par son camarade Louis Landry, révèle comment s’était déroulée l’audition :
Voici la mise en scène : Gounod devant une table avec la partition d’orchestre, Delibes va se placer à côté de Gounod, Massenet au piano bien entendu, et Thomas, de plus en plus ramolli, effondré dans un grand fauteuil, faisant semblant et peut-être même essayant d’écouter (je n’ai pas dit de comprendre). Quant à Reyer qui devait tant parler pour toi, il n’avait pas daigné venir.
Nous commençons : au bout de quelques instants Massenet s’apercevant que Delibes cherchait à exciter Gounod, va le chercher et le colle près du piano avec moi en le forçant d’admirer tout le temps. Les voilà donc tous les trois dans un coin différent et dans l’impossibilité de s’exciter mutuellement. Après la première partie Gounod déclare qu’il y a des longueurs mais du souffle et de l’avant, Delibes se tait et Thomas qui s’était demandé tout le temps si c’était une romance, se lève en disant : ça module trop, pourquoi ne pas rester dans le même ton. Il s’était aperçu que le morceau n’était pas en Ut son ton favori. Le patron ne lui laisse pas le temps de souffler et fait attaquer tout de suite la seconde partie. Il l’a chantée comme il chante lorsqu’il s’agit de s’y mettre. C’est-à-dire épatamment. Gros effet sur ces messieurs, même sur Thomas qui voyant que tout le monde était du même avis, déclare que c’est un très joli sentiment poétique. Gounod essaye d’insinuer que la fin est peut-être un petit peu longue, et j’ai vu le moment où le patron allait lui répondre qu’il n’était qu’un c...!
La 3e partie produit beaucoup d’effet mais néanmoins fournit à Thomas et à Gounod l’occasion de prononcer de belles paroles. Le premier voulant faire de l’esprit dit : Impuissance de ne pas moduler. (Hein ! c’est joli). Le second nous rappelle que dans « Don Juan » de Mozart, le grand Mozart est arrivé à produire un effet fantastique avec des accords au fond desquels on voit les cailloux (sic). Le Patron leur explique que cet effet tourmenté est voulu. (C’était la partie qui la veille l’avait le plus ému).
La 4e partie est celle qui a eu le plus de succès. Elle a passé comme une lettre à la poste, il n’y a pas eu une protestation. En résumé d’après ce que j’ai vu, Gounod qui a suivi consciencieusement tout le temps, a trouvé que c’était un envoi intéressant.
Il a formulé quelques critiques au sujet de tes outrances musicales et a dit que tu étais évidemment appelé à devenir quelqu’un, mais que tu n’étais encore qu’à l’état embryonnaire. La preuve en a-t-il dit, c’est qu’il est encore plus poète que musicien et qu’il a plus d’accent que d’idées. Tu vois qu’il y a là-dedans un mélange de bêtises et de choses justes, somme toute c’est un vrai succès [23].
LE PRIX DE ROME : ANTIDOTE DU MERCANTILISME
39 Il y eut bien quelques dissonances. En juin 1889 le premier grand prix de Rome ne fut pas attribué ; le poème de Sémélé n’était d’ailleurs guère inspirant. Paul Dukas (1865-1935), second grand prix en 1888, n’ayant recueilli que 3 voix sur 9, se souviendra plus tard : « Gounod se mit en quatre pour m’empêcher de l’obtenir, et me prodigua en revanche tous les conseils et les meilleures consolations. Saint-Saëns, au contraire, prit parti pour moi [24]. » Dukas en garda rancune à Gounod. Pourtant la juste remarque de son ami Albéric Magnard (1865-1914) qu’on ne saurait taxer d’académisme, à propos de la Sonate, « Quand vous serez débarrassé du fatras harmonique qui encombre la musique contemporaine, vous aurez toute liberté pour gravir les cimes [25] » évoque irrésistiblement ce qu’avait pu dire Gounod.
40 En fait, la méfiance d’une partie des candidats au prix de Rome avait des racines anciennes. Le 25 juin 1881, lors de l’audition des cantates du concours de Rome la section musique de l’Institut déclare qu’il n’y a pas lieu de décerner le prix. Les cinq candidats étaient élèves de Massenet. « Tout cela manque de vérité et de sincérité. Ces jeunes gens parlent pour ne rien dire, et ne disent pas, la plupart du temps, ce qu’ils veulent dire. Cela sent son Massenet. Ô Mozart, où es-tu ? » devait penser Gounod selon Les Annales du Théâtre et de la Musique de 1882 [26] tandis qu’Edmond Hippeau précise, dans La Renaissance musicale [27] :
Ce qui mérite d’être signalé, c’est la véhémence avec laquelle certain membre de la section musique s’est emporté contre les cinq concurrents ensemble, contre l’enseignement du professeur, contre le goût du public, contre les progrès de l’art musical et contre une foule de choses étrangères au sujet : « Ah ! ces jeunes gens ! quelle richesse de forme, quelle science, quelle imagination !... Mais quelles tendances subversives. »
42 Gounod n’est pas nommé (il pourrait aussi bien s’agir de Thomas) mais cela recoupe le contenu d’une note autographiée, Réflexions sur le concours de Rome de cette année [28] qu’il souhaitait communiquer à ses confrères avant le vote. Il exprimait sa crainte de voir les concurrents se préoccuper davantage du procédé que du sentiment. À tort, disait-il, car l’habileté technique, si nécessaire, ne devrait être qu’au service du sentiment, pour le maintenir dans les limites de l’art. Mais, ces limites, au nom de la liberté, on voudrait les briser « or il n’y a pas de Liberté sans équilibre, et pas d’équilibre sans Loi. L’ivrogne n’est pas libre : je crains qu’on en arrive à l’alcoolisme en art ». L’avis de Gounod fut suivi et aucun prix ne fut décerné cette année-là. Comme les cinq concurrents, tous élèves de Massenet, semblaient incarner les tendances de l’avenir, la presse y vit une querelle des anciens et des modernes et attribua à l’auteur malheureux du Tribut de Zamora un mesquin désir de revanche sur celui du Roi de Lahore.
43 De ces Réflexions, Gounod voulut faire une communication, L’Académie de France à Rome [29], qu’il s’apprêtait à lire lors de la séance de l’Académie des beaux-arts du 17 décembre 1881, « pour défendre un établissement artistique vis-à-vis duquel l’Académie doit témoigner de sa sollicitude ». Un confrère lui ayant fait remarquer qu’il était « inopportun que l’Institut prenne part aux discussions soulevées dans la presse [30] », Gounod retourna à sa place, renonça à la lecture, mais ne s’avoua pas vaincu. Prenant prétexte de défendre l’institution, Gounod voulait éclairer ses confrères sur ses convictions esthétiques : « Au moment où, sous le masque d’un soi-disant naturalisme dans l’art, on s’efforce de jeter la défaveur sur cette noble et généreuse institution de l’Académie de France à Rome, il m’a semblé que c’était un devoir de protester contre des tendances dissolvantes [31]. » Il s’insurge contre l’idée que le musicien n’a besoin que de musique pour se perfectionner. Autant que ceux de la littérature, les chefs-d’œuvre de la peinture sont une nourriture essentielle : « C’est de l’art, aussi moderne qu’ancien, de l’art immortel et universel [32]. » Soulignant que l’indispensable modèle de la Nature ne saurait être le seul maître et qu’il n’y a pas d’Art sans Science, donc sans l’enseignement de l’École, il conclut :
Défendons de toutes nos forces cet asile sacré qui abrite la croissance de l’artiste loin de l’obsession prématurée des besoins de la vie, et le prémunit à la fois, contre les suggestions du mercantilisme et contre les vulgaires triomphes d’une popularité sans noblesse et sans lendemain [33].
45 Dans ce texte, où il veut mettre en garde les artistes contre la démagogie d’un art soumis seulement au réalisme, Gounod se montre proche des Parnassiens, ce qui ne l’empêche pas d’apprécier les écrivains naturalistes.
46 Privé de lire son texte à l’Institut, Gounod ne désarma pas et dans son discours sur Don Juan d’octobre 1882, prononcé dans les mêmes circonstances devant le même auditoire, il reprit le même sujet sous un angle d’attaque plus discret. Ainsi le chef-d’œuvre de Mozart qui avait suscité sa vocation créatrice d’adolescent, dont il avait reçu la partition en souvenir du prix de Rome était-elle pour Gounod l’ultime recours contre les faux prophètes.
47 On conclura sur le témoignage d’Henri Büsser (1872-1973) qui remporta le premier grand prix de Rome en 1892 avec sa cantate Amadis et se félicita d’avoir noté toutes les inflexions de Gounod quand il dicta le poème aux candidats [34].
Notes
-
[1]
Carnet de voyage en Italie conservé dans le Fonds Jean-Pierre Gounod, à la date du 14 avril 1862.
-
[2]
Lettre inédite du 26 [?] août 1838, conservée par les descendants d’Urbain Gounod.
-
[3]
Étienne-Jean Delécluze (1783-1863), « Académie des beaux-arts. Séance annuelle et distribution des prix. », Journal des débats, 6 octobre 1839, p. 3.
-
[4]
Charles Gounod, Mémoires d’un artiste, Paris, C. Lévy, 1896, p. 82.
-
[5]
Ibid., p. 83.
-
[6]
Conservé dans le Fonds Jean-Pierre Gounod.
-
[7]
La copie de cette lettre se trouve dans le fonds Gounod réuni par Jean Mongrédien et conservé à la Médiathèque du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
-
[8]
Les extraits du journal de Fanny, traduits par Françoise Tillard sont extraits de son livre Fanny Hensel, Lyon, éditions Symétrie, 2007, p. 317 et p. 351.
-
[9]
Lettre conservée dans le Fonds Jean-Pierre Gounod.
-
[10]
BnF, Mus. : MS 6011 pour Romeo e Giulietta ; Beinecke Library, Yale, pour Cantatrici villane sous le titre « Fra gli scoglie la procella ». Voir aussi le catalogue des œuvres de Gounod contenu dans Gérard Condé, Charles Gounod, Paris, Fayard, 2009, p. 975.
-
[11]
Cette lettre ainsi que la suivante ont été publiées dans la Revue Hebdomadaire du 26 décembre 1908.
-
[12]
Carnet de voyage en Italie conservé dans le Fonds Jean-Pierre Gounod, à la date du 16 avril 1862.
-
[13]
Ernest Hébert, « La Villa Médicis en 1840, souvenirs d’un pensionnaire », Gazette des Beaux-arts, 1er avril 1901, p. 267-276.
-
[14]
Lettre du 15 avril 1888 conservée dans le Fonds Jean-Pierre Gounod.
-
[15]
BnF mss n.a.f. 14346, lettre citée par Hervé Lacombe, Georges Bizet, Paris, Fayard, 2000, p. 148.
-
[16]
BnF mss n.a.f. 14346, lettre citée par H. Lacombe, ouvr. cité, p. 171.
-
[17]
Lettre citée par H. Lacombe, ouvr. cité, p. 171 sans précision de source.
-
[18]
Dans une lettre à Paul Vidal de juin 1885, citée par Léon Vallas, Claude Debussy et son temps, Paris, A. Michel, 1958.
-
[19]
Édouard Noël et Edmond Stoullig, Annales du Théâtre et de la Musique, T. 10, 1885, p. 378.
-
[20]
Fragment de lettre reproduit en fac-similé par Maurice Boucher, C. Debussy, Essai pour la connaissance du devenir, Paris, Rieder, 1930, pl. XI.
-
[21]
Lettre citée par Marc Delmas, Gustave Charpentier et le lyrismefrançais, Paris, Delagrave, 1931, p. 50.
-
[22]
Archives de l’Académie de France à Rome : AFR, carton 118/1, folio 76-84. Rapport général sur les travaux de MM. les pensionnaires de l’Académie de France à Rome, en 1889.
-
[23]
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, Fonds Gustave Charpentier Dossier 93 « Mémoires. Personnalités musiciens III. Albert Carré. Louis Landry ».
-
[24]
Dans un curriculum vitae adressé par Dukas à Georges Humbert en 1899. Cité par Simon-Pierre Perret, Paul Dukas, Paris, Fayard, 2007, p. 49.
-
[25]
Lettre d’Albéric Magnard à Paul Dukas du 5 février 1901 citée par S.-P. Perret, ouvr. cité, p. 128.
-
[26]
Les Annales du Théâtre et de la Musique, 1882, T. 7 p. 504.
-
[27]
La Renaissance musicale, n° 18, 3 juillet 1881.
-
[28]
Un exemplaire est conservé dans le Fonds Jean-Pierre Gounod.
-
[29]
Publié dans La Nouvelle Revue du 1er janvier 1887, puis à la suite des Mémoires d’un artiste.
-
[30]
La Renaissance musicale n° 43, 25 décembre 1881, p. 10.
-
[31]
L’Académie de France à Rome, dans Mémoires d’un artiste, ouvr. cité, p. 297.
-
[32]
Ibid., p. 306.
-
[33]
Ibid., p. 311.
-
[34]
Henri Büsser, « Quelques souvenirs sur Charles Gounod », dans Institut de France, Séance annuelle des cinq académies du samedi 25 octobre 1941, Paris, Firmin-Didot, 1941, p. 67.