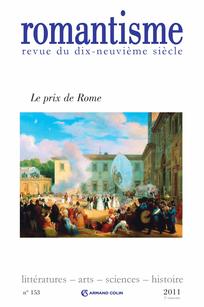« Encore un livre sur la Suisse ! »
Nous croyons d’abord devoir placer ici quelques réflexions sur la prodigieuse multitude d’écrits que les voyages en Suisse ont fait naître. Avant l’apparition de ceux [2] dont nous allons parler, nous n’avions pas moins de trois cents volumes sur les cantons helvétiques, sans compter les cartes et les gravures. N’est-il pas à craindre que le sujet ne s’épuise, et que la curiosité publique ne se fatigue ?
FORTUNE DU DISNEYLAND ALPIN ?
1 La littérature du voyage en Suisse est abondamment étudiée [3]. Les mots de La Revue Encyclopédique mettaient déjà en évidence qu’une pléthore documentaire risquait de fatiguer ce – ceux – qu’on nomme aujourd’hui le pôle de réception. L’article qui suit voudrait, dans une petite et discutable mesure, éviter le diagnostic de fatigue de l’esthétique, propre à la découverte des beautés de l’Helvétie pour les voyageurs et les lecteurs du XIXe siècle. Il s’agira de soutenir que l’ironie pourrait conduire les voies de cet évitement. Pour nous, une « écriture oblique [4] » constituerait un recouvrement (fût-il retors) ainsi qu’un renouvellement des manières de dire les rencontres qu’un voyageur noue avec les hommes et les paysages. En ce sens, l’ironie, souvent décrite comme une modalité d’énonciation corrosive, serait peu compatible avec ce que Claude Reichler nomme – voire dénonce comme – une « thèse projective [5] » (cette dernière soutient que, souvent, l’anthropologie littéraire s’enferre malheureusement dans une forme de solipsisme). C’est que l’ironiste n’aplanit pas l’altérité : il la rend piquante. Sans donner dans le panneau d’une relation transparente entre le texte et la réalité qu’il appréhende, nous voudrions considérer que l’ironie donne l’alerte : elle pointe, précisément. Elle permet à l’analyste de détecter la présence de l’autre, non pas sa disparition sous le poids des clichés et des redites.
2 Il reste indéniable que depuis que l’érudit John Grand-Carteret, au début du XXe siècle, a significativement sous-titré une partie de sa monumentale somme sur la littérature alpestre : « Une montagne de papier », le statut « naturellement livresque » de la montagne est pour ainsi dire consacré. On notera opportunément qu’un sous-titre de l’étude précédant une excellente édition du Voyage au Mont-Blanc [6] (1806) de Chateaubriand due aux soins de J. Rigoli est : « Des monts et des mots ». Le titre général de l’étude étant : Le Voyageur à l’envers. Montagnes de Chateaubriand, on admettrait volontiers que « d’une montagne de papier » à « Des monts et des mots », la critique fait la place belle à la question des surcharges d’Impressions de voyage en Suisse [7]. Rigoli, auteur de pages informées concernant le « désenchanteur des Alpes » (Chateaubriand) est, selon mes connaissances [8], un des seuls critiques à s’intéresser à l’ironie du paysage alpin de manière frontale. Avec la précision de l’éditeur, de l’historien et du critique littéraire, il aborde le cas de Chateaubriand. Le dossier du « désenchanteur » n’en demeure pas moins... « à charge [9] » !
3 Un des sommets les plus critiques que peut atteindre la montagne de papier pourrait consister en une récupération moniste d’un dualisme particulièrement virulent dans le discours ironique. Il s’agirait de liquider la métaphore et d’admettre qu’entre le représentant (le papier des impressions de récits de voyage, par exemple) et le représenté (le territoire suisse) la distance s’amenuise pour réaliser une sorte d’idylle postmoderne des simulacres. Voici la forme que pourrait prendre cette thèse :
Ma thèse est celle-ci. Il existe une visibilité suisse qui est un mythe, mais qui est un mythe matérialisé. Voir la Suisse, c’est comprendre comment nous avons matérialisé l’imaginaire et c’est pour cela, je crois, que nous ne pouvons plus rêver, parce que nous l’avons matérialisé, que cette matérialisation de l’imaginaire ne nous est pas propre à nous Suisses, mais que dans cette visibilité helvétique, nous avons réalisé le rêve de l’Occident tout entier [10].
5 C’est une thèse forte et elle a son intérêt. Dans son livre, au titre malicieusement rousseauiste La Beauté du reste. Confessions d’un conservateur de musée sur la perfection et l’enfermement de la Suisse et des Alpes, Bernard Crettaz, anthropologue parfois foucaldien, paraît proche des thèses d’un Baudrillard et s’aventure aux lisières du « Disneyland alpin [11] ». Le principal intérêt de cette réflexion est de montrer que la « matérialisation de l’imaginaire » constitutive du paysage suisse « ne nous est pas propre à nous Suisses », mais engage des représentations exogènes lesquelles informent la réalité endogène des perceptions identitaires (voire, comme le soutient Crettaz, construisent la réalité géographique). C’est un phénomène connu et Reichler a pu écrire à ce sujet que nous (et surtout le doyen Bridel [12]) « sommes devenus autochtones par intermédiaires ». Cependant, même si je partage les Confessions de Crettaz, je crois assez hardi de supposer sérieusement l’avènement d’une Suisse des simulacres. Pour l’anthropologue, la construction du village suisse présenté à l’Exposition nationale de Genève en 1896 permet pourtant le constat qui suit.
Dans ce village, il y a un alphabet helvétique qui se met en place. On bricole une systémique suisse. Cela veut dire que dès la fin du XIXe et en 1896, on sait ce qu’il faut mettre dans l’alphabet pour bricoler le vrai Vaud, le vrai Genève, le vrai Neuchâtel, le vrai Appenzell et le vrai Uri [13].
7 La vérité alphabétique du paysage suisse, si elle n’est pas exempte de « bricolage », relève alors de tactiques dont les stratégies sont descriptibles. Quelque légitime que soit la fortune postmoderne de l’alphabet enregistré par Crettaz, il faut interroger historiquement le sérieux de sa récitation. En effet, il y a dans un passage de Tartarin sur les Alpes comme une démonstration exemplaire (au sens fictionnel que comporte l’exemplum) de l’impossibilité du bon usage de la grammaire paysagère [14] suisse et de la « systémique » de ses simulacres. En effet, quatorze ans avant l’exposition analysée par Crettaz, en décembre 1885, Tartarin sur les Alpes est mis en vente dans les librairies parisiennes. Le livre est publié par Le Figaro, associé à Calmann-Lévy. Parution couronnée de succès : quelque 20 000 volumes auraient été vendus entre 1885 et 1886. L’auteur de cette réussite littéraire, Alphonse Daudet, a voyagé en Suisse en 1884. Les carnets de notes serrées à l’occasion de ce voyage familial participent de la genèse des aventures alpines du personnage tarasconnais. Dans le passage exemplaire qu’on va lire, on sera peut-être plus particulièrement attentifs, non pas aux traces des carnets de Daudet, mais au plagiat du dandy Roqueplan. Nous voici donc quarante-six ans avant l’exposition nationale dont l’analyse de Crettaz infère la cristallisation des concepts de vérités paysagères pour « le vrai Vaud, le vrai Genève, le vrai Neuchâtel, le vrai Appenzell et le vrai Uri ». Avec l’aide de Roqueplan, Daudet met en scène la matérialisation des contenus (passablement paysagers) du mythe suisse. Sa fiction – sur le mode burlesque ! – vérifie l’existence d’une grammaire du paysage suisse. Voici ce dont on informe Tartarin :
La Suisse, à l’heure qu’il est, vé ! Monsieur Tarascon, n’est plus qu’un vaste Kursaal, ouvert de juin en septembre, un casino panoramique, où l’on vient se distraire des quatre parties du monde et qu’exploite une Compagnie richissime à centaines de millions de milliasses qui a son siège à Genève et à Londres. Il en fallait de l’argent pour affermer et pomponner tout ce territoire, lacs, forêts, montagnes et cascades [...]. Avancez un peu dans le pays, vous ne trouverez pas un coin qui ne soit truqué, machiné comme des dessous d’opéra ; des cascades éclairées a giorno, des tourniquets à l’entrée des glaciers [...] l’entretien des crevasses est une des plus grosses dépenses de la Compagnie [15].
9 À l’ironie près, la proximité entre la thèse de Crettaz et ce passage est frappante. Il reste que même si la volonté « marketing » de penser les rentabilités du paysage est réelle et dispose aujourd’hui de moyens scientifiques efficaces parce qu’ils savent – à grand renfort de concepts – s’affiner avec un dialogisme constructif : la Suisse n’est pas exactement un « Kursaal », ni un vaste « casino panoramique ». La Compagnie partiellement anglaise et « richissime à centaines de millions de milliasses » n’est ostensiblement pas une réalité, mais un procédé hyperbolique d’ironie (et la grammaire, elle, connaît bien ce procédé). Les hyperboles de Daudet peuvent en revanche montrer combien dans les consciences d’alors (et probablement dans celle de Crettaz aujourd’hui) le ridicule (ou le « capital symbolique » de ridicule) d’une maîtrise conceptuelle et économique du paysage existe. La mise en évidence de ce ridicule repose sur la dénonciation comique d’une mystérieuse machinerie capable de produire des concepts paysagers qui, loin d’être des modèles pour qu’un savoir et une perception aient lieu, sont les savoirs caricaturaux préalables de cette perception. En ce sens, l’ironie, de même que certains procédés scientifiques de schématisations, simplifie et donne à connaître sur le mode d’un savoir aiguisé, décanté et disponible. Mais la connaissance ironique livrée n’est ici connaissance que dans la mesure où elle dénonce. Celle-ci, pour rester connaissance ironique, en « reste » au stade transcendantal de l’idée ou du modèle en bloquant l’accès à la réalisation sérieuse du savoir pourtant élaboré : elle est donc une reconnaissance suspendue. L’ironie en tant que pure reconnaissance interdit l’exercice de ce qu’elle rendrait pourtant possible : la connaissance appliquée. C’est pourquoi l’ironie est esthétique : elle ne sert essentiellement à rien. Il semble donc qu’entre le concept (celui du « vrai Uri », par exemple) et le réel paysager ainsi connu, la relation prenne toute son importance, il n’y a qu’elle qui résiste. Elle semble alors nantie d’une matérialité vraiment esthétique et se manifeste par le rire (ou sourire pour le cas de Daudet). En ce sens-là, il ne s’agit plus de savoir quels sont les vrais concepts qui pourront « affermer et pomponner tout ce territoire, lacs, forêts, montagnes et cascades », ni de savoir la vérité du bon paramétrage de la matière mythique identitaire et touristique « du vrai Uri », mais bien de sentir une matière paradoxale, tissée de concepts rendus sensibles grâce à la connaissance de leur vanité, une matière qui deviendrait en somme l’être de la relation paysagère ironique.
INFORTUNES DES RÉPLIQUES
On va demander, peut-être, la raison de la présomption qui me pousse à faire paraître le deux cent unième ouvrage publié jusqu’à ce jour sur la Suisse [16] ?
Théobald WALSH.
11 S’ils ne se matérialisent pas à même le pays, on ne niera pas qu’au cours du siècle les schèmes organisateurs des perceptions et représentations du paysage suisse sont passablement surveillés par une police discursive [17] à laquelle les choix lexicaux peinent à échapper. La surabondance du mot même « paysage » ainsi que celle de son corollaire scopique francisé le « pittoresque » (voire, par amalgame [18], le joli, riant, bien-cultivé) peut être tenue pour une preuve « lexicométrique [19] » dans nombre de périples touristiques. Il en va de même pour le sublime qui, scandé par des adjectifs convenus (horribles beautés, monts sourcilleux, noble aspect), semble débarrassé de son pouvoir d’émotion et nanti d’une sauvagerie dont la rhétorique oxymorique est trop rodée pour ne pas en neutraliser les effets.
12 Cependant, une curieuse ironie parvient à effacer littéralement les convenances imposées par les registres esthétiques du sublime et du pittoresque. Le paysage n’a alors plus d’énoncé, il devient en somme une pure énonciation, et gagne la force d’une réplique effacée. Examinons trois exemples issus de deux récits ordinaires (le premier, explicitement touristique, date de 1884 et le second remonte à 1831, l’orthographe est respectée, nous soulignons).
L’œil plonge maintenant dans les vallées de la Kander, de Kien, d’Engstligen et d’Adelboden, qui semblent être de velours vert, frangé par un ruban d’argent. Le sentier longe les parois vertigineuses du côté Nord [...] Halte ! Front ! Déploiement de points d’exclamations [20] !
14 Ce paysage, passablement implicite quant à ses objets d’admiration, appartient au registre du sublime (du grandiose, à tout le moins). Son sentier est ici arrêté par un énoncé typographique qui recouvre la santé injonctive et exclamative du sublime parce qu’il l’affranchit de contenus explicites.
15 Un autre fragment issu de l’incipit d’un récit ordinaire (1831) économise plaisamment l’« impression paysagère ».
Le temps était ravissant, l’air pur et serein, les oiseaux chantaient, les fleurs embaumaient, etc., etc. [21]
17 L’impression des contenus paysagers s’exprime par une convention typographique qui, parce qu’elle ne verbalise pas le pittoresque, le rend volatile. Convenons ici que l’abréviation semble davantage suivre les voies d’un mythe paysager volatilisé que « matérialisé ». Plus loin, le même auteur n’abrège plus, mais il cite l’impression, il rapporte entre guillemets une formule exclamative convenue. Nous sommes alors au sommet de la Dent de Vaulion dans le canton de Vaud, en septembre 1831 :
Ils virent très distinctement le lac des Rousses, de Joug, des Brennet, de Saint-Point, de Neuchâtel, de Genève, Yverdon, Besançon [...]. Après s’être exclamé vingt fois chacun : « Oh ! que c’est beau ! », ils descendirent.
19 La citation de l’énoncé laudatif « Oh ! que c’est beau ! [22] », montré comme vingt fois prononcé, confirmera la présence, en 1831, d’une ironie de l’extase que l’esthétique de la vue panoramique semble imposer.
20 Il arrive donc que « l’alphabet » du paysage suisse, pour suivre le fil métaphorique introduit par Crettaz s’étiole, quitte les lettres et se réduise à des signes typographiques d’abréviation ou d’exclamation, voire à des formules dont la vacuité impressionne. Ces points de détails esquissent un paysage dont l’ironie serait paradoxalement sans réplique, tant celle-ci tiendrait de la (re)marque. Non pas qu’il faille y débusquer la genèse sérieuse d’une « systémique » d’éléments paysagers dont les entreprises des siècles futurs assureront la matérialisation au détriment de l’onirisme – comme le suggère Crettaz – on se laissera plutôt aller à constater un allégement par connotation autonymique [23], une subversion narquoise qui fendille et alerte la rigidité des grandes catégories esthétiques du paysage suisse au XIXe siècle.
21 Depuis les belles pages que C. Reichler a consacrées à un détail paysager du chapitre premier de la cinquième partie de La Confession d’un enfant du siècle (1836) lesquelles, par cercles herméneutiques s’élargissant, montrent combien pour un tiers représenté à l’intérieur de la diégèse (en l’occurrence le personnage de Smith), une relation (celle d’Octave et Brigitte) à un « ensemble conventionnel de thèmes et d’objets, glaciers, cimes enneigées, riantes vallées, villages paisibles [24] » est perçue comme heureuse alors qu’en réalité le texte montrera la beauté d’une relation chimérique – Brigitte et Octave n’iront pas en Suisse et se sépareront à jamais – ; on sait le rôle substantiel que revêt le paysage suisse dans la construction esthétique d’un « désir médiatisé ». Ce rôle prégnant de médiation qu’a le paysage stéréotypé de l’idylle alpestre peut être diversement exploité. Il peut même s’inverser et fonctionner comme repoussoir sans que son statut de médiation soit remis en cause. C’est ce que permet de montrer une réplique d’un paysage de Suisse allemande sorti d’une « manufacture d’ignominies » qu’on rencontre dans La Femme pauvre. Léon Bloy qui qualifiait Tartarin sur les Alpes d’« une façon de guide cocasse à l’usage des explorateurs dont l’âme ne s’entrebâille que sur les plus hautes cimes et qui veulent crever de rire en gravissant les sentiers des monts » et son auteur de « mercanti de plume » chargé d’accomplir « la délectation et le rassasiement d’un public acéphale d’employés de commerce et de petits rentiers [25] », nous met en présence d’un condensé (mer et montagne) paysager repoussant dont l’ironie et la verve raviront. Dans ce roman de la fin du siècle, non plus dans la chambre d’Octave et Brigitte, « pleine de hardes en désordre, d’albums, de crayons, de livres, de paquets [26] » et où apparaissait une image de la Suisse idyllique, mais dans une chambre au désordre plus crasse et moins romantique, apparaît aussi l’imagerie populaire suisse. Affrontant les « moutardes contagieuses des rues de Paris », rue de Grenelle, derrière « une porte squameuse qui paraît être l’entrée la plus fâcheuse de l’enfer », le lecteur est introduit dans un taudis typiquement bloyen, on y :
apercevait un autre matelas, moucheté par les punaises et noir de crasse, étalé simplement sur le carreau. De l’autre côté, un vieux voltaire, qu’on pouvait croire échappé au sac d’une ville, laissait émigrer ses entrailles de varech et de fil de fer, malgré l’hypocrisie presque touchante d’une loque de tapisserie d’enfant. [...] Tel était le mobilier, assez semblable à beaucoup d’autres dans cette joyeuse capitale de la bamboche et du désarroi. Mais ce qu’il y avait de particulier et d’atroce, c’était la prétention de dignité fière et de distinction bourgeoise que la compagne sentimentale de Chapuis avait répandue, comme une pommade, sur la moisissure de cet effroyable taudis. La cheminée, sans feu ni cendres, eût pu être mélancolique, malgré sa laideur, sans le grotesque encombrement de souvenirs et de bibelots infâmes qui la surchargeaient. On y remarquait de petits globes cylindriques protégeant de petits bouquets de fleurs desséchées ; un autre petit globe sphérique monté sur une rocaille en béton conchylifère, où le spectateur voyait flotter un paysage de la Suisse allemande ; un assortiment de ces coquillages univalves dans lesquels une oreille poétique peut aisément percevoir le murmure lointain des flots ; et deux de ces tendres bergers de Florian, mâle et femelle, en porcelaine coloriée, cuits pour la multitude, on ne sait dans quelles manufactures d’ignominies [27] .
23 Certes, entre l’ironie comme expression du désir romantique avec laquelle une lecture girardienne peut analyser la présence significative d’un Tableau de la Suisse dans La Confession d’un enfant du siècle et le déchaînement syncrétique de l’ironie bloyenne, il y a un monde. Néanmoins, c’est bien encore la sédimentation des principaux clichés paysagers en vogue sous Louis-Philippe qui rend possible cette description vitriolée d’un manteau de cheminée arborant entre autres « particularités atroces » : « un paysage de Suisse allemande ». Celui-ci, comme contaminé par la mer (l’audition proleptique des mélodies d’« un assortiment de ces coquillages univalves dans lesquels une oreille poétique peut aisément percevoir le murmure lointain des flots) parvient évidemment à « flotter ». Il n’en demeure pas moins que le cadre immobilier – une « volière à cochons » dans le quartier parisien Gros-Caillou – doit servir de contexte pour l’interprétation de l’ironie soutenant « ces tendres bergers de Florian, mâle et femelle, en porcelaine coloriée, cuits pour la multitude, on ne sait dans quelles manufactures d’ignominies ». Ignobles, ils participent de « la prétention de dignité fière et de distinction bourgeoise [28] que la compagne sentimentale de Chapuis avait répandue, comme une pommade, sur la moisissure de cet effroyable taudis ». Cuit pour la multitude, recuit par l’ironie de Bloy, il semble très difficile de penser l’événement d’un amour idyllique sans l’intervention de la grâce. Et pourtant cette maison n’est pas seulement l’enfer dont sa porte squameuse est l’annonce, elle est aussi celle d’une martyre, héroïne de ce livre : Clotilde.
24 Il est peu pertinent de pousser plus avant la mise en relation de ce détail sécrété par l’industrie de l’objet-souvenir hideux avec le reste du roman (et d’affiner nos rapprochements entre les amours de Clotilde et celles, différemment douloureuses, de Brigitte dans La Confession d’un enfant du siècle). Qu’il suffise ici de tenir pour ferme que la présence intradiégétique d’une représentation de l’idylle atteste la continuité d’un thème paysager alpin et de ses éventuelles conséquences sentimentales. Sans pour autant perdre sa fonction médiatrice, le paysage suisse et ses lointaines résonances arcadiennes tendent certes à n’avoir lieu que sous le signe de l’ironie. C’est dire que celle-ci entre pleinement dans les commerces identitaires et paysagers. Les ignominies bergères de Bloy paraissent empêcher la performativité de cette fameuse « systémique » du paysage helvétique dont une des fonctions serait l’idylle, manufacturée en France puis exportée aussi bien en terre helvète que dans les systèmes perceptifs autochtones. L’ironie lézarde la constitution édifiante du « mythe matérialisé ». Pour faire une allusion facile, elle empêche l’avènement d’une esthétique du meilleur des mondes. Grâce à l’ironie, « l’Occident tout en entier » ou, plus modestement, le paysage suisse pourrait échapper à la vérification empirique d’une sélection des traits valorisants du paysage (sorte d’interprétation vérifiée à même le pays des « restes » rentables de l’idylle et de l’exploitation marchande de son capital « bien-être »). C’est ainsi que, fût-ce au prix du cauchemar, un passage ironique tel que celui de Bloy permet de sauver le rêve. À preuve conclusive de ce point – elle est très largement postérieure aux fragments cités, mais répliquera à l’énoncé « Nous ne pouvons plus rêver » épinglé précédemment –, le facétieux petit récit d’Henri Calet, délicieusement intitulé Rêver à la Suisse.
Tiédeur de l’air du soir, girandoles, douceur de vivre, cafés viennois, pêches Melba, musique, mouettes évoluant au-dessus du lac parmi un panorama toujours en place. [...] On s’ennuie un peu (le spleen), on invite à la valse une dame enrubannée (les derrières étaient alors sensiblement plus gros que maintenant, les poitrines plus volumineuses, on se portait mieux), puis on va se promener à deux en murmurant un poème de Byron [...] à deux sur la berge où de multiples écriteaux vous incitent à la bonté : PENSEZ AUX CYGNES. Il y aurait encore à écrire... sur l’abondance des produits, sur les Alpes, sur la fondue, sur les montres-bracelets, sur le folklore en général, sur les grandioses paysages vaudois [...] sur le téléski, sur l’empoisonnement par correspondance qui se pratiquait couramment pendant ses vacances, sur cette maladie toute nouvelle qui s’attaquait au foie des dames [29].
COUSINAGES
Que j’aime tes jolis chalets,
Tes vierges fraîches, délicates,
De tes monts les hardis sommets,
Et, tes aspects si disparates !
Tes glaces raillant le soleil,
Tes monceaux de neige éternelle,
Tes fleurs à l’incarnat vermeil,
Et ton onde où l’or étincelle !
F. GIRAULT, « À la Suisse [30] », 1835.
27 C’est sciemment que cet article (et son buissonneux paratexte) s’est plu à convoquer des sources hétéroclites. Quelque saugrenue que puisse paraître cette démarche, elle a permis d’illustrer l’importance de l’ironie comme renouvellement des perceptions et des représentations de l’esthétique des paysages suisses et de nuancer drastiquement la genèse d’un improbable « Disneyland alpin ». Il est malaisé de proposer une typologie [31] efficace des formes de l’ironie « alpine », celle-ci se manifeste aussi bien au niveau micro-textuel (les effets suspensifs de la connotation autonymique dont même les récits les plus ordinaires témoignent) qu’au niveau macro-textuel (intertextualité ludique avec des modèles littéraires connus). Notre propos n’entendait évidemment pas nier que la stéréotypie alpine soit une sorte de mal linguistique du siècle. L’exergue de ce point en est un exemple ordinairement significatif. C’est pourquoi, entre la fortune et l’infortune des représentations, je conclurai sur la perception d’un vertigineux cousinage.
28 C’est que les critiques littéraires spécialistes des paysages alpins citent parfois deux passages de Madame Bovary. Le premier concerne une conversation entre Emma et Léon. Ce dernier décrit alors son goût pour la promenade solitaire et la rêverie romantique. Il aime lire au soleil couchant dans un lieu dont le nom rumine le conventionnalisme rural. Léon rapporte ensuite ce que le voyage en Suisse évoque pour un personnage qu’il dit être son cousin (relation familiale assez facile à faire valoir lorsqu’on parle à une dame...).
Il y a un endroit que l’on nomme la Pâture, sur le haut de la côte, à la lisière de la forêt. Quelquefois, le dimanche, je vais là, et j’y reste avec un livre, à regarder le soleil couchant. – Je ne trouve rien d’admirable comme les soleils couchants, reprit-elle, mais au bord de la mer, surtout. – Oh ! j’adore la mer, dit M. Léon. – Et puis ne vous semble-t-il pas, répliqua madame Bovary, que l’esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limites, dont la contemplation vous élève l’âme et donne des idées d’infini, d’idéal ? – Il en est de même des paysages de montagnes, reprit Léon. J’ai un cousin qui a voyagé en Suisse l’année dernière, et qui me disait qu’on ne peut se figurer la poésie des lacs, le charme des cascades, l’effet gigantesque des glaciers. On voit des pins d’une grandeur incroyable, en travers des torrents, des cabanes suspendues sur des précipices, et, à mille pieds sous vous, des vallées entières, quand les nuages s’entrouvrent. Ces spectacles doivent enthousiasmer, disposer à la prière, à l’extase ! Aussi je ne m’étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imagination, avait coutume d’aller jouer du piano devant quelque site imposant [32].
30 Le second passage se situe peu après la narration de « l’éducation » d’Emma. Flaubert, ayant raconté la jeunesse d’Emma et rappelé que « quand sa mère mourut, elle pleura beaucoup les premiers jours » pour, ensuite, se laisser « glisser dans les méandres lamartiniens », écouter « les harpes sur les lacs, tous les chants de cygnes mourants, toutes les chutes de feuilles, les vierges pures qui montent au ciel, et la voix de l’Éternel discourant dans les vallons », rêve à ce qu’Emma songe de sa lune de miel avec Charles (première partie chapitre VII) :
Elle songeait quelquefois que c’étaient là pourtant les plus beaux jours de sa vie, la lune de miel, comme on disait. Pour en goûter la douceur, il eût fallu, sans doute, s’en aller vers ces pays à noms sonores où les lendemains de mariage ont de plus suaves paresses ! Dans des chaises de poste, sous des stores de soie bleue, on monte au pas des routes escarpées, écoutant la chanson du postillon, qui se répète dans la montagne avec les clochettes des chèvres et le bruit sourd de la cascade. Quand le soleil se couche, on respire au bord des golfes le parfum des citronniers ; puis, le soir, sur la terrasse des villas, seuls et les doigts confondus, on regarde les étoiles en faisant des projets. Il lui semblait que certains lieux sur la terre devaient produire du bonheur, comme une plante particulière au sol et qui pousse mal tout autre part. Que ne pouvait-elle s’accouder sur le balcon des chalets suisses ou enfermer sa tristesse dans un cottage écossais, avec un mari vêtu d’un habit de velours noir à longues basques, et qui porte des bottes molles, un chapeau pointu et des manchettes ! Peut-être aurait-elle souhaité faire à quelqu’un la confidence de toutes ces choses. Mais comment dire un insaisissable malaise, qui change d’aspect comme les nuées, qui tourbillonne comme le vent ? Les mots lui manquaient donc, l’occasion, la hardiesse.
32 Ces deux passages appellent différentes remarques (et nécessiteraient une analyse de texte [33] que je ne mènerai que peu dans les limites de cet article). Je ne ferai donc qu’un constat trop évident qui sera la « confidence de toutes ces choses » : nous avons affaire à une écriture ironique retorse. Faisons, maintenant, une dernière hypothèse (elle est très hasardeuse, « hardie » s’agissant de l’ironie flaubertienne) : les passages cités du roman (paru dès 1856) contiennent une leçon d’histoire de l’esthétique. Celle-ci répétera que les représentations paysagères sont fatiguées : elles sont stéréotypées. On l’a lu, le sublime [34] et l’idylle bégayent leurs clichés dans l’indistinction polysensorielle de la mer, de la montagne, du parfum des chèvres et des tintements – italiens ! – de citrons. « Toutes ces choses » culminant dans le kitch de l’habillement de Charles (le mari qui doit être assorti aux paysages, mais qui nous semble aussi désemparé qu’un caméléon sur un plaid écossais). Bref, Flaubert caricature la tradition descriptive enthousiaste du paysage avec une férocité rêveuse dont il faut chercher la mesure dans la redoutable « acuité » avec laquelle l’écrivain a compris les stéréotypes paysagers de son temps (Flaubert exprime avec délectation qu’il est désormais difficile pour « les vierges pures » de « monter au ciel » des Alpes comme des Amériques avec ou sans l’aide des voix d’Ossian, Chateaubriand, Lamartine, voire celle de « l’Éternel discourant dans les vallons »).
33 Fort de cette ultime hypothèse, passons du roman au monde, des personnages aux personnes. Je n’ignore pas que ce passage implique en l’occurrence un fâcheux postulat proche de l’ironie romantique. De même que le proposait la deuxième partie de cet article, on se fera touriste du canon littéraire auquel appartient Madame Bovary et, persuadé que cette fiction pourrait proposer un modèle scientifique éclairant, nous proposerons de livrer des éléments qui tendront à mettre en évidence l’importance des vertiges produits par les extraits paysagers flaubertiens comme preuve de la manière avec laquelle de vraies personnes ont perçu le paysage de montagnes et l’ont transmis. Un curieux texte dont la seconde édition (1854) est un peu antérieure à Madame Bovary sera convoqué. Il s’agit du Pèlerinage poétique en Suisse [35] d’André Hippolyte Lemonnier. L’état civil ne peut pas admettre le cousinage entre le personnage flaubertien cousin du clerc de notaire et les vers de Lemonnier (qui est un vrai voyageur en Suisse). Osons pourtant parier qu’un cousin capable de tels alexandrins serait une référence pour Léon. Quant à Emma (et à Flaubert !), gageons que pareil poème leur faciliterait « la confidence de toutes ces choses ».
Tes glaciers, Grindelwald, c’est la mer écumante,
Soudainement gelée au fort de la tourmente,
Comme, aux bornes du monde on nous peint ces climats,
Où la vague s’élève et retombe en frimas.
J’ai cru toucher au pôle, à ces rudes contrées,
Où s’arrêtent les flots des mers hyperborées :
Sur cet amas confus de glaçons entassés
J’ai cru lire ces mots par l’Éternel tracés :
Tu n’iras pas plus loin ! [...]
Ainsi dans l’Oberland, quand d’une haute cime
S’écoule l’avalanche avec un bruit sublime,
Sous son énorme poids les monts sont agités ;
On voit fumer les pins, sous les glaçons heurtés ;
Le colosse bondit, tombe, et l’âme troublée
Ressent le contre-coup de la terre ébranlée.
Par degrés, cependant, le calme est rétabli ;
L’avalanche n’est plus qu’un tonnerre affaibli :
Dans l’air, qui vibre encor, le ramier, l’hirondelle,
Éperdus, vers leurs nids volent à tire-d’aile ;
L’écho, d’un ton plaintif, répète au fond des bois
Le hurlement des loups et le cri des chamois ;
Mais le pic sourcilleux, roi de la solitude,
Va bientôt revenir à sa morne attitude ;
Le bruit décroît, il meurt, le trouble est réparé,
Et l’ordre universel n’est pas même altéré.
35 La question de l’ironie apparaît lorsque l’interprète fait intervenir le « modèle Bovary » dans ses analyses. En effet les clichés virevoltants qui structuraient le songe de la lune de miel ont permis assez exactement de dire (et de produire) l’« insaisissable malaise ». De plus, les vers de Lemonnier ont levé la prétérition de Léon en matière « d’effet gigantesque des glaciers », de « pins d’une grandeur incroyable » et autres « précipices ». L’ironie flaubertienne comporte la curieuse propriété de digérer le vide qu’elle produit sans cesse. Elle ne me paraît pas prioritairement chercher à offrir au lecteur une acidité et une assise capables de corroder le fonctionnement du cliché aux fins de l’éclairer sur l’état d’aliénation des regards (fût-ce le regard de celui qui écrit), mais bien, sans cesse, à ressasser la découverte d’un ressassement que je crois très proche de ce qu’un Derrida déclare de l’écriture et de ce « quasi-concept d’itérabilité [36] ». La pensée derridienne est difficile, autant que l’ironie flaubertienne. En l’occurrence, une analyse « déconstructionniste » a son utilité parce qu’il semble que l’ironie flaubertienne s’articule fréquemment à des structures stéréotypiques et qu’elle fasse donc particulièrement bien apparaître que l’intention qui anime l’énonciation ironique n’est pas de l’ordre d’une présence, mais, par l’emploi de clichés, s’efforce de présenter l’impossibilité d’une présence. Le recouvrement de l’esthétique des paysages suisses implique des vertiges ironiques auxquels le texte flaubertien nous convie. Il s’agit probablement d’une forme (déconstruite) de sublime. Quant à celui de Lemonnier, il est aussi sublime mais on le dira : différent.
Notes
-
[1]
Cet article doit beaucoup à une thèse intitulée « Impressions » ironiques du voyage en Suisse et dans les Alpes, soutenue à Dorigny en mai 2008. Je suis infiniment redevable à son directeur, Claude Reichler.
-
[2]
La Revue encyclopédique (ou analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans la littérature, les sciences et les arts..., Paris, Baudouin Frères, numéro de juillet 1822) citée en exergue attribue ces lignes aux Observations des Rédacteurs. Le premier exergue est extrait de la préface aux Lettres sur la Suisse, Altona, 1797.
-
[3]
Nommons ici la classique recension des pièces littéraires du voyage en Suisse faite par Gavin de Beer : Travellers in Switzerland, London-New York, G. Cumberlege Oxford University Press, 1949, ainsi que l’anthologie de Claude Reichler et Roland Ruffieux (Paris, Laffont, 1998). Renvoyons peut-être à l’état des lieux de Jean-Daniel Candaux, dans son article « Deux décennies de travail sur l’histoire de la montagne entre Encyclopédie et romantisme » (dans Compar(a)ison, Discours sur la montagne (XVIIIe et XIXe siècles) : rhétorique, science, esthétique, Gilles Bertrand et Alain Guyot (dir.), Bern, Peter Lang, 2003, p. 327 et sq.). Retenons le précieux tribut bibliographique versé par le géographe Adolf Waeber. Il a pris les dimensions d’un livre de 440 pages qui répertorie la littérature viatique en – et de – Suisse jusqu’en 1890. Voir Landes- und Reisebeschreibungen : ein Beitrag zur Bibliographie der schweizerischen Reiseliteratur, 1479-1890, Bern, K.J. Wyss, 1899. Enfin, les deux références qui suivent paraîtront indispensables à l’historien de la culture : John Grand-Carteret, La Montagne à travers les âges. Rôle joué par elle : façon dont elle a été vue, Grenoble et Moutiers, Librairies Dauphinoise et Savoyarde, 1903-1904 et C. Reichler, La Découverte des Alpes et la question du paysage, Genève, Georg, 2002.
-
[4]
On se réfère ici librement aux travaux de Philippe Hamon : L’Ironie littéraire. Essai sur les formes de l’écriture oblique, Paris, Hachette, 1996.
-
[5]
Voir C. Reichler : « Littérature et anthropologie. De la représentation à l’interaction dans une Relation de la Nouvelle-France au XVIIe siècle », dans L’Homme, n° 164, 2002.
-
[6]
Voir François-René De Chateaubriand : « Voyage au Mont-Blanc », dans Le Voyageur à l’envers. Montagnes de Chateaubriand, éd. précédée d’un essai critique par Juan Rigoli, Genève, Droz, 2005.
-
[7]
L’italique signalera qu’il s’agit d’un titre convenu au XIXe siècle (voir A. Waeber : Landes-und Reisebeschreibungen..., ouvr. cité). En un sens l’importance du nombre des imprimés répertoriés peut valider une des propositions de cet article. Celle de l’ironie comme tactique de résistance : une sorte de sauvegarde de l’impression, malgré les innombrables Impressions...
-
[8]
Voir l’article de Daniel Sangsue : « Le récit de voyage humoristique, (XVIIe-XIXe siècles) », RHLF, 2001, n° 4. Celui-ci établit une généricité viatique pour l’énonciation ironique. Selon lui, le récit de voyage humoristique « naît au XVIIe siècle avec le Voyage de Chapelle et Bachaumont et [son étude en suit] la tradition jusqu’à Töpffer ».
-
[9]
Voir C. Reichler : « Chateaubriand et le paysage des Alpes », dans Bulletin de la Société Chateaubriand, 2005, p. 79 à 97. Cet article nuance remarquablement le propos de J. Rigoli, tout en reconnaissant que le « dossier Chateaubriand » est en effet « à charge » !
-
[10]
Conférence de Bernard Crettaz dans le cadre de « Lausanne Jardins 97 » et publiée par le Département d’architecture de l’EPFL, sous le titre « Ah Dieu ! Que la Suisse est jolie ! ». Voir également La Beauté du reste, confessions d’un conservateur de musée sur la perfection et l’enfermement de la Suisse et des Alpes, Genève, Zoé, 1993.
-
[11]
On peut consulter les analyses baudrillardiennes de Disneyland dans son livre Simulacres et simulation et dans ses Cool Memories. Remarquons que ce « concept philosophique » a eu une scientificité diverse. Ainsi Marc Augé déclare-t-il : « Disneyland, c’est le spectacle lui-même qui est mis en spectacle : le décor reproduit ce qui était déjà décor et fiction » (L’Impossible Voyage, Paris, Payot et Rivages, Paris, 1997, p. 32).
-
[12]
Philippe Sirice Bridel (1757-1845) : ses écrits ont une teneur nationaliste fervente. Paradoxalement, il revendique parfois l’autonomie de la chose littéraire helvète avec les mots de ceux qui l’auraient oblitérée. C’est donc au moyen de représentations exogènes que le Doyen Bridel entend parfois souligner la prépondérance des représentations endogènes.
-
[13]
« Ah Dieu !... », ouvr. cité, p. 21. Notons ce passage que d’aucuns jugeraient très baudrillardien : « Quand je parcours les Alpes, de Nice au Tyrol, ou que je vais à travers la Suisse [...]. Chaque fois dans la réalité, on a déjà devancé l’observateur » (p. 32). Dans le passage de Tartarin sur les Alpes, convoqué ci-après, le parallélisme entre le territoire enfantin et mercantile des personnages de Walt Disney et les paysages à « tourniquets » payants, « pomponnés », « truqués, machinés comme des dessous d’opéra » est, si ce n’est historiquement fondé, du moins drôle à établir ! Néanmoins, ce pouvoir performatif qui investirait les discours touristiques (devancer le réel, le produire) gagne les propos sérieux et très informés d’un historien tel que Laurent Tissot, lequel, non sans se référer au Guide bleu (selon Barthes), écrit que le guide-itinéraire « vide le pays de ses habitants ». Le Baedeker est un « défenseur » d’un « absolutisme utilitariste » [...] et met en place un « idéal autarcique ». Voir Naissance d’une industrie touristique. Les Anglais et la Suisse au XIXe siècle, Lausanne, Payot, 2000, p. 70 et 72.
-
[14]
Dans son livre, Les Figures paysagères de la nation. Territoire et paysage en Europe (XVIe-XXe siècle) (Paris, EHESS, 2004), François Walter expose et discute autrement ce « “lexique” international de l’appartenance nationale, une ’international cultural grammar’ avec un thesaurus ou une check-list d’ingrédients comme le paysage [...] qui se décline ensuite dans un lexique national, voire se subdivise en idiomes régionaux. Ce mode interprétatif rejoint quelque part les présuppositions des linguistes formalistes russes » (p. 192).
-
[15]
Les Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, éd. et préf. de Jean-Didier Urbain, Paris, Payot & Rivages, 2007, p. 236. Daudet s’inspire ici de Nestor Roqueplan. En effet, dans La Vie parisienne. Regain (Paris, Lecou, 1853, p. 169 et sq.) on lit : « A l’approche du printemps, les habitants, machinistes habiles, mettent en place des montagnes artificielles, telles que le mont Blanc, le Rigi, amènent de l’eau dans les bassins, s’habillent à la Guillaume Tell [...] ». Roqueplan nous semble encore plus virulent que Daudet à l’endroit de la mercantilisation paysagère de l’Helvétie. Il déclare : quand « revient l’hiver, ils [les habitants] serrent toute cette décoration dans un seul canton disposé en magasin, reprennent des habits européens, chantent la “Grâce de Dieu”, parlent français et mangent tranquillement, dans leur pays redevenu plat, l’argent qu’ils ont gagné à montrer de fausses montagnes ».
-
[16]
Comte Théobald Walsh : Notes sur la Suisse, la Lombardie et le Piémont, Paris, C.J. Trouvé, 1829, p. 2. Avec celui de Gurovski (Impressions et Souvenirs. Promenade en Suisse en 1845) et certains moments « touristophobiques » des Voyages en zigzag de Töpffer, le récit de Walsh fait partie des témoignages les plus connus et les plus ironiques sur la Suisse au XIXe siècle.
-
[17]
Cette note se permet d’illustrer la surveillance dont nous parlons par un extrait d’un récit ordinaire fait en 1864. Il s’agit de deux jeunes enthousiastes épigones de Töpffer, arrivés près d’Andermatt, ils remarquent : « Autour de nous, nul signe de végétation ! On aurait dit qu’il était défendu même à l’herbe de laisser voir ses fines languettes vertes ! Le bruit imposant de ces séries de cascades étouffant le son de nos voix, joint à un froid assez intense occasionné par la fine pluie dont nous avait gratifié la Reuss, nous montrait l’aspect de ces lieux comme il est en réalité, c.a.d [sic] sévère, d’une beauté froide, glacée, arride [sic] et laissant dans nos jeunes cœurs le sentiment d’une solitude effrayante ». (Victor Rilliet, En Zigzag derrière Töpffer : deux jeunes Bâlois dans les Alpes en 1864, éd. Paul Hugger et Jean-Paul Verdan, Bâle, Société suisse des traditions populaires, 1999, p. 48). Ici, l’énoncé « l’aspect de ces lieux comme il est en réalité c.a.d », puis la série de stéréotypes sont intéressants. En effet, l’auteur le dit lui-même : « l’aspect de ces lieux » est à dire, il est à dire selon les contraintes « grammaticales » d’une énumération propre à un paysage lexicalement arrêté dans le cliché. Ce qui est « à voir » est donc « à dire » dans une forme d’aveuglement lexical.
-
[18]
Il existe de nombreuses études sur les sens de « pittoresque ». À ce sujet, on doit renvoyer à William Gilpin : Trois Essais sur le beau pittoresque, éd. du Moniteur, 1982 [1792]. On consultera avec profit la postface due aux soins de Michel H. Conan. Sur l’origine et l’évolution des catégories esthétiques du paysage, on consultera Robert Kopp : « Locus amoenus ou locus horribilis ? », dans La Suisse - une idylle ?, Peter Schnyder et Philippe Wellnitz (dir.), PUS, 2002.
-
[19]
À ce propos, se référer aux analyses de Daniel Maggetti, « La montagne dans les anthologies romandes de la deuxième moitié du XIXe siècle », dans Französisch heute, 1990, p. 192 à 202.
-
[20]
Albert [Azeline] Bovet, Carnet d’un touriste, Neuchâtel et Paris, Delachaux et Niestlé, Fischbacher, 1884, p. 52.
-
[21]
Ms fr. 9019. Ce manuscrit, illustré de la main de l’auteur appartient à la BPU de Genève. L’auteur – Albert Hentsch, il a alors 27 ans – intitule gouaches et textes : Voyage dans les cantons de Genève Vaud et Neuchâtel (Suisse). Le périple dure du 22 au 30 septembre 1831. Sur ce manuscrit, on peut consulter J.-D. Candaux, Töpfferiana : un survol des premiers imitateurs genevois de Rodolphe Töpffer, Genève, Georg, 1996.
-
[22]
La métonymie exclamative pour le moins guidée que Daudet utilise alors que son héros tarasconnais arrive au sommet du Rigi est très proche du fragment concernant la cime vaudoise de la Dent de Vaulion. En effet, dans Les Aventures prodigieuses de Tartarin... (ouvr. cité, p. 181), on lit : « le 10 août 1880, à l’heure fabuleuse de ce coucher de soleil sur les Alpes, si fort vanté par les guides Joanne et Baedeker [...] Monter si haut, venir des quatre coins du monde pour voir cela... Ô Baedeker !... »
-
[23]
Pour les linguistes, la différence entre la mention et l’emploi (ou employé en usage) fait référence à la réflexivité du langage. Dans l’énoncé « le paysage est joli », « joli » est employé en usage (il qualifie le paysage). Dans l’énoncé « joli a quatre lettres », joli est mentionné, il désigne l’adjectif joli. Quant à la « connotation autonymique », elle désigne l’emploi simultané de l’usage et de la mention. On parle de connotation autonymique lorsque le locuteur emploie et cite à la fois un mot.
-
[24]
La Découverte des Alpes..., ouvr. cité, p. 4. L’analyse de Reichler prend appui sur les travaux de Girard et sait admirablement montrer l’efficacité théorique du « désir médiatisé ».
-
[25]
La critique acerbe de Bloy à l’endroit de Daudet citée ci-dessus provient d’un article intitulé « Un Voleur de gloire », paru le 31 décembre 1888, il concerne la pièce tirée du roman. Voir Léon Bloy, Histoires désobligeantes. Belluaires et porchers, Paris, Union générale d’éditions, 1983, p. 245 et sq.
-
[26]
Alferd de Musset, La Confession d’un enfant du siècle [1836], dans Œuvres complètes en prose, Maurice Allem et Paul Courant (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1982, p. 228. Citons la suite de ce passage : « Notre chambre était pleine de hardes en désordre, d’albums, de crayons, de livres, de paquets, et sur tout cela, toujours étalée, la chère carte que nous aimions tant. [...] Allons en Suisse ! [...] c’est là qu’éclatent dans toute leur splendeur les trois couleurs les plus chères à Dieu : l’azur du ciel, la verdure des plaines, et la blancheur des neiges au sommet des glaciers. [...] Déjà Brigitte parlait du beau lac ; déjà Lausanne, Vevey, l’Oberland [...] ; déjà l’oubli, le repos, la fuite, tous les esprits des solitudes heureuses, nous conviaient et nous invitaient ; déjà, quand, le soir, les mains jointes, nous nous regardions l’un l’autre en silence, nous sentions s’élever en nous ce sentiment plein d’une grandeur étrange qui s’empare du cœur à la veille des longs voyages, vertige secret et inexplicable qui tient à la fois des terreurs de l’exil et des espérances du pèlerinage. »
-
[27]
Léon Bloy, La Femme pauvre : épisode contemporain, Paris, Mercure de France, 1957 [1re éd. 1897], p. 16 et 17. L’action est située en 1879. Des détails paysagers disséminés dans un roman résolument anti-champêtre de Huysmans (En rade, publié dans la Revue indépendante dès 1886) peuvent confirmer l’importance d’une ironie qui campe un paysage empiriquement impossible. Aux antipodes de la polysensorialité, le paysage nous plonge dans l’enfer de l’a-sensorialité : « - C’est tout de même étrange, dit Jacques, nous voici parvenus au Marais de la Putridité – et ce n’est pas un marais et il ne sent rien ! [...] Louise ouvrait le nez, humait le manque d’air. Non, aucune odeur n’existait [...] le vide, rien, le néant de l’arôme et le néant du bruit, la suppression des sens de l’odorat et de l’ouïe » (En Rade, Romans, Paris, Laffont, coll. « Bouquins », 2005, p. 828).
-
[28]
Un détail décoratif de la demeure de Crevel dans La Cousisne Bette (1846) de Balzac présente un dispositif textuel comparable (mais la prétention bourgeoise est en l’occurrence plus fondée). Le désir bourgeois ridicule de paysage suisse en prend pour son grade. En effet, selon le narrateur balzacien : « On aurait achevé tous les embellissements de Paris avec le prix des sottises en carton-pierre, en pâtes dorées, en fausses sculptures consommées depuis quinze ans par les individus du genre Crevel. [...] La chambre à coucher, tout en perse [...]. L’acajou dans toute sa gloire infestait la salle à manger, où des vues de Suisse, richement encadrées, ornaient des panneaux. Le père Crevel, qui rêvait un voyage en Suisse, tenait à posséder ce pays en peinture, jusqu’au moment où il irait le voir en réalité. » (La Cousine Bette, La Comédie humaine, sous la dir. de Pierre-Georges Castex, t. VII, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1977, p. 157.)
-
[29]
Henri Calet [Raymond Barthelmess] : Rêver à la Suisse. Avertissement de Jean Paulhan, Pierre Horay, 1984. La première publication de ce récit dont l’ironie subtile réalise une forme de satire sociale virulente date de 1948, aux éditions de Flore.
-
[30]
Ces vers datent de 1835, dans un poème intitulé « À la Suisse », issu d’un recueil Joies et larmes poétiques. Ils sont cités par Claudine Lacoste-Veysseyre dans Les Alpes romantiques. Le thème des Alpes dans la littérature française de 1800 à 1850, Genève, Slatkine, 1981, 2 vol, p. 301, sans qu’il soit possible d’en trouver une référence plus précise.
-
[31]
Quelques pages d’un numéro du Bulletin (2009) de l’Association culturelle pour le voyage en Suisse apportent de précieux éclaircissements sur ce point.
-
[32]
Gustave Flaubert, Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1951, p. 365 (2e partie, chap. I). C. Reichler, dans son livre (La Découverte..., ouvr. cité, p. 194) commente ce passage. Selon moi, il laisse entendre que le « cousin » est une construction flaubertienne réaliste qui pourrait refléter l’état de l’esthétique du sublime. J. Rigoli (Le Voyageur à l’envers..., ouvr. cité, p. 31), fournit un commentaire du même passage : « Flaubert, qui ne dépend lui d’aucun “cousin”, digère et restitue avec délices les hyperboles de Rousseau et de Bourrit, en une “conversation” si enracinée dans l’opinion commune, qu’il ne peut être absolument certain de son effet parodique. » Il cite, à l’appui de son argumentation concernant l’indécidabilité, une lettre du 9 octobre 1852 à Louise Colet. Pour ce qui regarde l’excitation de l’imagination musicale, je ne peux pas m’empêcher de songer à la VIIe Lettre d’un voyageur (parue dans la Revue des deux Mondes du 1er septembre 1835) où le voyageur sandien s’adresse à Franz Liszt en ces termes : « Je reçois de vos nouvelles [...] : vous avez un piano en nacre de perle ; vous en jouez auprès de la fenêtre, vis-à-vis le lac, vis-à-vis les neiges sublimes du Mont-Blanc. Franz, cela est beau et bien ; c’est une vie noble et pure que la vôtre. » (Œuvres autobiographiques, Georges Lubin éd., Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1971, t. 2, p. 850.)
-
[33]
Qu’il me soit permis de dire ici combien je partage les analyses proposées par Jeanne Bem dans « Le désir de réel et les images mentales – à propos de “Madame Bovary” » (Nouvelles Lectures de Flaubert, Tübingen, Gunter Verlag, 2006).
-
[34]
Bouvard et Pécuchet, les deux copistes géniaux de Flaubert, lorsqu’ils en viennent à aborder la question du sublime ont également recours à une série de clichés : « Ils abordèrent la question du sublime. Certains objets, sont d’eux-mêmes sublimes, le fracas d’un torrent, des ténèbres profondes, un arbre battu par la tempête. Un caractère est beau quand il triomphe, et sublime quand il lutte. – “Je comprends, dit Bouvard, le Beau est le Beau, et le Sublime le très Beau.” » (chap. V, Œuvres, éd. citée, t. II, p. 840).
-
[35]
Andé-Hippolyte Lemonnier, Pèlerinage poétique en Suisse, Paris, Cherbuliez, 1854, p. 25 et 26. La première édition date de 1836, Lemonnier est également homme de loi, archéologue, ethnologue et héraldiste, il meurt en 1871. On peut compléter à l’envi ce choix. Un exemple un peu plus connu serait celui Charles Didier (1805-1864), un ami de George Sand. Dans ses Mélodies helvétiques (Barbezat et Delarue, Genève et Paris, 1828), on lit : « Comme au jeune aigle, enfant des célestes campagnes, /Rendez-moi mes glaciers, rendez-moi mes montagnes, /Berceau des grands pensers et des nobles projets./O nature adorée, ô campagne immortelle !/À tes seules leçons je veux rester fidèle, /Car, la même toujours, tu ne lasses jamais ! » (p. 11). À propos de Didier, on lira l’étude de Christopher Warwick Thompson : Walking and the French Romantics. Rousseau to Sand and Hugo, New York, Peter Lang, 2003. Pour la bonne bouche, une dernière citation cousine sera livrée. Il s’agit de vers alpins transcrits d’un manuscrit (Ms Chaudesaigues) dont la Bibliothèque municipale de Grenoble est propriétaire. Le voyage est daté de 1831 : « Quel tableau ! que d’éclat ! que mon âme est saisie/Non, non, je n’y tiens plus ; c’est trop dans une fois/Oui, mon cœur est trop plein ! Je meurs de poésie ! »
-
[36]
« Étant donné cette structure d’itération, l’intention qui anime l’énonciation ne sera jamais de part en part présente à elle-même et à son contenu. L’itération qui la structure a priori y introduit une déhiscence et une brisure essentielle » (Jacques Derrida, Limited Inc., Paris, Galilée, 1990, p. 46). On renverra également aux limpides analyses d’Anne Herschberg-Pierrot qui décrit le fonctionnement de l’ironie flaubertienne dans son livre sur le Dictionnaire des idées reçues : « L’ironie flaubertienne vise en effet à brouiller la relation satirique en incluant dans sa cible le destinataire et l’énonciateur [...] à la dépersonnalisation de l’énonciation se joint une modalisation ironique ’à outrance’, qui tend à faire perdre la faculté de juger. » (Le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, Lille, Presses universitaires de Lille, 1988, p. 87).