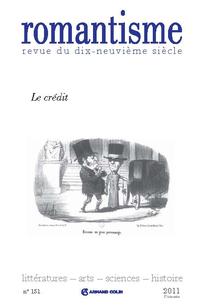1 La place du crédit dans la littérature post-révolutionnaire est longtemps restée inaperçue. Alors que nombre d’études furent consacrées à la place et au rôle des relations débiteur-créancier dans la comédie classique, ce questionnement s’effaça dès lors qu’on entrait dans la modernité littéraire. La scène archétypale de Monsieur Dimanche renvoyant peut-être trop caricaturalement à des relations de classes obsolètes, la critique sembla rejeter le crédit dans les oubliettes de l’Histoire alors même qu’elle mettait au jour le rôle immense de l’argent. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est sans doute parce que la monnaie et la finance entrèrent en littérature que l’on ne vit plus le crédit. Le roman réaliste – à commencer par le roman balzacien – était le roman de l’argent et cette généralisation permettait de s’en tirer à bon compte sans s’embarrasser du complexe écheveau juridico-financier des billets à ordre, lettres de change et autres rémérés.
2 Cette simplification est évidemment fâcheuse puisque, d’une part, elle nie les réalités du premier XIXe siècle en ignorant le rôle exorbitant que joua le crédit dans une économie française et européenne où États et individus vivaient à crédit. On ne saurait d’autre part analyser le crédit comme une simple modalité d’usage de l’argent sans l’amputer de ses deux principes constitutifs : le temps et le désir. Parce que l’endettement permet de satisfaire ici et maintenant un désir dont on acquittera le prix ultérieurement, le crédit doit bien être considéré comme du désir médiatisé par l’argent, de l’argent modalisé par le temps. Parallèlement aux enjeux économiques, on comprend donc qu’il faille appréhender les fondements socio-anthropologiques, psychologiques et philosophiques des schèmes fiduciaires. On ne saurait en effet comprendre l’argent littéraire, a fortiori l’argent balzacien, sans interroger cette éthique de la dette, nourrie de la condamnation aristotélicienne de l’intérêt et de la critique catholique de la spéculation, qui, si elle relève d’une forme d’impensé, informe la littérature du XIXe siècle. En opérant un survol trop rapide, nous exposerons la manière dont l’obsession fiduciaire saisit non seulement le texte balzacien, mais aussi un large pan de la littérature populaire à partir des années 1820. Il s’agira ainsi de montrer comment les schèmes du crédit structurent, selon des modalités variées, les œuvres et, chez Balzac, offrent au lecteur une expérience fictive du crédit dont les enseignements valent toujours aujourd’hui…
LA DETTE, PHÉNOMÈNE D’ÉPOQUE
Pourquoi tant de dettes ?
3 L’absence de reconnaissance du rôle et de la place du crédit dans la littérature du premier dix-neuvième siècle repose sans doute sur une vision trop historiciste des rapports qu’entretiennent la fiction et la finance. De nombreux auteurs estiment en effet que le crédit ne joue de véritable rôle littéraire qu’à partir de la fin du XIXe siècle avec l’avènement de l’économie moderne. Ainsi, selon Henri Mitterrand, il faut attendre Zola pour que soit « saisi […] le passage d’une économie de la garantie-or, du coffre-fort et de la thésaurisation, encore quelque peu balzacienne, à une économie du papier-monnaie, du marché boursier et de la spéculation [1] ». Quant à Jean-Joseph Goux, il démontre que la fascination du roman pour la fiducie procède de l’abandon de l’étalon-or, inconvertibilité qui, selon la théorie de Walras, ôte tout fondement objectif à la monnaie et par extension à toute valeur. La littérature pouvait alors interroger, comme en miroir, une volatilité du signe monétaire qui la renvoyait à l’arbitraire du signe linguistique mis au jour à la même période par les travaux de Saussure et étudier « l’esthétisation de la marchandise et la brisure du sujet [2] » procédant de la fiduciarisation corollaire des rapports humains.
4 Il ne s’agit certes pas de « démonétiser » les conclusions d’une analyse aussi pertinente qu’éclairante, mais d’interroger les défauts, propres à toute historicisation. J.-J. Goux dresse bien un parallèle entre Gobseck et M. Teste, mais il range rapidement La Comédie humaine du côté d’un « nouveau paradigme du prêt à intérêt […] positif [3] », aux antipodes de la fiducie inquiète de Valéry. Sans doute la lecture de récits balzaciens ultérieurs eût-elle permis de dépasser cette lecture euphorique… mais elle eût mis à mal la vision finaliste du critique. Car le déchaînement littéraire des années 1825-1845 constitue bien une énigme, un anachronisme déroutant qu’une étude de corpus large corrobore de manière saisissante. Nous avons mesuré, grâce à la base Frantext, la fréquence des termes crédit, créancier, usurier, usure, dette, débiteur, escompte, escompter dans un corpus de 253 œuvres écrites entre 1800 et 1869 et couvrant la plupart des genres [4]. Le premier enseignement offert par cette étude confirme la place exorbitante du crédit chez Balzac. La surreprésentation lexicale de l’isotopie fiduciaire y est flagrante, chacun des items affichant des fréquences très supérieures à la moyenne [5]. Le phénomène balzacien ne saurait cependant masquer le fait que, sur la période 1830-1845, la fréquence des huit termes sélectionnés culmine spectaculairement dans l’ensemble du corpus de référence. Plus que le poids des fréquences, toujours discutable, c’est bien la physionomie de la courbe qui doit retenir notre attention en ce qu’elle met en évidence, sur une plage de quinze années, un « phénomène-crédit », un fait d’époque dont l’abondante littérature physiologique constitue bel et bien le premier symptôme.
Le rôle des physiologies dans l’invention de la dette
5 En effet, dès les années 1820, cette « littérature malicieuse de l’observation » s’est attachée à décrire « tout un comique familier appartenant aux situations de la vie courante, aux petits obstacles de la vie, à la toilette, aux dettes, aux femmes [6] ». Cette « écriture de l’actualité » (Nathalie Preiss) s’intéressa ainsi très précocement au crédit. Jacques-Gilbert Ymbert livre en 1822 L’Art de faire des dettes puis en 1824 L’Art de promener ses créanciers, suivi en 1827 d’une sorte de synthèse de Marco de Saint-Hilaire, L’Art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, enseigné en dix leçons, ou Manuel de Droit Commercial par feu mon Oncle. Les physiologies stricto sensu suivirent avec, en 1840, une anonyme Physiologie du créancier publiée dans Le Charivari, doublée un mois après d’un Croquis à la plume : Physiologie du débiteur, puis, en 1841, une Physiologie de l’usurier de Charles Marchal, une Physiologie de l’argent par un débiteur et une Physiologie du Créancier et du Débiteur de Maurice Alhoy. Devançant le roman dans sa mise en texte du crédit, la physiologie contribua fortement à inventer les identités topiques qu’ordonnaient les jeux des dettes et créances. L’usurier, le créancier et le débiteur devenaient ainsi des types, certes nourris des poncifs du siècle passé, mais enrichis d’une réflexion économique qui, sous ses dehors goguenards, témoignait d’une appréhension nouvelle du rôle du crédit. Conçu à la fois comme un outil de conquête – il produit de la dynamique sociale et engendre des richesses – mais aussi comme un piège dans lequel l’individu peut sombrer, le crédit devenait ce pharmakon dont le roman réaliste allait se nourrir.
6 Premier écrit physiologiste consacré au crédit, L’Art de faire des dettes pose avec une remarquable précocité les bases de cette nouvelle science fiduciaire. Relatant les théories d’un « jeune homme comme il faut » dont la société ne reconnaît pas la valeur [7], ce traité justifie les débits – y compris non acquittés – en estimant que ces jeunes talents ont un droit de tirage sur la société, comportement d’ailleurs justifié par comparaison avec l’État. Pour Ymbert, « plus on emprunte, plus on a de crédit. […] Ce qui réussit à une puissance ne saurait faillir à un homme comme il faut [8] », constat repris par un Marco de Saint-Hilaire qui estime que « la splendeur d’un État étant toujours en proportion de la masse de ses dettes (voyez l’Angleterre), relativement aux individus, raisonnez par analogie [9] ». Cet argumentaire spécieux qui détourne les principes économiques libéraux d’un Mill ou d’un Bentham n’en cache pas moins un manque à être et un manque de reconnaissance qui renvoient au Mal du siècle. Il sera constamment repris par les autres physiologistes puis par le roman qui, tout en héritant de ces stéréotypes, saura, notamment chez Balzac, passer de l’observation des réalités du crédit à leur mise en texte. Cette migration générique est importante puisque, en dramatisant les dettes et créances, on pouvait sortir du simple discours de provocation pour appréhender les conséquences tant sociales qu’individuelles, tant économiques que psychiques, de cette nouvelle hégémonie du crédit.
Quand le crédit pallie les carences de liquidités
7 Sans doute la sensibilité particulière des « gens-de-lettres » à la dette – qu’on se souvienne d’Illusions perdues – explique-t-elle pourquoi la littérature participe si puissamment de la construction d’un imaginaire social du crédit, mais on aurait tort de n’y voir qu’une position corporatiste. De la même manière, on ferait fausse route en n’expliquant l’omniprésence des dettes de La Comédie humaine qu’à l’aune des débits contractés à la ville par l’auteur [10]. L’explication peut sans doute éclairer l’acuité particulière de la vision balzacienne, mais elle reste marginale au regard de l’ampleur d’un phénomène qui dépasse largement Balzac. Les principales causes de cette fiduciarisation spectaculaire de la production littéraire, qui contredit la vision historiciste évoquée plus haut, nous semblent prioritairement résider dans les données économiques et monétaires contextuelles. Dans un pays que l’épisode des Assignats a rendu durablement méfiant à l’égard du papier-monnaie officiel, l’insuffisance chronique des liquidités, outre ses conséquences naturellement inflationnistes, handicape l’industrie et le commerce, ralentit la croissance et provoque des faillites artificielles semblables à celle de Birotteau. Mais ses méfaits se ressentent également au niveau des particuliers qui, toutes classes sociales confondues, courent après l’argent. Car les viveurs ou les impécunieux qui s’endettent pour subvenir à leurs besoins ne sont pas les seuls à devoir recourir au crédit. Comme l’explique doctement Crevel dans La Cousine Bette, chacun « tripote de son mieux », c’est-à-dire se résout à utiliser les instruments fiduciaires comme une monnaie de substitution. On réescompte – c’est-à-dire on revend sans attendre que le débiteur rembourse les sommes dues – les reconnaissances de dettes ou les billets dont on est bénéficiaire pour acquitter ses propres dépenses. Mais le créancier qui, comme Lousteau, essaye de monnayer ses billets ou lettres de change pour en tirer un peu d’argent frais doit négocier avec un usurier ou avec quelque négociant faisant office de banquier.
– Barbet, dit Étienne au libraire, nous avons cinq mille francs de Fendant et Cavalier à six, neuf et douze mois ; voulez-vous nous escompter leurs billets ?
– Je les prends pour mille écus, dit Barbet avec un calme imperturbable. – Mille écus [3 000 francs] ! s’écria Lucien.
– Vous ne les trouverez chez personne, reprit le libraire. Ces messieurs feront faillite avant trois mois […] Mais vous me reviendrez, et je ne vous donnerai plus alors que deux mille cinq cents francs [11].
9 Cette monnaie-bis est bien peu sûre. Toujours soumise au risque de non-remboursement, elle n’a d’autre fondement objectif que la confiance qu’inspire le débiteur premier… Aussi sa valeur réelle peut-elle aller de soixante pour cent à… zéro, virtualité aggravée par la volatilité physique des dettes et créances qui, telles des maladies honteuses, contaminent l’ensemble du corps social. Mais cette viralité est ambivalente. Elle met certes l’individu à l’encan en le plaçant sous la coupe de financiers qu’il ne connaît pas, en créant des systèmes contraignants d’obligations [12], mais elle n’est que l’avers de la puissance circulante du crédit qui constitue le principe dynamique de l’économie de ce premier dix-neuvième siècle, notamment théorisée par Saint-Simon [13]. Dans sa capacité à se nourrir des éléments du réel, le roman comprend très vite l’intérêt qu’il peut tirer de cette ambivalente dynamique fiduciaire pour nourrir ses fables.
QUAND LE CRÉDIT ORGANISE LE RÉCIT
La systématique du crédit
10 Le couple créancier-débiteur s’affirme, logiquement, comme la structure actantielle fondamentale de nombreux récits. Gobseck s’organise ainsi autour des relations complexes, à la fois morales et financières, qui s’établissent entre le créancier éponyme et Derville, entre l’usurier et Anastasie de Restaud, double relation dont dépend le mariage de Camille de Grandlieu. La Maison Nucingen se construit également sur ce schéma binaire, mais le transpose de la sphère strictement privée à la sphère publique qui régit les relations entre l’État et la Haute-Banque. Laissant à trois reprises courir le bruit de sa liquidation, ce débiteur de génie manipule si bien ses créanciers (grandes familles aristocratiques, banquiers…) qu’il sait, ici, les convaincre de lui prêter de l’argent, là, leur faire accepter un remboursement partiel qui solde les dettes… Celui qui obligera bientôt rois et États n’est pas seulement le modèle de cette finance aussi insolente qu’entreprenante. Il met en évidence les paradoxes d’un système où, parfois, « le débiteur est plus fort que le créancier » (MN, 6, p. 391).
11 Mais s’en tenir à ce schéma dual, au demeurant déjà largement éprouvé par la comédie classique, reviendrait à ignorer la puissance agrégative du crédit. Par le jeu complexe de l’escompte et du réescompte, les billets circulent de main en main associant par là même plusieurs personnages qu’ils relient et unissent en un système. Une fille d’Ève offre un exemple typique de ce phénomène à travers le cas de Raoul Nathan, jeune journaliste à la mode qui veut entrer en politique. Sa fortune personnelle ne lui permettant pas de satisfaire au cens, il s’endette auprès de du Tillet, le redoutable banquier qui n’est autre que le beau-frère de sa maîtresse, Marie-Angélique de Vandenesse. Loin d’agir par charité, du Tillet voit plutôt dans ce crédit le moyen de circonscrire un rival politique en le « tena [n] t ainsi par le licou de la lettre de change » (FE, 2, p. 345). Du Tillet renouvellera les effets, mais, finissant par exiger son dû, jettera Nathan dans les bras de Gigonnet, « la providence à vingt-cinq pour cent des jeunes gens embarrassés » (p. 351). Ruiné, acculé par ce terrible créancier et au bord de l’emprisonnement pour dette, Nathan envisage le suicide et ne se tire de ce mauvais pas que par les efforts de Marie-Angélique. Celle-ci fait en effet signer de fausses reconnaissances de dettes par son ancien maître de musique, Schmuke, lettres de change qu’elle se fait payer par Nucingen grâce à la médiation de Delphine. Avouons-le, c’est surtout la magnanimité de Vandenesse, le mari trompé, qui permettra de liquider l’ensemble de ces dettes. Félix paye pour que la signature de sa femme malheureusement apposée au bas de lettres de change infamantes, ne circule pas dans tout Paris. Raoul est donc sauvé et le traquenard de du Tillet échoue. Mais ce ballet de billets, outre le fait qu’il structure totalement le récit et dynamise ce qui n’aurait été qu’une banale histoire d’adultère, permet de mettre en présence des protagonistes jusqu’ici étrangers et de créer de nouvelles relations de dépendance qui débordent le seul cadre du récit. À partir d’Une fille d’Ève, Vandenesse, en dette à l’égard de Nucingen, s’engage à soutenir le banquier pour le remercier de s’être montré si complaisant. Voilà comment, entre vaudeville et fresque historique, une dette privée participe de la grande alliance entre noblesse et bourgeoisie qui caractérise le siècle.
12 La même aptitude du crédit à créer du lien se retrouve dans Illusions perdues puisque c’est par la grâce de la lettre de change que les Cointet, papetiers jaloux de David Séchard, parviendront à dépouiller légalement le jeune inventeur au terme d’épisodes juridico-financiers qui, s’ils peuvent déconcerter le lecteur contemporain [14], constituent un puissant outil de motivation. C’est dans le déploiement de la mécanique implacable de la lettre de change que le récit fabrique sa vraisemblance ; c’est par la fiction de cet argent donné pour vrai que la fiction romanesque acquiert sa crédibilité. Il est d’ailleurs intéressant de noter que ces effets de motivation ne s’établissent pas à la seule échelle du récit mais de l’œuvre tout entière puisque nombre de dettes permettent, d’un roman à un autre, d’assurer le lien entre les différents récits de La Comédie humaine.
Le crédit comme objet mélodramatique : entre commodité et fatalité
13 Principe de motivation du système des personnages, le crédit assure également, sur le plan diégétique, des retournements de situation qui conditionnent le lancement ou la relance de l’action, le récit jouant de la double temporalité endettement/remboursement. Le roman populaire use ad libitum de cet expédient narratif, à l’instar des Mystères de Paris qui débute quasiment avec le remboursement par Rodolphe des « deux cent vingt francs dix sous » dus par la Goualeuse à l’ogresse. En opérant cette restitution, Rodolphe – qui se voue lui-même au bien pour racheter une ancienne faute, c’est-à-dire pour payer sa dette, « libère » Fleur-de-Marie et rend possible la reconnaissance ultérieure de sa fille. Dans Le Comte de Monte-Cristo, le héros rachète à Boville, son ancien geôlier, les 200 000 francs de dettes de Morrel et sauve l’armateur de la faillite. En convoquant le hasard, de manière plus ou moins vraisemblable, ces effets de surprise privilégient un schéma euphorique qui reste cependant relativement minoritaire. La dynamique narrative du crédit est en effet le plus souvent déceptive, notamment chez Balzac, où les remboursements imprévus d’une créance laissée pendante ne servent souvent à rien, arrivent trop tard et ne parviennent pas à interrompre le cours du malheur. Dans Pierrette, la grand-mère, pauvre et sans secours, désespère de pouvoir sauver sa petite-fille des griffes de Rogron quand, de manière inattendue, un ancien débiteur de son mari restitue à « sa créancière capital et intérêts, […] environ quarante-deux mille francs » (P, 4, p. 139). Mais la vieille dame arrive trop tard et ne peut que recueillir Pierrette expirante. Le même effet de contretemps se retrouve dans Illusions perdues puisque, au moment précis où David signe les documents conférant aux Cointet la pleine propriété de l’imprimerie Séchard, « la voix de Kolb retentit dans l’escalier » (IP, 5, p. 724) annonçant que Lucien venait d’envoyer quinze mille francs… Arrivé quelques minutes auparavant, ce remboursement aurait interrompu toute la procédure et sauvé Ève et David. Mais il fallait que le crédit impose sa loi… Sans doute Balzac aime-t-il à jouer des codes mélodramatiques, mais ce schéma déceptif est avant tout destiné à illustrer la violence d’une institution sociale qui broie les êtres. Le récit refuse non seulement de céder aux facilités de ces remboursements miraculeux, mais il multiplie même les situations où le personnage est rattrapé par des dettes, contractées antérieurement, que ni lui ni le lecteur n’avaient gardées en mémoire. Tout se passe comme si le crédit poursuivait son chemin à notre insu, comme s’il s’agissait d’une mécanique vivante et autonome qui impose sa loi au personnage. Cette habileté narrative que Genette dénomme paralipse participe de la production de l’intérêt romanesque en créant des rebondissements, mais elle permet également d’illustrer la manière dont l’imaginaire populaire se représente le crédit comme un principe transcendant, un impératif moral.
14 Le roman populaire saura bien entendu saisir les opportunités mélodramatiques de cette justice à crédit qui permet de punir le débiteur fautif qui doit assumer le passif moral et financier dont il croyait pouvoir se débarrasser. Quand Monte-Cristo exige in fine de Danglars qu’il honore cinq millions de billets (chap. 104, « La signature de Danglars »), il ne prend pas en traître l’ancien comptable du Pharaon qui, dès sa première entrevue avec le mystérieux comte (chap. 46, « Le Crédit illimité ») savait pouvoir/devoir mettre d’importantes sommes à sa disposition. Danglars n’ayant pas voulu croire à cette échéance, il est acculé à la faillite, obligé d’assumer une dette d’ailleurs moins financière que morale, le banquier s’effaçant devant le traître qui a vendu Dantès. À l’exception du Cabinet des Antiques peut-être, ce genre de dénouement moral est très rare dans La Comédie humaine. La latence des effets de crédit y est plutôt convoquée pour mettre en évidence la puissance aveugle de créances qui s’imposent aux individus et finissent toujours par les briser. Pas de miracle à crédit, mais la loi d’airain de la dette qui doit, d’une manière ou d’une autre, être acquittée. Avec le cynisme et la froideur inhérents au secrétaire de la société, Balzac expose d’ailleurs la fonctionnalité de cette règle dans L’Interdiction et Les Petits Bourgeois. S’il loue la bonté d’âme et les idées humanitaires d’un Popinot qui pratique le prêt gratuit, il doit constater que son remplacement par la terrible usure de Cérizet ne change rien. « Une fois mort l’ange dont la bienfaisance pesait sur ce quartier, l’usure de bas étage est accourue […]. Chose étrange, bonne à étudier d’ailleurs, l’effet produit, socialement parlant, ne différait guère. » (PB, 8, p. 120).
Le crédit balzacien comme contrainte narrative
15 Cette loi d’airain n’a cependant pas que des traductions thématiques et s’impose à la structure narrative de La Comédie humaine. À la différence du roman populaire qui n’ajuste qu’approximativement la balance des dettes et créances, le roman balzacien se conforme scrupuleusement à l’impératif d’équilibre. Pas une œuvre – à l’exception du Député d’Arcis, inachevée – qui ne se referme sans qu’ait eu lieu le remboursement financier ou moral de la dette première… fût-ce, parfois, au prix de quelque entorse à la cohérence psychologique voire au vraisemblable romanesque. Ici, c’est Lucien qui effectue à la fin de la troisième partie de Splendeurs et misères des courtisanes un remboursement aussi édifiant qu’improbable. Celui qui n’a jamais assumé ses dettes et qui a toujours fait payer les autres ne peut imaginer de quitter la vie terrestre, et La Comédie humaine, sans apurer ses comptes. Là, c’est César Birotteau qui opère le « payement intégral de sa dette », exploit dont le narrateur auctorial reconnaît lui-même qu’il s’agit d’un « résultat sinon impossible, du moins gigantesque » (CB, 6, p. 287). Dans ces deux cas, la violence exercée par le crédit sur la structure narrative est spectaculaire, mais ces romans ne font qu’illustrer la règle fiduciaire qui s’impose dans La Comédie humaine. Et de manière tout aussi systématique, le récit de crédit, une fois le remboursement effectué, est « expédié » en quelques pages. Dépourvu de matière, il ne survit pas aux dettes qu’il a lentement – parfois complaisamment – accumulées, situation qui rappelle La Peau de chagrin, ce proto-récit de crédit où le talisman possède des modalités de fonctionnement tout à fait semblables aux lettres de change. Dans ce roman comme dans toute histoire de dette, « l’histoire se terminera quand il n’y aura matériellement plus rien à voir de cette peau-point de vue, par laquelle le roman se regarde vectoriellement disparaître dans l’objet rétractile où le héros aperçoit aussi la figure lucide et finale de son devenir [15] ».
TROIS MODALITÉS D’INSCRIPTION NARRATIVE DU CRÉDIT
Karr ou l’invasion du crédit
16 La puissance tout à la fois coercitive et dynamique qu’exerce la matrice fiduciaire sur le récit balzacien est, d’un point de vue socio-critique, une illustration particulièrement intéressante de la manière dont le roman intériorise une norme sociale. Reflet du génie et de la spécificité du réalisme balzacien, elle est également le symptôme de la fascination qu’exerce globalement le crédit sur le roman du premier XIXe siècle. Par-delà les dispositifs financiers complexes qui enserrent débiteurs et créanciers, les dettes s’affirment comme une norme absolue qui régit le comportement des individus. Sous les tilleuls d’Alphonse Karr [16] offre ainsi dès 1831 un exemple parfait de ces troubles combinatoires fiduciaires où le monétaire se mêle à l’éthique. Ayant fui le domicile paternel pour échapper aux humiliations d’un père peu aimant qui veut lui imposer un mariage de convenance, Stephen, le héros, accepte les conditions d’une vie pauvre afin de gagner l’indépendance financière qui lui permettra d’épouser Magdeleine. Ce faisant, il considère que la jeune femme a une dette à son égard et il se sentira à la fois trahi et floué quand, sur la pression de son propre père, elle renoncera à cette union morganatique pour épouser Edward, un bon parti qui n’est autre que l’ancien meilleur ami de Stephen. Le héros cède alors à un délire de possession, reprochant à cette « misérable femme de [lui] avoir ainsi pris [s] a vie et [s] on bonheur pour ne rien [lui] donner en échange [17] », délire qui, loin de se cantonner à l’inconstante, s’étend bientôt à l’ensemble de la gente féminine. Grâce à l’un de ces coups de baguette magique du crédit évoqué plus haut, Stephen se trouve à la tête d’une fortune considérable, mais loin d’utiliser sa richesse pour tenter de reconquérir sa belle, il se lance au contraire dans une carrière de séducteur. Chaque femme conquise est aussitôt abandonnée, comme s’il s’agissait de faire payer à toutes la dette primordiale contractée par Magdeleine : « il a été trompé par une. Eh bien, sa vengeance s’exerce contre les femmes et est un sacrifice perpétuel, un sacrifice de l’amour le plus constant à celle qu’il hait et qu’il a le droit de haïr » (p. 243). Cette pathologie créancière n’est pas simplement le fruit d’une monétarisation des rapports humains qui caractériserait ce siècle de fer. Elle illustre cette nouvelle catégorie de sujets modernes aux prises avec la fiducie, Stephen faisant indéfectiblement penser au Granville d’Une double famille qui, dans un récit exactement contemporain, succombe lui aussi, pour des causes similaires, à la même folie créancière. Sous les tilleuls,comme nombre des Scènes de la vie privée publiées à la même époque par Balzac, est ainsi jonché de dettes protéiformes, tour à tour anecdotiques ou vitales : ici, les « ardoises » que le jeune homme accumule classiquement dans sa mansarde, là, un billet à ordre qui aurait permis à Stephen de se « refaire »… s’il ne l’avait utilisé comme chandelle pour lire un billet amoureux de Magdeleine… Il y a surtout cette dette mortelle contractée auprès du frère. Stephen – qui économise ses maigres subsides pour pouvoir épier au théâtre la belle Magdeleine qu’il n’a plus le droit de fréquenter – refuse ainsi de lui prêter les quelques florins nécessaires au remplacement d’un équipement militaire trop usé. Le frère mourra vaillamment sur le champ de bataille à cause d’un étrier rompu… Le prêt refusé inaugure une dette inextinguible. On comprend par conséquent que le héros – à l’instar de la plupart des personnages balzaciens – ne puisse appréhender les relations humaines autrement que par le prisme de la dette.
La calcification mélodramatique du crédit dans le roman populaire
17 Symptôme précoce de la pathologie sociale du crédit qui gagne l’ensemble de la société, ce roman à maints égards maladroit et hétérogène doit cependant être considéré comme une des premières satires de la dette, une satire au sens étymologique puisque Sous les tilleuls est saturé de dettes protéiformes. Le récit est comme envahi, voire agi, par un facteur social qui semble impossible à maîtriser. Là réside la différence avec le roman populaire qui, parce qu’il en domestique les polyphonies, instrumentalise l’objet-crédit et finit par le réifier. Logique invasive là, logique calcifiante ici. Le crédit apprivoisé mêle ses structures à des motifs plus classiques à l’instar du Comte de Monte-Cristo qui peut être lu comme un récit de vengeance énoncé sur le mode de la dette. L’argent, tour à tour prêté ou emprunté, est l’arme par laquelle s’exerce la vengeance et s’effectue le rachat, par laquelle Busoni libère Villefort (« vous m’avez assez payé votre dette [18] »), par laquelle Danglars est puni. Il est d’ailleurs intéressant de souligner que quand Verne « recommence », à la fin du siècle, Monte-Cristo avec Mathias Sandorf (1885), il ne se contente pas de reprendre le motif et la structure du récit de Dumas, il en importe l’écheveau des dettes et créances et emprunte la mécanique fiduciaire du roman faisant ici pleuvoir les remboursements aussi imprévisibles que « justes », endettant là les méchants qui avaient trahi le héros Sandorf (devenu l’énigmatique docteur Antekirtt) et qui seront conduits, par la violence de l’argent, à payer leur dette morale [19]. Entre Karr et Verne s’écoule un demi-siècle au cours duquel les ressorts complexes du crédit sont certes domestiqués, mais aussi banalisés. Ils se transforment en autant de stéréotypes mélodramatiques que l’on retrouve jusque dans L’Argent de Zola où le récit, mettant en scène le savoir-faire de la Méchain, joue à plein de la latence des effets de crédit et de leur puissance contaminante [20].
La Comédie humaine ou l’expérience fictive du crédit
18 Cette évolution ne donne que plus de relief à l’invention balzacienne du crédit. Peut-être parce qu’il expérimenta toute sa vie les stratégies les plus élaborées pour vivre avec ses dettes, Balzac prit véritablement le crédit au sérieux et refusa d’instrumentaliser ce qu’il savait être plus qu’un expédient financier. Ses débiteurs ont beau parader, ils ont compris, à l’instar de Maxime de Trailles que la lettre de change, « c’est le Pont-des-soupirs, on n’en revient pas » (HA, 7, p. 780) ; ils savent qu’en s’endettant, en paraphant un chiffon de papier, ils engagent leur être. Lucien en fait l’amère expérience quand Samanon lui propose de lui racheter à 30 % les billets de Fendant et Cavalier. Il avait reçu « 5 000 francs », mais il ne peut en tirer que 1500, dévaluation qui sanctionne la démonétisation du poète : « vous ne valez pas grand-chose, dit [Samanon] à Lucien, vous vivez avec Coralie et vos meubles sont saisis » (IP, 5, p. 509). Faute d’argent vivant, le papier-monnaie s’impose mais sans valeur fixe et c’est par conséquent le sujet émetteur ou l’endosseur, celui qui signe ou contre-signe le billet, qui deviennent l’aune de cette monnaie à la fois fausse et véritable. L’individu est devenu le véritable étalon d’une monnaie de substitution qui circule à son insu et se dévalorise à mesure qu’elle circule. Ramené à l’état de marchandise, le sujet dont la signature est ballottée quitte la sphère du hors de prix. Il est coté, évalué, réduit à une quantité algébrique et l’on comprend que – revisitant de manière faussement plaisante le pacte diabolique – Balzac ait pu dans Melmoth réconcilié mettre une âme en vente à la Bourse.
19 En ce sens, on peut considérer que le contexte économique très particulier des années 1830-1845 expérimente, à petite échelle, une phase d’inconvertibilité du signe monétaire qui surviendra à la fin du siècle. Voici pourquoi la mise en texte balzacienne du crédit préfigure les problématiques fiduciaires dont J.-J. Goux voit l’avènement chez Valéry. Elle les préfigure aux plans thématique et narratif, mais aussi énonciatif puisque, par effet de capillarité, la relativisation de la valeur monétaire s’étend au signe linguistique, précarisant le pacte véridictoire consubstantiel au récit réaliste.Sous les tilleuls offre une illustration de cette contamination puisque, parmi la myriade de dettes qui saturent le récit, surgissent inopinément les dettes réelles de l’auteur à l’égard de son éditeur, une métalepse narrative avouant :
Il est possible que Charles Gosselin, notre éditeur, nous ait payé ce livre d’avance, et que le finir soit aujourd’hui l’acquittement d’une dette. Il est possible encore que ce livre offert au public soit écrit pour une seule personne, destiné seulement à être lu par elle (p. 158).
21 Par sa désinvolture, la mention des fondements incertains du contrat relève de la veine frénétique et pourrait n’être qu’anecdotique. Mais le fait que Balzac reprenne de manière de plus en plus systématique cette problématique de l’énonciation fiduciaire nous incite à prendre au sérieux la métalepse ironique de Karr. L’auteur n’est pas, comme on pourrait le croire, le créancier du lecteur, mais son débiteur, Balzac construisant son œuvre comme promesse, engagement de récits à venir (voir le Catalogue…), endettement permanent et entretenu tant à l’égard des éditeurs que du lecteur. De la même manière que Raphaël demande à Blondet de lui « faire crédit d’une heure d’ennui » (Pch, 10, p. 130) pour lui raconter l’histoire de sa vie, l’auteur essaye de maintenir l’intérêt d’un lecteur qui comme « ce diable de Couture [, ] a tellement l’habitude d’anticiper les dividendes, qu’il anticipe le dénouement de [l’] histoire » (MN, 6, p. 347 [21]).
22 En faisant de la matrice fiduciaire non seulement le principe organisateur du récit, mais sa condition de possibilité énonciative, La Comédie humaine ne conte pas seulement les aventures de personnages qui jouent ou pâtissent de la dette, elle décrit le mouvement d’intériorisation de l’argent à crédit qui caractérise les sociétés modernes. L’argent n’est plus un donné extérieur, un médium qui permet d’agir sur le monde. Il s’affirme comme un objet ambigu qui est certes vecteur du commerce mais dont la valeur s’établit tout autant en fonction des objets échangés que des individus qui le possèdent. César Birotteau, dans la première partie du roman éponyme vit clairement dans cette illusion instrumentale, mais il découvre bientôt avec effroi les réalités de l’argent dette qui anéantit sa réputation et son être. Le « je DEVAIS » angoissé qui s’écrit en lettres capitales dans La Peau de chagrin n’est pas seulement la marque d’un pouvoir d’achat en berne, il traduit la privation d’un pouvoir être : « je DEVAIS. Devoir, est-ce s’appartenir ? » (Pch, 10, p. 199). Le récit balzacien restitue ce glissement de la praxis à l’ontologie en liant strictement la temporalité des dettes à celle du sujet. De manière systématique, la vitesse du récit – très rapide durant la phase de l’endettement – ralentit spectaculairement quand vient l’heure de la restitution, à l’instar d’Une fille d’Ève où les dettes sont contractées trois cents fois plus vite qu’elles ne sont remboursées [22]. En représentant de manière sensible le changement qualitatif de durée qui caractérise la phase de restitution, Balzac préfigure les analyses de Simmel [23].
23 L’aspectualisation du récit permet de faire ressentir au lecteur cette durée débitrice à travers des ruptures et des arythmies qui montrent que le sujet endetté n’est plus maître de lui-même. Par-delà la dépendance au créancier, le sujet débiteur hypothèque sa durée. Victime d’un pacte faustien moderne, il a vendu son âme et son temps pour pouvoir jouir immédiatement d’une fortune virtuelle, euphorisante, mais éphémère. Les plus frénétiques savent certes, comme Rastignac, solder les dettes d’hier avec les emprunts de demain, mais tous cherchent à faire une fin en échappant à la spirale mortifère du crédit. Tous savent que celui qui fait trop durablement défaut est condamné à disparaître, que ce soit par la mort (Lucien), l’exil (Danglars), ou l’exclusion hors du récit (d’Esgrignon). Lire La Comédie humaine, c’est faire l’expérience fictive du crédit, non pas seulement comprendre comment s’organisent les mécanismes de la banque et des différentes sortes d’effets, mais ressentir avec le personnage la manière dont s’exprime la violence du crédit. Là où la représentation des physiologistes ou de Dumas reste une symptomatique sociale, le roman balzacien dépasse le phénomène. Sa mise en texte du crédit permet d’appréhender la manière dont le sujet intériorise les normes du crédit, intériorisation si profonde que la modernité du sujet semble résider dans cette temporalisation monétaire de son existence. Là réside le véritable réalisme d’un texte balzacien qui, s’il représente des mécanismes caducs, livre un savoir sur les conséquences de l’argent virtuel dont notre époque reste tributaire et expérimente toujours les tragédies.
Notes
-
[1]
Henri Mitterand, « L’Argent et la lettre », Le Roman à l’œuvre, genèse et valeurs, Paris PUF, 1998, p. 178, nous soulignons.
-
[2]
Frivolité de la valeur, Paris, Blusson, 2000, p. 11.
-
[3]
Ibid., p. 25, nous soulignons.
-
[4]
On trouvera un exposé détaillé de la méthode et des résultats de cette étude lexicographique dans le premier chapitre de notre ouvrage Le Crédit dans la poétique balzacienne à paraître, 2011, Garnier.
-
[5]
Sachant qu’une fréquence relative positive indique un emploi supérieur à l’usage courant, qu’un score supérieur à 5 indique un phénomène remarquable, des fréquences de 8,6 (« crédit ») ou de 26,8 (« dettes ») désignent bien la spécificité du texte balzacien.
-
[6]
R. Chollet, notice du Code des gens honnêtes ou l’art de n’être pas dupe des fripons, Œuvres diverses, t. II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1996, p. 1334.
-
[7]
Marco de Saint-Hilaire complétera en 1827 ce portrait dans L’Art de payer ses dettes et de promener ses créanciers… en évoquant « cette classe d’infortunés, de déshérités, de leur part de la fortune nationale […], hommes éminemment producteurs, en un mot […], mais qui, n’ayant pas une obole de revenu annuel, sont bien forcés de faire des dettes pour vivre honorablement », Paris, Librairie Universelle, 1827, p. 9.
-
[8]
Jacques-Gilbert Ymbert, L’Art de faire des dettes, Paris, Rivages poches-Payot, 1996, p. 25.
-
[9]
Marco de Saint-Hilaire, L’Art de payer ses dettes…, ouvr. cité, p. 36.
-
[10]
Cette thèse, qui fut assez largement partagée, est abondamment illustrée par l’ouvrage de Bouvier et Maynal, Les Comptes fantastiques de Balzac, Paris, Sorlot, 1938.
-
[11]
Balzac, Illusions perdues, Œuvres complètes, édition de Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976-1981, t. V, p. 504-505. Toutes les références aux œuvres de La Comédie humaine renvoient à cette édition dont nous citerons désormais le titre en abrégé suivi du tome et de la page.
-
[12]
On a là l’un des ingrédients de la crise des subprimes survenue en 2009.
-
[13]
Nous renvoyons à l’article d’Olivier Chaïbi, dans le présent volume, « Entre crédit public et crédit mutuel : un aperçu des théories sur le crédit au XIXe siècle ».
-
[14]
Sur la fonction de déstabilisation des énoncés financiers, on peut se reporter à notre article, « “À quoi ça rime” – Les ambivalences sémiotiques du compte de retour », in Illusions perdues, Presses de la Sorbonne Paris, 2003.
-
[15]
P.M. de Biasi, « Cette singulière lucidité », Balzac et la Peau de chagrin, Claude Duchet (dir.), SEDES/CDU, 1979, p. 179.
-
[16]
Sous les tilleuls assurera une belle notoriété au futur rédacteur en chef du Figaro. Il est encensé par la Revue des deux mondes, qui loue « son art infini » et note qu’il « possède à un haut degré ce qui manque à M. Balzac » (Chronique de la quinzaine, 14 octobre 1833, t. 4, 1833).
-
[17]
Alphonse Karr, Sous les tilleuls, Calmann-Lévy, 1882, p. 139.
-
[18]
Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, Le Livre de poche, 1998, t. 2, p. 1326.
-
[19]
Verne avait déjà instrumentalisé la mécanique des dettes dans Les Cinq Cents Millions de la Bégum (1879).
-
[20]
Si Zola se contente de reprendre ces schémas stéréotypés, il renouvelle le schème fiduciaire dans le cadre du modèle boursier en important le paradigme du marché à terme. Voir sur ce point Christophe Reffait, La Bourse dans le roman français du second XIXe siècle, Honoré Champion, 2007, et Hélène Gomart, Les Opérations financières dans le roman réaliste, Honoré Champion, 2004.
-
[21]
Pour une approche détaillée de ces perspectives énonciatives, nous renvoyons à La Poétique du crédit balzacien, chap. 4, ouvr. cité.
-
[22]
Dix pages (p. 343-352) suffisent à rapporter les dix mois d’endettement frénétique de Raoul, alors que trente pages (p. 353-383) sont nécessaires pour raconter les trois – longues – journées au cours desquelles Angélique liquide le passif de son amant. Pour une analyse plus détaillée de ce mécanisme, nous nous permettons de renvoyer à notre article « Chronos créancier… ou les rapports du temps et de l’argent dans Illusions perdues », Méthodes – revue de littérature, 2004, p. 185-193.
-
[23]
« Le rapport étroit entre l’argent et le tempo de la vie se manifeste dans le fait qu’accroissement ou diminution monétaires […] créent ces phénomènes de différences qui psychiquement se reflètent sous forme de ruptures, d’incitations, de concentrations dans le cours des représentations », Georg Simmel, Philosophie de l’argent, PUF, « Quadrige », 1999, p. 649-650.