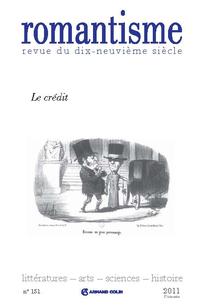1 Ce qui frappe d’emblée, dans le traditionnel florilège de citations qui ouvre les quatorze pages de la notice « Crédit » du Dictionnaire de Pierre Larousse, est leur emphase. Nous y lisons par exemple cette définition d’Eugène Pelletan : « Le crédit est l’avenir ramené au présent ». Citation dont la suite, ici tronquée, aurait d’ailleurs été plus probante encore, puisque le crédit y est décrit comme « l’avènement à la durée, le signe, en un mot, du progrès [1] ». Nous y trouvons aussi une formule un peu prudhommesque attribuée à tort à Jean-Baptiste Say : « Le crédit est l’âme du commerce, et seul vivifie l’industrie [2] ». Nous y remarquons surtout une métaphore étonnante et inspirée, due à Adam Smith : « Le crédit ouvre un chemin dans les airs ». Véritable programme pour une poésie saint-simonienne du crédit ! – à ceci près que le texte original de Smith est plus précisément consacré aux billets de banque [3]. Dans leurs inexactitudes mêmes, ces citations semblent vouloir signifier la puissance du crédit. Nous pouvons même nous demander si la phrase de Pierre-Joseph Proudhon glissée dans ce bouquet – « Le crédit, à force de dégager le capital, a fini par dégager l’homme de la société et de la nature » – a bien été comprise dans son sens péjoratif [4] et non pas comme un témoignage de plus de la force prométhéenne du crédit. Finalement, dans presque toutes ces sentences, nous pourrions substituer au mot Crédit les mots Rêve, Imagination, Foi, Élan, Énergie, Génie, etc., tant il est vrai que le terme semble revêtir au XIXe siècle un éclat qu’il a pour nous un peu perdu, parce qu’il nous apparaît aujourd’hui soit terni dans les enseignes qui désignent ses matières d’application (Crédit Foncier, Crédit Agricole), soit remisé dans des compléments du nom (maison de crédit, crise du crédit) qui l’éloignent de son emploi intransitif, en majesté.
2 Deuxième aspect notable de la notice de Larousse : elle ne distingue pas a priori les différentes acceptions du mot. En effet, avant même de développer le sens proprement économique du terme, la définition indique que le crédit est la « réputation de solvabilité et de bonne foi, qui fait que l’on trouve aisément à emprunter », reliant d’emblée et indissolublement la confiance et ses applications financières, la crédibilité et la créance, la bonne mine et le prêt, le bon air et l’avance. « L’on sait qu’une personne qui a du crédit emprunte à meilleur marché qu’une personne qui n’en a pas », disait Say [5]. La réputation fait le revenu, le revenu fait la réputation, en une circularité auto-réalisatrice que vont justement interroger les réformateurs sociaux. Car si l’on ne prête qu’aux riches, quand prêtera-t-on aux pauvres ? Et comment élargir la confiance hors du cercle où certains, s’entre-évaluant ou peut-être ne s’entre-évaluant plus (car la confiance est bien pour Simmel une « forme antérieure ou postérieure de savoir sur un être humain [6] »), circonscrivent la circulation du crédit ? Question d’autant plus légitime que le crédit manifeste sa volatilité, sa réversibilité voire son arbitraire, lorsque ce même raisonnement par récurrence qui a fondé l’honorabilité d’un homme le précipite soudain dans la ruine. Par sa circularité même, le crédit peut soudain s’évider. Il est la loi du mouvement.
3 « Le crédit est présent partout où les deux parties d’une transaction sont différées dans le temps », commence ici Pierre-Cyrille Hautcœur. L’aller et retour entre le prêt et son remboursement n’a de sens que par le délai aménagé entre ces deux versements. Le crédit est ainsi une exception au cours naturel des jours et des mois, à la faveur de laquelle une aspiration, un besoin ou une urgence vont se trouver exaucés, comme nous le signale la définition dont repart quant à lui Alexandre Péraud : « Le crédit doit bien être considéré comme du désir médiatisé par l’argent, de l’argent modalisé par le temps ». C’est ainsi que le crédit permet de déroger tout à la fois au temps de la nature, au fixisme social, à la morale de la tempérance et à l’ordre divin. En effet, pour que se déploie l’idée du crédit, il faut d’abord accepter que l’avenir puisse être préempté, le temps artificiellement replié, les cycles naturels devancés. Cette hypothèque de l’avenir semble supposer, par symétrie, l’idée d’un développement continu, une confiance dans le progrès (comme l’exprime Eugène Pelletan), voire la conception d’une raison dans l’histoire. Pour que le crédit se développe, il faut aussi déclarer légitime la jouissance aujourd’hui de ce qu’on ne paiera que plus tard, ce qui pourrait apparaître comme une inversion du pacte noué entre l’Église et le croyant, une subversion de la promesse de Salut ou du pari pascalien, une ironie fiduciaire de la perspective de la foi – ce qui n’empêche pas l’Église de réformer sous la Restauration sa position sur l’usure et l’intérêt.
4 Mais s’aventurer ici dans une anthropologie du crédit ne permettrait pas d’indiquer la multiplicité de ses manifestations au XIXe siècle. Lorsqu’une femme du monde obtient des liquidités d’une revendeuse à la toilette en lui abandonnant un bijou, lorsqu’une misérable met son rouet au mont-de-piété pour pouvoir manger, lorsque Maigrat avance des denrées aux ouvriers de Montsou (et se paie sur leurs filles), nous entrons dans la nébuleuse du crédit privé. Cette première catégorie du crédit, qui recouvre souvent le crédit pauvre [7], n’est pas celle qui intéresse ordinairement les économistes, comme le montre bien la notice de Charles Coquelin dans son Dictionnaire d’économie politique [8]. Plus avant, lorsqu’un État a besoin d’argent et émet un emprunt auprès de sa population, ayant compris que l’impôt n’est pas la panacée, cela définit le crédit public, autre cas particulier du crédit. Dans cette opération, l’État engage sa bonne foi, prouve sa moralité et l’intérêt de son investissement collectif, mesure enfin la confiance que lui accorde le pays, pour reprendre les idées de Michel Chevalier [9]. Enfin lorsqu’un commerçant, ayant besoin de fabriquer et écouler une certaine quantité de marchandises avant de pouvoir régler ses fournisseurs, leur signe des lettres de change à trois mois, c’est une première modalité du crédit commercial. Sa conséquence est que ces effets de commerce constituent bientôt une véritable monnaie dans les affaires, en particulier en un premier XIXe siècle où la Banque de France a une politique d’émission de billets par trop pusillanime, comme nous le rappellent ici Pierre-Cyrille Hautcœur et Alexandre Péraud. C’est-à-dire que le commerçant A règle son créancier B avec les lettres de change que lui a signées son débiteur C. De là plus de fluidité dans les transactions commerciales, mais aussi tout un « système de circulations » sur les dangers duquel l’oncle Pillerault édifie son neveu Birotteau, lorsque ce dernier est tenté d’utiliser des effets de commerce du brave Anselme Popinot pour échapper à la faillite [10].
5 Crédit privé, crédit public, crédit commercial [11] : ces trois champs du crédit vont connaître des mutations fondamentales au XIXe siècle. Et le crédit passera même pour l’enjeu central du siècle. En témoignent la remarque incidente de Coquelin en 1852 sur le fait que « quelques hommes aventureux ont exagéré outre mesure la puissance du crédit », ou bien la réflexion du banquier Cernuschi en 1866 pour qui « le mot de crédit a tout envahi [12] ». D’abord, le crédit n’est pas une idée neuve pour les hommes du XIXe siècle et, comme l’a montré le premier ouvrage de Jean-Michel Rey sur le sujet [13], cette notion participe même d’un faisceau de souvenirs traumatiques : toute pensée du crédit, toute réflexion sur la confiance, toute invention d’ingénierie financière sont analysées en fonction du souvenir de la banqueroute de l’Écossais Law et du scandale des Assignats, conçus comme avertissements contre les dangereuses fictions du crédit. Ensuite, le crédit est un enjeu par excellence de l’âge post-révolutionnaire parce que toute velléité de crédit public interroge le rapport de l’État à sa constitution, à la force, à l’opinion. « C’est le besoin du crédit qui oblige les gouvernements à ménager l’opinion publique », remarquait Mme de Staël dans des pages vibrantes centrées sur la figure de son père, et elle soulignait que le crédit public suppose de créer les « formes constitutionnelles » de la transparence des finances publiques [14]. Ainsi, de même que le Traité de Say estime que le crédit d’une monarchie est nécessairement faible, la républicaine notice du Dictionnaire de Pierre Larousse souligne que « dans les États modernes, le crédit est en raison directe du degré de liberté politique et de sécurité publique dont y jouit » : le crédit est ainsi la forme financière de la persuasion autant que de la démocratie. Enfin, le crédit est une question centrale au XIXe siècle – et cela explique cette espèce d’essentialisme qu’on a remarqué dans les emplois du mot – parce qu’il est la porte étroite par laquelle communiquent capital et travail. C’est ce que manifeste avec éclat le débat sur la gratuité du crédit qui met aux prises Frédéric Bastiat et Pierre-Joseph Proudhon fin 1849 dans les colonnes de La Voix du Peuple. D’un côté, le pamphlétaire libéral rappelle que « celui qui prête une maison, un sac de blé, un rabot, une pièce de monnaie, un navire, en un mot une VALEUR, pour un temps déterminé, rend un service » et qu’il devrait pour cela « recevoir quelque chose » – « quelque chose que j’appelle INTÉRÊT », conclut Bastiat. De l’autre, le pamphlétaire socialiste soutient que celui qui prête « ne se prive pas […] du capital qu’il prête », qu’il le prête « parce qu’il n’est ni dans son intention, ni dans sa puissance de le faire personnellement valoir », et qu’il ne saurait donc percevoir d’intérêt sans que cela signifie récompenser l’oisiveté [15]. Pour sortir de ce qu’Olivier Chaïbi appelle un « dialogue de sourds », l’une des solutions que proposera l’économie sociale sera d’institutionnaliser la confiance, en faisant que les associations de travailleurs endossent les risques du crédit, donnent des gages au capital, pour faire baisser les taux et libérer le crédit aux ouvriers [16]. Mais, on l’a bien compris, la ligne de front du siècle entre libéralisme et socialisme, entre défense de la propriété et dénonciation de la spoliation du travail passe bel et bien ici, au cœur de ce débat sur la gratuité du crédit.
6 Pour tenter de rendre compte de l’éminence de la question du crédit au XIXe siècle, nous avons opté pour un dossier très resserré, qui ne s’extrait guère de l’acception économique du terme. Nous n’avons pas forcément cherché ici à jouer de toutes les variations offertes par le champ sémantique de la fides [17], tant est déjà riche le sens financier de la notion de crédit, qui englobe aussi bien les questions de la valeur et de la confiance en économie, que celles de la spéculation et de la crise. Deux études diachroniques dessinent d’abord les évolutions majeures de l’idée et de la pratique du crédit au fil du siècle. D’un côté, Olivier Chaïbi esquisse une véritable histoire intellectuelle du crédit au XIXe siècle, laquelle, nous faisant passer de la réhabilitation de la notion sous la Restauration aux projets bancaires d’obédience saint-simonienne sous le second Empire, éclaire une mutation d’importance : comment la France du XIXe siècle est passée d’une « aversion séculaire » envers l’idée de crédit à une pratique qui devait exaucer, par le mouvement même de la libéralisation du crédit, une partie des objectifs formulés par les théoriciens dont les débats ont culminé en 1848. D’un autre côté, Pierre-Cyrille Hautcœur brosse toute l’histoire économique et financière des outils et des institutions de crédit, montrant comment on est passé de l’hypothèque négociée chez le notaire en 1820 au prêt accordé par le Crédit foncier quelques décennies plus tard, du financement des industries locales par des banques de province sous la Restauration à un réseau bancaire et un marché boursier nationaux à la fin du siècle, ou encore de l’emprunt d’État auprès de cercles financiers restreints au large placement de titres en Bourse. Autant d’évolutions du crédit « de l’interpersonnel à l’impersonnel », qui participent d’un mouvement d’abstraction que les romans zoliens comme le roman populaire des années 1880 contribuent à décrire. Mais de même qu’Olivier Chaïbi interroge la rémanence des préoccupations d’économie sociale en contrepoint de la libéralisation du système bancaire au second XIXe siècle, Pierre-Cyrille Hautcœur pointe les limites de toute idée d’« intégration » de la finance au XIXe siècle, signale les biais et artefacts introduits par la modernisation même des instruments de crédit, indique l’assujettissement politique de l’État à la bourgeoisie rentière au fil des décennies.
7 De telles études, qui montrent comment l’institution bancaire a progressivement (mais inégalement) investi le triple champ du crédit commercial, du crédit public et du crédit privé, contribuent à expliquer pourquoi la banque s’est imposée comme un objet romanesque de choix, qui distingue assez bien la littérature financière du XIXe siècle de celle des siècles précédents. Saisie dans ses mutations, son rapport à la Bourse, sa double face privée et publique, la banque permet de figurer – d’une manière plus abstraite et puissante que le récit de la faillite d’un parfumeur – toute la volatilité du crédit. Car comme le montre la lecture du Comte de Monte Cristo et des Buddenbrook que propose ici Jean-Michel Rey, le crédit d’une banque ou d’une affaire familiale n’est que la résultante de flux escomptés, le solde toujours indécis de mouvements financiers dont la valeur est elle-même dépendante de la confiance. « Je n’existe que par le crédit », plaide Du Tillet auprès de Birotteau : « Nous en sommes tous là [18] ». Et dans L’Argent, Hamelin concède à Saccard, qui a acheté force actions pour soutenir le cours de l’Universelle : « le vrai matériel d’une banque est son crédit, elle agonise dès que son crédit chancelle [19] ». La fragilité essentielle du crédit serait bien symbolisée par ce petit point sur le i que Du Tillet omet dans sa signature, lorsqu’il feint de recommander Birotteau à Nucingen : signe infinitésimal et convenu par lequel la confiance va se refuser et le crédit s’abolir. La douloureuse labilité du crédit, à la Bourse cette fois, serait tout aussi bien métaphorisée par la crise de confiance conjugale que met en scène Ferragus [20]. Dans le présent volume, Jean-Michel Rey examine en quoi la ruine familiale est un brusque retournement qui conduit à « faire apparaître l’immoralité » de ce qu’on tenait jusqu’alors pour la plus parfaite honorabilité. Mais de quelle immoralité s’agit-il au juste ? L’immoralité de la rémunération du risque, comme le dirait Proudhon ? Ou bien celle du risque même que l’on prend lorsqu’on gage tout le présent sur l’avenir ? La question ne peut nous être indifférente, deux ans après le déclenchement d’une crise financière qui était une crise plurielle du crédit – crise du crédit immobilier, des titres qui en dérivaient, ainsi que des agences qui notaient les banques.
8 Quant à détailler « ce que le crédit fait à l’œuvre [21] », Jean-Michel Rey l’a bien montré dans son deuxième livre sur le crédit, qui s’ouvrait sur les « promesses » que formule Antonin Artaud, « en disponibilité de poésie », auprès de son éditeur [22]. C’est cette écriture à crédit, dont le XIXe siècle de la « littérature industrielle » et des préfaces-manifestes reste emblématique, qu’envisagent ici Alexandre Péraud et Adeline Wrona. Ils se sont partagé le siècle et les champs : Alexandre Péraud joint le corpus balzacien et le roman populaire dans son étude du premier XIXe siècle, pendant qu’Adeline Wrona adosse sa lecture de L’Argent de Zola à une étude des rapports entre le roman et la presse. Alexandre Péraud a montré ailleurs [23] comment la posture de débiteur qu’adopte incidemment Balzac dans sa correspondance – « il faut encore me faire crédit jusqu’en 1837 », écrit-il dans une lettre de 1835 – détermine une véritable « fiduciarisation » de la narrativité romanesque, laquelle se constitue voire s’exhibe comme économie à crédit. On pourrait avancer que tout roman, par essence gagé sur la tension résolutive du récit, participe d’un tel schéma, mais Alexandre Péraud retrempe ici l’analyse de l’écriture balzacienne dans la mise en évidence d’une véritable obsession contemporaine pour les questions de crédit, laquelle, exprimée par les physiologies et en partie expliquée par le contexte financier, informe aussi le roman à la mode d’Alphonse Karr. Alexandre Péraud montre comment le crédit agrège les personnages et informe la temporalité romanesque. Son intérêt se concentre sur les effets de contraction ou de dilatation de la temporalité narrative qui dans le roman balzacien caractérisent les phases d’endettement des personnages ou de remboursement, tandis que le commentaire d’Adeline Wrona sur la temporalité romanesque isole ce que le roman a de commun avec la presse : la périodicité de sa parution, parallèle à celle de la Bourse. Éternel retour qu’un roman comme L’Argent va jusqu’à thématiser en faisant écho, avec sa théorie des crises cycliques, aux travaux contemporains de Clément Juglar.
9 Les contributions d’Alexandre Péraud et Adeline Wrona se rejoignent lorsqu’elles insistent l’une et l’autre sur cette ironie par laquelle le débiteur accède en fin de compte à une position de puissance. C’est ce que montrent les physiologies des années 1820 à 1840 qui célèbrent plaisamment les faiseurs de dettes. C’est ce que montre aussi le démontage des interdépendances financières de la presse, de la politique et des affaires sous la troisième République. Et c’est ce qui ressort en fin de compte de la construction même de la posture d’auteur. Lorsque Raphaël narre ses malheurs à Blondet, lequel joue l’impatience, il s’exclame : « Si ton amitié n’a pas la force d’écouter mes élégies, si tu ne peux me faire crédit d’une demi-heure d’ennui, dors [24] ! ». Mais si le romancier du XIXe siècle, qu’il s’agisse du Balzac d’Illusions perdues ou du Zola de « L’Argent dans la littérature », se plaît à représenter ainsi, avec un dolorisme plus ou moins appuyé, le poète en héroïque débiteur, il n’en reste pas moins que cette construction occulte un fait fondamental : justement, le roman que nous lisons ne nous ennuie ni ne nous endort. Il nous paie comptant, rubis sur ongle, de plaisir.
Notes
-
[1]
Eugène Pelletan, Profession de foi du XIXe siècle, VIe Partie, chap. Ier (« Luther »), Pagnerre, 1864, p. 304. Sauf indication contraire, tous les écrits cités dans cet avant-propos et dans la bibliographie qui clôt le dossier sont publiés à Paris.
-
[2]
Cette phrase apparaît en fait sous une forme légèrement différente dans la notice « Crédit », signée « Fr », du Dictionnaire technologique, ou nouveau dictionnaire universel des arts et métiers, et de l’économie industrielle et commerciale, t. VI, Paris, Thomine-Fortic, 1823, p. 216.
-
[3]
« Les judicieuses opérations de banque [celles qui substituent du papier à l’argent et à l’or], en fournissant, si je puis me permettre une métaphore aussi violente, une sorte de voie de roulage à travers les airs [a sort of waggon-way through the air], mettent le pays en état […] d’accroître énormément le produit annuel de sa terre et de son travail. » Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, Livre II, chap. II, trad. Pauline Taieb, PUF, 1995, p. 366.
-
[4]
Ce propos dénonce en fait les travers d’un crédit foncier qui transforme les producteurs en joueurs et s’assimile à une fiction. Système des contradictions économiques, ou philosophie de la misère, vol. II, Guillaumin, 1846, p. 247.
-
[5]
Jean-Baptiste Say, Traité d’économie politique, Livre IV, 1803, p. 285.
-
[6]
Georg Simmel, Secret et sociétés secrètes, Circé, 1996, p. 22.
-
[7]
Voir Laurence Fontaine, L’économie morale ; pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe pré-industrielle, Gallimard, « NRF essais », 2008, 437 p.
-
[8]
Article « Crédit » du Dictionnaire de l’économie politique, Ch. Coquelin et Guillaumin (dir.), Guillaumin, 1852-1853, p. 494.
-
[9]
Abondamment citées dans la notice du Dictionnaire de Pierre Larousse.
-
[10]
Voir dans César Birotteau l’avertissement du juge Popinot et la mercuriale de Pillerault : La Comédie humaine, vol VI, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1977, p. 247 et 252.
-
[11]
Parallèlement, le crédit se constitue selon ses matières d’application (crédit foncier, mobilier, agricole, industriel, etc.), qui ont chacune leur logique de rentabilité, même si les taux sont interdépendants. C’est à ces différentes matières, et aux institutions de crédit associées, que s’intéressent la majorité des pages de la volumineuse notice du Dictionnaire de Pierre Larousse.
-
[12]
Cernuschi, Illusions des sociétés coopératives, Lacroix, Verboeckhoven/Guillaumin, 1866, p. 42.
-
[13]
Jean-Michel Rey, Le Temps du crédit, Desclée de Brouwer, 2002.
-
[14]
Germaine de Staël, Considérations sur la Révolution française [1818], Ire partie, chap. V, éd. Jacques Godechot, Tallandier, 1983, p. 90.
-
[15]
Voir « Gratuité du crédit », 2e et 3e lettres, in Frédéric Bastiat, Œuvres complètes, t. V, Guillaumin, 1862-1864, p. 113 et p. 125.
-
[16]
Voir l’article éclairant de Vincent Bourdeau, « Peut-on faire confiance aux pauvres ? L’exemple du crédit coopératif chez Léon Walras (1848-1870) », dans Conflit, confiance, Robert Damiens et Christian Lazzeri (dir.), Presses universitaires de Franche-Comté, 2006, p. 195-226.
-
[17]
Voir le prologue étymologique du livre de Laurence Fontaine, ouvr. cité, p. 17-24.
-
[18]
Ouvr. cité, p. 300.
-
[19]
Émile Zola, L’Argent, chap. XI, dans Les Rougon Macquart, t. V, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1967, p. 333.
-
[20]
Telle est la lecture éclairante de la nouvelle que propose le sociologue et historien de la Bourse Paul Lagneau-Ymonnet : « Pourquoi fallait-il que Jules Desmarets fût agent de change ? La Bourse et le crédit (1815-1840) », in François Vatin et Nicole Edelman (dir.), Économie et littérature, France et Grande-Bretagne 1815-1848, éd. Le Manuscrit, 2007, p. 163-194.
-
[21]
Pour reprendre le titre de la communication de Laurent Zimmermann au colloque « Modalités du croire : croyance, créance, crédit », organisé les 23 et 24 mai 2008 autour de l’œuvre de Jean-Michel Rey.
-
[22]
Jean-Michel Rey, Les Promesses de l’œuvre, Desclée de Brouwer, 2003.
-
[23]
Alexandre Péraud, La poétique balzacienne du crédit, Paris, Éditions Classiques Garnier, 2011, à paraître.
-
[24]
Honoré de Balzac, La Peau de chagrin, dans La Comédie humaine, vol. X, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1979, p. 130.