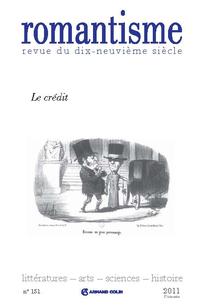1 Le « crédit » se présenterait fréquemment comme une stricte affaire de famille, au XIXe siècle notamment, avec tous les ingrédients qui conviennent à une telle variante et les rebondissements qui s’imposent ; avec ses avatars et les répercussions qu’il ne peut manquer d’avoir au-delà même du lieu où il se produit. La famille étant dans cette optique une sorte de condensé d’un état de la société, une instance qui est un véritable révélateur dans une époque où ce mécanisme relativement nouveau qu’est le crédit a un rôle de premier plan et où il est protéiforme, à l’œuvre partout. On peut en faire l’hypothèse en évoquant plusieurs romans dont l’action se passe à ce moment précis et se situe dans un cercle particulièrement restreint. Je n’en retiens que deux ici, particulièrement emblématiques, puisque le crédit y a une place déterminante et que c’est, en partie au moins, l’opération qu’il représente qui fait basculer l’intrigue [1]. L’un a pour cadre la France, dans la première moitié du siècle : Le Comte de Monte-Cristo ; l’autre, Les Buddenbrook, a pour toile de fond l’Allemagne, dans la seconde partie du siècle et évoque un milieu plus fermé encore que celui du roman d’Alexandre Dumas. Cette limitation à l’espace familial serait le point commun le plus évident de ces deux romans qui, par ailleurs, sont, comme on le sait, totalement différents dans leur visée, dans leur style, dans leur construction également.
2 Dans l’un et l’autre, pourtant, un épisode directement lié à l’univers financier devient une sorte de péripétie, modifie fondamentalement le cours des choses en affectant à chaque fois les principaux protagonistes. Une situation parfaitement respectable (dans l’ordre de la morale la plus courante) débouche sur une véritable catastrophe, fait même apparaître certains des protagonistes comme étant proches de l’escroquerie ou de la délinquance. C’est le crédit qui suscite des mutations de cette envergure : rien ne paraît pouvoir le tempérer, il est comme animé d’un mouvement interne d’expansion dont on ne semble pas pouvoir connaître les limites. Le Comte de Monte-Cristo et Les Buddenbrook s’emploient à décrire – et à analyser – une transformation de cette ampleur. Véritables épopées d’une chute qui présentent le « crédit » sous un jour fortement défavorable : histoires d’un déclin brusque qui n’a été possible qu’en raison d’une pratique rusée de la dissimulation, plus encore d’une sorte de duplicité à l’endroit des plus proches, notamment des membres de la famille. À des titres divers, des histoires d’amour ou de simple affection servent de paravent – ou de couverture – à des opérations financières crapuleuses ; les premières sont en somme la condition des secondes. Il y a là un mélange dont les auteurs de roman du XIXe siècle savent tirer le meilleur parti. La légèreté de certains textes du XVIIIe siècle à ce même propos n’est plus de mise ici. Le crédit a incontestablement donné au temps une tout autre gravité. Rien ne saurait plus être comme avant son apparition sur la scène européenne. Il a introduit dans la société – ou dans certaines familles – de grands déséquilibres, des conflits majeurs.
3 Ces deux romans – mais il y en bien d’autres sur ce même propos à cette époque – sont, dans certains chapitres en tout cas, de véritables traités d’économie politique en abrégé [2], et en ont toute la rigueur, toute la précision et toute la cruauté. (Une cruauté dont on peut comprendre qu’elle a littéralement fasciné certains écrivains de ce moment. Grâce à elle, un certain envers des choses se montre sans aucun fard, avec violence, sur un mode parfois caricatural. L’économie politique laisse apparaître ce qu’elle fait.) L’essentiel de ce savoir récent y est donné à l’état dispersé, réparti entre les principaux épisodes dans lesquels la dimension du crédit apparaît sur un mode inéluctable. Alexandre Dumas anticipe manifestement certains propos du jeune Marx ou même de Proudhon ; Thomas Mann est contemporain d’énoncés comme ceux de Georg Simmel [3] et de quelques autres [4]. Reste que le roman se donne – et pour l’un et l’autre c’est manifestement le cas – de grandes libertés qu’un traité d’économie et un pamphlet politique ne peuvent pas en général se permettre. La rumination romanesque a, dans cette perspective, des avantages certains ; elle ne manque d’ailleurs pas d’en user. On le voit nettement chez ces deux romanciers, dans certains moments décisifs de l’intrigue où se produit une transformation spectaculaire ; un changement du tout au tout qui concerne aussi bien la situation d’ensemble que le statut social ou même la position morale des deux personnages le plus fortement impliqués, le baron Danglars et M. Grunlich. Le roman est bien évidemment à même de resserrer une intrigue, d’introduire ou de proposer des causalités que le réel ne peut pas connaître, de faire surgir des liens insoupçonnés de la science économique ou de la pratique ordinaire des affaires. Les enchaînements implacables qu’il est susceptible de proposer ont souvent une valeur de vérité incontestable.
4 Ce peut être l’occasion de redire qu’après la Révolution de 1789, tant en France qu’en Allemagne, et à moindre titre en Angleterre, on ne cesse de toutes les manières possibles – dans des récits ou avec des fragments d’analyse, dans des pamphlets politiques ou en se réclamant d’un savoir économique récent – d’évoquer, voire de ressasser, les aspects majeurs du crédit, d’en montrer le plus souvent la nécessité ou, à l’inverse, d’indiquer le danger qu’il représente ; et, parmi ces aspects, le plus crucial, et bien entendu le plus frappant, celui qui prend la forme d’un désastre général, d’une stricte banqueroute financière. La stupeur et le désarroi provoqués par des événements de cet ordre occupent manifestement tous les esprits depuis des décennies, et donc ceux des romanciers tout particulièrement, comme un traumatisme qui se transmettrait inchangé sur plusieurs générations, qui obligerait tout un chacun à y réfléchir, à se prononcer, avec ses propres moyens, sur des phénomènes d’une ampleur exceptionnelle concernant la vie même d’une société, son devenir, sur des processus qui sont devenus l’ordinaire de l’économie ; comme un choc qui autorise chacun à broder à son propos, à inventer des suites ou des prolongements, à imaginer les intrigues les plus folles dans un espace connu, supposé rassurant, censé être dénué de véritables différends – celui de la famille.
SCÈNES INTIMES
5 Saisir de tels phénomènes par le biais d’une sorte de saga familiale permet souvent de les cerner avec davantage de précision, d’aller dans le sens d’une certaine minutie ; permet aussi de faire se croiser la grande Histoire, celle qui en France commence avec les exploits économiques de John Law, et une simple anecdote familiale particulièrement riche en rebondissements. Les similitudes ou les ressemblances parlent d’elles-mêmes. La famille est dans ce contexte comme une sorte de prototype. Le crédit est, à cette époque, ce qui passe tout entendement, ce qui est proprement inimaginable dans ses effets, ce qui a des aspects monstrueux. Ce serait là, à mon sens, une des raisons pour laquelle le roman s’y attarde, brode indéfiniment autour d’un tel motif, cherche à en saisir quelque chose par le simple biais d’histoires familiales. La difformité familiale est d’une certaine manière plus acceptable ou plus tolérable qu’une monstruosité d’ensemble qui risque de gangréner tout le corps social, voire de l’engloutir.
6 Tant du côté français que du côté allemand, toute l’époque est véritablement hantée par une possibilité de cet ordre, aussi bien au niveau de l’État qu’à celui plus restreint de l’entreprise familiale – qu’elle soit une banque (dans Le Comte de Monte-Cristo) ou un commerce important (dans Les Buddenbrook). Il est désormais concevable que, d’un seul coup, alors que toutes les apparences allaient dans un autre sens, il y ait faillite d’un système qui semblait solide, établi de longue date, destiné à durer. Qu’il y ait donc écroulement général d’un ensemble dont tout paraissait garantir la solidité et la stabilité. Il s’agit de la plus grande catastrophe qui soit pour une société qui, au sortir de la Révolution, est dans l’obligation de tout refonder, sa monnaie autant que ses valeurs, son économie autant que son tissu moral ou politique. C’est comme une idée nouvelle en Europe qui se fait jour dans ces décennies. Elle peut se résumer à ceci : il faut très peu de choses pour qu’une spéculation financière conséquente, honorablement menée, se transforme en une ruine totale, pour qu’un système s’écroule en entraînant dans sa chute bien d’autres éléments déterminants d’une tout autre nature. Même si on fait tout pour l’oublier, un tel schéma est partout présent. Dans toutes les histoires de liquidation (forcée), il y a – c’est en tout cas ce qu’il faut supposer – un point de rupture à partir de quoi tout se renverse, tout s’inverse, avec une brutalité déconcertante et, surtout, une rapidité que rien ne laissait prévoir. L’échec devient d’un seul coup patent, ressemble même parfois à un destin général. La déconfiture apparaît dans toute son ampleur ; et la violence, sous une forme ou sous une autre, est forcément au rendez-vous.
7 Certaines scènes du roman d’Alexandre Dumas et de celui de Thomas Mann [5] construisent, avec tous les détours nécessaires, et les détails qui conviennent en la circonstance, de tels processus, leur donnent une extrême vraisemblance, leur confèrent une crédibilité même, dans un moment où, en France comme en Allemagne, la discipline historique prend une place de tout premier plan. Où l’on voit comment, peu à peu, une famille apparemment unie se déstructure fortement à la suite d’une affaire financière douteuse, et, conséquence proprement inévitable dans un tel contexte, comment des liens de parenté se défont de manière inattendue. Tout un tissu apparemment solide s’effrite avec une rapidité déconcertante. On est ici dans une perspective où se mêlent une décadence, un effondrement, une chute et un processus de l’ordre de la disgrâce. La finance et la morale subissent un sort analogue, sont prises dans une tourmente qui tend à les détruire l’une et l’autre, à imposer la ruine financière et, dans le même temps, à faire apparaître l’immoralité – ou quelque chose qui serait équivalent – qui était, en fin de compte, au principe des conduites réputées exemplaires ou honnêtes. Là où la moralité la plus élémentaire semblait devoir régner sans partage, ce sont ses différents contraires qui s’imposent. La fin catastrophique de l’histoire oblige à relire d’un autre œil le déroulement de l’intrigue, à porter sur l’ensemble de certaines conduites vertueuses un regard méfiant. Le crédit s’inscrirait, en grande partie, dans l’ère du soupçon qui trouve au XIXe siècle ses principaux représentants.
8 Derrière les valeurs les mieux assurées il y a quelque raison de soupçonner des opérations contestables, douteuses, ou même des « sophismes [6] » : c’est ce qui constitue une partie de la matière de ces romans. On pourrait dire, d’un point de vue philosophique, que le XIXe siècle commence par la démarche de Jeremy Bentham – je pense surtout à sa théorie des fictions et à son insistance sur l’imaginaire [7] – et s’achève par le travail de Nietzsche qui met l’accent, on le sait, sur ce qu’il appelle, pour bien la différencier de l’histoire, la généalogie – cette discipline qui s’occupe en priorité des questions de morale et de politique, et qui montre que nous ne savons plus ce que nous faisons quand nous qualifions, quand nous jugeons, quand nous punissons.
9 La ruine financière n’est par conséquent jamais un phénomène isolé : elle s’accompagne, le plus souvent, d’une défaillance morale ou d’un sentiment de même nature lui aussi d’une très grande ampleur. Depuis l’épisode bien connu de la banqueroute de John Law, dans les années 1720 en France, et après l’histoire des assignats au début de la Révolution, l’opération tend à se répéter presque à l’identique, sur un mode analogue en tout cas. Cela comme si l’introduction même du crédit dans l’univers économique laissait entrevoir – pour quelques analystes au moins : Montesquieu et Marivaux pour citer les contemporains [8] les plus lucides de la grande Banqueroute – l’envers même de l’opération, son risque majeur, la défaillance soudaine du système, de manière quasi inéluctable. Là où il y avait un enrichissement escompté, solennellement annoncé, parfaitement programmé, en conformité avec l’état de la société [9], c’est en fait la ruine qui a lieu et, immanquablement avec celle-ci, le discrédit moral, la défaveur, la disqualification, le déshonneur, c’est-à-dire tout ce qu’il peut y avoir de plus négatif, de péjoratif dans une telle perspective. Tout semble devoir se produire ici dans la perspective biblique (ou chrétienne) de la Chute. Dans Les Buddenbrook, au moment où la forfaiture de M. Grunlich éclate au grand jour, le seul mot que celui-ci balbutie à l’adresse à son beau-père est « Père ». On peut interpréter et entendre dans ce seul mot, plusieurs fois répété comme une sorte d’ultime appel au secours, la parole du Christ en croix, sa détresse fondamentale : « Père, pourquoi m’avez-vous abandonné. »
LA GRANDE MENACE
10 Toutes les valeurs se vident ainsi de leur substance, ou s’inversent en très peu de temps. La rapidité de la chose sidère les observateurs… ou les intéressés. La banqueroute financière va de pair avec ce qu’il faut bien appeler un nihilisme moral ou politique, un nihilisme qui serait comme structurellement lié au système. Avant même que Nietzsche n’utilise le terme (vers 1880) pour évoquer la dévaluation de toutes les valeurs « morales », certains analystes avaient fait, sur un mode empirique, un constat similaire dans l’ordre financier, c’est-à-dire une remarque qui s’appliquerait à la société en son entier. Ce n’est donc pas un pan du corps social qui est ainsi menacé, c’est la quasi-totalité de la société qui risque de perdre son centre de gravité. Dans les deux romans que j’évoque ici, c’est, dirait-on trop rapidement, la famille qui perd son âme, qui fait les frais d’opérations douteuses accomplies (pendant un temps au moins) avec la plus grande discrétion. Tout ce qui constituait la valeur des liens familiaux se défait. Et, dans les deux cas, il y a un moment dans l’intrigue où il n’est plus possible de dissimuler l’ampleur de la faillite financière et morale. Véritable moment de vérité par rapport auquel chacun des protagonistes se détermine.
11 Voyez dans Les Buddenbrook l’ironie dont fait montre le banquier Kesselmeyer à l’endroit de M. Grunlich qui essaie, une dernière fois, de sauver les meubles, c’est-à-dire d’obtenir un dernier « crédit » pour tenter de faire l’impossible, de rétablir une situation qui ne peut manifestement plus l’être.
Oui, vous êtes un fat, un maladroit, mon cher ! Voudriez-vous avoir l’extrême bonté de me dire ce que vous allez encore inventer ? Peut-être allez-vous découvrir quelque part au monde une banque qui vous donnera une seule pièce blanche ? Ou un autre beau-père ? Ah ! non. Votre plus beau tour de force, vous l’avez derrière vous. Ces choses-là ne se font qu’une fois. Tous mes compliments ! Hein, ma haute considération [10].
13 Mis à part quelques spécimens satiriques, il n’y a pas de poème qui prenne pour thème la Banqueroute et tout ce qui en dépend. L’objet, dirait-on, ne s’y prête pas, pour différentes raisons. Il n’y a pas non plus de pièces de théâtre marquantes à ce propos. Quelques scènes de pièce tout au mieux chez Goethe, Nerval et quelques autres ; mais sans qu’on s’y attarde véritablement, sans qu’une analyse d’ensemble soit sérieusement esquissée. Il faut l’espace du roman – de l’histoire romancée – pour donner consistance à des intrigues de la puissance de celles qu’on voit dans l’épisode des assignats pendant la Révolution ou, plus encore, dans l’événement qu’a constitué la politique financière de John Law pendant la Régence. Avec un retard inévitable en quelque sorte, certains romanciers s’emparent de cette matière, l’envisagent sous divers aspects, la dissèquent, construisent des récits qui, le plus souvent, miment ou répètent l’histoire de Law [11], en reprennent en tout cas les grandes lignes sur un mode fictionnel bien entendu. Car il y a là une histoire fabuleuse, celle où, en un premier temps, certains individus croient pouvoir s’enrichir considérablement pour, ensuite, s’apercevoir qu’en fait ils se sont ruinés – définitivement et sans aucun recours possible, et qu’ils ont du même coup ruiné leurs proches. Une illusion grandiose se double, plus ou moins rapidement, d’une grande déception [12]. C’est un double processus qui a manifestement de quoi fasciner et dont on ne peut rendre compte qu’en majorant certains tours romanesques, qu’en brodant sur un canevas analogue ou proche. Pour le dire au plus bref : pendant un premier temps, rien ne se signale à l’attention, tout s’effectue dans la discrétion ou le silence – pour le mieux. Le récit ne révèle donc rien – ou bien peu de choses – de ce qui se trame dans l’ombre ; il donne éventuellement de légers indices de ce qui ne va pas, de ce qui ne s’intègre pas à la perspective de l’ascension familiale ou de la réussite sociale. Jusqu’à ce que se produise un événement crucial qui vient – brusquement et de manière brutale le plus souvent – rendre manifeste la banqueroute totale : révélateur d’une situation qui, en s’exposant, introduit un dénouement, non sans violence d’ailleurs, non sans dégâts sur l’ensemble du milieu familial [13].
14 Tout ce qui passait inaperçu – pour des raisons de bienséance ou de convenance avant tout – devient d’un seul coup la raison (ou l’occasion) d’une catastrophe ; entendons par là, dans cet espace romanesque, la ruine d’une famille dont, avant cet événement, on vantait toutes les qualités, qui était au plus haut dans la hiérarchie sociale, hors de tout soupçon, promise au plus grand avenir. Les plus hautes valeurs sont malmenées, et les conventions bouleversées à un point qui semblait jusqu’alors inimaginable. On est entré dans l’ordre de l’incroyable. Les histoires de crédit ne se situent jamais sur un seul plan. C’est d’ailleurs ce qui fait leur intérêt. Elles ne cessent de déborder le contexte économique dans lequel elles sont censées se produire. C’est sans doute ce qui leur donne leur part de fantastique, ou leur aspect magique ; en somme, tout ce qui peut trouver place dans un roman et alimenter une intrigue, la pimenter. Ici encore, Les Lettres persanes donnent le ton pour tous les romans qui, au XIXe siècle, mettront au cœur de leur intrigue les mécanismes les plus rudimentaires du « crédit », qui reviendront sur ce qu’on pourrait appeler, dans un tel contexte, le grand motif de la foi jurée.
15 Le crédit : une histoire de famille se déroulant dans un milieu relativement clos, avec un nombre restreint de personnages, bien identifiables, différenciés, à un moment bien choisi de l’Histoire d’un pays. Certains chapitres tant du Comte de Monte-Cristo que des Buddenbrook, assez consistants d’ailleurs et pleins de considérations économiques, ont effectivement un même objet : montrer à quelles conditions, et pour quelles « raisons », la faillite d’un système devient visible pour tous, comment la ruine atteint les fortunes les mieux protégées ; faire apparaître comme éminemment fragile ce qui s’imposait jusqu’alors comme la garantie incontestable d’un ordre financier. Ce n’est pas précisément le récit d’un malheur qui est ici en jeu ; mais, bien plutôt, le processus paraissant implacable d’une déchéance générale, une dégradation qui a pour cause principale, le plus souvent, des maladresses ou même de véritables malversations financières, et pour condition (en bref) les failles d’un système économique récent, celui qui gage tout le présent sur l’avenir – entendons par là l’inconnu par excellence, l’incertain, l’imprévisible [14]. Une famille ayant une certaine position sociale – comme on dit – gère au présent un passé qu’elle tient à transformer en avenir – et en avenir meilleur évidemment, sur le plan financier avant tout. C’est précisément ce que font, du moins ce que tentent de faire un temps, avec des moyens assez différents et des fortunes diverses, le baron Danglars et le consul Johann Buddenbrook. Dans les deux cas, sous des aspects différents, le roman s’étend sur l’instance qui constitue la pièce maîtresse du système de crédit, c’est-à-dire en fait ce qui en est la garantie première ou ultime. La garantie, en l’occurrence, étant de l’ordre d’une institution établie de longue date ou un simple nom de famille. Perspective dans laquelle un aspect restreint vaut pour un ensemble, la partie pour le tout.
16 Les histoires de crédit ayant pour cadre principal une famille mettent parfaitement en évidence le rôle fondamental que peuvent avoir le nom propre et la signature, l’importance du patronyme. Ce serait, le plus souvent, comme un gage qui n’a plus même besoin d’être donné, une hypothèque qui va de soi, une caution qui l’emporte sur tout le reste – comme des valeurs immuables sur lesquelles le temps n’aurait aucune efficace. Ce qui sombre dans de tels récits, ce qui chute donc, c’est aussi, sinon surtout, la puissance du nom propre, la réputation qu’il est censé donner, le renom qu’il est supposé procurer par soi seul. Une sorte de déclin (plus ou moins long) de la Substance. Autre façon de dire qu’avec le crédit on commence à sortir d’une optique qui aurait des accointances avec une forme ou une autre d’aristocratie.
L’HOSPITALITÉ ROMANESQUE
17 Le roman, on le sait, fait alterner des séquences de récit (qui comportent parfois des dialogues) et des réflexions en tous genres qui émanent de tel ou tel personnage, voire parfois du narrateur. Dans les deux romans que j’évoque, le crédit – avant tout sous la forme de la banqueroute – est l’objet d’un récit mettant en jeu plusieurs personnages d’une même famille, des personnages qui, dans leurs échanges, tracent les contours de l’événement catastrophique et en font, de cette manière, en partie au moins, l’analyse. Le XIXe siècle est, de ce point de vue, le moment où le crédit perd en grande partie son mystère, où ses principales opérations apparaissent fréquemment au grand jour. Et ce grâce aux romans, précisément. Grâce à ces nombreuses histoires [15] dont le centre est une banqueroute retentissante : autrement dit un événement dramatique qui oblige tous ceux qui sont, de près ou de loin, impliqués dans ces affaires à préciser les cernes du processus, à évoquer les faits antérieurs, à se faire (souvent contre leur gré) les analystes ou les historiens de la catastrophe en question. Il y aurait, ici même, une sorte de proximité entre la construction du temps romanesque – on sait tout ce que le XIXe siècle a fait dans cette direction – et mille histoires rapportées, assez semblables sur le fond, dont le ressort est le crédit ou, mieux, qui sont basées en l’occurrence sur le fait d’une confiance trahie, sur une parole qui a fait foncièrement défaut. D’un même mouvement, on a le temps qui voit tout et, à force d’être décrit et analysé, le crédit qui se trouve sans cesse mis à nu. Ou bien : la caution donnée automatiquement par un patronyme prestigieux et, simultanément, la perfidie d’un membre de la tribu qui introduit la débâcle et le déshonneur pour l’ensemble du clan. Certaines opérations se font dans l’ombre pour éclater, ensuite, au grand jour et causer la perte de leur auteur.
18 Tout l’épisode initié par John Law avait déjà par lui-même des affinités avec une pratique romanesque, dans le goût du XVIIIe siècle. Montesquieu ne s’y est pas trompé qui, dans les Lettres persanes, en reprend l’essentiel par le biais de la parodie. Les romans du XIXe siècle accentuent certains traits, comme si, en se décantant, l’histoire effective de Law permettait qu’on fasse un usage plus imaginaire de certains traits, qu’on les grossisse, qu’on en donne une sorte de caricature ou de parodie. Ce serait, par exemple, la demande faite par le Comte de Monte-Cristo d’un « crédit illimité [16] », et tout ce que cette demande exorbitante suscite chez le banquier Danglars. Entre les façons de dire en usage et la réalité il y a un hiatus, un abîme même. La grammaire peut l’emporter fortement sur le réel : ce qui n’est pas sans conséquences sur les opérations les plus élémentaires de la finance. C’est l’extrême habileté d’Alexandre Dumas d’insérer une telle remarque dans le cours du roman, d’en faire même un épisode majeur de l’intrigue et de proposer une réflexion d’une grande pertinence dans cette perspective. Évoquer le crédit, comme l’ont fort bien compris Alexandre Dumas et Thomas Mann [17], c’est être de plain-pied avec un propos proprement philosophique, se trouver happé de ce côté-là. Et reprendre, autant qu’il le faut, l’exposé d’une partie de l’économie politique. Cela relèverait aussi d’une démarche allant dans le sens d’une certaine démocratisation du savoir ; savoir qui peut s’avérer dangereux, qui est à même de menacer les équilibres précaires en place.
Cette lettre, reprit Danglars, je l’ai sur moi. […] Cette lettre ouvre à monsieur le comte de Monte-Cristo un crédit illimité sur ma maison.
– Eh bien ! Monsieur le baron, que voyez-vous d’obscur là-dedans ?
– Rien, monsieur, seulement le mot illimité…
– Eh bien ! Ce mot-là n’est-il pas français ? Vous comprenez, ce sont des Anglo-Allemands qui écrivent.
– Oh ! si fait, monsieur, et du côté de la syntaxe il n’y a rien à redire, mais il n’en est pas de même du côté de la comptabilité.
20 On connaît l’un des paradoxes les plus consistants qui règle les entreprises économiques de cette nature. Toute l’économie politique du XIXe siècle tourne autour de ce qui semble être un principe qu’on peut résumer ainsi : pour pouvoir prétendre engager des opérations financières à moyen ou même à long terme, il faut avoir avant tout des garanties, c’est-à-dire fondamentalement une autorité morale, un pouvoir symbolique, un ascendant effectif – bref, ce qu’on appelle aussi avoir du crédit [18]. On pourrait parler d’une condition de possibilité et, sans doute, plus précisément, d’une loi d’airain du crédit dans sa forme moderne. Il est évident qu’une histoire dont l’axe majeur est le devenir d’une famille de grands commerçants, ou la conquête du pouvoir par un banquier au passé plus que douteux, il est évident qu’une telle histoire, quand elle est habilement racontée, vient montrer et, en même temps, mettre à nu cette étrange redondance : pour avoir du crédit financier, il faut avoir du crédit moral. Et, c’est comme la loi du genre, si celui-ci vient à faire défaut, celui-là s’effondre rapidement, de manière définitive même, selon une nécessité implacable. Grandes variations sur l’« être » et l’« avoir » qui peuvent prendre évidemment des allures ironiques, se prêter à mille formes de récit, devenir parfois même de simples proverbes. Qui n’a plus rien est moins que rien… Et ainsi de suite.
21 Dans un tel contexte, la fortune – qui, en français, porte bien son nom – se construit sur quelque chose qui est éminemment fragile : la confiance qu’on accorde à quelqu’un, confiance qui repose, le plus souvent, non pas sur du réel avéré, mais sur ce qu’on dit, sur la réputation, sur la considération, sur le renom – bref, sur le faire-croire collectif en cours d’énonciation. Ici encore, si l’on peut ainsi parler, il faut les détours de développements romanesques pour que se mettent en place, progressivement, les diverses modalités de ce faire-croire. Et c’est toujours le rôle majeur du lecteur de faire crédit – au texte même, c’est-à-dire à ces innombrables histoires où quelqu’un, paraissant irréprochable et tenant bien son rôle, en vient avec le temps à manquer à sa parole, en raison de certaines circonstances. Quelqu’un qui, par un biais ou par un autre, a aussi fini par comprendre ce que permettait le Système [19] en place, quelles ruses devenaient possibles dans cette perspective – aux limites de la légalité.
22 Tous les romans dans lesquels il est fortement question du « crédit » comportent, sous une forme ou sous une autre, sur un mode direct ou de façon cryptée, une théorie du roman – une esquisse de cela en tout cas. C’est comme une nécessité qui tient à l’objet en question, à la puissance du processus, à la polysémie du terme aussi. Tous convoquent également une démarche qu’on peut sans hésitation appeler philosophique. Un des exemples les plus frappants étant, à mes yeux, The Confidence-Man [20] de Melville qui date du milieu du XIXe siècle. On pourrait distinguer [21] dans ce roman trois constituants majeurs : des emprunts philosophiques (à l’empirisme notamment), un usage continuel de la rhétorique et du performatif, une réflexion sur le faire-croire qui concerne aussi bien l’intrigue en construction que le genre romanesque. On constate la fragilité d’une telle construction, qui laisse voir et qui avoue en partie de quoi elle est formée. Quelque chose du même ordre est évidemment à l’œuvre chez Thomas Mann et chez Alexandre Dumas, sous d’autres formes. En plusieurs langues, une même hantise parcourt l’Europe du XIXe siècle. Le « crédit » est incontestablement l’un des noms de ce phénomène, son nom le plus énigmatique même. Les histoires auxquelles il se prête sont susceptibles de réveiller de vieilles peurs, de les actualiser, ou de satisfaire d’anciens désirs. Le roman du crédit a un rôle crucial dans ce siècle. Il semble souvent se calquer sur des savoirs en cours de construction – ou les anticiper.
Notes
-
[1]
On voudra bien voir dans les pages qui suivent de simples remarques à propos de ces deux romans, bien trop succinctes pour aller dans le détail, pour en proposer une interprétation d’ensemble. Il y faudrait de tout autres développements. Il en va de même pour les quelques hypothèses que j’esquisse ici. Je me permets de renvoyer à mon livre, Le Temps du crédit, publié en 2002 chez Desclée de Brouwer et à celui qui y fait suite, Les promesses de l’œuvre : Artaud, Nietzsche, S. Weil, 2003, chez le même éditeur.
-
[2]
On relira notamment le chapitre LXVII intitulé « Projets de mariage » dans lequel le Comte de Monte-Cristo explique à Danglars, non sans arrière-pensées, quelles sont les trois catégories de fortune. À l’adresse du baron il dit simplement « votre fortune fictive ou votre crédit ». Manière rusée de préparer le terrain pour la suite des opérations.
-
[3]
Je pense avant tout à son grand livre intitulé Philosophie de l’argent dans lequel les différents aspects du « crédit » sont traités avec la plus grande précision, et sur un mode original.
-
[4]
Peu importe qu’il y ait des emprunts et qui les fait. L’essentiel est plutôt dans ce va-et-vient, dans le fait qu’un texte littéraire et un texte philosophique peuvent échanger leurs ressources, parfois même sans que les auteurs perçoivent ce qu’ils font. L’essentiel est aussi dans le processus d’imprégnation, comme l’avait fort bien vu Valéry. Le meilleur exemple à ses yeux : une phrase de Mon cœur mis à nu reprend une pensée d’un manuscrit de Léonard de Vinci que « Baudelaire ne pouvait pas connaître ». Une telle question prend au XIXe siècle une importance énorme.
-
[5]
Je ne peux en faire l’analyse ici. On aura compris aussi que je considère que Thomas Mann est le quasi contemporain d’Alexandre Dumas, du moins dans Les Buddenbrook. L’hypothèse n’est pas absurde à mes yeux et pourrait s’étendre à d’autres romans de Thomas Mann.
-
[6]
Terme d’époque qu’on trouve aussi bien chez Jeremy Bentham que chez Edgar Quinet pour analyser différentes formes du discours politique. D’autres auteurs vont dans le même sens, Bastiat par exemple.
-
[7]
On sait que Lacan a fait de nombreux emprunts à Bentham.
-
[8]
Mais une telle leçon met du temps à être comprise, si tant est qu’elle l’ait été…
-
[9]
Et politiquement rentable, si l’on peut dire ainsi.
-
[10]
Traduction Geneviève Bianquis, Points Seuil, 1981, p. 190.
-
[11]
Le nom de Law apparaît dans le roman d’Alexandre Dumas. Au moment où le baron Danglars fait comprendre à sa fille qu’il la met en gage pour renflouer sa propre fortune, il lui dit notamment ceci : « J’ai obtenu avec un banquier, mon confrère, la concession d’un chemin de fer, seule industrie qui de nos jours présente ces chances fabuleuses de succès immédiat qu’autrefois Law appliqua pour les bons Parisiens, ces éternels badauds de la spéculation, à un Mississipi fantastique » (chap. XCVI, « Le père et la fille »). Il faudrait revenir sur ce que représente ce gage vivant, sur la place qu’il a dans le roman familial, sur ce qu’il permet de faire, un temps au moins. Dans un tout autre contexte ayant trait à une insulte, on lit ceci : « Monsieur, je suis une garantie vivante, reprit Monte-Cristo. […] Nous avons tous deux dans les veines du sang que nous avons envie de verser, voilà notre garantie mutuelle » (chap. LXXXIX, « L’insulte »).
-
[12]
On dirait en termes différents : un rapport à soi sous le signe de la pure contradiction.
-
[13]
De manière latérale, les questions qu’on ne peut manquer de se poser à la lecture de ces romans : de quoi était donc constituée la famille en question pour être aussi vulnérable ? Quelle importance pouvait-elle donner à l’argent ? Quelle échelle de valeurs avait-elle ? Et ainsi de suite.
-
[14]
Il faudrait reprendre ici bon nombre de remarques du banquier Danglars, montrer l’intelligence qu’il acquiert du fait de sa rencontre avec le Comte de Monte-Cristo. À l’adresse de sa fille qu’il veut marier dans les conditions que l’on sait il explique ce qu’on apprend dans le « cabinet de banquier ». Ce qu’on apprend notamment par ouï-dire. La leçon doit être transmise : c’est même une des fonctions majeures de la famille. « On y apprend que le crédit d’un banquier est sa vie physique et morale, que le crédit soutient l’homme comme le souffle anime le corps, et M. de Monte-Cristo m’a fait un jour là-dessus un discours que je n’ai jamais oublié. On y apprend qu’à mesure que le crédit se retire, le corps devient cadavre, et que cela doit arriver dans fort peu de temps au banquier qui s’honore d’être le père d’une fille si bonne logicienne » (chap. XCVI, « Le père et la fille »).
-
[15]
Qui souvent s’empruntent des éléments, qui se parodient ou se plagient continuellement. En France, il a fallu plus d’un siècle pour commencer à comprendre quels étaient les principaux constituants du crédit et ce qui s’était passé lors de la banqueroute de 1720. On a d’abord oublié, mais la Révolution est venue rappeler à l’ordre. Le XIXe siècle rumine indéfiniment cette histoire.
-
[16]
Le chapitre XLVII porte titre « Le crédit illimité ». Dans ce même chapitre, le banquier Danglars dit : « Voilà trois signatures qui valent bien des millions. »
-
[17]
Mais aussi Melville, Musil et bien d’autres de la même époque.
-
[18]
On connaît l’ironie du jeune Marx à ce propos.
-
[19]
On désignait par ce terme, au début du XVIIIe siècle, l’ensemble des opérations effectuées par John Law.
-
[20]
La récente traduction par Philippe Jaworski, dans la « Bibliothèque de la Pléiade », propose de traduire ce titre par L’Escroc à la confiance.
-
[21]
Pour le dire trop vite.