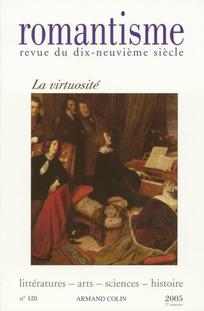1Cette rubrique est assurée par une équipe de travail dont les membres appartiennent au conseil de rédaction et dont Paule Petitier est la coordinatrice.
2Les livres reçus par Romantisme ne peuvent pas tous être l’objet d’un compte rendu; mais leur signalement complet est publié, au fur et à mesure de leur envoi à Romantisme, sur http://www.equipe19ser.jussieu.fr
Fin de siècle
Raoul Minhar et Alfred Vallette, À l’écart, présentation, notes et dossier par Sophie Spandonis, Paris, Honoré Champion, 2004. Réédition d’après l’originale et unique édition de ce roman, à Paris chez Perrin en 1891, 187 p.
3Alfred Vallette et Raoul Minhar pouvaient être contents de leur argument: au premier mot, on ne sait qui est étranglé, on ne saura pourquoi, par le jeune rentier à demi littérateur qui raconte cette histoire. «La chose», comme l’appelle ce Lucien Mauchat, perturbe sa vie pendant quelques années, la durée du roman. Trop original pour exprimer remords ou repentir, pour s’expliquer, le personnage n’a rien de commun avec Raskolnikov ni avec le Robert Greslou du Disciple. D’ailleurs il échappe sans mal à une police distraite. Pour faire passer la chose, qui n’en a pas moins rejeté le personnage pour toujours à l’écart, les auteurs recourent plutôt à la psychologie contemporaine – médicale, schopenhauérienne, darwinienne, etc. Déjà le titre en forme de locution adverbiale fait penser à Huysmans et en effet, comme dans À rebours ou En rade, on trouve ici un cas singulier de sensibilité «moderne». Là s’arrête le rapprochement, car Mauchat en catimini quitte Paris pour le jeune protectorat de Tunisie, et le récit s’acharne alors à s’interdire le roman exotique, en restant tout de même un itinéraire. En outre, à Tunis, Mauchat se lie avec Malone, un solitaire Irlandais polyglotte, au point de lui confier la chose. Malone avoue en retour qu’il est un halluciné: il fusille par accès toutes sortes de portraits, car ils l’obsèdent. Tous deux s’unissent pour affronter les irrémédiables singularités de leurs existences grâce à diverses disciplines mentales ou physiques, un peu comme tant de couples d’amis chez Barrès (Simon et le personnage d’Un homme libre), Lorrain, Rebell, ou même comme Bouvard et Pécuchet; sans succès ni fraternité durable cependant, car les coups de revolver effraient Mauchat qui fuit Malone, qui se suicide en consignant pour son ami, de minute en minute, les préliminaires de sa pendaison. Revenu en France, Mauchat herborise et, vérifiant au sein de la nature la vérité du darwinisme, se convainc qu’en somme tuer est chose banale.
4Un peu négligemment imprimé (Sophie Spandonis a corrigé beaucoup de coquilles), le roman n’eut de succès ni auprès du public ni auprès de la critique et il n’a pas favorisé la notoriété de R. Minhar. Les articles cités dans le dossier de réception marquent des réserves, même celui de Jules Renard, ami de Vallette, et au Mercure de France encore: à l’excellent sujet d’À l’écart aurait mieux convenu une nouvelle (p. 171; et voir p. 173). Réédité en 2005, ce livre surgit comme un témoin excentrique dans l’histoire de la littérature des années symbolistes. D’une part il montre quels ingrédients paraissaient requis pour écrire un roman visiblement destiné à un public jeune, supposé tant soit peu philosophe et artiste, et c’est ce que Sophie Spandonis met très intelligemment en valeur dans sa préface et dans ses notes: un «conte pour les assassins», pour parler comme Maurice Beaubourg; un roman de l’ennui; un cas de manie hallucinatoire avec des éléments de psychologie clinique savamment soulignés par l’annotation; des conversations littéraires, de la philosophie comme en réclamait Renard dans son Journal du 11 avril 1890. Mais d’autre part, la combinaison n’a pas réussi en 1891, et il n’est pas du tout inutile de se demander pourquoi, car c’est ainsi qu’on comprendra au plus près de leur imagination Bourges, Barrès, Gide, ou Darien et bien d’autres, et c’est le premier mérite, historien, de cette republication.
5Or la préfacière n’a pas exclu pour À l’écart une deuxième chance, proprement littéraire, grâce aux suggestions de ce récit elliptique. Ainsi a-t-elle suivi la piste des allusions à Caïn, avec Valérie Léonard (dont l’étude est citée p. 182); celle du motif du «double», comme elle a porté son attention sur la langue et le style des auteurs. Il est probablement d’autres intérêts que le lecteur doive encore à son initiative. Ainsi, en l’année où Bourges publie Les oiseaux s’envolent et les fleurs tombent sous l’invocation «des grands poètes anglais du temps d’Élisabeth», Minhar et Vallette ont certainement laissé des indices d’une piste shakespearienne. Quand Mauchat lui dit la chose (p. 81), l’Irlandais commente, «comme on fait une citation»: «What’s done cannot be undone». C’est en effet une parole de Lady Macbeth (V, 1), et l’irlandais Edmond Malone fut un des éditeurs de Shakespeare les plus célèbres du xviiie siècle: À l’écart réserve des plaisirs d’étude et de lecture dont on remercie les éditeurs et Sophie Spandonis.
Pierre Citti
Géraldi Leroy, Batailles d’écrivains. Littérature et politique, 1870-1914, Paris, Armand Colin, 2003, 349 p.
6Les relations entre littérature et politique à la fin du xixe siècle ont souvent été traitées sous l’angle historique ou chronologique. Elles l’ont rarement été dans une perspective directement littéraire, et d’une manière globale. C’est à cette entreprise que Géraldi Leroy s’attache dans cet ouvrage en proposant une synthèse qui expose avec une grande clarté les positions adoptées par les différents acteurs du champ littéraire. Plutôt que d’additionner une série de monographies d’écrivains, Géraldi Leroy a choisi de présenter, l’une après l’autre, les grandes questions, politiques ou sociales, qui ont occupé la dernière partie du xixe siècle. Il étudie ainsi, successivement, les «visions de l’Allemagne», les «images de la Commune», l’affaire Dreyfus, le choix du régime politique (république ou monarchie?), la question de la laïcité, la «grande question du prolétariat», et enfin le problème colonial. Ce parti pris l’a conduit à présenter d’une manière discontinue, en plusieurs endroits de son développement, les positions politiques de Barrès, de Maurras, de Péguy ou de Zola, par exemple, mais il a l’avantage de souligner les affrontements polémiques et de dessiner la complexité des configurations idéologiques. Il lui permet aussi d’envisager – à côté des engagements les plus célèbres – les choix effectués par des écrivains aujourd’hui oubliés ou jugés secondaires.
7Il est impossible de résumer dans le détail l’ensemble des analyses ainsi conduites. Contentons-nous d’un parcours rapide qui donnera une idée de la richesse de cet ouvrage. En ce qui concerne la Commune, par exemple, G. Leroy rappelle l’importance du traumatisme idéologique provoqué par l’événement dans la conscience de la plupart des représentants de la classe intellectuelle, mais il montre aussi les formes que prend la réhabilitation de l’aventure communarde, après l’amnistie de 1880, chez Jules Vallès (avec L’Insurgé), Lucien Descaves (avec Philémon, vieux de la vieille) ou Léon Cladel (avec INRI). L’affaire Dreyfus est étudiée, comme on pouvait s’y attendre, à travers les engagements de Bernard Lazare et de Zola (c’est, d’ailleurs, un sujet que G. Leroy connaît bien, puisqu’il a été le premier à en avoir proposé une vision d’ensemble, en 1983, avec l’ouvrage collectif intitulé Les Écrivains et l’Affaire Dreyfus); mais elle est aussi perçue, d’une manière contrastée, à travers différents itinéraires individuels, pris dans le camp dreyfusiste (Péguy, Mirbeau, Benda) et dans le camp antidreyfusiste (Barrès, Brunetière, Maurras). Le chapitre consacré à la question du prolétariat présente les problématiques opposées de l’anarchie et du socialisme, s’attarde sur Péguy (à qui G. Leroy a consacré de nombreuses études depuis son Péguy entre l’ordre et la révolution, publié en 1981), pour se terminer par une évocation des solutions idéologiques traditionalistes imaginées par René Bazin, Paul Bourget ou Georges Sorel. Enfin, le chapitre sur la question coloniale pénètre avec beaucoup de finesse à l’intérieur des visions algériennes d’un Daudet, d’un Loti ou d’un Maupassant, avant d’analyser «l’arabophilie» des frères Tharaud ou la lucidité critique de Victor Segalen dans Les Immémoriaux.
8Au terme de ce panorama, G. Leroy souligne le nombre et la diversité des différents engagements (ou «investissements» idéologiques) qu’il a pu analyser. Contrairement à une idée reçue, les écrivains de la seconde moitié du xixe siècle ne se sont pas cantonnés, pour la plupart, dans une position de rejet ou d’indifférence vis-à-vis de la chose publique. La violence des polémiques qui se sont déroulées, la diversité des écrits qui ont été produits l’attestent suffisamment. Nombreux sont ceux qui ont voulu abolir les frontières existant entre littérature et politique, tout en se méfiant des partis politiques et en tenant à conserver leur propre indépendance. «Les écrivains ont ainsi beaucoup participé à modeler la figure de “l’intellectuel” tant par l’utilisation d’une notoriété médiatique à des fins politiques que par les modes d’intervention face à l’opinion et la revendication de motivations personnelles désintéressées. L’intellectuel de “droite” participe pleinement à ces catégories, même s’il ne se réclame pas des valeurs universalistes invoquées par son homologue de “gauche”» (p. 325-326). De fait, cette étude d’ensemble souligne – bien qu’aucune statistique ne puisse être avancée – que les défenseurs des valeurs traditionnelles et les nostalgiques de l’ordre établi l’emportent largement sur les idéalistes ou les prophètes. «Pour un Vallès que de Barrès!», note G. Leroy (p. 326). Si, à la fin du xixe siècle, les écrivains ont volontiers abordé les questions politiques ou sociales, c’était plus pour défendre l’univers dans lequel ils vivaient que pour rêver à de lointaines utopies.
Alain Pagès
Balzac
Kyoko Murata, Les métamorphoses du pacte diabolique dans l’œuvre de Balzac, Paris, Klincksieck, 2003, 328 p., préface de Nicole Mozet.
9Kyoko Murata a choisi un sujet apparemment simple et banal, le pacte diabolique, dont elle révèle en fait la complexité et la profondeur. Car si tout le monde peut citer d’emblée la pacte de Raphaël de Valentin avec l’antiquaire et celui de Vautrin avec Lucien de Rubempré, il est plus difficile d’envisager les subtiles variations de Balzac sur ce thème faustien. L’influence de Maturin, de Goethe, d’Hoffmann lui indique d’emblée la voie du fantastique, qu’il emprunte dès le roman de jeunesse Le Centenaire et jusqu’à La Peau de chagrin. Mais déjà chez lui, le fantastique devient philosophique et permet d’aborder les grandes questions du temps, de la fatalité ou du déterminisme, de la mort, tandis que la peau symbolise l’Autre, le double intérieur et pointe la limite ténue entre raison et folie. Balzac fait pénétrer le pacte diabolique dans l’espace réaliste avec Melmoth réconcilié et César Birotteau. Comme l’écrit spirituellement Nicole Mozet dans sa préface, «en faisant entrer le pacte en Bourse, le moins qu’on puisse dire est qu’il le démonétise». La puissance diabolique devient ainsi économique, mais entre surtout dans la dialectique du désir, toujours relancé par le manque, mais ici circonscrit à l’espace matériel par une ironie ravageuse. La victime, bien peu innocente, est cependant un exclu du profit, acculé au vol pour ne pas sombrer. Transformé en homme riche et doté du don de double vue comme Gobseck, il perd le goût de vivre en découvrant l’abîme des bassesses humaines. Décidément pour Balzac, la question du salut de l’âme n’a plus de sens si «nous sommes tous actionnaires dans la grande entreprise de l’éternité» (Melmoth réconcilié, p. 384). Il ne reste plus au romancier que la raillerie, seule «littérature des sociétés expirantes» (Préface de La Peau de chagrin). La démonstration de l’auteur est convaincante et bien menée.
10Vautrin le tentateur, le corrupteur, est naturellement au cœur de cet essai. Son satanisme s’enracine profondément dans la réalité, dans cette boue physique et morale des bas-fonds. Préparé dans la création balzacienne par Argow le pirate et par Ferragus, ce Protée est investi d’un double sens, positif et négatif, étant à la fois exclu et au-dessus des lois. Avec Rastignac, il traite d’égal à égal, avec Lucien de Rubempré, il domine, il écrase, il vampirise. Mais devenu sa créature, Lucien éveille en lui les sentiments d’un père et d’une mère. Du coup Herrera rejoint Goriot et s’avère l’antéchrist de la maternité. Ces nuances sont analysées avec finesse par Kyoko Murata, mais on s’étonne de ne pas lui voir évoquer la dimension diabolique de Lucien lui-même, personnage luciférien par son nom et par sa faiblesse.
11Mais elle va plus loin, en montrant dans la cousine Bette ou dans Madame Evangelista les pendants féminins de Vautrin, bien plus dangereux encore dans la mesure où ces monstres femelles disposent d’un pouvoir qui parvient à détruire des familles entières. La peur balzacienne du féminin est ici évidente. On aurait pu souligner avec plus de force sa dimension fantasmatique et son association inconsciente avec le thème maternel de la femme sans cœur. Pourtant la femme peut aussi être exaltée, comme elle l’est en Séraphîta, l’androgyne chez qui domine le féminin. À côté du pacte diabolique, existe en effet dans La Comédie humaine le pacte angélique, que Kyoko Murata semble bien être la première à identifier comme tel. Pacte de confiance entre Goriot et Rastignac, entre Félix de Vandenesse et Henriette de Mortsauf, pacte qui rejoint encore l’amour maternel avec son dévouement absolu. Sans doute aurait-il été indiqué de souligner la parenté entre Henriette et Séraphîta, entre l’ange terrestre et l’ange céleste.
12Comme le souligne Kyoko Murata, Balzac a donc non seulement inventé le fantastique social en inscrivant le pacte diabolique dans la société bourgeoise et capitaliste du Paris de la Restauration, mais aussi «annoncé la fin de Satan en réduisant le pouvoir surnaturel absolu à une valeur relative, celle d’échange». Il a certes exalté la poésie du Mal, mais l’auteur de cet essai aurait peut-être pu insister davantage sur la façon dont il a intégré la méta-physique et la mystique au roman réaliste, repoussant ainsi sans cesse ses limites. Malgré quelques maladresses stylistiques bien naturelles, ce travail subtil et documenté constitue une analyse très stimulante des diverses formes prises par le pacte diabolique dans l’œuvre balzacienne, analyse qui démontre son originalité profonde par rapport à toute la littérature fantastique antérieure et contemporaine.
Anne-Marie Baron
Balzac et l’Italie. Lectures croisées, Paris, Paris-Musées/Éditions des Cendres, 2003, 204 p.
13Cet ouvrage rassemble les actes d’un colloque international organisé par la Maison de Balzac et l’Institut culturel italien de Paris, les 10 et 11 novembre 2000. Ce colloque s’était tenu à l’occasion d’une belle exposition, «Il signor di Balzac. Balzac vu par l’Italie» (Maison de Balzac, du 10 octobre 2000 au 7 janvier 2001), à laquelle avait collaboré activement Paola Dècina Lombardi, qui avait organisé à Rome une exposition similaire. Comme le souligne Roland Chollet dans sa brillante et suggestive introduction, le thème du colloque est abordé sous de multiples facettes et sous des angles différents dans les contributions réunies dans ce volume, qui inaugure la collection des «Rencontres de la Maison de Balzac». Le dessein du recueil est bien expliqué par le titre choisi pour ses pages liminaires: il s’agit de raconter encore une fois «Une histoire d’amour», celle des rapports entre la France et l’Italie, dont Balzac a été un témoin privilégié et un artisan incomparable. À commencer par l’évocation de Dante, par la relation que La Comédie humaine entretient avec La Divine Comédie: acte d’hommage inscrit au fronton de l’œuvre, déclaration d’intentions, «parallèle implicite» que le cycle romanesque de Balzac nous demande inlassablement d’éclaircir, et sur lequel – remarque opportunément Roland Chollet – «tout reste à dire».
14Dans le cadre de cette «histoire d’amour», de cette «alliance intime et continue de l’Italie et de la France», dont parlait Balzac en 1846, les aspects les plus novateurs et stimulants des études ici réunies relèvent de leur caractère de «lectures croisées» qui, loin de toute prétention de constituer un bilan exhaustif d’un si vaste sujet, suivent deux perspectives générales et opposées: celle qui porte sur «l’orientation italienne» de Balzac (dans le sens de l’approche fondatrice de Fernand Baldensperger en 1927) et celle qui porte sur «quelques orientations balzaciennes de l’Italie». Quelquefois ces deux perspectives se superposent, et quelquefois elles sont plus franchement opposées, mais c’est justement la simultanéité ou l’alternance des points de vue qui permet de retracer les étapes d’un itinéraire très complexe et le sens de la traversée d’une multiplicité de textes autour du thème de cette rencontre.
15Il est donc tout à fait naturel que, dans l’étude fort intéressante qui sert d’ouverture à l’ouvrage, Mariolina Bertini explore ponctuellement l’Italie de Balzac à travers l’«œuvre pionnière» de René Guise et de Raffaele de Cesare, deux grands érudits, deux chercheurs intransigeants, dont les travaux et les éditions constituent des points de repère fondamentaux. Philippe Berthier contribue aussi efficacement à compléter ce chapitre de l’italianité (dans «Gina ou l’Italie») et consacre des réflexions importantes au rôle de médiateur joué par Stendhal, dans la construction d’une certaine image ou d’un certain fantasme de l’Italie balzacienne. Il revient évidemment sur l’hommage rendu à l’auteur de La Chartreuse de Parme, dans la Revue parisienne en septembre 1840, et souligne avec beaucoup de finesse, «la générosité» de Balzac face à celui qui, grâce à son roman italianissime, «avait confisqué le plus beau pays du monde» (p. 52). Comme Stendhal, par ailleurs, si l’on essaie de dégager la place que l’Italie occupe dans son œuvre, il faut convenir que Balzac n’a jamais cessé de méditer sur l’histoire de l’art et sur la musique italienne. D’où l’intérêt des articles de Marie-Hélène Girard et d’Adrien Goetz, regroupés sous la rubrique «Beau comme un Titien», qui s’interrogent sur l’existence d’une esthétique ou d’une sensibilité esthétique «italienne», chez l’auteur du Chef-d’œuvre inconnu. Suit la contribution de Paola Dècina Lombardi qui, à propos de l’amitié de Balzac pour Rossini et de l’admiration manifestée pour le compositeur du Mosé dans Massimilla Doni, vise surtout à confronter le «silence» de Rossini, après le Guillaume Tell, à la notion balzacienne de «suicide de l’art».
16Si les études que nous avons rapidement examinées s’attachent essentiellement aux traits constitutifs de l’orientation italienne de Balzac, les textes de Rinaldo Rinaldi et Mario Lavagetto déclinent la présence de La Comédie humaine dans le roman moderne italien, notamment dans l’œuvre de Carlo Emilio Gadda et Italo Calvino. Comme le remarque Roland Chollet, plus d’un siècle et demi après sa mort, Balzac est donc encore, dans la littérature italienne, une présence difficile à saisir, mais une «référence d’écriture et de pensée dont ni le roman ni la théorie de la littérature ne sauraient se passer» (p. 20). Certes, une présence plus difficile à saisir chez Gadda, malgré les affinités de destin et les analogies de quelques thèmes autobiographiques, et malgré les analyses séduisantes de Rinaldo Rinaldi dans «Balzac dans Gadda. Technique de la citation dans La Cognizione del dolore». Force est de constater que la présence d’un intertexte balzacien dans le roman de Gadda relève plutôt d’un «effet de lecture» que d’un examen objectif. Peu importe, ce qui compte c’est que la connaissance de Balzac peut introduire le lecteur à l’œuvre de Gadda, et vice versa.
17S’agissant de Calvino face à Balzac, le travail de Mario Lavagetto est à la fois plus simple et plus complexe, puisque, dans ce cas, la présence de La Comédie humaine comme référence et comme intertexte, est avérée, indéniable. Lavagetto écrit un essai magistral, dans lequel l’analyse du discours de Calvino sur Balzac ne va pas sans évoquer, constamment, tant l’approche originale d’un théoricien de la littérature qui se situe lui-même par rapport au modèle insaisissable du romanesque balzacien, que certains aspects de l’œuvre de Calvino, envisagé à la fois comme romancier et comme critique.
18Rappelons enfin que cet ouvrage présente aussi un étonnant récit inédit de Caroline Marbouty, un récit «d’outre-tombe» de Balzac, sur son escapade de 1836 à Turin, et une étude de Roger Pierrot sur les dédicataires et correspondants italiens du romancier. «Dovuto a Balzac», conclut Roland Chollet.
Mariella Di Maio
Chateaubriand
Jean-Christophe Cavallin, Chateaubriand cryptique ou les confessions mal faites, Paris, Honoré Champion, coll. «Romantisme et Modernités», n° 74, 2003, 216 p.
19Parmi les étonnements que suscitent les Mémoires d’outre-tombe, la suppression par Chateaubriand des pages magnifiques qu’il a consacrées à son second séjour à Venise en 1833 n’est pas l’un des moindres. Avec d’autres chapitres, l’inoubliable «rêverie au Lido» est aujourd’hui reproduite en annexe des éditions des Mémoires d’outre-tombe. Si quelques extraits en avaient été repris dans l’Essai sur la littérature anglaise, l’ensemble a été redécouvert et publié en 1936 seulement par Maurice Levaillant.
20C’est notamment à ces pages que Jean-Christophe Cavallin s’est intéressé dans cet essai où il interroge le geste même qui a conduit à leur suppression; comme il le dit lui-même dans une belle formule, Chateaubriand cryptique offre un «prétexte à lire un livre désécrit». La raison de la «censure» de ces pages, qu’on attribue parfois à la pression de l’entourage de Chateaubriand, J.-C. Cavallin la cherche dans le texte et propose, dans une ingénieuse hypothèse de travail, de la rattacher à la confession incomplète du jeune François-René
21avant sa première communion, qu’il complètera, terrorisé entre autres par la lecture du «livre des Confessions mal faites». Les Mémoires d’outre-tombe sont ainsi une autobiographie trouée de silences, où le «moi» se tait ou se cache, un texte crypté qu’il s’agit de déchiffrer, au sens étymologique.
22La première partie de l’ouvrage étaie cette hypothèse, en situant la rédaction de l’autobiographie dans son contexte intellectuel. Opérant autour de 1830 un changement radical dans sa conception de l’écriture mémorialiste, Chateaubriand dépasse le dilemme entre deux constructions du moi proposées l’une par les Confessions de Rousseau, solution sincériste, l’autre par les Confessions d’Augustin, solution eschatologique, au profit d’une «allégorie des temps» qui comble le «blanc occasionné par l’ablation du moi intime». (p. 49). C’est que, dans les années de la Restauration, un bouleversement s’opère dans l’épistémologie de la science historique, avec notamment les Principes de la philosophie de l’Histoire de Michelet, qui présente en France la pensée de Giambattista Vico, la préface de Quinet à sa traduction des Idées sur la philosophie de l’histoire de l’humanité de Herder, à quoi s’ajoutent les Prolégomènes des Essais de palingénésie sociale de Ballanche. S’appuyant sur ces travaux, Chateaubriand transmue résolument le moi des Mémoires d’outre-tombe en une allégorie de son temps. Cette idée, qui avait été formulée par Jean-Claude Berchet dans un article du CAIEF (1988), permet à J.-C. Cavallin de repenser fondamentalement le rapport du moi et de l’Histoire chez Chateaubriand: «l’homme des Mémoires» échappe à toute psychologie pour devenir la personnification d’une époque révolue. La figure de cette personnification s’élabore comme un palimpseste de mythes et de héros légendaires, transmuant l’autobiographie en une nouvelle forme d’épopée.
23Mais ce n’est pas tant les implications de cette hypothèse que l’essai va étudier – pour cela on se référera plutôt au Chateaubriand mythographe du même auteur (Champion 2000) – que le dilemme entre l’aveu et le silence, le dévoilé et le tu. Dans la nouvelle vision des Mémoires telle qu’elle s’élabore dès 1830, tous les détails de la vie intime prennent sens dans le vaste mythe des temps que le moi représente: l’homme des Mémoires s’incarne en Moïse dans le désert et, par sa voix, «parlent par ventriloquie Énée, Ulysse, Renaud, Achille» (p. 45). Cette hypothèse invite ainsi l’auteur à une herméneutique vertigineuse, car, considérant tout le texte comme chiffré, il dévoile les clés d’un déchiffrage.
24Ainsi, la deuxième partie développe l’idée d’un «moi crypte», où crypte prend son double sens de caveau funéraire et de cachette. Chateaubriand transforme son moi intime en un espace cryptique, sorte de caveau où il accueille dans une «ingestion cultuelle» (73) les morts, notamment des femmes muées en «sibylles»: Pauline de Beaumont qui sera à l’origine du premier projet des Mémoires d’outre-tombe; Lucile que J.-C. Cavallin rapproche de la sibylle de Samothrace de l’Orphée de Ballanche, car elle devient garante des traditions face au danger de la fracture révolutionnaire et l’initiatrice à la poésie. Mais l’ingestion de cette sibylle, le «devenir Lucile» (p. 91), pose l’alternative entre libérer Lucile de sa crypte, dans un geste de dissipation d’une substance précieuse, et la renfermer dans un corps cachot. Cette très belle lecture retrouve le psychologique par le biais du symbole; l’approche en effet tend vers celle d’un C.G. Jung, par exemple dans son chapitre sur «Les symboles de la mère et du réenfantement» dans Métamorphoses et symboles de la libido.
25La troisième partie s’attache résolument aux pages sur Venise. La question qui se pose pour Chateaubriand est que Venise est occupée par Rousseau, Byron, mais aussi d’autres écrivains français contemporains, notamment Casimir Delavigne: quel angle reste-t-il pour être neuf? «Chateaubriand choisit un mythe pour chiffrer les épisodes de cette gigantomachie» (112), celui de l’Aurore, figure de la jeunesse éternelle, et de Tithon, l’interminable vieillesse, à travers lequel l’auteur propose une éblouissante analyse de ces livres retranchés des Mémoires d’outre-tombe.
26Certes, l’hypothèse d’un chiffrage du texte qu’une clé suffit à décrypter donne une idée un peu réductrice du sens, enfermé dans une lecture univoque et dans une intentionnalité auctoriale. Sans doute aussi, certains rapprochements intertextuels apparaissent comme arbitraires. Ainsi, dans «L’aurore eschatologique du Tasse», J.-C. Cavallin construit son analyse sur la supposition que le terme rare d’«aréneuses» et celui de «juveniles» seraient des souvenirs de la Jérusalem délivrée. Chateaubriand connaissait bien ce poème, mais cela suffit-il pour préférer un rapprochement acrobatique à une explication assez simple dans les deux cas: l’adjectif «aréneux» appartient au vocabulaire de la poésie néoclassique française (il apparaît chez André Chénier, par exemple), emprunté à Virgile sans doute, et le Dictionnaire de l’Académie l’atteste dès 1762; et «juveniles» me semble être la forme abrégée de Musae juveniles, expression qu’on trouve dans la Vie de Rancé (Philomati Musae juveniles). Enfin, le lecteur sera sans doute surpris d’apprendre dans la bibliographie qu’en dehors des essais de J.-C. Cavallin aucun ouvrage critique n’a été publié sur Chateaubriand après 1978. Il est vrai que l’auteur rend ici un bel hommage au travail fondateur de Levaillant, mais, depuis, d’autres lectures ont été faites de ces pages sur Venise, ne serait-ce que celle qu’en a donnée le bel article de Philippe Berthier («Dernières italiques», 1990). La démonstration aurait gagné en force en accordant une meilleure attention aux travaux publiés sur cette question.
27Il n’en reste pas moins que cet essai instruit de manière convaincante une idée forte, celle d’une autobiographie composée à partir du renouvellement de la philosophie de l’Histoire sous la Restauration. Dans des pages passionnantes par la qualité des lectures, stimulantes par bien des rapprochements, traversées d’une gaie érudition, il offre une belle interprétation de l’atelier textuel qu’ont été les Mémoires d’outre-tombe.
Jean-Marie Roulin
Littérature populaire
Douleurs, souffrances et peines: Figures du héros populaire et médiatique, Angels Santa (dir.), L’ull critic, Lleida, 2003, 345 p.
28Hyperbolique autant qu’imméritée, injuste et spectaculaire, la souffrance consacre le héros du roman populaire et induit des dynamiques narratives à l’efficacité éprouvée – pour reprendre les mots de Charles Grivel, «il faut souffrir pour plaire […] “Il n’y a pas d’amour heureux”, dit la chanson; il n’y a pas de héros heureux, dit le roman. Tout récit vit de l’exposé des malheurs et des peines de son personnel: il n’y a pas de récit heureux» («Présentation», p. 14). C’est à cette dimension essentielle de la fiction populaire que s’intéresse le présent ouvrage collectif, issu d’un colloque tenu à l’Université de Lleida en septembre 2000, à l’occasion de la rencontre de la Coordination internationale des chercheurs en littérature populaire et culture médiatique. Si nous nous contenterons de rendre compte des communications portant sur le xixe siècle, soulignons d’emblée l’étendue et la richesse du corpus qu’analyse ce volume, lequel étudie de nombreuses formes (notamment cinématographiques et télévisées) de la fiction médiatique en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud: en ce domaine, le croisement disciplinaire et la variété des approches se révèlent riches en découvertes.
29En ce qui concerne la littérature du xixe siècle, Ellen Constans ouvre son intéressante contribution par une mise au point très claire, appuyée sur des références bibliographiques précises et précieuses: elle rappelle ainsi, en quelques pages, l’évolution narratologique et thématique du roman populaire depuis ses débuts jusqu’au commencement du xxe siècle. Le premier âge d’or du feuilleton (1840-1845) se centre volontiers sur la figure du «surhomme» analysée, entre autres, par Umberto Eco, si bien que l’œuvre réparatrice du Justicier voire du vengeur tout-puissant répond à l’injuste souffrance que subit le personnage principal (Le Comte de Monte-Cristo), ou qui accable les innocentes victimes des violences sociales (Les Mystères de Paris). En revanche, les récits plus proches du roman de mœurs, qui s’imposent progressivement au fil du siècle, s’intéressent de plus en plus non pas au héros qui détermine l’action, mais à la victime qui la subit — victime qui prend le plus souvent les traits d’une femme et presque toujours d’une mère. Du roman populaire épique au roman de la victime, se dessine un partage à la fois esthétique et idéologique dont les enjeux s’avèrent considérables.
30C’est au roman de la victime que sont consacrées les trois études qui ouvrent le recueil. Le premier article dégage les traits essentiels propres à ce type de récit, qui triomphe dans le dernier quart du xixe siècle: à la différence du héros masculin que consacrent sa capacité de révolte et l’affirmation de sa toute-puissance face à ses persécuteurs, l’héroïne se caractérise par la résignation exemplaire qui en fait une martyre — d’où le discours clairement démobilisateur et conservateur propre au genre, par ailleurs non dépourvu d’ambiguïtés idéologiques. Ambiguïtés et conservatisme qu’on retrouve aussi bien en amont (le mélodrame révèle une «distribution» comparable entre les épreuves que surmonte le héros et le martyre que subit l’héroïne) qu’en aval (dans le roman-feuilleton brésilien contemporain notamment): à l’évidence, la souffrance au masculin n’est jamais symétrique de la douleur au féminin.
31Reste que, même pour le «surhomme» du roman populaire épique, la souffrance est à l’origine et au cœur du dispositif d’épreuves qui en fait un héros: c’est ce que montre le deuxième mouvement du recueil, qui, des Mémoires du diable de Soulié aux Mystères de Marseille de Zola, témoigne éloquemment des multiples dispositifs narratifs qu’engendre le motif de l’injustice initiale et de sa nécessaire réparation. Claude Schopp montre notamment comment la fiction s’articule volontiers au fait-divers, qui en constitue la source et la matrice: en 1832, le suicide de Victor Escousse, jeune dramaturge déjà célèbre, est à l’origine d’une légende restée vivace jusque très avant dans le siècle.
32Précisons pour terminer que ces études sur le xixe siècle prennent une résonance nouvelle quand on les confronte, comme nous y invite cet ouvrage, aux analyses inspirées par les productions médiatiques modernes et contemporaines: sans doute est-ce là l’un des intérêts majeurs de ce volume.
Corinne Saminadayar-Perrin
Lamartine
Alphonse De Lamartine, Correspondance Deuxième série (1807-1829), t. I, 1807-1815, Textes réunis, classés et annotés par Christian Croisille et Marie-Renée Morin, Paris, Honoré Champion, 2004, 566 p.
33L’entreprise éditoriale menée par Christian Croisille de proposer aux lecteurs de Lamartine une édition renouvelée, étendue et complète, de sa correspondance, se poursuit. Le tome I de la Deuxième série qui traite des années 1807-1815, les années de formation du jeune Lamartine, est enfin disponible. Il suit la publication des lettres couvrant la période 1830-1867 car Christian Croisille travaille à rebours de la chronologie lamartinienne. Concernant les années 1807-1815, le travail de Marie-Renée Morin, ici co-éditeur, qui, la première, a exhumé des archives du Château des Virieu où elles dormaient les belles lettres de Lamartine à son condisciple et ami, rendait en effet moins urgent et moins nécessaire de commencer par le commencement l’édition de cette Correspondance: quand Lamartine n’est encore que le fils de son père et de sa mère, le neveu de son oncle, et un larron essentiel du trio romantique formé au collège de Bellay par Virieu, Guichard puis Vignet, et lui.
34De 1807 à 1815 s’égrènent pour Lamartine les éléments d’une vie adulte débutante. 1807: la fin du collège. Elle suscite en pratique toutes les lettres qui sont nécessaires à la poursuite des amitiés vécues en classe de rhétorique, dans les dortoirs, à la Chapelle. 1808-1809-1810: rien de notable, à vrai dire, pour Lamartine durant ces trois années, si ce n’est les amours, les amitiés consolidées ou fragilisées, et les lectures qui composent une correspondance romantique, admirative ou perplexe devant Rousseau, Chateaubriand et Madame de Staël, une vie exaltée à la manière d’un jeune Werther (découvert aussi pendant ces années-là) ou à la manière du jeune Chateaubriand des Mémoires d’Outre-tombe dans ses journées solitaires au château de son père. Sauf que Lamartine ne songe jamais à mourir, qu’il délaisse sa passion amoureuse pour Henriette Pommier en faveur d’un voyage d’agrément en Italie en 1811 et qu’il contracte une maladie vénérienne sérieuse qui le rend ensuite grabataire pendant une bonne partie de l’année 1813. «Il y a des compensations, des consolations dans tous les événements et je les savoure. Je suis très bien logé, j’ai une excellente cuisinière, je la mets à l’épreuve et j’ai bon appétit, je ne manque de rien de tout ce qui peut contribuer à m’amuser ou à me guérir», écrit ainsi Lamartine à son ami Dupuys en juin 1813. Que les sucreries et les poulardes rôties soient dignes de figurer autant que Rousseau et ses Charmettes dans cette Correspondance aiguille sur un autre chemin que celui auquel mène ce premier désenchantement d’avant la Restauration qui fait entrevoir un tout petit Musset puis un tout petit Baudelaire d’avant l’heure sous les traits mutants du jeune Lamartine.
35Plus qu’au spleen – inévitable – cultivé de lettre en lettre par l’expéditeur et modulé habilement en fonction du destinataire, le lecteur s’intéressera donc davantage à la matière poétique des lettres. Lamartine pense tout d’abord par citations antiques (Horace, Virgile, Cicéron), puis il se met à penser progressivement avec ses propres outils, c’est-à-dire ses propres vers qu’il appelle des impromptus et qui jaillissent et trouent la vile prose de ses lettres, selon l’expression de l’épistolier. Lamartine rime comme il pense ou pense comme il rime, selon des élans spontanés, plus éloquents que lyriques et qui sont autant des petites fusées que des fragments d’œuvres inachevées. En ce sens, la Correspondance est déjà littéraire, pas érudite, ni même instruite, mais sensible à une poétique de la conversation héritée de l’Ancien régime, qui ne néglige pas le travail formel et que Marc Fumaroli nous a appris à connaître. Lamartine lit aussi Scarron. Après l’année italienne, il n’alterne plus seulement prose et vers mais aussi français et italien, et cette marquetterie lamartinienne de toutes les langues et de toutes les formes est la plus sûre introduction qui soit au cœur d’une conscience poétique pour laquelle la rime est une respiration parmi les autres. En juin 1810, à Virieu: «La traduction me fatigue bientôt, je fais quelques méchants vers sans peine et sans soin, et puis j’écris d’un style rompu à Guichard et à toi». En mars 1812, à Dupuys: «Tu vois par cette prose rimée que je t’écris en courant que je dois m’occuper à présent de grands vers tragiques, c’est vrai». Des Méditations de 1820 demeure davantage dans notre mémoire la prose rimée que ses grands vers tragiques, laissons encore au Lamartine de 1807-1815 le temps de le découvrir.
Dominique Dupart
Romantisme allemand
Romantische Identitätskonstruktionen: Nation, Geschichte, und (Auto-)Biographie, Glasgower Kolloquium der Internationalen Arnim-Gesellschaft, herausgegeben von Sheila Dickson und Walter Pape, Tübingen, Niemeyer, 2003, 302 p.
36Ce volume consacré aux constructions identitaires romantiques concernant la nation, l’histoire et l’autobiographie est une publication collective de la Société Internationale Achim von Arnim. Il reprend les contributions d’un colloque tenu à Glasgow et c’est donc par l’analyse de l’œuvre et de la trajectoire de l’écrivain Arnim que sont proposées des approches du programme poétique et idéologique du romantisme allemand.
37Achim von Arnim (1781-1831) est l’une des figures centrales du romantisme allemand que les études françaises connaissent trop succinctement [1]. On sait qu’il publia, en collaboration avec Clemens Brentano, le plus célèbre recueil de chansons populaires allemandes, Le Cor enchanté de l’Enfant (Des Knaben Wun-derhorn). Le premier tome parut en 1805, avec une dédicace à Goethe et un essai d’Arnim Sur les Poésies populaires exposant les visées patriotiques du recueil: la publication de poésie populaire a pour but d’éveiller le sens d’une appartenance commune entre le Peuple et les élites, nécessaire à la résurrection politique de la nation, aussi bien qu’à l’épanouissement des individus. La publication du Cor enchanté correspondait au moment où les guerres napoléoniennes donnaient une dimension nouvelle à l’engagement patriotique des jeunes intellectuels et écrivains allemands (les Discours à la Nation allemande de Fichte datent de l’hiver 1807-1808). Le Cor enchanté exerça aussi une forte influence sur la jeune génération poétique (Eichendorff, Uhland, Mörike) et suscita de nouvelles vocations de collecteurs: les frères Grimm, collaborateurs des deuxième et troisième tomes, publièrent en 1812 leur propre recueil de Contes, dont on sait la fortune.
38Les contributions de ce volume portent surtout l’attention sur la complexité des reconfigurations identitaires qui s’opèrent dans le premier xixe siècle, non seulement dans l’œuvre de ces écrivains pour qui la littérature a une évidente fonction sociale, mais aussi dans leur trajectoire personnelle.
39Fils d’un aristocrate prussien propriétaire de domaines et attaché au service de Frédéric II, le jeune Arnim rejette spectaculairement à l’âge de 20 ans le prénom de Louis, par lequel il était connu dans les milieux francophiles de Berlin, et se donne un nouveau prénom, en harmonie sonore avec son patronyme. Destiné à administrer le domaine familial, Arnim entreprend avec son frère, en cette même année 1801, le «voyage de formation» en usage dans son milieu. Ils doivent initialement se rendre en France, ils poussent en Grande-Bretagne: non pas seulement Londres, mais aussi le Lake District et l’Écosse, sur les traces de l’épopée ossianesque, qui est pour la jeune génération «paradigme élégiaque» et modèle, par la collecte de chants populaires, d’une littérature authentiquement nationale. La publication du recueil de chants populaires allemands, peu après le retour sur le continent, scelle la fraternité littéraire avec Brentano. Quelques années plus tard, Arnim épouse Bettina, sœur de Brentano. Les «couples adelphiques» ne sont pas rares dans la jeune génération romantique (les Schlegel, les Grimm), mais celui que forment les beaux-frères Arnim et Brentano incarne métonymiquement l’Allemagne unifiée qu’ils veulent faire advenir. L’un est issu de l’aristocratie prussienne protestante, l’autre de la bourgeoisie commerçante catholique de Francfort (le père de Brentano était d’origine italienne). Le groupe social restreint constitué par les jeunes intellectuels et artistes, pour qui la redéfinition des identités individuelles et collectives est un enjeu fort de la création esthétique, est de fait socialement ouvert, par-delà les délimitations d’Ancien Régime.
40Bettina, au demeurant, est tout sauf passif lien entre Arnim et Brentano. Adolescente, elle a voulu construire le modèle féminin d’une amitié élective intense, fondée sur des enthousiasmes intellectuels et des lectures partagées. De cette «amitié érotisée» avec Caroline von Günderode, pour reprendre l’expression de Barbara Becker, elle fera un livre épistolaire (La Günderode, 1840) qui mêle la correspondance échangée entre les deux femmes et des ajouts fictifs. Sa célèbre Correspondance de Goethe avec un enfant (1835) se fonde également sur une relation érotisée et fictionnalisée: délaissée par Caroline, qui s’est engagée dans une passion malheureuse pour Creuzer et finit par se suicider, Bettina s’est rapprochée de la mère de Goethe, afin d’entrer en relation avec le génie qui autrefois courtisa sa propre mère. L’ouvrage, nourri de lettres réelles et de souvenirs recueillis sur Goethe enfant, élève un «monument» au génie allemand et participe à la construction du sacre de l’écrivain dans la nouvelle société nationale: mais tout un dispositif d’allusions, de projections croisées entre personnages romanesques et individus réels, relève aussi de la construction de Soi par la relation à l’œuvre et à son auteur. Bettina, au demeurant, n’a pu se soustraire continûment aux déterminations sociales de la condition féminine: mère d’une famille nombreuse, elle ne publie de livres qu’après son veuvage en 1831. Elle entre en relation avec George Sand en 1845 mais la police intercepte leur correspondance. Bettina est sous surveillance, pour s’être engagée avec ardeur dans la question sociale, notamment par la publication en 1844 d’un livre-manifeste adressé au roi de Prusse et par des appels dans la presse à étudier le paupérisme.
41Cette représentation du peuple et de la misère prolétaire, qui pose en nouveaux termes la question sociale (Bettina a fréquenté le jeune Karl Marx en 1842) est fort éloignée de la conception du peuple élaborée par le premier romantisme. Dans les textes d’Arnim et Brentano publiés au début du siècle, le peuple est le référent suprême de la nation parce qu’il figure symboliquement le lien entre l’individu et le collectif et incarne la stabilité dans une société que menace la rupture. Et ce dans l’ordre politique et l’ordre culturel, indissolublement. L’importation de modèles étrangers en matière de construction de la culture nationale va de pair avec la volonté de promouvoir le terreau et les pousses proprement nationales, comme le souligne la métaphore du Jardin d’Hiver (1809) développée par Arnim: les plantes étrangères n’ont valeur que d’inspiration et d’incitation.
42Arnim, il faut le souligner, fut aussi parmi les premiers à formuler les éléments principaux d’un nouvel antisémitisme, celui de l’ère nationale. Il fonde en 1811 la patriotique et antisémite Société de la Table Ronde germanique, qui prône l’unification de l’Allemagne sous l’égide de la Prusse. Il publie au même moment un discours sur Les Signes caractéristiques des Juifs et la pièce Halle et Jérusalem qui s’attardent moins sur les vieux thèmes de l’antisémitisme religieux qu’ils n’énoncent avec une particulière virulence les moyens de «démasquer» les Juifs assimilés. Pour exclure le Juif de la nouvelle communauté que constitue la nation, religion et culture ne font pas argument: le rejet se trouve donc fondé sur une supposée corporéité spécifique des Juifs (odeurs, maladies héréditaires). Des contributions du volume présenté ici soulignent par ailleurs le rôle dévolu par Arnim – et la plupart des romantiques –, à l’Orient comme origine de toute religion et poésie, et le phantasme d’une réconciliation entre Orient et Occident, imagination et raison. Les Orientales sont pour Arnim messagères de la poésie primitive, voyantes et prophètes, images-reflets du poète romantique lui-même. De là sans doute l’ambiguïté de la belle Esther dans les Héritiers du Majorat, nouvelle fantastique de 1820: définie et élevée comme Juive, elle est en réalité fille du noble décédé, qui, pour assurer la continuité d’un majorat excluant le sexe féminin, lui a substitué un quelconque bâtard. Figure maternelle et sacrificielle, participant à d’étranges sabbats, elle ne permettra pas la réconciliation de l’Orient et l’Occident, puisque la nouvelle, par-delà sa mort, s’achève sur l’arrivée des troupes napoléoniennes, la fin du droit féodal et le triomphe malodorant de la marâtre juive d’Esther.
43L’importance des transferts culturels à l’époque romantique, la forte similitude des processus à l’œuvre dans la construction des cultures nationales, incitent à pousser plus avant l’investigation sur d’autres espaces littéraires. Les œuvres et trajectoires évoquées ici brièvement méritent assurément une exploration approfondie.
Anne-Marie Thiesse
Notes
-
[1]
Pour une présentation dense d’Arnim et de son entourage, ainsi que la traduction de quelques textes majeurs, voir Romantiques allemands, t. II, Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», 1973, 1744 p.