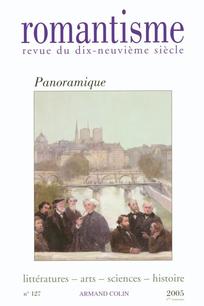J’en suis venu à me demander où est la question du réalisme. [1]
1Marcel Schwob ne cite jamais le nom d’Émile Zola dans la préface de Coeur double, qui est pourtant le grand texte théorique qu’il consacre à la question du naturalisme. Lorsqu’on sait que cette préface date de 1891, que Schwob y définit une troisième voie du roman, entre naturalisme et analyse psychologique, il faut bien admettre que l’omission de Zola ne peut être que délibérée. Zola, dont la notoriété est sûre et l’hégémonie sur le monde des lettres établie, a publié La Bête humaine en 1890 et L’Argent le 4 mars 1891, assez tièdement accueilli par la critique [2]. Huysmans lui répond par Là-bas, en feuilleton dans L’Écho de Paris à partir du 15 février 1891, avec les jugements polémiques que l’on sait. Toujours dans L’Écho de Paris en mars 1891 commence à paraître l’Enquête sur l’évolution littéraire de Jules Huret, que le journaliste envisage avant tout comme une enquête sur la querelle des «anciens» naturalistes et des «modernes», symbolistes ou psychologues. Or Marcel Schwob n’est pas interrogé par Jules Huret, peut-être parce qu’il ne s’est à l’époque signalé que par des études philologiques (sur Villon, l’argot, le jargon des Coquillards) qui semblent le placer en marge des débats littéraires contemporains. Pourtant la préface de Coeur double doit être considérée comme une forme de réponse, et il n’est pas impossible que la parution de cette enquête dans L’Écho de Paris ait déterminé Schwob à en reprendre la problématique centrale. On sait que Schwob dirigeait alors avec Catulle Mendès le supplément littéraire de ce même journal, et qu’au même moment il y fait paraître les contes qui composent Coeur double. Il y a donc bien, en ce début de l’année 1891 et autour de L’Écho de Paris, un débat qui se radicalise, dont Schwob ne pouvait rien ignorer, et auquel il prend part.
Dans la pensée de Marcel Schwob, le naturalisme est contesté, comme chez presque tous les symbolistes de l’époque, mais il est surtout contourné par la définition d’une esthétique véritablement réaliste, dont Schwob fait de Frantz Jourdain (architecte et ami de Zola, précieux collaborateur de l’architecture fictionnelle du magasin «Au Bonheur des Dames» et de la maison du Rêve, et écrivain oublié) l’inattendu représentant [3]. En somme, une confrontation est possible: l’écriture schwobienne, si souvent décrite par ses contemporains comme une somme érudite (Renard) voire ésotérique (France), un jeu fin et ironique (Gourmont), une élégante marqueterie (Léautaud), se caractérise par une forme de présence du savoir dans la fiction, et pose le problème de l’insertion, de l’ostentation ou de la dissimulation de ce savoir. Un dialogue s’instaure donc avec Zola et le naturalisme, à partir des mêmes enjeux: la place de l’érudition dans la fiction, l’utilisation du fameux «document humain », la nécessité de l’enquête de terrain, la fonction du détail.
Une critique épistémologique
2Dans la préface de Coeur double [4], Schwob recycle les préceptes d’Aristote sur la tragédie [5] et revient dans un premier temps sur l’utilité poétique et l’influence structurelle de la terreur et de la pitié dans la composition des grandes œuvres du théâtre antique. Ainsi dans les tragédies d’Eschyle, «l’âme devait être en quelque manière une harmonie, une chose symétrique et équilibrée. Il ne fallait pas la laisser en état de trouble; on cherchait à balancer la terreur par la pitié» [6]. L’analyse ne diffère pas, ici, des principes aristotéliciens, mais Schwob ajoute plus loin :
À de semblables effets une composition spéciale est nécessaire. Le drame implexe diffère systématiquement du drame complexe. La situation dramatique tout entière est dans l’exposition d’un état tragique, qui contient en puissance le dénouement. Cet état est exposé symétriquement, avec une mise en place rigoureuse et définie du sujet et de la forme. D’un côté ceci ; de l’autre cela. Il suffit de lire Eschyle avec quelque attention pour percevoir cette permanente symétrie qui est le principe de son art. [7]
4C’est dire que l’épuration des passions impliquait une structure telle que chaque moment de la représentation contienne en même temps tous les autres. C’est ce que Schwob appelle le drame implexe, tragédie « symétrique» où tous les moments se répondent et où les péripéties naissent de l’exploration de programmes narratifs contenus dans la crise initiale, par opposition au drame complexe, dont la construction semble moins rigoureuse [8]. Là où le drame implexe témoigne d’une recherche d’efficacité dramatique aux dépens du vraisemblable (« les personnages étaient vraiment de gigantesques marionnettes terrifiantes et pitoyables. On ne raisonnait pas sur la description des causes, mais on percevait l’intensité des effets» [9]), le drame complexe témoigne de l’apparition d’une volonté mimétique dans une représentation linéaire. Ainsi se met en place le système esthétique de Schwob, qui oppose symétrie et réalisme, et qui permet, par l’identification des prééminences successives de l’un ou l’autre principe, une interprétation binaire de l’histoire de la littérature, passée et présente:
Nous touchons aujourd’hui, après le romantisme et le naturalisme, à une nouvelle période de symétrie. L’Idée qui est fixe et immobile semble devoir se substituer de nouveau aux Formes Matérielles, qui sont changeantes et flexibles. [10]
6D’un côté (celui des formes), le réalisme est défini par la narration chronologique d’événements vraisemblables, c’est-à-dire liés par une causalité rationnelle, et la représentation d’éléments observables de la vie réelle. De l’autre (celui de l’idée), le classicisme symétrique fait passer au second plan cette préoccupation de vraisemblance, au nom d’une plus grande efficacité des effets ou d’une recherche de la perfection formelle de l’œuvre que Schwob appelle «Idée» [11]. L’esthétique réaliste se distingue donc de l’esthétique symétrique par la représentation d’événements liés par une loi de causalité, alors que la composition symétrique repose sur une juxtaposition dont la justification ne relève pas d’une mimesis pseudo-scientifique:
Alors la science du xixe siècle, qui devenait géante, se mit à envahir tout. L’art se fit biologique et psychologique. […] Il devait prendre une apparence d’érudition. Le xixe siècle est gouverné par la naissance de la chimie, de la médecine et de la psychologie, comme le xvie est mené par la renaissance de Rome et d’Athènes. Le désir d’entasser des faits singuliers et archéologiques y est remplacé par l’aspiration vers les méthodes de liaison et de généralisation. [12]
8On reconnaît aisément dans les deux formes de positivisme envisagées, le naturalisme et le roman d’analyse. Ces deux écoles, par ailleurs concurrentes, participent selon Schwob d’une même erreur épistémologique: croire que la littérature peut emprunter à la science ses raisonnements et ses découvertes. Cette «méthode de liaison et de généralisation» que critique Schwob renvoie naturellement à un certain nombre de textes théoriques de Zola dans lesquels il s’attache à fonder la scientificité du naturalisme:
[…] le romancier est fait d’un observateur et d’un expérimentateur. L’observateur chez lui donne les faits tels qu’il les a observés, pose le point de départ, établit le terrain solide sur lequel vont marcher les personnages et se développer les phénomènes. Puis l’expérimentateur paraît et institue l’expérience, je veux dire fait mouvoir les personnages dans une histoire particulière, pour y montrer que la succession des faits y sera telle que l’exige le déterminisme des phénomènes mis à l’étude [13].
10C’est à cette théorisation du roman expérimental que pense Marcel Schwob lorsqu’il remarque que la science «se mit à envahir tout». Depuis 1880, Émile Zola s’est institué le champion de ce rapprochement de la science et de la littérature, qu’il exprime souvent en formules frappantes et volontiers provocatrices: «le plus souvent, il me suffira de remplacer le mot médecin par le mot romancier pour rendre ma pensée claire et lui apporter la rigueur d’une vérité scientifique» [14], écrit-il à propos de L’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale [1865] de Claude Bernard. Il serait aisé d’objecter – d’autres ne s’en sont pas privés [15] – que l’expérimentation littéraire, fictive, diffère de l’expérimentation physique, par le simple fait que l’expérimentateur scientifique est toujours, avant tout, un observateur des résultats réels de sa propre expérience, et qu’en conséquence les opérations décrites par Zola se condamnent à rester des hypothèses fictives et invérifiables. Marcel Schwob, constatons-le, n’avance pas cet argument, peut-être parce qu’après tout ses propres intuitions sont parfois proches de celles de Zola [16].
11De même, Schwob n’a jamais été de ceux qui ont attaqué le naturalisme pour ses prétendues préoccupations ordurières. On trouve chez les deux théoriciens la même dénonciation des illusions romantiques et la même conviction qu’il est impossible de représenter une âme isolée du milieu dans lequel le personnage évolue: Zola parle d’action des sens sur l’esprit, Schwob de «suçoirs», et tous deux sont convaincus de l’importance des sensations dans la constitution du «moi». Cependant cette observation n’a pas chez les deux écrivains les mêmes conséquences littéraires. Zola insiste sur l’action des sens, au sens où l’immersion du «héros» de roman naturaliste dans un milieu se traduira nécessairement par une programmation narrative du personnage (déterminé par un milieu, un corps, une hérédité), qui devient une sorte de phénomène de laboratoire [17], ce qui est contraire aux convictions de Schwob, pour qui les interactions des sensations et de l’âme ne sont pas aussi réglementées que Zola le laisse penser [18]. Pour Schwob, les sensations peuvent se dérégler, la belle mécanique déterministe s’emballer, et Coeur double regroupe un certain nombre de nouvelles qui détournent les postulats zoliens, pour en arriver à la conclusion que l’homme est double, non pas comme Zola le concevait (âme et corps, habitant et habitat en interaction nécessaire), mais parce que les sensations physiologiques sont trompeuses, et que le corps peut trahir l’âme.
12En définitive, on pourrait dire que Schwob reproche au naturalisme de privilégier l’«esthétique du tableau de mœurs» au détriment de l’«esthétique de l’analyse individuelle» [19]. Il serait faux pourtant de rapprocher Schwob des Goncourt parce qu’il s’éloigne de Zola. La majeure partie de la préface de Coeur double est consacrée à la réfutation des erreurs épistémologiques conjointes du naturalisme et de ce que Schwob appelle le «roman analyste», désignant ainsi toute fiction qui prétend décrire minutieusement la psychologie complexe d’un personnage central, comme, par exemple, Chérie:
Ce roman de Chérie a été écrit avec les recherches que l’on met à la composition d’un livre d’histoire, et je crois pouvoir avancer qu’il est peu de livres sur la femme, sur l’intime féminilité de son être depuis l’enfance jusqu’à ses vingt ans, peu de livres fabriqués avec autant de causeries, de confidences, de confessions féminines […] [20].
14L’expérimentation de Goncourt, somme toute, est assez proche de celle de Zola: dans les deux cas, il s’agit de considérer des lois générales de comportement au regard desquelles les actions des personnages sont prévisibles et, par là même, vraisemblables. Dans les deux cas également il s’agit de crédibiliser la fiction par la collecte de «documents» (les notes prises sur le terrain, les ouvrages consultés, ou les lettres des lectrices) à partir desquels ces lois peuvent être statistiquement déduites. Dans un article intitulé «Le Réalisme» publié dans Le Phare de la Loire le 15 avril 1889, Marcel Schwob avait déjà renvoyé dos à dos les deux écoles après avoir fait allusion, pour la rejeter, à la distinction de Maupassant :
Entre les deux réalismes, il n’y a finalement qu’une différence de point de vue de l’auteur sur son projet, et non une différence méthodologique: il s’agit, comme le rappelle Philippe Hamon, soit de «peinture de la jeune fille moderne, de la jeunesse moderne (projet naturaliste)» soit de «peinture d’une jeune fille (projet “psychologique ”) » [22]. C’est précisément cette méthode déductive à visée généralisante, qui fait des personnages non plus des fictions singulières mais des types, que rejette Marcel Schwob: «L’art véritablement entendu semble au contraire se séparer de la science par son essence même». [23] Dès lors que l’écriture s’appuie sur un raisonnement illusoire de type: observation du réel (ou de documents)/construction fictionnelle d’un personnage/ position du personnage dans un milieu/déduction de modifications narratives à partir de récurrences observées dans la réalité et érigées en lois, la distinction entre la jeune fille et une jeune fille est non avenue pour Marcel Schwob. Car ce que peint le roman analyste, ce n’est pas, ce ne peut pas être, une jeune fille, mais une sorte de double de laboratoire de la jeune fille. On voit bien dès 1891 ce qui, dans cette double contestation esthétique et scientifique, mènera peu à peu Marcel Schwob au récit de l’absolue singularité d’une vie dans le genre biographique (cheminement qui, évidemment, suit les pas des Goncourt historiens), explicitement détourné de l’ancrage historique et appartenant de plein droit à la littérature fictionnelle [24].Maupassant avait clairement divisé les romans en subjectifs et objectifs dans la préface de Pierre et Jean. Ceci déplace le problème sans le résoudre. On est convenu d’appeler analyse psychologique la description des états de l’âme. Ceux qui en tiennent pour ce genre-là ne font pas moins de réalisme que les articles qui décrivent les choses. Ils cherchent les «documents humains» autant que les naturalistes. Paul Bourget se plaît dans la lecture du journal d’Amiel non moins que Zola en dépouillant des liasses de notes sur les mines d’Anzin. L’un aime le réalisme subjectif; l’autre le réalisme objectif. [21]
Marcel Schwob lecteur de Frantz Jourdain
15Dans ce même article de 1889 sur «Le Réalisme», Schwob avançait une autre solution esthétique pour sortir de l’aporie des projets naturaliste et psychologique:
Il y a entre ces deux formules place pour le vrai réalisme - celui qui n’a pas de prétentions scientifiques, qui ne cherche pas le lien des causes efficientes. Ce sera l’impressionnisme; il s’agira d’imiter la nature dans les formes que nous saisissons en elle. […] La composition factice est là pour remplacer le système d’organes qui préside à l’union des choses vivantes. L’art de composer les impressions remplace les causes finales qui imposent des formes aux parties de la nature. [25]
17Ce texte annonce évidemment, dans son insistance à substituer une «composition factice» à une représentation des rapports de cause à effet observables dans le monde réel, ce que Schwob définira deux ans plus tard comme le drame implexe-symétrique. Selon Schwob, l’impressionnisme aurait eu une éphémère existence, et un représentant: «Je trouve cet art de la composition chez un écrivain de l’école réaliste, M. Jourdain». Il est certain que la lecture schwobienne d’À la Côte [1889] de Frantz Jourdain est tributaire de ses conceptions esthétiques personnelles: il s’agit de montrer que l’artiste, à l’instar du biographe, «n’a pas à se préoccuper d’être vrai» [26], que la mimesis littéraire ne peut être que représentation d’une sensation, et non pas d’une observation prétendument scientifique. Implicitement, Schwob suppose (comme il l’expliquera plus tard dans un article de 1892 à propos de L’Écornifleur de Jules Renard [27]) que la perception du monde réel est naturellement discontinue et fragmentaire, et que ce n’est que par un effort a posteriori de rationalisation logique que l’esprit restitue l’illusoire continuité de son expérience du réel. Dès lors, le véritable artiste réaliste devient une sorte d’enregistreur de la perception, et doit s’efforcer d’en représenter l’initiale fragmentation: parataxe, «taches», «touches», aplats habilement répartis, narration fragmentée en tableaux elliptiques, recueils de textes courts, deviennent les équivalents de cette perception. Ainsi la formule «imiter la nature dans les formes que nous saisissons en elle» résume-t-elle une esthétique impressionniste, au sens que lui donne Brunetière lorsqu’il analyse les Rois en exil d’Alphonse Daudet: «Ouvrir les yeux d’abord et les habituer à voir la tache, habituer la main en même temps à rendre pour l’œil d’autrui ce premier aspect des choses […]»; «Chaque scène ainsi devient un tableau, qui s’arrange comme une toile suspendue sous les yeux du lecteur.» [28] Il y a là deux niveaux d’analyse, qui sont naturellement liés – l’un étant la conséquence poétique de l’autre – celui de l’énoncé et celui de l’énonciation: par delà la métaphore picturale traditionnelle, l’impressionnisme combine l’énoncé d’une perception fragmentaire et l’énonciation paratactique de cette perception, ce qui n’est qu’une autre manière de définir un art «symétrique». Schwob écrit d’ailleurs d’une nouvelle du recueil de Frantz Jourdain:
Dans «Les trois robes blanches », je note justement ce procédé de contraste symétrique qui introduit dans la succession de la vie une loi esthétique. La première robe, c’est la pelisse de baptême, le premier costume officiel de Mademoiselle Marcelle; la seconde, c’est la robe de première communion; «fillette d’hier, femme de demain», la petite Marcelle prendra sa volée dans sa troisième robe, dans le voile blanc de la mariée. [29]
19On comprend que cette nouvelle est composée de trois tableaux qui résument la vie du personnage en trois époques symétriques (par la blancheur de la robe) et juxtaposées. Les ellipses, les «silences du récits» [30] entre ces trois moments font de ce texte une sorte de condensé narratif, à l’opposé du roman de formation, à l’opposé du projet psychologique de Goncourt (pourtant, Marcelle est aussi bien Chérie, et la composition présente bien des points communs avec le morcellement de l’intrigue de Chérie en tableaux successifs, de même évidemment par l’omniprésente blancheur attachée au personnage central) puisque l’analyse ne prétend pas entrer finement dans le détail des sensations et des pensées qui naissent dans l’âme fictive du personnage. À l’opposé, aussi, du projet naturaliste qui prétend montrer le personnage dans un milieu (à propos d’une scène du Rouge et le Noir de Stendhal, dans laquelle Julien prend la main de Madame de Rénal, Zola apportait cette correction personnelle, qu’aussi bien il aurait pu proposer à Frantz Jourdain: «donnez l’épisode à un écrivain pour qui les milieux existent, et dans la défaite de cette femme, il fera entrer la nuit, avec ses odeurs, avec ses voix, avec ses voluptés molles» [31]). Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, jamais cette robe blanche ne prend valeur de symbole dans le récit de Jourdain; il n’y a pas de volonté de conférer au vêtement une signification supérieure et explicative qui résulterait de sa récurrence narrative, du type: cette robe signifie la pureté de Marcelle, ou les regrets des parents, ou même une enfance ennuyeuse, une médiocrité bourgeoise, etc. La robe n’est pas un signe, c’est un artifice poétique, qui restitue à l’ensemble une unité esthétique que la fragmentation impressionniste mettait en péril. Jourdain semble d’ailleurs avoir voulu donner aux trois parties du récit la fixité même des tableaux, du jour du baptême:
Depuis le matin, la maison est sens dessus dessous. […] Les joues roses, la respiration égale, la bouche entr’ouverte, la mignonne créature sommeille paisiblement, sans se douter qu’elle est l’héroïne de la journée et la cause de ce remue-ménage. La toilette de gala de Mademoiselle est prête. Soigneusement étendue sur les meubles, elle troue, de sa note claire, la teinte purée de pois de la chaise longue et des fauteuils. [32]
21au jour de la première communion:
Une matinée de mai, très fine, tout embuée d’un brouillard rose. Le bruit de la rue qui s’éveille monte jusqu’à la fenêtre de la fillette dont les yeux s’ouvrent lentement. Tout repose encore dans la maison. [33]
23et au jour du mariage:
Encore un serrement de main, c’est la fin. Le dernier invité a pris congé. La maison est vide. Dans la salle à manger, les domestiques desservent le buffet dressé pour le lunch. Dehors, la neige s’est mise à tomber et glace d’un reflet cru l’appartement, qui s’emplit d’ombre et de mélancolie. [34]
25Il s’agit là de décrire au présent, et de rapporter également les actions au présent, pour donner au lecteur l’illusion de stagnation de la narration, chaque moment étant ainsi présenté comme en une sorte de parenthèse chronologique, de temps suspendu, où les actes deviennent décoratifs. Ce procédé, combiné à la composition symétrique et elliptique du récit, définit l’impressionnisme de Frantz Jourdain, dont Schwob fait le véritable réalisme.
26Une analyse exactement similaire pourrait être menée à partir d’une autre nouvelle du recueil, que Schwob mentionne également dans son article, intitulée «Les bottes», qui retrace en quelques pages et en cinq tableaux la carrière militaire d’un certain Bullant, d’abord « lieutenant de mobiles» (rencontré dans la rue et à un bal), puis en 1870 caporal de la Garde Nationale (rencontré encore dans une rue), capitaine «d’enterreurs» à la capitulation (toujours entrevu dans une rue), enfin «décoré et commandant dans la territoriale» (entrevu en Normandie). Pour Schwob, les éternelles «bottes d’ordonnance» desquelles Bullant est toujours chaussé et sur lesquelles insiste à chaque rencontre le narrateur du récit sont l’équivalent de la robe blanche de Mademoiselle Marcelle: «Ainsi, un trait commun, la robe blanche, les bottes, a servi à M. Jourdain pour établir un contraste et une liaison entre les tableaux réalistes qui peignent les phases de la vie d’un être.» [35] On voit que Schwob ne s’intéresse qu’à la composition, à cette «liaison entre les tableaux» qui n’a pas de rapport avec la «méthode de liaison et de généralisation» naturaliste: l’une est de l’ordre du raisonnement causal dans un énoncé linéaire, chronologique; l’autre de l’ordre de la juxtaposition avec récurrence d’un «motif ». L’écriture impressionniste-symétrique est donc probablement fondée sur une remise en cause du fonctionnement chronologique et causal du récit – l’illusion du post hoc ergo propter hoc, qui concourt à produire dans le texte un « effet de vraisemblable», notamment «par la saisie et la compréhension, de la part du lecteur, de relations entre les séquences narratives qui se succèdent, et notamment des relations hiérarchiques […] de cause à effet (X est jaloux de Y, c’est pourquoi X nuit à Y) » [36] – au profit d’un «effet de cohérence» d’ordre formel et esthétique [37].
27On retrouverait aisément ces procédés dans les autres nouvelles du recueil, notamment dans le texte éponyme (dédié à Huysmans), «À la Côte», douze tableaux de l’itinéraire parisien d’une sorte de Rastignac naïf et laborieux, puis de plus en plus cynique, principal clerc qui se résout à épouser une vieille fille bossue pour sa fortune et qui, faisant l’expérience de la douceur d’un foyer, se rachète enfin par la douleur qu’il éprouve à la mort de sa femme. L’essentiel, là encore, réside dans la composition du récit, où l’on retrouve l’esthétique du tableau permettant d’inclure le personnage principal figé dans la «scène d’intérieur»:
Un silence sévère emplit la pièce qui fleure bon l’honnêteté, la loyauté, la droiture, les vertus intimes et civiles. Devant une longue table, fléchissant sous le poids des dossiers à chemises bleues qui s’entassent sur la basane fanée, quelqu’un est assis et écrit. C’est M. Le Bessac, le principal clerc de Me Planteau, titulaire, – rue du Helder, – d’une des plus importantes études de Paris. [38]
29Peut-être y aurait-il là, pour un auteur naturaliste, matière à développer l’idée d’une interaction entre l’habitat et le personnage, interaction naturellement suggérée par les qualités humaines prêtées à la pièce; ou encore matière à amplifier une opposition entre les «honnêtes gens» et les bohêmes, entre les Gras et les Maigres comme le fait Zola dans Le Ventre de Paris. Mais l’habitat ne prend jamais dans la suite du récit de Jourdain cette importance narrative, n’entre jamais dans une possible détermination du personnage. Ce ne sont pas d’éventuelles influences extérieures qui vont déterminer une évolution du clerc de notaire, mais l’expérience de la pitié – par laquelle, significativement, cette nouvelle se rapproche de la problématique des textes de Coeur double de Schwob. Et parallèlement à cette lente métamorphose, les personnages se découperont sur des fonds toujours changeants et toujours «peints» avec la même technique où l’on reconnaît la «patte» de Frantz Jourdain:
Assise près de la fenêtre, devant un petit secrétaire, Mlle Didron écrit. Sa maigre personne, dont la silhouette s’enlève en vigueur sur la tenture cramoisie des murs, forme une curieuse opposition avec le gros luxe joyeux de la chambre. Des paquets sur les meubles, des cartons par terre, des journaux déchirés à côté d’une pelote de ficelle, toute la débandade d’une installation provisoire et l’indice d’un prochain départ. [39]
31Le décor, dressé toujours à la manière d’indications théâtrales, a une signification mais, à la différence du décor naturaliste qui est une sorte d’actant collectif, aucune influence sur le personnage qui s’y trouve plongé. Le milieu n’a qu’une fonction décorative (souligner un trait de caractère, former une opposition qualitative), et lorsque la représentation quitte ces intérieurs confortables qui semblent les lieux privilégiés de la fiction chez Jourdain, la description conserve le caractère artificiel, le « carton-pâte» des décors de théâtre [40].
32Cette combinaison d’une saisie impressionniste de quelques «moments» de la vie des personnages, d’une syntaxe descriptive théâtrale, et de la récurrence esthétique d’un objet qui n’a pas forcément un caractère symbolique (qui n’a pas, en quelque sorte, de fonction analogique ou diégétique, mais qui n’est pas non plus un détail absolument gratuit en ce qu’il permet une unification esthétique du texte) ne pouvait que séduire Marcel Schwob et lui apparaître comme la manifestation exemplaire de ce véritable «réalisme» qu’il rêvait:
La mimesis véritable résidera donc dans un texte qui donne à lire un équivalent de cette discontinuité des signes perceptibles dans le monde réel (par juxtaposition, tableaux contigus, ellipses, condensation du récit sur la «représentation d’une crise», début in medias res, fragmentation des points de vue et des voix), en se méfiant des pièges du symbole, en restituant une unité aux fragments du texte ou du recueil par la récurrence de ces signes explicitement vidés de tout contenu analogique:Toutes choses ont entre elles des rapports. Quand nous saisissons leurs rapports de position, nous les classons suivant la cause et l’effet. Quand nous les concevons selon leurs relations de ressemblance et de grandeur, nous les classons suivant les idées logiques de notre esprit. Ces notions étant communes à tous les philosophes, il est fort à parier qu’elles ne suffisent pas à la vérité. On peut imaginer que les choses ont entre elles d’autres rapports que le rapport scientifique et le rapport logique. Elles peuvent se rapporter l’une à l’autre en tant qu’elles sont des signes. [41]
On sait que pour Schwob, «synthèse» est synonyme de «construction symétrique», et que son art, tout autant que celui de Frantz Jourdain, s’oppose à la prolifération énumérative par l’ellipse, l’allusion, la brièveté, toutes choses qui entraînent une composition qui pourrait sembler disparate si dans la nouvelle ne se dessinait un ensemble de corrélations discrètes entre motifs ou objets, ou couleurs, entre incipit et chute. En un sens, la nouvelle (de Jourdain ou de Schwob) impose une double lecture, linéaire puis oblique, et suppose chez le lecteur l’expérience simultanée de l’éparpillement et d’une supérieure unité [43]. Dans le texte naturaliste en revanche (cet extrait de la préface de Coeur double renferme la seule allusion évidente à l’œuvre de Zola) la syntaxe énumérative impose une lecture purement linéaire. En évoquant les «détails» qu’accumule le texte naturaliste, se condamnant ainsi à mimer un discours pédagogique et à ne conserver que «l’apparence de l’érudition» [44], à n’être, en d’autres termes, que mimesis sans mathesis, coquille descriptive vide de tout savoir, Schwob en revient à une contestation du naturalisme, sur un plan différent: non plus épistémologique, telle qu’elle s’exprime dans les préfaces (examen de la validité des postulats théoriques, de la rigueur des raisonnements, de la possibilité de l’expérimentation), mais poétique.Il est singulier que, dans le temps où on parle de synthèse, personne ne sache en faire. La synthèse ne consiste pas à rassembler les éléments d’une psychologie individuelle, ni à réunir les détails de description d’un chemin de fer, d’une mine, de la Bourse ou de l’Armée. Ainsi entendue, la synthèse est de l’énumération; et si des ressemblances que présentent les moments de la série l’auteur cherche à tirer une idée générale, c’est une banale abstraction, qu’il s’agisse de l’amour, des salons ou du ventre de Paris. La vie n’est pas dans le général, mais dans le particulier; l’art consiste à donner au particulier l’illusion du général. [42]
Poétiques du savoir
33Parce qu’ils sont le lieu d’un même enjeu – l’insertion d’un savoir, c’est-à-dire, bien souvent, d’une «fiche» érudite [45] – les textes de Schwob et Zola sont comparables. L’œuvre de Schwob a parfois été décrite comme un montage narratif auquel préexistent ces fameuses «fiches» caractéristiques de l’écriture réaliste:
Mon opinion depuis longtemps sur la littérature de Schwob. Au fond, très au fond, je n’y trouve aucun intérêt. C’est de la fabrication, de la marqueterie, et je sens comment c’est fait et avec quoi. De vastes lectures, dans tous les genres, – des phrases et des idées notées sur des fiches, – puis arrangement, combinaison de ces phrases et de ces idées classées par catégorie, en un tout quelconque. […] C’est truqué au possible. [46]
35À en croire Léautaud, il n’y aurait au fond pas de différence entre cette poétique de «marqueterie» intertextuelle et la poétique du «raboutage» [47] des savoirs du texte naturaliste, sinon que le savoir schwobien est puisé dans de «vastes lectures», nuance qui a son importance: si Zola est l’homme des enquêtes, Schwob est l’homme du savoir livresque, même si en définitive le savoir et le «document » se ramènent toujours à un texte à «placer» dans la fiction, et la poétique du savoir à une poétique intertextuelle. Schwob et Zola ne se préoccupent pas des mêmes champs du savoir, la mathesis ne suppose pas chez l’un et l’autre les mêmes compétences. Zola – les dossiers préparatoires le montrent – apporte une minutieuse attention à l’investigation préalable: la fictionalisation du réel est seconde par rapport à l’arpentage du réel, mais dans le même temps le détermine, puisque le découpage de ce réel en «tranches» arpentables et descriptibles s’appuie déjà sur l’anticipation fictionnelle (les plans de Zola prévoient «un roman judiciaire (Province)», «un roman qui aura pour cadre le monde ouvrier»). Rien de tel chez Marcel Schwob, d’abord parce que l’écriture ne manifeste pas un projet anthropologique méthodique, ensuite parce que c’est souvent une découverte surprenante qui va permettre une fictionalisation du document («document humain» contemporain ou, plus fréquemment, document historique). Là où Émile Zola anticipe un roman «à faire», Marcel Schwob semble soumis au hasard des trouvailles et des rencontres: son article sur «La psychologie du bonneteau», par exemple, ne participe pas d’un projet fictionnel préétabli de description méthodique du réel. Pourtant le texte, pour peu qu’il ait été assumé par un narrateur impersonnel, et non, comme le veut ici la tradition de la chronique, par l’auteur censé décrire une «chose vue», n’aurait pas été indigne de figurer dans un recueil naturaliste (dans le genre des Soirées de Médian, avec pour sujet les faubourgs, les barrières, l’argot) :
Derrière le pont de Caulaincourt s’ouvrent des terrains vagues bordés de masures; la ville est sauvage, les maisons disjointes et hâtivement plâtrées; parfois la route coupée de fondrières, court entre des cabanes; les cabarets sont des huttes de branchages, plaqués de terre sèche; il y a des assommoirs vitrés sur trois faces, où les carreaux crevés à coup de poing, sont partout bandés de papier. Le comptoir est vide, seule la loi Griffe s’étale sur le mur nu. [48]
37Ce texte semble une sorte d’exercice de style naturaliste, tant on y lit tout ce qui doit crédibiliser la description, la topographie réelle, l’organisation logique en plans progressivement resserrés, de l’extérieur vers l’intérieur, en propositions abondamment juxtaposées, comme chez Zola, les détails «inutiles» à effet de réel, jusqu’à la référence au texte affiché. Mais bien sûr, cette programmation crédibilisante n’est là que pour être immédiatement déçue: la transparence du texte naturaliste est déjouée là même où le texte semble le plus réaliste, c’est-à-dire lorsqu’il rapporte ou imite les paroles du joueur de bonneteau:
Le bonnet, c’est Fifrelin qui a jeté le nom de lingerie. Un beau centre, n’est-ce pas? Nous autres, c’est des linges, on tient de la bonneterie. C’est vrai qu’au fond, tout ça c’est du charriage, on bat contre tout le temps, quoi… Mais toi, t’es baron – moi je suis marquis, pas vrai? Ainsi moi, le teneur, supposons, je suis baron, je fais un chiqué, un beau; mais toi, l’autre baron, pourquoi que tu tâches à voir la carte?
39Les référents deviennent opaques, inaccessibles au lecteur dont l’attente était celle de la limpidité réaliste. Et lorsqu’on sait le ton facilement satirique des chroniques de Marcel Schwob, il n’est pas impossible de lire ce texte comme une sorte de parodie de «tranche de vie» naturaliste, ce que sous-entend l’inscription de l’«assommoir» au cœur de la description initiale. De fait, le genre de la chronique est peut-être chez Marcel Schwob le seul lieu d’une écriture réaliste, encore celle-ci est-elle souvent mise à distance, parodiée ou détournée (prétexte à un décalage fantastique [49]) ou complétée par une version fictionnelle de la même intrigue (c’est le cas du doublet «L’Exécution» /«Instantanées», chronique dans L’Événement du 5 février 1891 et nouvelle du recueil Coeur double).
40Par ailleurs, le savoir «ventilé» dans le texte schwobien n’est qu’exceptionnellement – sous contrainte, par exemple, du genre de la chronique – un savoir sur la réalité du monde contemporain, et ne prétend pas tant entretenir un rapport avec une réalité vérifiable (même si cette vérifiabilité n’est qu’une chimère) que renvoyer à une période historique ou à un corpus littéraire: l’équivalent pour Schwob de l’investigation naturaliste (observations du monde réel, entretiens avec des interlocuteurs compétents, «documents humains», lectures techniques) est l’enquête philologique. Entre les deux se dessinent d’évidentes analogies méthodologiques, à cette différence près que la première vise à informer la réalité, la seconde à rappeler l’histoire [50]. Le savoir dispensé dans le texte schwobien est avant tout historique et philologique, et beaucoup plus rarement un savoir scientifique, moderne. Bien plus, il semble exagéré de dire que ce savoir est dispensé: il n’y a pas chez Marcel Schwob de réelle volonté didactique ou encyclopédique, il n’y a pas de véritable mathesis, au sens étymologique, mais plutôt ce qu’Yves Vadé appelle une «couleur historique» [51]. La multiplication des points de vue, des lexiques spécialisés ou archaïsants, des voix énonciatrices, la juxtaposition des détails historiques, font du texte schwobien un «jeu kaléidoscopique» [52] dans lequel l’histoire acquiert une fonction esthétique qui exclut toute perspective globalisante, toute synthèse en forme de «tableau» d’une époque. C’est là évidemment ce qui rapproche les textes de Schwob des techniques impressionnistes décrites à propos de Frantz Jourdain: le savoir historique se manifeste chez Schwob essentiellement sous forme de détails, que le lecteur doit collationner, et qu’il est évidemment plus aisé d’insérer dans le texte fictionnel. En cela, Schwob échappe à la problématique du «raboutage» à laquelle l’écrivain naturaliste doit proposer une solution, puisque ce qui importe dans la marqueterie, ce n’est pas tant de rendre invisibles les juxtapositions que de les disposer en une harmonieuse géométrie.
41Le vrai – c’est-à-dire, la mathesis, l’impression que produit le texte de dispenser un savoir – est donc à la fois une question de détails et de composition. Comme le détail réaliste, le détail historico-linguistique schwobien est peut-être un «luxe», mais cette ostentation prend une signification un peu différente chez Marcel Schwob. À la question: «Tout, dans le récit, est-il signifiant, et sinon, s’il subsiste dans le syntagme narratif quelques plages insignifiantes, quelle est en définitive, si l’on peut dire, la signification de cette insignifiance?» [53], Roland Barthes répondait qu’à côté des détails dont la présence semble motivée par une importance narrative ou par une fonction esthétique (récurrence symbolique, symétrie, attribut constitutif d’un personnage) d’autres ne peuvent faire l’objet d’une justification dans l’économie du récit et prennent une signification en quelque sorte métanarrative: ils sont chargés de connoter « la catégorie du réel », ils «ne disent finalement rien d’autre que ceci : nous sommes le réel » [54] et deviennent le signifiant du réalisme. Il y a donc vraisemblablement une analyse similaire à mener concernant le détail «inutile» schwobien, et sa signification métalittéraire. Le terme technique serait alors chargé de signifier la «catégorie de l’histoire», le signifiant, dans son inhabituelle sonorité, devenant connotateur d’historicité du texte, éventuellement d’exotisme. Cette fonction sonore du mot est une différence majeure entre Schwob et Zola, et permet de comprendre pourquoi le lecteur a souvent l’impression, lisant un texte de Marcel Schwob, de lire un texte poétique.
Pour Schwob comme pour Zola, le savoir qu’il s’agit de «ventiler» dans le récit se présente sous forme de texte (la «fiche» raillée par Léautaud, les «minutes» de l’enquête naturaliste), ce qui implique que la question de l’insertion de ce savoir est toujours une question d’intertextualité. On pourrait résumer ce qui oppose les deux auteurs en avançant que la poétique schwobienne semble tournée vers un effort de légitimation extrafictionnelle de la présence du savoir (innovations génériques, déplacement du récit vers des lieux et/ou des époques bigarrés, fonction esthético-symétrique des détails érudits) qui se manifeste dans la fiction en une écriture de la disparate, alors que la poétique zolienne tend à légitimer cette présence par des artifices intrafictionnels (par l’entremise du personnage).
En définitive, la combinaison, dans l’écriture schwobienne, du refus de la linéarité du récit réaliste au profit d’une composition symétrique qui pourrait être considérée comme un exemple du «principe d’équivalence» par lequel Roman Jakobson définissait la fonction poétique du langage, et de la fragmentation de la fresque historique en allusions lexicales et sonores, autorise finalement à définir, bien souvent, le récit bref de Schwob comme un poème en prose où, comme le voulait Baudelaire, tout « est à la fois tête et queue, alternativement et réciproquement» [55].
Notes
-
[1]
Marcel Schwob, «Le Réalisme», article paru dans Le Phare de la Loire le 15 avril 1889 et repris dans les Œuvres, Belles Lettres, 2002, p. 829.
-
[2]
Par exemple dans Le Temps du 22 mars 1891, Anatole France parle d’un roman fastidieux et lourd qui « sent le procédé».
-
[3]
Les rapports entre Frantz Jourdain (1847-1935) et Émile Zola sont abordés dans l’article d’Atsuko Nakaï: «Frantz Jourdain médiateur entre architecture et littérature» (Les Cahiers naturalistes n° 74, 2000, p. 271-281). On y trouve également une brève approche de l’œuvre littéraire de Jourdain, et notamment du recueil de nouvelles Beaumignon [1886], qui montre combien il fut un artiste éclectique, non seulement architecte, ami et collaborateur de Zola, amateur d’art moderne, mais aussi écrivain. Il publia plusieurs ouvrages de fiction dont le plus connu est peut-être L’Atelier Chantorel [1893], roman dans lequel le héros, Gaston Dorsner, est une sorte de double fictif de l’auteur. Il est intéressant de noter que Frantz Jourdain collabora aussi parfois au Phare de la Loire, journal nantais dont le père de Marcel Schwob était propriétaire.
-
[4]
Cœur double, Gallimard, coll. «L’imaginaire», 1997, p. 12-13. On se réfèrera ici à cette édition, la publication des Œuvres de Marcel Schwob aux Belles Lettres ne reprenant cette préface que sous la forme légèrement modifiée du texte de Spicilège, «La terreur et la pitié».
-
[5]
La crainte et la pitié apparaissent dans la définition de la tragédie que donne Aristote dans la Poétique (1449 b): «c’est une imitation faite par des personnages en action et non par le moyen d’une narration, et qui par l’entremise de la pitié et de la crainte, accomplit la purgation des émotions de ce genre» (Poétique, LGF, 1990, trad. Michel Magnien, p. 110).
-
[6]
Cœur double, ouvr. cité, p. 14.
-
[7]
Ibid., p. 16.
-
[8]
On pourrait avancer que l’utilisation de ce couple d’adjectifs antonymes dans la théorie théâtrale, mène à l’opposition d’une forme dramatique fondée sur la symétrie et d’une forme dramatique fondée sur la linéarité de la représentation. Cette opposition se double implicitement d’une distinction entre clôture et ouverture, la tragédie eschyléenne représentant un idéal de circularité, antithèse de la prolifération picaresque (dont on peut proposer comme exemple Moll Flanders de Daniel de Foe, que Schwob traduisit en 1895).
-
[9]
Cœur double, ouvr. cité, p. 15.
-
[10]
Ibid.
-
[11]
Sur ce point les affirmations programmatiques de Schwob sont nombreuses et on verra qu’elles éloignent cette «Idée» de sa sœur mallarméenne-symboliste. Il y a là une question qui touche à la réflexion schwobienne sur le «particulier» et le «général», réflexion commencée dans cette préface de Cœur double («L’art consiste à donner au particulier l’illusion du général») et développée dans la préface des Vies imaginaires («L’art est à l’opposé des idées générales, ne décrit que l’individuel, ne désire que l’unique. I1 ne classe pas; il déclasse. Pour autant que cela nous occupe, nos idées générales peuvent être semblables à celles qui ont cours dans la planète Mars»). D’une préface à l’autre, Schwob semble avoir précisé son manifeste et exclu le «général» du champ de la représentation littéraire. Derrière cette mystérieuse «Idée» s’annonce déjà l’impressionnisme de Schwob, au sens où l’«Idée» est perception, regard porté sur le réel et qui le perçoit à la fois comme fragmenté et réunifiable en une juxtaposition de notations symétriques.
-
[12]
Cœur double, ouvr. cité, p. 20.
-
[13]
Émile Zola, Le Roman expérimental [1880], Œuvres complètes, Tchou, coll. «Cercle du livre précieux», 1968, vol. X, p. 1178.
-
[14]
Ibid., p. 1175.
-
[15]
Voir par exemple l’introduction de Michel Butor au Roman expérimental de Zola dans ce même volume.
-
[16]
Il suffit pour s’en convaincre de comparer aux célèbres lignes des Romanciers naturalistes, dans lesquelles Zola définit son «héros» comme «le sujet physiologique de notre science actuelle, un être qui est composé d’organes et qui trempe dans un milieu dont il est pénétré à chaque heure» (Les Romanciers naturalistes [1881], OC, vol. XI, p. 75), un passage de la préface de Cœur double: «La vie humaine est d’abord intéressante pour elle-même; mais, si l’artiste ne veut pas représenter une abstraction, il faut qu’il la place dans son milieu. L’organisme conscient a des racines personnelles profondes; mais la société a développé en lui tant de fonctions hétérogènes qu’on ne saurait trancher ces milliers de suçoirs par où il se nourrit sans le faire mourir» (ouvr. cité, p. 11).
-
[17]
On lit ainsi dans Le Roman expérimental : «Nous estimons que l’homme ne peut être séparé de son milieu, qu’il est complété par son vêtement, par sa maison, par sa ville, par sa province; et, dès lors, nous ne noterons pas un seul phénomène de son cerveau ou de son cœur, sans en chercher les causes ou le contrecoup dans le milieu. […] Le personnage n’y est plus [dans les lettres modernes] une abstraction psychologique, voilà ce que tout le monde peut voir. Le personnage y est devenu un produit de l’air et du sol, comme la plante; c’est la conception scientifique» (ouvr. cité, p. 1301-1302).
-
[18]
Même si Zola précise que ces différentes déterminations peuvent se combattre ou s’équilibrer, voire être «corrigées» par l’éducation.
-
[19]
Cette distinction est empruntée à l’article de Philippe Hamon, «Autour de Chérie », dans les actes du colloque Les frères Goncourt: art et écriture, Presses universitaires de Bordeaux, 1997, p. 279.
-
[20]
Edmond de Goncourt, Chérie [1884]/édition établie et annotée par Jean-Louis Cabanès et Philippe Hamon, La Chasse au Snark, «collection de la Société des études romantiques», 2002, p. 39-41.
-
[21]
Article repris dans la section «Critique littéraire» des Œuvres de Marcel Schwob, ouvr. cité, p. 829. On voit que deux ans avant Cœur double, Schwob n’hésitait pas à nommer Zola, Maupassant, Bourget, et à réutiliser le lexique développé par les Goncourt, repris par Zola; Schwob parlait alors couramment le langage naturaliste. La réflexion de Cœur double, en comparaison, semble beaucoup plus abstraite et parfois obscurément philosophique. N’était-ce alors que pour faciliter la compréhension des lecteurs du Phare? Cela n’explique pas l’obstination dans le gommage des noms par la suite.
-
[22]
Philippe Hamon, art. cité, p. 280, n. 15.
-
[23]
Cœur double, ouvr. cité, p. 21.
-
[24]
Ce seront les Vies imaginaires, en 1896, précédées en préface de cette affirmation programmatique: «L’art est à l’opposé des idées générales, ne décrit que l’individuel, ne désire que l’unique. Il ne classe pas; il déclasse. Pour autant que cela nous occupe, nos idées générales peuvent être semblables à celles qui ont cours dans la planète Mars […]» (préface reprise dans Spicilège sous le titre «L’art de la biographie», Œuvres, ouvr. cité, p. 629).
-
[25]
«Le Réalisme», Œuvres, ouvr. cité, p. 830.
-
[26]
Vies imaginaires, ouvr. cité, p. 633.
-
[27]
Article repris dans Spicilège, Œuvres, ouvr. cité, p. 617-620.
-
[28]
Ferdinand Brunetière, Le Roman naturaliste, Calmann-Lévy, 1895 (chap. «L’impressionnisme dans le roman», p. 84 et 89).
-
[29]
«Le Réalisme», ouvr. cité, p. 830.
-
[30]
Cette expression est employée dans un article de Marcel Schwob sur Robert-Louis Stevenson repris dans Spicilège, Œuvres, ouvr. cité, p. 580.
-
[31]
Émile Zola, Les Romanciers naturalistes, ouvr. cité, p. 76.
-
[32]
Frantz Jourdain, À la Côte [1889], Librairie Moderne, 1889, p. 145-146.
-
[33]
Ibid., p. 149-150.
-
[34]
Ibid., p. 154.
-
[35]
«Le Réalisme», ouvr. cité, p. 830. Il faudrait cependant nuancer ce jugement et distinguer la fonction de l’objet récurrent dans les deux nouvelles: s’il est évident que les bottes de Bullant conservent cette utilité unificatrice qu’ont déjà les successives robes de Mademoiselle, il est possible que ces bottes acquièrent une certaine valeur symbolique, du fait à la fois de leur permanence et du ton parfois ironique du narrateur, qui suggère peut-être que le personnage est réductible à son apparence (en témoignerait sa conduite peu héroïque pendant la guerre de 1870, du moins le texte le suggère-t-il) et, in fine, à la qualité de ses bottes. En un sens, cette nouvelle mériterait plus ample analyse, pour en montrer l’ironie et les éventuels points communs avec les textes des Soirées de Médian, centrés sur la représentation de ce même événement historique.
-
[36]
Philippe Hamon, Le Personnel du roman, Genève, Droz, 1998, p. 14.
-
[37]
Schwob conclut ainsi son article sur le réalisme et Frantz Jourdain : « J’entends par la forme une liaison, une synthèse, une construction symétrique par laquelle l’art cherche à représenter l’idée de la nature».
-
[38]
Frantz Jourdain, À la Côte, ouvr. cité, p. 14-15.
-
[39]
Ibid., p. 61.
-
[40]
Un exemple, pour s’en convaincre, tiré toujours de la nouvelle «À la Côte»: «Tout dort dans la campagne. Au loin, onze heures sonnent à une horloge de village, lentement, et les vibrations de la cloche jettent une inconsciente mélancolie dans l’imposant silence de la nuit. Un chien hurle à la lune avec une agaçante et impressionnante persistance. Sur la route où s’allonge l’ombre grimaçante des arbres dénudés, la voiture roule, emportée par le trot de deux solides chevaux. […] Un village. Sur le pavé, les roues font un bruit de tonnerre qui vient mourir contre les volets clos des maisons basses engourdies dans le sommeil.» (p. 100-101) Naturellement, il est possible que cette tendance décorative du texte descriptif chez Frantz Jourdain naisse de ses préoccupations architecturales: Jourdain écrit comme un décorateur d’intérieur, un décorateur de théâtre.
-
[41]
Marcel Schwob, préface au Démon de l’absurde de Rachilde, Œuvres, ouvr. cité, p. 666.
-
[42]
Cœur double, ouvr. cité, p. 20.
-
[43]
Expérience qui, on l’a déjà noté, est censée reproduire celle de l’observation du monde réel, d’abord perçu comme discontinu puis réunifié par un effort de la raison. Pour Schwob, toute écriture qui s’attache à restituer cette fragmentation initiale peut être dite impressionniste, en même temps que réaliste, puisqu’il y a bien mimesis de la perception du réel.
-
[44]
Cœur double, ouvr. cité, p. 20.
-
[45]
Les rapports problématiques entre trame narrative et «fiche» à insérer dans la fiction ont été analysés par Philippe Hamon, notamment dans son article «Un discours contraint» (Littérature et réalité, Seuil, 1982), où il affirme: «C’est donc le savoir, la fiche d’information, qui bien souvent préexiste dans les ébauches du romancier à tout montage narratif (et cette habitude de composition, d’écriture, est aussi une marque du discours réaliste), qui crée le personnage romanesque; ce dernier n’est donc plus que la justification, le truchement a posteriori de ce savoir, le garant vraisemblable d’une tranche lexicale technique à placer.» (p. 141) Il est d’ailleurs possible que ce soit précisément cette instrumentalisation du personnage réaliste que vise Marcel Schwob lorsqu’il évoque «l’apparence de l’érudition», c’est-à-dire l’insertion dans le texte de connaissances qu’il importe d’exhiber ostensiblement, sans réelle justification narrative. En un sens, c’est l’ensemble du savoir réaliste qui devient un luxe du récit, tout comme certains détails à un degré inférieur deviennent un luxe de la description.
-
[46]
Paul Léautaud, Journal littéraire, Mercure de France, 1956, vol. 1 (1893-1906), p. 74.
-
[47]
Philippe Hamon, «Un discours contraint», loc. cit., p. 177, n. 36.
-
[48]
Marcel Schwob, Œuvres, ouvr. cité, p. 1065.
-
[49]
Ainsi par exemple l’«Essai sur le parapluie», Œuvres, p. 1035.
-
[50]
Le modèle de cette mathesis philologique est évidemment représenté par les textes dans lesquels Schwob remonte la généalogie de la fiction jusqu’à exposer non seulement les sources, mais aussi les successifs avatars et les variations anthropologiques d’un unique récit mythique, hagiographique, médiéval. Il s’agit essentiellement de «Plangôn et Bacchis», préface à La Chaîne d’or de Théophile Gautier, et de «Saint Julien l’Hospitalier», préface à la Légende éponyme de Gustave Flaubert, contenues dans les Œuvres (ouvr. cité, p. 590 et 598).
-
[51]
Yves Vadé, «L’Histoire en miettes» (Marcel Schwob d’hier et d’aujourd’hui: actes du colloque Marcel Schwob de l’Université Bordeaux III, 19-20 novembre 1998, Champ Vallon, 2002, p. 230).
-
[52]
Ibis., p. 231. L’expression est une sorte de synonyme de la «marqueterie» de Léautaud. Yves Vadé montre bien que la raison de cette écriture fragmentaire pourrait être le scepticisme de Marcel Schwob, qui ne semble pas croire à un véritable progrès des civilisations, à un «sens» de l’histoire. La Croisade des enfants est évidemment le modèle de cette fragmentation, de cette «parcellarisation de l’histoire».
-
[53]
Roland Barthes, «L’effet de réel», repris dans Littérature et réalité (ouvr. cité, p. 83).
-
[54]
Ibis., p. 89.
-
[55]
Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose (Le Spleen de Paris), Gallimard, coll. «NRF Poésie», 1973, «À Arsène Houssaye», p. 21.