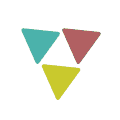1Un livre publié en 1858 par la romancière Virginie Ancelot s’intitulait mélancoliquement Les salons de Paris. Foyers éteints [1] ; pourtant, sous le Second Empire la tradition de salons parisiens était encore bien vivante. Nés aux débuts du XVIIe siècle et ayant survécu à la chute de l’Ancien Régime, à la tempête révolutionnaire et à la centralisation de la vie mondaine autour de la Cour sous le Premier Empire, les salons reprirent toute leur importance dans la vie politique, artistique et culturelle à la Restauration. Ils connurent leur âge d’or sous la Monarchie de Juillet, quand tous ceux qui avaient quelques ambitions, voulaient se faire connaître ou simplement se tenir au courant de ce qui se passait, fréquentaient les salons les plus connus de la capitale : celui de madame Récamier et ceux de Cristina di Belgiojoso et de la princesse de Lieven, de la comtesse Merlin et de Delphine de Girardin, de la comtesse de Circourt et de la comtesse de Boigne [2]. Quand éclata la Révolution de Février 1848, plusieurs des ses principaux protagonistes étaient des fidèles du salon de Marie d’Agoult, salon qui devint le véritable quartier général du mouvement.
2Élu présidente de la République le 10 décembre 1848, Louis Napoléon Bonaparte ouvrit immédiatement les salons de l’Élysée, et donna des réceptions brillantes qui avaient les honneurs de sa cousine Mathilde, fille de Jérôme, le dernier frère survivant de l’Empereur [3]. Mathilde vivait à Paris depuis quelques années ; née en 1820 à Trieste, où s’étaient installés après la chute de l’Empire ses parents Jérôme Bonaparte et Catherine de Wurtemberg, elle avait passé sa jeunesse en Italie, entre Rome et Florence. En 1835, après la mort de sa mère et un court séjour à la Cour du Wurtemberg, elle fut promise à son cousin Louis Napoléon ; toutefois, elle fut contrainte d’abandonner le projet de mariage quand son fiancé, ayant vainement tenté de soulever la garnison de Strasbourg au nom de la tradition napoléonienne, dut partir en exil. Revenue à Florence avec son père, la jeune princesse se retrouva « maîtresse de maison » ; Jérôme (tout en faisant face à de gros soucis financiers) aimait la vie fastueuse et recevait chaque soir : « Tous les étrangers qui passaient par Florence – rappelle Mathilde dans ses souvenirs – se faisaient présenter chez nous [4]. » Elle faisait ses premières armes de salonnière : « Je me suis toujours extrêmement appliquée à me faire aussi aimable que possible. J’avais un usage du monde qui me donnait beaucoup d’aplomb ; j’accueillais chacun avec une égale politesse ; je m’occupais des personnes âgées sans montrer d’ennui et même sans en ressentir [5]. »
3À la fin de 1840, elle fut mariée au comte Anatolij Demidov, un Russe très riche, propriétaire de mines et de fonderies ; son mari la conduisit immédiatement en Russie, où elle fut très bien accueillie par le tsar Nicolas Ier, cousin de sa mère. En août 1841, ils arrivèrent finalement à Paris, objet de tous les rêves de Mathilde « depuis que j’avais le sentiment de moi-même » [6]. Quelques temps après, les époux revinrent à Florence, mais le mariage n’était pas heureux : Anatolij battait sa femme et la trahissait ouvertement. Mathilde, avec l’appui du Tsar, réussit à se séparer de son mari qui fut contraint de lui verser une rente annuelle de 200 000 francs. Au printemps de 1846, la princesse s’établit à Paris ; elle fut chaleureusement accueillie par la famille royale des Orléans, fréquenta la maison de son oncle Paul de Wurtemberg, et commença à recevoir chez elle Adolphe Thiers (qu’elle avait connu à Florence en 1837) et quelques artistes et hommes de lettres qui lui avaient été présentés par son amant, le sculpteur Émilien de Nieuwerkerke.
4Mathilde n’apprécia nullement la Révolution de Février 1848 et la chute de Louis-Philippe ; elle était sceptique sur la possibilité d’un retour des Bonaparte au pouvoir, même si son frère Napoléon Jérôme et plusieurs de ses cousins s’étaient fait élire à l’Assemblée Constituante. Quand Louis Napoléon (qui était encore célibataire) fut élu président, Mathilde accepta, toutefois, de l’aider à recevoir ses hôtes. En outre elle donna, dans sa demeure de la rue de Courcelles, des fêtes en l’honneur du président et lui fit connaître des hommes politiques influents, ainsi que des artistes, des journalistes et des écrivains.
5À la fin de 1850, Julie Bonaparte, une jeune cousine de Mathilde, vint s’installer pour quelque temps à Paris ; née à Rome en 1830, elle était la fille aînée du prince de Canino, Charles Lucien fils de Lucien, et de Zénaïde, fille de Joseph Bonaparte. Julie aussi avait grandi en Italie, entre Rome et Florence, mais dans un milieu beaucoup plus simple, plus familial et, en même temps, plus intellectuel que celui de Mathilde ; son père, un zoologue bien connu, professait ouvertement des idées républicaines, et avait suivi avec soin l’éducation de ses enfants. Julie s’était mariée en 1847 à un noble romain, Alessandro del Gallo di Roccagiovine ; son mari était le fils du marquis Luigi, un homo novus de grande culture et intelligence, qui avait bâti la fortune de sa famille pendant les guerres de l’Empire [7]. Les deux époux allèrent en voyage de noces d’abord à Paris, où Julie revit sa cousine Mathilde, et ensuite à Londres, où elle connut finalement Louis Napoléon, échappé depuis peu du fort d’Ham. Revenue à Rome, Julie suivit de près la brève et glorieuse aventure de la République romaine de 1849, son père ayant été élu député et puis nommé vice-président de l’Assemblea Costituente. À la chute de la République romaine, Charles Lucien dut partir en exil et, quelque temps après, obtint de son cousin président la permission de s’établir à Paris, à condition de ne plus s’occuper de politique. Sa femme Zénaïde refusa de le suivre et lui envoya à sa place Julie, accompagnée de son mari.
6Julie fut reçue à l’Élysée par le Président, et accueillie avec beaucoup d’amitié par Mathilde, qui l’invita presque tous les jours et lui présenta ses amis. Julie, elle aussi, joua le rôle de « maîtresse de maison » dans le salon de son père, au 107, rue de Lille. Horace de Viel-Castel la décrivit « gentille, très-vive et très-coquette, c’est un jeune écuyer qui brûle de revêtir ses premières armes », mais ajouta avec malignité que Julie lui paraissait avoir déjà « toute la rouerie d’une bonne petite adresse féminine » [8]. Chez elle (elle resta à Paris jusqu’en novembre 1851) se rendaient Louis Napoléon, le vice-président de la République Boulay de la Meurthe, plusieurs ministres, des savants amis du prince de Canino, des exilés italiens, Victor Hugo, Alexandre Dumas et Napoléon Jérôme. Certains de ces personnages ne s’aimaient pas du tout, mais quand on en fit la remarque à Charles Lucien, il répondit que « son salon était un terrain neutre où il voulait avoir toutes les célébrités, sans regarder leurs opinions » [9].
7Mathilde avait en quelque sorte pris Julie sous son aile. Dans la dernière période de la République, le salon de Mathilde rue de Courcelles (au n° 24, dans l’hôtel qui avait été celui de la reine Christine d’Espagne et que le président lui avait donné) était le plus brillant du monde officiel. Fêtes, bals et soirées plus intimes s’y succédaient. Elle avait également loué (puis acheté) un petit château à Saint-Gratien, proche de Paris, où elle passait le printemps et l’été. Mathilde avait une personnalité forte et décidée, parfois autoritaire. Elle était capable d’une grande générosité, et avait une totale liberté d’esprit ; Viel-Castel, qui la fréquentait beaucoup, la jugeait vive et bonne, d’« un caractère franc et loyal » [10], mais incapable de bien juger les gens qui allaient chez elle. Il l’accusait aussi de n’accorder aucune importance à l’aristocratie et aux traditions familiales, sauf pour ce qui concernait les Bonaparte et Napoléon, « ce grand homme, cette grande gloire, dont il n’est pas permis de discuter les actes, chez lequel nul n’a le droit de découvrir une tache. C’est le fétichisme le plus complet qui se puisse imaginer » [11].
8On a dit que Mathilde avait vendu ses bijoux pour financier le coup d’État ; elle aida certainement son cousin, mais elle n’aurait jamais pu lui fournir les importants capitaux dont il avait besoin (et qu’il reçut par ailleurs). Quoi qu’il en soit, elle fut très proche de Louis Napoléon les jours qui précédèrent le 2 décembre 1851 : le soir du 1er décembre, en rentrant de l’Élysée, elle put raconter au député Achille Jubinal que son cousin se maintenait « héroïquement calme » [12].
9Jusqu’à la proclamation de l’Empire en décembre 1852, Mathilde fut la « première dame » de la République, présidant les dîners et les bals de l’Élysée. Son rôle se trouva forcement changé après le mariage, en janvier 1853, de Napoléon III avec Eugénie de Palafox, comtesse de Teba. Mathilde se limita alors à tenir son rôle de princesse impériale en participant aux cérémonies et en fréquentant les Tuileries, mais elle voulut aussi se créer une société à elle, et – passionnée de peinture et peintre dilettante elle-même – recevoir à son gré ses amis et les gens de lettres et les artistes. En outre, elle n’aimait guère l’étiquette compliquée qui régnait à la Cour de son cousin (même s’il s’agissait d’une « copie réduite » de celle en vigueur à la Cour de Napoléon Ier) [13], et ne supportait pas l’ennui des réceptions officielles [14].
10Dès les premières années du Second Empire, les salons devinrent l’endroit où pouvaient se rencontrer les élites exclues de la vie politique par le régime impérial (on parlait alors d’une opposition de salon) : il y avait les salons orléanistes et légitimistes (de la comtesse d’Haussonville, de la duchesse de Galliera, de Louise de La Redorte), les salons de l’opposition libérale et républicaine (de Marie d’Agoult, des Bertin), les salons des académiciens et des savants (de madame Ancelot, de madame Mohl née Mary Clarke). Les ministres, les présidents du Sénat et du Corps législatif, les hauts fonctionnaires de l’Empire recevaient aussi, avec faste et élégance, mais sans réussir à former des véritables centres d’attraction [15].
11De retour d’Italie au cours de l’année 1855, Julie trouva sa place au sein de la constellation des salons parisiens. Sa mère Zénaïde était morte au mois d’août 1854, et son père avait insisté pour que ses enfants viennent s’établir définitivement à Paris. Julie s’installa donc, avec son mari, ses cinq enfants et ses sœurs au 142 rue de Grenelle, à l’hôtel Montholon qui leur avait été assigné par l’empereur. Elle continua à aller chez son père, qui recevait surtout des savants : Charles Lucien, en effet, ne s’était pas rallié au coup d’État comme l’avaient fait presque tous les Bonaparte, et était donc très mal vu par la société impériale (en particulier par l’Impératrice, qui ne lui pardonnait pas son opposition au Pape).
12Peu à peu, Julie réussit à attirer chez elle, outre des amis de son père et de sa cousine Mathilde, des ministres (Abbatucci, Fould), des diplomates, des hauts fonctionnaires (comme Boittelle, le préfet de police, ou Barthe, sénateur et président de la Cour des Comptes) ; elle noua une amitié très tendre – mais qu’on a tous les motifs de croire platonique – avec Adolphe Billault, ministre de l’Intérieur et très proche de l’Empereur. Au même temps, elle se lia avec Adolphe Thiers, qu’elle avait connu en 1847 chez Mathilde et qu’elle avait revu dans le salon de Louise de La Redorte (sa cousine par les Clary). Thiers était alors le personnage le plus remarquable de l’opposition à Napoléon III, et sa présence dans le salon d’une cousine de l’Empereur était considérée avec quelque perplexité, tant par ses amis que par la Cour [16].
13L’amitié de Julie avec Billault (qui avait 25 ans de plus qu’elle) naquit au moment où la jeune femme perdit son père (il mourut le 29 juillet 1857). Le ministre, qui lui voua une « profonde affection » [17], devint le « grand homme » de son salon : il venait lui apporter les dernières nouvelles politiques, il y conduisait ses connaissances et appuyait les requêtes de ses protégés. Julie continua à soutenir fidèlement son ami même quand, après l’attentat de Felice Orsini en janvier 1858, Billault dut donner sa démission (pour revenir au ministère de l’Intérieur en novembre 1859).
14Julie – avec quelque coquetterie – lui exprimait parfois la sensation de ne pas être à son niveau : « Vraiment on croirait difficilement que vous avez la patience de causer avec moi, de m’écrire et surtout de me lire [18]. » Billault toutefois l’avait en grande estime, et il aimait parler de l’« intelligence élevée », du « caractère si loyal », du « cœur si aimant » et du « bon sens si tolérant pour les autres et parfois si sévère pour vous » de Julie [19]. Il la suivait dans ses lectures (et la dissuadait de lire les romans de George Sand, que Julie aimait beaucoup), la conseillait dans ses relations avec les personnages officiels.
15Le rapport avec Adolphe Thiers était plus intellectuel : avec lui, Julie allait voir les expositions et les musées ; elle écoutait avec un grand intérêt les longs discours que Thiers aimait tenir sur les sujets les plus variés. Ils se rencontraient également chez Malvina d’Albuféra, grande amie de Julie et qui fut longtemps, jusqu’à sa mort en 1877, la « dame de cœur » de Thiers : Émile Ollivier, qui recueillit les confidences de Julie, nous décrit ainsi leurs soirées : « On le cajolait, on lui offrait du chocolat, il lisait des Fables de la Fontaine ou tout autre chef-d’œuvre de notre littérature; on causait de tout excepté de politique; il ne songeait qu’à reposer et rafraîchir son esprit [20]. »
16Julie aimait la compagnie des hommes âgés, ses « vecchioni », comme elle l’écrivait à son mari [21], mais à ses jeudis matins ou à ses vendredis soirs il y avait foule : des hommes politiques, des étrangers (dont le duc de Parme), des militaires, des hommes de lettres, des ecclésiastiques, des savants. Il n’était pas toujours aisé pour elle de conduire la conversation, entre des gens si différents : au temps de l’affaire Mortara (quand un enfant juif baptisé par sa bonne fut enlevé à sa famille par le gouvernement romain) il y eut dans son salon une grande discussion entre le nonce apostolique, l’abbé Laine chapelain de l’Empereur et le préfet de police Boittelle. L’opinion de Julie était qu’il s’agissait d’« une sotte affaire dans laquelle le gouvernement pontifical s’est maladroitement fourvoyé » [22]. Toute en étant croyante, elle avait en religion des idées assez ouvertes ; elle entra en correspondance avec Lacordaire, qui était alors retiré à Sorèze, et qui lui écrivait en la rassurant sur son orthodoxie : « Je n’ai rien trouvé non plus en vous de “protestant”. Vous êtes née à la lumière de Rome, au pied de Saint-Pierre, et les subtiles diminutions du protestantisme ne vous ont point atteinte [23]. »
17Ses relations avec Mathilde, qui n’aimait pas avoir une salonnière rivale dans sa famille, se firent tendues, même si les deux cousines se fréquentaient souvent ; Julie avec Billault l’appelait la « haute et puissante dame » [24], et Mathilde disait de Julie qu’elle était fausse et aimait seulement « di fare dello spirito » (faire de l’esprit) [25]. Elles avaient plusieurs habitués en commun, qui passaient d’un salon à l’autre essayant de ne pas irriter les deux dames (surtout Mathilde).
18Julie, comme sa cousine, vivait assez éloignée de la Cour, s’y rendant seulement à l’occasion des cérémonies officielles ou des dîners de famille. Toutes les deux furent invitées aux fameuses séries de Fontainebleau ou de Compiègne, mais elles ne s’y trouvèrent pas à leur aise. Mathilde n’aimait pas du tout l’Impératrice et en disait beaucoup de mal, Julie trouvait la société impériale frivole, et elle était froissée du peu d’attention qu’Eugénie accordait à elle-même et à ses sœurs. Julie n’avait pas avec l’Empereur la même familiarité que sa cousine : Mathilde tout enfant avait joué avec Louis Napoléon « comme s’il eût été de notre âge » [26], elle avait été brièvement fiancée avec lui, et disait sans façon à Julie : « L’Empereur est ennuyeux mais il est très honnête homme, et il a du cœur [27]. » Tout en lui portant beaucoup d’affection et une grande estime, Julie était plutôt intimidée par le souverain.
19Les deux princesses avaient des situations différentes : Mathilde appartenait à la famille impériale, jouissait d’une subvention annuelle de 200 000 francs (qui devinrent 500 000 en 1860, après la mort du roi Jérôme) et bénéficiait d’un véritable service d’honneur, avec un secrétaire des commandements, trois dames « pour accompagner », un chevalier d’honneur et une lectrice. Liée par sa mère aux familles royales européennes, elle était tenue de recevoir chez elle les princes étrangers et de donner de temps en temps des réceptions pour l’Empereur et l’Impératrice. Julie, pour sa part, appartenait à la « famille civile » de l’Empereur, avait une subvention annuelle de 20 000 francs (plus 20 000 pour indemnité de logement) [28], et avait un train de vie beaucoup plus simple.
20Leurs images publiques aussi différaient : Mathilde, séparée de Demidov, affichait sans trop de problèmes sa relation avec Nieuwerkerke et accueillait des amis artistes et quelque peu bohèmes, acceptant qu’ils s’expriment chez elle librement et sans contraintes. Julie au contraire faisait bon ménage avec son mari, s’occupait de ses enfants et tenait fermement au respect des bienséances chez elle. Elles considéraient d’une façon dissemblable la tradition napoléonienne : si pour Mathilde Napoléon Ier et la gloire de la famille étaient incontournables, pour Julie (petite-fille de Lucien, le frère républicain et rebelle de l’Empereur), « cette espèce de fétichisme » que l’on avait pour Napoléon Ier « ne pouvait pas durer. Je l’admire bien pourtant, mais je ne suis pas à son égard aussi absolue que le reste de ma famille [29]. »
21Malgré leur rivalité, les deux cousines n’avaient pas seulement des amis en commun, mais aussi les mêmes idées sur plusieurs sujets, en particulier sur l’unité et l’indépendance de l’Italie, où toutes les deux avaient passé leur enfance et leur jeunesse. Mathilde aimait l’Italie, parce que sa famille proscrite y avait trouvé un refuge : « J’avais vu de mes yeux l’abaissement de cette belle contrée, son humiliation sous le joug étranger », écrivait-elle dans ses mémoires. « J’avais éprouvé ses ressentiments, partagé ses espérances. Qu’y avait-il de plus simple que, une fois en mesure de le faire, je lui prêtasse le concours de ma situation [30] ? » Sa maison devint donc (à la grande colère de Viel-Castel, qui trouvait qu’elle parlait du Pape et des Autrichiens comme aurait pu le faire « le Mazziniste le plus prononcé ») [31] le centre de tous les personnages politiques favorables à la cause italienne, les Italianissimi, dont Lavallette, Benedetti, Bonjean, ainsi que son frère Napoléon Jérôme et ses amis. Elle en arriva même à considérer la question italienne comme « la pierre de touche » qui lui faisait reconnaître « les vrais partisans de l’Empire » [32].
22Julie aussi approuvait l’idée de l’indépendance de l’Italie (en désaccord avec son ami Thiers, qui redoutait l’unité de ce pays, et considérait l’Italie « notre ennemie ») [33], mais elle se posait le problème du rôle du Pape, et craignait que la construction d’un État unitaire ne se révélât un rêve impossible ; avec Lacordaire, elle pensait que « la cause de l’Italie est juste, celle de la Papauté l’est aussi ; le nœud du problème est de ne sacrifier ni l’une ni l’autre » [34].
23La position ouvertement pro-italienne de ses cousines, ainsi que les liens qu’elles maintenaient dans le pays de leur enfance, avaient de l’importance pour Napoléon III, au moment où – de concert avec le roi de Sardaigne et son ministre Cavour – il allait décider de déclarer la guerre à l’Autriche. À un dîner aux Tuileries, en janvier 1859, il s’entretint plus longuement que d’habitude avec Julie, et en parlant de l’Italie lui dit : « C’est un pays charmant, il est vrai qu’on aime toujours le pays où l’on a été, étant jeune [35] ! » Quelques mois après, en juillet, après l’armistice de Villafranca, l’empereur répondit d’un air triste à Julie qui le félicitait de son prompt retour : « Malheureusement, ce n’était pas fini [36] ! »
24Avec le temps, Napoléon considéra également avec intérêt l’amitié de sa cousine pour Thiers ; de son côté, l’historien utilisa Julie pour faire passer des messages à l’Empereur. En janvier 1860, Thiers la chargea de dire au souverain que la rumeur selon laquelle il allait écrire une réponse au pamphlet Le Pape et le Congrès était fausse. Napoléon III demanda alors à Julie l’opinion de Thiers sur le pouvoir temporel du Pape ; sa cousine lui dit que son ami n’approuvait pas que Pie IX perdît les Romagnes, mais qu’il parlait peu de politique et qu’il désirait seulement s’occuper de littérature et vivre tranquille [37]. Elle s’empressa de défendre son ami face à l’Impératrice, qui accusait Thiers de vouloir une coalition contre la France. Quand l’Empereur découvrit qu’elle était liée à Lacordaire, il lui dit un peu étonné : « Vous le connaissez lui aussi ? », pour lui demander ensuite si le grand prédicateur lui était très hostile – ce à quoi Julie lui répondit qu’elle ne le croyait absolument pas [38].
25Connaissant ses relations avec Thiers, plusieurs personnages du gouvernement s’adressaient à Julie pour lui demander l’appui de l’historien, surtout à l’occasion des élections à l’Académie (où Thiers jouissait d’une grande influence) : Walewski, par exemple, la pria de demander à Thiers de donner son vote pour l’élection à l’Académie de Camille Doucet [39]. À travers Julie, il y eut échange de compliments entre Troplong, le président du Sénat, et Thiers, qui chargea la princesse de dire à Troplong que « si un jour il désirait remplacer à l’Académie Française le duc de Pasquier, il lui donnerait volontiers sa voix » [40].
26Chez elle, Thiers rencontrait Billault, qui appréciait l’influence de Julie sur le célèbre historien : le ministre raconta à la princesse que la reine Sophie des Pays Bas (cousine de Mathilde et grande admiratrice de Napoléon III) lui avait confié avoir trouvé Thiers « singulièrement modéré envers l’Empire », et que, à l’avis de Billault, cette modification était due à la « bonne et douce influence » de Julie [41]. Le salon de la princesse commençait à prendre forme : Billault lui écrivait que son salon avait pris une « excellente position », qu’il ne pouvait « qu’être utile au gouvernement de l’Empereur » [42] et qu’il attirait « les hommes les plus éminents » [43]. Le ministre mourut subitement en octobre 1863 ; sa mort désola la princesse, qui se fit un devoir de cultiver la mémoire de son ami.
27Dès 1863, elle accueillit Victor Duruy, le nouveau ministre de l’Instruction publique, qu’elle avait en grande estime. Parmi les nouveaux habitués on comptait aussi Arthur de La Guéronnière, journaliste et collaborateur de Napoléon III, auquel Julie trouvait « un grand charme dans l’esprit et par conséquent dans la conversation » [44] et qui, sur la question italienne, avait les mêmes idées que Julie. Un autre de ses fidèles, le marquis Henri-Auguste-George de La Rochejaquelein (fils et neveu des deux plus célèbres généraux royalistes de la Vendée, et qui s’était rallié à l’Empire en opposition aux orléanistes), avait sur ce sujet une opinion diamétralement contraire. Lui et le sénateur Barthe se trouvaient d’accord : « ils sont tous les deux anti-unitaires », écrivait Julie, « car ils croient que cette unité serait funeste à la France, et ils soutiennent à outrance le pouvoir temporel du Pape » [45].
28À la même époque, l’historien Charles Giraud lui présenta Prosper Mérimée, qui était aussi un familier de Mathilde [46] et des Tuileries (ayant connu l’Impératrice tout enfant), et qui connaissait bien Thiers. Depuis quelques années, Mérimée avait servi de trait d’union entre Thiers et Napoléon III : en 1857, l’Empereur avait chargé Mérimée de dire à Thiers (ainsi qu’il le raconta à Nassau William Senior), qu’il considérait son Histoire du Consulat et du Premier Empire comme le plus grand monument élevé à la mémoire de son oncle. Thiers avait alors chargé Mérimée de répondre à l’Empereur qu’il s’occupait peu de politique, qu’il avait toujours ses « chimères constitutionnelles », mais qu’il était « très-sensible à un éloge qui vient de si haut » [47].
29Le rôle de Mérimée auprès du couple impérial était peut-être plus complexe que ce qu’on pense communément : son dernier biographe, Pierre Pellissier, suppose que Napoléon III avait chargé l’écrivain des missions « plus discrètes, presque secrètes », et qu’il le considérait comme un « agent d’influence » auprès de ses amis à travers l’Europe entière [48]. On peut l’imaginer à propos des relations de Thiers avec Julie. Aux élections législatives du 31 mai et du 1er juin 1863, Thiers ayant été élu, malgré l’opposition violente de Persigny (ministre de l’Intérieur à partir de la fin de 1860). Julie se trouva embarrassée avec Thiers : ils avaient décidé de rester bons amis malgré la politique, mais la princesse sentait « qu’un air glacé a passé entre nous ». Elle désapprouvait hautement la violence de Persigny contre l’élection « d’un homme célèbre qui, j’en suis convaincue, ne demandait pas mieux que d’être aussi bien avec nous que lui aurait permis sa dignité » [49].
30Thiers lui assura que son but en entrant au Corps législatif était « d’empêcher la guerre et de ramener en France les libertés constitutionnelles » [50]. Il avait en effet approuvé le décret du 24 novembre 1860, qui accroissait le rôle des Chambres, instituait trois ministres sans portefeuille, et concédait aux journaux de publier le compte rendu intégral des débats [51]. Mérimée pensa alors que Thiers pouvait jouer un « grand rôle » [52], en conciliant les milieux libéraux – dont il était le chef de file – avec l’Empire. Il ne réussit pas à obtenir que l’historien assistât à la séance impériale de l’ouverture des Chambres du 5 novembre 1863 : il demanda alors à Julie d’intervenir, mais sans résultat. Mérimée se fâcha avec elle, et lui écrivit : « C’est que vous êtes paresseuse et que vous ne vous donnez pas la peine de gouverner les gens, ce qui vous serait facile [53]. »
31Au cours des ces années, Julie et Mathilde (à laquelle on avait donné le surnom de « Notre-Dame des Arts ») étaient au centre de la vie mondaine et intellectuelle parisienne. La « qualité » de salonnières leur était reconnue soit par leurs amis soit par le public, et dans les journaux on parlait souvent de leurs réceptions.
32En 1862, Sainte-Beuve (qui connaissait Mathilde depuis 1841) fut chargé d’écrire pour La Galerie Bonaparte de l’éditeur allemand Glaeser un portrait de la princesse [54]. La description était flatteuse : la princesse avait « le front haut et fier, fait pour le diadème », son regard était « vif et perçant », sa physionomie exprimait « noblesse, dignité », son caractère était simple et droit : « rien dans l’ombre ». Le critique louait le cœur de Mathilde : « Elle a les amitiés longues, sûres, fidèles. Elle a besoin de confiance dans les relations : “J’ai besoin, dit-elle, de croire aux gens que je vois”. » Il justifiait même l’impétuosité de la princesse et son esprit tranchant et absolu, en le mettant sur le compte de son origine méridionale : « Sa pensée nette n’a jamais un instant de trouble, d’hésitation ; elle ne conçoit que ce qui est clair et ce qui s’explique clairement. […] C’est un ciel d’Italie tout d’azur, avec un horizon net et arrêté ; pas un nuage, pas une vapeur : le bleu pur et les lignes certaines. » Il retrouvait également en elle « quelque chose de la forme et du profil d’esprit du grand Empereur » [55].
33Mais surtout (et c’était son plus grand compliment), « la princesse Mathilde est, en effet, artiste dans l’âme. […] Elle a le sens visuel et pittoresque remarquablement développé, et elle n’a cessé de le cultiver par l’étude et par le travail [56]. » Son talent de salonnière se révélait dans les brillantes réceptions de l’hiver à Paris où Mathilde, « toujours présente et toujours prête, parlant à chacun, variant l’accueil et l’à-propos », semblait « née pour la représentation », mais aussi pendant l’été à Saint-Gratien, quand « entourée, de quelques amis toujours les mêmes », elle paraissait au contraire « faite pour l’intimité, pour un cercle d’habitudes paisibles, riantes et heureuses » [57].
34Le portrait de Sainte-Beuve se terminait par l’éloge des qualités plus traditionnelles de la princesse, ses œuvres de bienfaisance, ainsi que de sa disponibilité à offrir son appui et son patronage : « Sa maison est une sorte de ministère des grâces. Tout ce qu’elle peut solliciter et appuyer, elle le fait ; elle considère cette charge, dit-elle, comme un des devoirs de sa condition [58]. »
35On a aussi un portrait contemporain de Julie [59], écrit toutefois non par un auteur célébré comme Sainte-Beuve, mais par une amie de la princesse, Marie Thérèse Bartholoni née Fraser Frisell, dame d’honneur de l’Impératrice Eugénie. Madame Bartholoni évoquait l’« esprit fin, mordant, curieux de s’instruire, le don d’écouter et d’admirer les autres » de Julie, et rattachait le « petit cénacle » choisi de la princesse aux traditions glorieuses de l’hôtel de Rambouillet.
36La personnalité de Julie était plus discrète et nuancée que celle de Mathilde (elle s’était donné comme devise Ferme de cœur, mobile d’esprit). L’archéologue et historien Alfred Maury la définit dans ses mémoires comme une femme « du caractère le plus aimable et d’une intelligence vive », dont la conversation avait « un laissez-aller et une franchise pleine de charme chez une femme de son rang ». Maury nous décrit aussi les efforts que Julie faisait pour attirer chez elle des hommes distingués (il dit qu’elle « travaillait » à se composer un salon), dont des personnages qui se tenaient éloignés des Tuileries et s’opposaient au gouvernement de l’Empereur [60]. L’helléniste et bibliothécaire du Corps législatif Emmanuel Miller, un ami de Flaubert, la considérait une « admirable maîtresse de maison », parce que chez elle chacun pouvait « se croire l’objet d’une attention particulière » [61].
37Julie et Mathilde avaient chacune leur petite coterie « privée » et exclusive, mais elles organisaient aussi des réceptions plus nombreuses. Mathilde était contrainte par sa position à donner des soirées officielles : aux frères Goncourt elle racontait ses mardis : « Tous les gens qu’il faut que je reçoive… C’est l’ennui de mon état… Ceux que je ne veux pas recevoir les autres jours… Enfin, la porte est ouverte. Par exemple, je ne leur donne rien, pas un rafraîchissement [62]. » Elle préférait recevoir ses amis en petit comité, soit à Paris, soit à Saint-Gratien, et s’amusait à se faire inviter par eux, surtout par Sainte-Beuve. Elle fut même tentée de participer aux fameux dîners Magny, mais elle préféra en inviter les commensaux chez elle.
38Julie avait des soirées où elle recevait un grand nombre d’invités et des petites réunions plus restreintes vers 5 heures de l’après midi, où – raconte Alfred Maury – « un petit nombre de personnes faisaient cercle autour d’elle et où l’on causait librement de mille sujets » [63]. Julie affectionnait particulièrement ces causeries intimes, en dehors – disait-elle – « du flot des ennuyeux et des indifférents, qui parlent pour ne pas se taire » ; elle craignait particulièrement que « quelques femmes futiles ou peu intelligentes » ne viennent l’interrompre [64]. Les « règles » d’une bonne conversation étaient pour elle bien claires : « Pour que la conversation soit agréable, intéressante, elle doit embrasser toutes les époques, toutes les sciences ; elle doit enfin effleurer bien des choses difficiles et délicates sans froisser les idées de ceux qui causent, tout en n’ayant pas l’air de leur concéder quoi que ce soit [65]. »
39Tant Julie que Mathilde tenaient à avoir chez elles les nouveaux écrivains : en mai 1864, il y eut chez Julie une soirée « fort brillante », où était présent Flaubert, auteur dit Julie « d’un roman qui a eu de la célébrité et qui est spirituel et original » [66]. L’écrivain était encore chez elle en juin, ainsi qu’Ernest Renan [67] ; Julie avait connu ce dernier à travers Hortense Cornu, une femme de lettres qui avait été filleule de Napoléon III et qui – tout en maintenant ses opinions républicaines – était très liée à l’Empereur et à l’Impératrice. La princesse mettait en contact ses habitués et leur demandait de lui conduire leurs amis : le 5 juin 1864, elle présenta Flaubert à Mérimée, et quelques jours après Flaubert vint chez elle avec Hippolyte Taine, revenu d’Italie.
40Dans le salon de la rue de Grenelle, on parlait surtout d’histoire et de littérature ; ses amis lui apportaient leur bagage d’érudition, d’étude et d’expérience, ils lui donnaient leurs livres qui venaient de sortir. L’atmosphère était sérieuse, mais pas pédante. On était plutôt conservateur en littérature : Germinie Lacerteux des frères Goncourt (qu’elle jugeait « vulgaires et prétentieux ») [68], par exemple, fut fort critiqué, et Julie se déclara « violemment intolérante contre cette littérature réaliste qui, tout en ne nous montrant que d’affreuses créatures, a cependant le singulier attrait d’exciter plutôt la curiosité que la colère des femmes honnêtes » [69].
41Parfois, Julie jugeait ses invités uniquement sur leurs compétences mondaines. Elle aimait assez Flaubert et appréciait son talent, mais elle se scandalisait quand il définissait Renan « un homme nuageux », et appelait Thiers « le roi des épiciers » [70]. Elle le trouvait « complètement dépourvu de poésie et de sentimentalité », d’une conversation « presque toujours vulgaire » [71], et « inférieur parfois dans la vie de salon à d’autres hommes qui ont moins d’esprit que lui » [72].
42Une fois, Thiers et Mathilde, qui ne se fréquentaient plus, séparés par la politique, se rencontrèrent chez Julie : ce fut toutefois une occasion agréable : « ils ont un peu marivaudé ensemble. Thiers a été pétillant d’esprit, ma cousine a été très naturelle et fort gaie ». À la fin, Mathilde tendit la main à l’historien, en lui disant : « Adieu, mon ennemi ! », et Thiers lui répondit : « Je regrette de ne pouvoir pas dire : “Adieu, mon amie !” » [73].
43En politique, parmi les nouvelles recrues de Julie, il y avait le jeune et beau ministre d’Italie, Costantino Nigra, que la princesse recevait à d’autres moments que ses « vecchioni » (qui auraient pu en devenir jaloux). Julie était une enthousiaste, qui se passionnait pour ses nouveaux amis et en parlait à tout le monde. Flaubert écrivit à Jules Duplan que la princesse ne parlait que de Renan : « La princesse Julie raffole de Renan, ne parle que de ses œuvres, et même vous en tanne, si j’ose m’exprimer ainsi [74]. »
44Julie était très fière de son salon, et écrivait avec orgueil à son mari qu’elle et ses sœurs étaient devenues « una piccola potenza » (une petite puissance) [75]. Elle s’était aperçue que Mathilde était devenue « gelosissima » de ses amitiés, et des « uomini distinti » [76] qui venaient chez elle. En effet, quand Julie était présente à la rue de Courcelles ou à Saint-Gratien, Mathilde cherchait à la mettre de côté. Elle n’était d’ailleurs pas la seule, car chez sa cousine les autres femmes ne pouvaient souvent être « qu’à l’état d’oreilles » [77]. Julie reconnaissait le charme de Mathilde et de sa conversation ; toutefois, elle décelait dans sa cousine « un fond de despotisme qui ne cède que devant ceux qu’elle aime » [78].
45De même que Mathilde, Julie ne se plaisait pas aux réceptions de Cour, et elle s’y rendait seulement parce que l’Impératrice lui avait fait savoir qu’elle tenait beaucoup à la présence des femmes de la famille aux grands bals. Julie et sa petite coterie sérieuse déploraient la frivolité et le « mauvais genre » des fêtes de la société impériale ; un des fidèles de Julie, Charles Giraud de l’Institut, lui décrivit scandalisé une fête où l’ambassadeur d’Autriche, Richard de Metternich, dirigeait un orchestre qui mimait les cris des animaux, tandis que sa femme Pauline (la femme la plus brillante du monde officiel) jouait du tambour. Giraud (et Flaubert était d’accord avec lui) en concluait : « Des spectacles pareils m’affligent au lieu de m’égayer. La première société d’un empire, qui emprunte les amusements d’une classe inférieure ; des grandes dames décolletées, des personnages au cordon rouge, qui viennent rire à la voix enrouée d’un coq ou d’un coucou, et se payer d’un spectacle, ou d’un concert burlesque emprunté à la rue : cela m’afflige et ne m’amuse plus. […] La grande société de ce pays donne sa démission de toutes les choses qui légitiment sa grandeur : de la grâce, du goût, de la dignité, de l’esprit [79]. »
46Julie et Mathilde en arrivaient parfois à devoir se disputer la compagnie de leurs amis avec des femmes appartenant au demi-monde – telles que la Païva ou Jeanne de Tourbey – qui, elles aussi, tenaient salon. Julie commentait scandalisée que les femmes de son temps lui paraissaient en révolution, « en ce que les femmes du monde prennent les allures des femmes entretenues, celles-ci prennent les attitudes et les goûts des femmes du monde » [80]. Mathilde faisait des scènes à Flaubert parce qu’il fréquentait la de Tourbey, qui par ailleurs avait été une chère amie (presque une élève) de Sainte-Beuve, et qui fut longuement la maîtresse de Napoléon Jérôme, frère de la princesse. Avec les Goncourt, Mathilde se plaignait de devoir partager « avec de pareilles femmes », le temps de Taine et de Renan, de Sainte-Beuve et de Flaubert, qui dînaient chez elle et ensuite s’empressaient d’aller « chez cette gueuse » (la Tourbey) [81].
47Julie, ainsi que ses sœurs, jouissait dans la société parisienne d’une réputation sans tache, et était considérée, écrit Alfred Maury, comme « ce qu’il y avait de plus honorable dans la famille Bonaparte » [82]. Mathilde avait une situation mondaine bien plus splendide, mais sa vie privée et ses manières se trouvaient souvent critiqués : Pauline de Metternich, en rappelant dans ses Souvenirs la rencontre à Paris en 1867 entre la princesse et l’empereur François Joseph d’Autriche, se déclarait sûre que son souverain n’avait nullement apprécié Mathilde : « elle était trop brusque de manière, trop criarde, trop délurée pour lui plaire » [83].
48Viel-Castel depuis plusieurs années se plaignait dans le secret de son journal des amis et des discours qu’on faisait chez Mathilde, de la liberté de langage de la princesse, de l’influence qui y maintenait Nieuwerkerke : « Le monde reproche à Nieuwerkerke de n’avoir pas fait prendre à la Princesse l’attitude d’une Altesse Impériale. Elle pouvait rendre de grands services à l’Empereur en lui rattachant tout le monde littéraire et artistique dont elle est aimée, et elle ne l’a pas fait [84]. » Dans son snobisme d’Ancien Régime, il lui reprochait d’admettre dans son intimité les artistes qui, « loin d’être flattés de se trouver dans les salons des grands seigneurs, s’y trouvent très malheureux ; leur caractère ombrageux les rend moroses, ils sont jaloux de toute supériorité, ils y prennent en haine les distinctions sociales qui ne les établissent pas au premier rang, et devant eux la conversation devient fort difficile, parce que chaque mot d’une personne du monde leur paraît l’indice d’une intention blessante pour eux [85]. » Quelques années après, il concluait que « la pauvre Princesse Mathilde croit avoir un salon, elle n’a qu’un bazar où tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute ! » et que la « fréquentation de gens aux manières vulgaires » avait corrompu ses manières : « elle en est arrivée à prendre pour de l’aisance majestueuse, la familiarité la plus commune » [86].
49À partir de 1860, Charles-Augustin Sainte-Beuve avait pris une place importante dans le salon de la princesse Mathilde. L’affection entre le grand critique et la princesse était profonde : Sainte-Beuve conseillait Mathilde dans ses lectures, lui présentait ses amis, organisait pour elle des cours d’histoire tenus par Julien Zeller. Mathilde s’occupait avec un soin presque maternel du bien-être du critique, et elle utilisa tout son crédit auprès de l’Empereur pour le faire nommer sénateur, malgré les idées notoirement anticléricales de Sainte-Beuve et ses liens avec l’opposition politique à l’Empire. Au portrait flatteur que le grand critique avait écrit d’elle, Mathilde répondit avec une description intelligente et affectueuse de son ami : « un esprit éminent, fin, caustique, insinuant, indulgent, par bonté de cœur, par habitude de la vie ; souriant à toutes les malices ; en découvrant partout ; accessible à tout le monde, mais sachant garder ses préférences ; philosophe à la façon des Grecs – auxquels il ressemble beaucoup par la forme extérieure – un croyant sans religion, un philosophe avec des indignations, un scrutateur par curiosité : enfin un esprit qui comprend tous les esprits, qui les explique tous, et qui a le rare bonheur de n’avoir de la passion que ce qu’il faut pour rester jeune et impartial [87]. »
50Sainte-Beuve maintenait ses idées et se permettait – avec une grande prudence et sans aucune agressivité – de critiquer les convictions granitiques de Mathilde en ce qui concernait l’histoire napoléonienne : « Daignez vous mettre au point de vue d’un public si morcelé, si travaillé en sens divers, et qui n’était point placé comme vous-même, Princesse, au cœur de la tradition et dans la lignée directe de l’homme [88]. » Il cherchait aussi, à travers la princesse, à faire passer des messages au gouvernement, à lui faire comprendre qu’il était inutile de vexer journalistes et hommes des lettres, dont les idées n’étaient pas conformes à la politique impériale. Il fallait expliquer à La Valette, alors ministre de l’Intérieur et ami de Mathilde, que si on réduisait les écrivains amis du gouvernement « à n’avoir pour asile que le foyer même de l’adversaire », ça aurait pu signifier qu’une « école gouvernementale » n’était pas possible, qu’il n’y avait que l’opposition, et que « bien sot est celui qui ne choisit pas ce cadre » [89].
51Quand, le 6 mars 1867, Émile de Girardin fut condamné à une forte amende pour un article paru sur son journal La Liberté et intitulé « Les Destinées meilleures », Sainte-Beuve écrivit à Mathilde : « Je vous jure que je suis très-affecté, non pas individuellement, mais politiquement de tout cela. Veuillez penser qu’il y a contradiction entre inaugurer un régime qu’on proclame plus indulgent [le décret du 19 janvier 1867 avait remplacé, au Corps législatif, l’adresse par le droit d’interpellation, et envisageait la réforme de la liberté de la presse et du droit de réunion] et le faire précéder par un acte plus sévère qu’on n’eût fait du temps où il y avait des avertissements [90]. »
52Sainte-Beuve amena chez Mathilde ses collègues hommes de lettres : Flaubert, les Goncourt, Taine, Renan, Théophile Gautier (que Mathilde, pour lui assurer un revenu fixe, nomma son bibliothécaire, avec une pension annuelle de 6000 francs). Gustave Flaubert avait été une « recrue » de Mathilde avant que de devenir un habitué de Julie : du début de 1863, il fréquentait la rue de Courcelles. À sa manière timide et gauche, il était très attaché à la princesse, et il se sentait très proche d’elle : « Ne vous semble-t-il pas, que tous, tant que nous sommes (malgré les différences de fortune, de rang et même de sexe), nous vivons sur un radeau de la Méduse, et qu’en dehors de ce petit nombre-là, il y a, tout autour de nous, comme un océan d’hostilités et de bêtise ? C’est pourquoi il faut se tenir ferme et garder l’espoir [91]. » Il tenait beaucoup à l’opinion de Mathilde sur ses ouvrages : « J’aimerais à écrire quelque chose qui vous fût réellement agréable ! », lui écrivait-il en mars 1867, quand il préparait L’Éducation sentimentale, « car je vous avouerai, Princesse, que je redoute beaucoup votre jugement et que j’ambitionne votre suffrage » [92].
53Les frères Goncourt furent les fidèles chroniqueurs du salon de Mathilde, reportant minutieusement les invités, les humeurs et les traits saillants de la princesse. La première fois qu’ils furent invités chez elle, elle ne leur fit pas une bonne impression : « C’est une grosse femme, un reste de belle femme, un peu couperosée, la physionomie fuyante et des yeux assez petits, dont on ne voit pas le regard ; l’air d’une lorette sur le retour et un ton de bonne enfance, qui ne cache pas tout à fait un fond de sécheresse. » Passionnés par les salonnières du XVIIIe siècle, ils n’apprécièrent ni le dîner tout à fait ordinaire ni la conversation à table, les « expressions d’atelier » et « l’argot de demi-monde » [93] utilisés par les convives. Toutefois, ils changèrent bientôt d’avis et se laissèrent fasciner par la nouveauté de ce milieu à la fois princier et artistique, gouverné par une personnalité forte et originale. « La princesse est le type d’une femme toute moderne, la femme artiste, quelque chose de très différent de ce qu’on appelait la virtuose au XVIIIe siècle » [94] ; elle leur paraissait « une espèce de Marguerite de Navarre dans la peau d’une Napoléon » [95].
54Tout de suite, ils notèrent que la princesse n’aimait pas la compagnie des femmes ; elle se plaignait du « niveau si singulièrement descendu de la femme » depuis le XVIIIe siècle, de l’ignorance et de la frivolité des dames de son monde [96]. Pour elle (comme pour Julie, qui disait que les femmes qui viennent « me font honneur, celles qui ne viennent pas me font plaisir » [97]) la présence des autres femmes constituait parfois un problème ; les Goncourt décrivent « sa figure de crucifiement et d’envie » [98], quand deux dames insignifiantes l’empêchent de participer à une intéressante conversation avec le fameux physiologiste Claude Bernard.
55Les Goncourt devaient aussi faire face aux changements d’humeur de Mathilde ; parfois, ils la trouvaient affectueuse et prévenante, parfois c’était à peine si elle leur parlait. Quand ils lui envoyèrent leur nouvelle œuvre, Madame Gervasais, la princesse leur dit seulement que le livre lui semblait « assez bien fabriqué » [99]. Elle leur paraissait « un Napoléon-femme », une « femme mâle » [100], franche sinon brutale, mais jamais perfide, très tendre au fond, « un singulier et attachant mélange de bonté à la fois grossière et délicate » [101]. Aux deux frères, Mathilde déclara que son seul plaisir au monde c’était de vivre « au milieu de gens qu’elle aime, qui lui sont sympathiques » [102], et qu’à tous les honneurs et les fêtes du monde elle préférait rester chez elle avec ses amis.
56La fonction de Mathilde, ainsi que celle de Julie (avec un pouvoir plus réduit) était souvent d’appuyer la carrière des amis et des amis des amis, de leur obtenir des décorations ou des avancements de carrière, d’aider les artistes et les hommes de lettres (surtout Mathilde) à obtenir des commissions ou à pouvoir publier ou représenter leurs œuvres. Ce fut Mathilde qui obtint du directeur de la Comédie Française que soit représentée la pièce Henriette Maréchal des Goncourt, qui essuya un insuccès mémorable. Mathilde et un peu Julie aussi cherchaient même à intervenir au moment des élections à l’Académie. Les deux cousines soutiennent avec courage Ernest Renan quand, en 1864, on lui retira la chaire d’hébreu au Collège de France parce qu’il avait nié la divinité de Christ. En 1866, Mathilde réussit à empêcher qu’on retirât à Hippolyte Taine, pour l’indépendance de ses opinions, son poste d’examinateur de français à Saint-Cyr.
57L’affection jalouse et exclusive que Mathilde portait à ses amis se heurtait à l’habileté presque « professionnelle » de salonnière de Julie. Quand elle surprit les Goncourt demandant à Nieuwerkerke l’adresse de la princesse Julie, qui avait invité les frères à ses mardis, elle cria au « raccrochage », et pendant une heure éreinta sa cousine, qui venait « lever ses invités chez elle » [103]. Quelques années après, à un dîner de famille aux Tuileries, Julie (qui avait mis son fils aîné chez les Jésuites), affirma que les Jésuites n’étaient pas les ennemis du gouvernement impérial. La colère de Mathilde explosa : « Oh, quelle femme ! La menteuse ! […] Tout ce qu’elle dit, des mensonges ! Je la crois folle… Elle se teint les sourcils à présent [104]. »
58L’évolution dans un sens libéral du gouvernement de Napoléon III fut accueillie d’une manière différente par Julie et Mathilde. À cette époque, Mathilde n’aimait pas s’occuper de politique, sauf ce qui concernait la cause italienne ou la défense du prestige de la dynastie napoléonienne. Julie, au contraire, cherchait à suivre toutes les séances du Corps législatif. Se rattachant à la tradition plus ouverte de la branche Lucien, elle était convaincue qu’une plus grande liberté s’insérait dans la ligne de la plus authentique tradition bonapartiste : en 1866, elle écrivait : « Les Bonaparte représentent en même tems que les principes de 89, le régime d’autorité ; on ne s’arrêtera plus maintenant dans la voie du progrès ni de la liberté [105]. » Son salon était considéré par la société impériale comme un salon indépendant, et avait même un certain « cachet frondeur » [106].
59L’amitié avec Thiers continuait, malgré l’opposition déclarée de l’historien au gouvernement de Napoléon III. Thiers continua à aller souvent chez Julie, qui notait dans son journal les critiques de son ami : « Il trouve le gouvernement trop personnel, il demande la responsabilité des ministres, il se plaint que la presse n’ait assez de liberté [107]. » Après le décret du 19 janvier 1867, madame Cornu demanda à Julie ce qu’en pensait Thiers, s’il en était mécontent ou s’il préférait « le régime légal quel qu’il soit appliqué à la presse et à l’association, au régime de l’arbitraire » [108]. Lors d’un dîner de famille, début février 1868, Napoléon III demanda à voix basse à Julie si elle voyait encore Thiers, et ce qu’il pensait de la loi de la presse. Julie lui répondit qu’il paraissait la croire nécessaire. Napoléon III alors lui dit : « Je trouve qu’il a raison », et il ajouta ensuite : « Nous serons peut-être obligés d’arriver à ses idées [109]. »
60Toute la diplomatie et l’habilité de Julie ne suffirent pas à éviter des discussions, dans son salon, entre Thiers et les autres habitués : dans ses Mémoires, Alfred Maury relate de vifs échanges sur la liberté de presse, dont Thiers « réclamait la plus large extension ». Un de ses contradicteurs lui avait dit : « Vous-même, quand vous étiez ministre, ne disiez-vous pas qu’il était impossible de gouverner en France avec une liberté absolue des journaux, et n’avez-vous pas demandé les lois de septembre [1835] ? ». L’historien répondit embarrassé : « Cela peut-être, mais aujourd’hui, je veux cette liberté. » Maury en concluait que ça signifiait « qu’il n’était pas au pouvoir, qu’il n’aimait pas le régime impérial, parce qu’il voulait un gouvernement constitutionnel où lui ministre fût tout-puissant » [110].
61Les deux cousines continuaient à se tenir éloignées de la Cour, au même temps qu’augmentait l’influence de l’Impératrice. Les règles compliquées d’étiquette paraissaient surannées à Julie : « Tout ce fatras de servilité, de futilité élégante, de laquais aristocratiques, qui s’appelle la Cour, n’est plus de notre temps […], tout cela avait raison d’être à l’époque des dynasties de droit divin, alors que le roi était l’image de Dieu sur la terre, mais à présent cela n’en impose qu’au vulgaire et encore [111]. » À vrai dire, la Cour de Napoléon III était une Cour « moderne », et si l’aristocratie (impériale ou d’Ancien Régime) y était nombreuse, on y accueillait également étrangers, hommes de lettres, savants, artistes et militaires d’origine plébéienne.
62L’éloignement des deux princesses était lié aussi à un conflit interne à la famille impériale : il y avait un contraste entre les membres plus indépendants et intelligents (qui étaient souvent mis de côté) comme Julie, Mathilde et son frère Napoléon Jérôme, et les Murat (qu’Eugénie affectionnait et protégeait particulièrement). « À la Cour on ne juge pas de l’esprit des gens, mais de leur caractère, et les Murat sont plus malléables que les Bonaparte » [112], écrivit Julie, tandis que Napoléon Jérôme considérait les Murat comme « des médiocrités cancanières » [113].
63Julie, Mathilde et son frère avaient formé des sociétés, non pas d’opposition, mais alternatives à une Cour dominée par l’Impératrice. Ils avaient plusieurs amis en commun (avec une majorité d’hommes politiques et journalistes d’idées avancées chez Napoléon Jérôme), et les mêmes opinions sur l’unité italienne. Napoléon Jérôme avait eu plusieurs différends avec sa sœur (surtout de nature financière), tandis qu’il aimait beaucoup Julie, dont il appréciait l’esprit et le bon sens. Surtout après 1865, quand il fut écarté de la vie politique, il allait souvent chez sa cousine (qui était liée aussi à la princesse Clotilde, la pieuse femme du prince). Il y retrouvait ses amis et il pouvait aussi se confronter – sur un terrain neutre – avec les hommes du gouvernement ou bien avec Thiers. Il approuva le premier discours de Thiers député, qu’il trouva « beaucoup plus libéral que l’orateur en général » [114] ; Julie en parla à l’historien, qui envoya de suite au prince le texte de son discours. Napoléon Jérôme chargea alors Julie de dire à Thiers qu’il avait été « très sensible à cette déférence de sa part » [115].
64Julie était fascinée par la personnalité forte et originale de Napoléon Jérôme (tout en critiquant son anticléricalisme farouche), le jugeait « indépendant de caractère, libéral en politique, fidèle en amitié » [116]. Elle aimait beaucoup l’avoir dans son salon, même si – dans sa parfaite amabilité – certaines fois elle était un peu choquée de son manque « d’urbanité, de politesse » [117]. Avec Renan, elle déplorait que son cousin n’ait pas réussi à collaborer avec l’Empereur : « J’ai toujours regardé l’union des qualités si grandes et si diverses de l’Empereur et du prince Napoléon comme la condition de salut pour notre pays » [118], écrivait Renan à Julie. Pour l’écrivain, ainsi que pour Julie, l’intelligence, les idées ouvertes et les amitiés dans les milieux républicains et avancés du prince pouvaient être un utile stimulant pour la politique impériale.
65En effet, Napoléon III ne voyait pas d’un mauvais œil les amitiés formées par ses cousins dans les milieux artistiques, littéraires ou d’opposition, car ils pouvaient constituer un appui dans son projet des concessions libérales progressives.
66La rivalité entre Mathilde et Julie, parfois latente parfois explicite mais toujours présente, explosa en juin 1868 en raison d’une étourderie commise par Julie aux dépens de Sainte-Beuve, le plus célèbre et influent ami de sa cousine. Julie avait toujours aimé écrire et étudier (en famille on l’appelait « l’écrivassière ou la gribouilleuse » [119]), et elle aimait faire lire ses écrits à amis et fidèles. Elle avait connu Sainte-Beuve dans le salon de Mathilde, et il y avait eu entre eux échange de lettres et de courtoisies ; le critique lui avait donné une copie dédicacée de son roman Volupté [120], mais il n’était jamais allé rue de Grenelle. Enfin, la princesse, comptant sur l’indulgence du critique, se décida à lui envoyer trois des volumes de son journal, avec une lettre respectueuse [121].
67Malheureusement, Julie avait complètement oublié avoir écrit dans un de ces cahiers qu’on lui avait raconté que Sainte-Beuve menait « malgré son âge, une vie crapuleuse ; il vit avec trois femmes à la fois, qui sont à demeure chez lui ». Elle ajoutait que le critique lui avait laissé des cartes, mais qu’il n’était jamais entré dans son salon et que, tout en étant admiré comme écrivain, il ne jouait pas de considération personnelle. Elle terminait en accusant Sainte-Beuve d’avoir fait « des pieds et des mains pour entrer au Sénat, duquel pourtant il se moquait », d’avoir écrit du mal de personnes qui lui avaient fait du bien, et – par-dessus le marché – de passer pour très gourmand et ayant une vie privée « très immorale ». La conclusion de la princesse était que Sainte-Beuve « n’a qu’un Dieu, le plaisir : il n’a aucune conviction religieuse, et un jour, en parlant de l’homme du peuple et de lui-même, il disait : “L’homme sans éducation est une fleur des champs, tandis que je suis une fleur de serre” » [122].
68Le critique (qui était déjà très malade) en resta, comme il est naturel, profondément affecté. Il lui renvoya les cahiers, avec une lettre amère et irritée. « Le hasard est quelquefois malin et spirituel », lui écrivait-il, en soulignant que s’il n’était jamais entré dans son salon ce n’était pas faute d’y être invité : « Ce n’est donc point à mon peu de considération comme vous dites, que j’ai pu devoir de n’y être point admis, mais à une discrétion de ma part et à un éloignement instinctif dont j’ai à me féliciter aujourd’hui ». Il rebattait point sur point les accusations de la princesse : « Comment se pourrait-il que j’eusse tout fait des pieds et des mains pour entrer au Sénat, quand je n’ai jamais fait d’article sur l’Histoire de César ». Concernant ses idées religieuses, il accusait Julie de s’exprimer sur ce sujet avec une « crudité » qui la lui faisait juger « beaucoup plus irréligieuse que je ne demanderais jamais à une femme de paraître ». Il niait sèchement « l’histoire des trois femmes à domicile », comme une « légende vraiment herculéenne ».
69Il tenait surtout à repousser la dernière affirmation de la princesse : « Quoi ! J’aurais dit qu’un homme sans éducation est une fleur des champs, tandis que moi, je suis une fleur de serre ! Non, non, croyez-le bien, Princesse, je n’ai jamais pu dire ni penser qu’un homme fût une fleur. Je réserve ces images pour un sexe différent. » La lettre était très digne, mais dans le post-scriptum Sainte-Beuve laissa filtrer ses rancunes, ses doutes sur ses collègues : « Et, à propos encore, quelles sont donc, Princesse, ces personnes qui m’ont fait du bien et dont j’ai dit du mal ? Faire du bien mais savez-vous Princesse, que j’ai fait du bien à beaucoup de gens par ma plume et qu’il y a trois ans, avant la bonté toute gratuite de l’Empereur, j’en étais après quarante ans de littérature à vivre uniquement de cette plume. Ah s’ils sont jolis les gens qui m’ont fait du bien ! Si c’est quelqu’un de vos familiers qui s’est exprimé ainsi, vous pourrez lui dire de ma part que je dis que c’est un faquin. Je parle ainsi parce que je soupçonne quelqu’un [123]. »
70Julie, prise de panique, lui répondit tout de suite par une lettre maladroite, dans laquelle elle l’assurait « que vous avez en moi une personne qui aura pour vous toujours de l’estime » [124], puis lui envoya Pierre-Antoine Lebrun et Charles Giraud, des amis communs, pour essayer de l’apaiser. Mais Sainte-Beuve avait été touché dans un endroit sensible : dans un de ses Dossiers littéraires il commenta avec amertume qu’il lui était « bon de connaître, pour savoir ce que disent de moi, quand j’ai le dos tourné, les gens qui, moi présent, me font le plus d’avances » [125]. Il chercha consolation chez sa grande et fidèle amie, la princesse Mathilde : il lui conta toute l’histoire, en se plaignant d’avoir été traité « de la manière la plus grossière, la plus calomnieuse », et d’avoir eu « un aperçu de ces aménités qui s’imprimeront, comme évangile, le lendemain du jour où l’on ne sera plus » [126].
71Mathilde, indignée pour l’offense faite à son ami, se déchaîna contre sa cousine : « Quelle charogne, et combien mon indulgence l’avait ménagée ! L’orgueil et l’envie l’ont perdue ! J’en suis, ma foi, bien aise », répondit-elle à Sainte-Beuve, en ajoutant que, « dans une société bien organisée, on devrait s’entendre pour retrancher un membre aussi infect. C’est la fausseté même [127] ! » Elle répandit l’aventure dans son entourage : le 3 juillet sur le Figaro un entrefilet racontait l’histoire d’une princesse qui avait « un salon panaché ; recevant les jours gras tout le diocèse de M. Sainte-Beuve, les jours maigres toute la petite chapelle de M. Dupanloup » et qui avait cherché, en lui envoyant ses manuscrits, la louange du « Van Dyck du genre », en oubliant d’avoir inséré Sainte-Beuve dans « une espèce de physiologie des salons de Paris ». L’aventure, continuait l’article, avait été conté « à une autre princesse, vive comme la poudre, qui fit explosion en ces termes : “Je reconnais bien là ma chère cousine ! Elle mange du Renan avec mon frère et du bon Dieu avec ma belle-sœur !” ». La conclusion de l’auteur anonyme était que « le salon de l’adroite princesse est mis à l’index, et il est probable que, cet hiver, on n’y verra plus que des soutanes ».
72Tous les amis communs de Julie et Mathilde furent mis au courant, et pendant quelques jours on ne parla que de cela : le sage Flaubert écrivit à Mathilde que Sainte-Beuve n’avait pas été « très philosophe. Il me semble qu’à sa place j’en aurais ri. Je me vante peut-être ; mais il y avait, je crois, mieux à faire qu’à se fâcher [128]. » Les Goncourt, au contraire (qui avaient pour Julie la même antipathie qu’elle avait pour eux), s’en donnèrent à cœur joie, traçant dans leur journal un portrait de la princesse au vitriol : « La Roccagiovine, cette cousine intrigante de la Princesse, cette racoleuse de célébrité pour son salon […] cette femme aux gros yeux ronds, qui se vante à faux, dit la Princesse, d’avoir été la maîtresse de Billault et de La Guéronnière, la Roccagiovine, bel esprit par là-dessus et se piquant d’écrire ». Mais ils perçurent aussi, dans l’indignation de Sainte-Beuve, « amère et un peu épouvantée, la prescience des funérailles que lui préparent bien des amitiés qui se sont approchées de lui » [129].
Mérimée, que Julie avait appelé au secours, se déroba, mais il lui écrivit avec indulgence : « malgré le côté comique de l’aventure, je vous ai plainte de tout mon cœur ». S’il lui fût arrivé la même chose, de sa part, il lui aurait « fait une belle guerre et je vous aurais rendue bien malheureuse, mais la chose serait restée entre nous » [130]. Toutefois, l’histoire était trop piquante pour la laisser tomber, et Mérimée écrivit à la comtesse de Montijo (« Vous jugez de la confusion de la pauvre femme qui écrit des mémoires et qui n’a pas de mémoire » [131]), et à des autres connaissances, en concluant que Sainte-Beuve avait « poussé trop loin la vengeance » [132] et que, en tout cas, « heureusement que tout s’oublie vite à Paris » [133].
Sainte-Beuve lui-même comprit qu’il avait exagéré ; quelques jours après la parution de l’article dans le Figaro, il écrivit à son amie Jeanne de Tourbey (en lui donnant un portrait de Julie proche de la vérité : « c’est une assez bonne personne, mais remuante, active, inquiète et très bas bleu » [134]), que c’étaient des « misères dont on rit un moment et auxquelles est dû l’oubli » [135].
Julie se sentit trahie par sa cousine ; toutefois, leurs relations ne changèrent pas, et dès le 16 juillet elle alla à Saint-Gratien rendre visite à Mathilde, en lui emportant de cette manière son pardon : « Le beau rôle dans tout cela vous est resté », commenta son ami Emmanuel Miller [136].
Une fois passés les premiers moments, Julie jugea avec hauteur (au fond, elle était un membre de la famille impériale, et Sainte-Beuve un homme de lettres, d’origine bourgeoise, qui vivait de sa plume) le comportement du critique : « Sainte-Beuve avec tout son esprit est peu homme de monde [137]. » Plus tard, elle écrivit dans ses Pensées : « L’homme lâche peut, impunément, se donner le plaisir d’être impertinent avec une femme de grande situation, parce qu’il sait bien, qu’elle évitera, à tout prix, le bruit malséant qui rejaillirait sur elle et les siens, si elle répondait aux attaques injustes, bêtes ou absurdes [138]. »
Sainte-Beuve, si vigoureusement soutenu par Mathilde, ne comprit pas que la fidélité à sa famille (donc, le lien avec sa cousine) avait pour la princesse plus d’importance que l’amitié qu’elle lui portait, et qu’en dépit de toute sa culture et de sa célébrité il était tenu à suivre soigneusement la ligne de conduite qu’elle considérait juste. Quelques mois plus tard, Sainte-Beuve (qui depuis longtemps critiquait l’œuvre du gouvernement impérial sur la liberté de presse, et qui se sentait libre d’écrire où il voulait) décida de quitter l’officiel Moniteur universel pour le journal d’opposition modérée Le Temps. Quand, le 1er janvier 1869, un article de Sainte-Beuve parut dans Le Temps (« Nos ennemis personnels » [139], selon la princesse), la colère de Mathilde se retourna contre lui. Elle lui fit une scène terrible, puis répandit toute son indignation auprès de leurs amis.
Aux Goncourt, elle raconta être allée chez Sainte-Beuve pour lui demander de quitter Le Temps pour un journal plus proche du gouvernement, et qu’il lui avait répondu « que rien ne le forçait de donner sa démission au Sénat ; ça lui était bien égal ; que d’ailleurs, son intention était bien de ne jamais servir le petit Prince impérial » [140]. Mathilde lui reprocha de s’être brouillée, à cause de lui, avec l’impératrice, lui rappela tous les avantages et les faveurs qu’elle lui avait procurés. Enfin, elle lui cria : « Mais qui êtes-vous ? Un vieillard impotent. Vous ne pouvez pas seulement vous servir dans vos besoins ! Mais quelles ambitions avez-vous donc encore ? [141] ».
Flaubert essaya de calmer Mathilde : « Ce n’est pas le drapeau qu’il faut regarder, mais ce qu’il y a dessous ; où l’on écrit importe peu ; le principal est ce que l’on écrit. » À son avis, le grand tort de Sainte-Beuve avait été « de faire quelque chose qui vous déplaise et, du moment que vous le priez de ne pas écrire dans ce journal, il aurait dû vous complaire » [142]. À George Sand, il écrivit que la rupture lui paraissait « irrévocable » et que le tort allait surtout au critique, qui ne s’était pas conduit « en galant homme. Quand on a pour ami un aussi bon bougre, et que cet ami vous a donné trente mille livres de rente, on lui doit des égards [143]. » Mérimée se déclara « bien fâché » de la querelle, mais il ajouta qu’il était frappé de la « maladresse » avec laquelle toute l’affaire avait été conduite [144].
Sainte-Beuve était convaincu de ses bonnes raisons, et que « tout cela passera » [145]. Il ne s’aperçut même pas que la princesse considérait leur rupture comme définitive : quelque jours après leur brouille, il lui écrivit une lettre étonnée, où il disait qu’il n’arrivait pas à découvrir d’avoir eu des torts envers Mathilde, et qu’il était encore sûr de leur amitié. Mathilde lui envoya une dernière lettre, en l’accusant d’avoir tout refusé : « Vous n’avez voulu entendre rien et vous avez beau dire que ce n’est pas passer à l’ennemi que publier un ou plusieurs articles en journal ennemi, le public ne juge pas ainsi les choses, et ceux-là mêmes qui vous ont conquis célèbrent aujourd’hui leur victoire et notre défaite [146]. » Mathilde et Sainte-Beuve ne se revirent plus. Quand, en octobre 1869, la princesse sut que le critique était très malade, elle se précipita chez lui mais il ne put la recevoir. Il réussit seulement à dicter un billet : « Une satisfaction profonde est d’avoir retrouvé ce à quoi on avait cessé de croire [147]. » Il mourut le 13 octobre 1869.
Naturellement, Julie accueillit avec satisfaction la nouvelle de la rupture, ajoutant que « tout cela amuse mes amis qui, cet été, ont eu tant de peine à me défendre contre ma cousine à propos de mes quelques pages qui avaient tant irrité l’irascible critique » [148]. Malgré la prophétie du Figaro, son salon ne fut pas mis à l’index : l’année suivante, Mérimée écrivit à un ami commun, le comte Arthur de Gobineau, que la princesse était « en grande prospérité, flirtant avec des philosophes et qq [quelques] fois avec des abbés » [149].
Les élections de mai-juin 1869 (les premières après les lois de mai et juin 1868 sur la liberté de presse et de réunion) virent la grande montée du Tiers Parti et des républicains. Elles marquèrent un tournant décisif, dans un sens libéral, dans la vie politique de l’Empire. Le cercle de Julie devint alors un espace privilégié, où pouvaient se rencontrer les hommes du gouvernement et les politiques nouveaux, dont Émile Ollivier, qui avait fait son apparition dans le salon à partir du début 1867.
Le 26 février 1869, Julie donna une brillante réception en l’honneur de la reine Sophie des Pays-Bas, où intervint « la fine fleur du monde officiel ». L’esprit d’opposition, raconte Alfred Maury qui était présent, « commençait à gagner même les serviteurs de l’Empire », et ce soir on fit cercle autour de Napoléon Jérôme, « qui parlait haut et qui avait là plus l’apparence d’un chef de mécontents que du cousin germain de l’Empereur ». Autour de lui il y avait Duruy et même Maupas, le ministre de la Police du 2 décembre 1851, « le dernier homme », commente Maury, « que j’aurais supposé être devenu un fauteur du gouvernement parlementaire » [150].
On eut recours à la capacité de médiation de Julie au moment où le carme Hyacinthe Loyson, le plus célèbre et aimé des prédicateurs de l’époque, décida de quitter son couvent et fut excommunié. Le carme annonça sa décision, soulevant un énorme scandale, le 21 septembre 1869, avec une lettre au journal Le Temps dans laquelle il protestait « contre le divorce, impie autant qu’insensé, qu’on s’efforce d’accomplir entre l’Église, qui est notre mère selon l’éternité, et la société du dix-neuvième siècle dont nous sommes les fils ». Il avait toujours manifesté des idées libérales, en politique comme en religion, position qui s’accentua pendant la préparation du premier Concile œcuménique du Vatican, qui allait discuter de l’infaillibilité papale. S’il se réjouissait de voir l’Empire entrer « dans des voies sincèrement libérales et pacifiques qui lui concilieront tous ceux qui ne [veulent] pas de la Révolution » [151], il croyait aussi fermement que seulement le christianisme pouvait « sauver la société contemporaine, et l’Église catholique seule peut sauver le christianisme, et se sauver elle-même en se réformant » [152].
Julie était très liée au père Hyacinthe, qui lui avait été d’un grand secours quand elle avait perdu, à deux années de distance, ses filles Laetitia et Mathilde. Julie l’appuya comme elle pouvait, tout en espérant qu’il se réconcilierait avec l’Église : une de ses amies, la poétesse Augustine-Malvina Blanchecotte, lui écrivit que « la société entière avait l’œil sur vous […] pour tout remettre, tout pacifier, tout ramener » [153].
Après la querelle avec Sainte-Beuve, l’atmosphère chez Mathilde avait changé : les Goncourt se rappelaient que, quand ils étaient entrés dans le cercle des amis de la princesse, on appréciait et on encourageait la liberté de parole et d’opinion, et qu’« il y avait des indépendances courageuses et des personnalités » qui savaient tenir tête aux colères et aux engouements passionnés de Mathilde. Maintenant il n’y avait, disaient les frères, « que des mendiants, des valets, de bas esprits, de bas cœurs, une claque servile » [154]. La princesse restait généreuse et accueillante, mais elle était devenue encore plus absolue, et ne supportait d’être contredite sur rien. Le cercle libre, artistique et joyeux d’avant était devenu à tous les effets une petite Cour, avec ses courtisans et ses favoris, ses hypocrisies et ses mesquineries.
Entre-temps, l’évolution du régime impérial se poursuivait rapidement : Eugène Rouher, le plus influent des ministres de l’Empereur, donna sa démission et Napoléon III nomma un nouveau gouvernement. Le sénatus-consulte du 6 septembre 1869 renforça le pouvoir du Corps législatif. L’Empereur, enfin, dans son discours à l’ouverture des Chambres le 29 novembre 1869, affirma : « La France veut la liberté, mais avec l’ordre. L’ordre, j’en réponds ; aidez-moi à fonder la liberté. » Julie en était enthousiaste (« L’Empire libéral ! Ce fut le rêve de notre exil » [155]) ; Mathilde, pour sa part, craignait que son cousin ne se dessaisît d’une trop grande partie de son pouvoir.
À la fin de décembre, Émile Ollivier fut chargé par l’empereur de former un nouveau gouvernement : presque tous les ministres allaient chez Julie, qui notait dans son journal que son salon était devenu « un petit club » [156]. On en voyait peu chez Mathilde, qui continuait à donner des brillantes soirées, souvent avec la présence du couple impérial (après la fin de sa longue liaison avec Nieuwerkerke, en l’automne 1869, la princesse s’était rapprochée de l’impératrice). Madame Rouher, désolée de l’éloignement du pouvoir de son mari, disait à Julie que le seul salon où l’on pouvait aller c’était « celui de la princesse Mathilde, parce qu’elle ne reçoit pas tous les nouveaux ministres » [157]. Mathilde boudait le gouvernement d’Ollivier et ne parlait pas de politique, mais on voyait bien – écrivit Julie à sa sœur Augusta – qu’elle était « furieuse » [158].
Julie passa un très mauvais moment au début de janvier 1870, quand Pierre Bonaparte (qui était son propre oncle, le frère de son père) assassina le journaliste Victor Noir : « Je ne vois dans tout cela qu’un sujet de Napoléon III tué par un Bonaparte », écrivit-elle désolée dans son journal [159].
Son ami Thiers pensait du bien d’Ollivier (qui le ménageait beaucoup) et du nouveau système libéral, et lui assura que l’Empereur sauvait « sa dynastie en cédant, tandis que Charles X et Louis-Philippe ont perdu la leur en résistant » [160]. Il désapprouva toutefois le plébiscite du 8 mai 1870, qui pourtant se termina avec un beau résultat pour l’Empereur : plus de sept millions de oui. Quelques jours après, le 21 mai, un sénatus-consulte instituait l’Empire libéral.
Le ministère Ollivier dut bientôt affronter ses premières difficultés aux Chambres : Julie commença à avoir des doutes sur Ollivier, qui avait « de l’éloquence, de l’honnêteté tout plein, mais il est dépourvu de l’esprit de suite et il a le grand malheur de ne pas savoir écouter » [161]. Les jours suivants, se profila la question de la candidature prussienne du prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen au trône espagnol ; le 6 juillet, le ministre des Affaires étrangères Gramont déclara à la Chambre que le gouvernement français ne tolérerait pas un roi prussien à Madrid. Le comte de Solms, premier secrétaire de l’ambassade de Prusse, affectait d’aller dans tous les salons : il alla aussi chez Julie, où il déclara « que Prim seul et le roi de la Prusse étaient au courant de cela » [162]. Le 12 juillet, Thiers, venant de la Chambre, dit à Julie qu’on pouvait maintenir la paix si l’Empereur le voulait, que la Prusse retirait la candidature du prince, qu’on était « dans un coupe-gorge » [163], qu’il fallait en sortir.
La déclaration de guerre désespéra Julie : au père Loyson elle dit en pleurant que « l’infaillibilité du Pape [qui avait été proclamée le 18 juillet] et la guerre d’Allemagne feront reculer de 5 ou 6 cent ans la civilisation en Europe » [164]. Le 25 juillet, elle dit adieu aux Tuileries à l’Empereur, qui avait « l’air pensif, mais pas préoccupé » [165] ; ce fut la dernière fois qu’elle le rencontra.
Sous le coup des terribles nouvelles qui arrivaient du front, et face au péril d’une imminente invasion allemande, les semaines suivantes furent pleines d’angoisses pour toute la famille Bonaparte. On conseilla à Julie de retourner en Italie, elle en était atterrée : « Je n’ai pas le courage de quitter ma France bien-aimée, et puis qui sait quand je reviendrai. Mon mari m’établirait à Rome et je ne reverrais plus ce doux pays de France, où l’on cause si bien [166] ! » Mathilde se décida à partir le 4 septembre ; le même jour, Julie quitta Paris pour Rome.
Mathilde, qui au début de la guerre avait eu la plus grande confiance dans la victoire des armées françaises, se déchaîna contre l’Impératrice après la défaite : « elle seule a été la cause de tous nos malheurs », écrivit sur son journal, « cette femme qu’on tient pour vertueuse parce qu’elle n’a pas eu d’amant, a perdu le meilleur et le plus généreux des hommes et avec lui notre pauvre pays. Elle a bouleversé notre société en exagérant le luxe, en donnant l’exemple d’une coquetterie sans bornes, en accordant plus de valeur à l’extérieur des hommes et des choses qu’à leurs qualités réelles [167]. » Elle resta en exil en Belgique jusqu’au printemps 1871, quand elle put rentrer à Paris. Saint-Gratien n’avait heureusement pas été endommagé, et là, ainsi que dans son nouvel hôtel de la rue de Berri, Mathilde accueillit plusieurs de ses vieux amis. Des nouvelles connaissances se joignirent et son salon eut encore une vie très longue, jusqu’à la fin du siècle, aux dernières années de la princesse qui mourut en 1904.
Julie, après quelque temps, ouvrit son salon à Rome, dans son palais de la place Trajane. Elle recevait les amis français de passage, des hommes de lettres et des hommes politiques italiens fidèles à la France, des membres de la noblesse romaine. Son salon, connu et apprécié, n’eut toutefois jamais le même poids que celui de Paris. Julie en effet se tenait éloignée de la nouvelle Cour du Quirinal, et n’approuvait pas la politique pro-allemande du gouvernement italien. Elle ne voulut plus revenir à Paris ; « comment une Bonaparte peut-elle vivre en France », se demandait-elle, « sous un autre régime que sous celui des Napoléons [168] ? »
Notes
-
[1]
Mme Virginie Ancelot (1792-1875), Les salons de Paris. Foyers éteints, Paris : Jules Tardieu, 1858, 2e éd.
-
[2]
Cf. Victor du Bled, La société française du XVIe au XXe siècle, Paris : Perrin, 1905-1913 ; id., La société française depuis cent ans, Paris : Bloud et Gay, 1923 ; Henri d’Almeras, La vie parisienne sous le Règne de Louis-Philippe, Paris : Albin Michel, 1925 ; Maurice Agulhon, Le cercle dans la France bourgeoise. Étude d’une mutation de sociabilité, Paris : Armand Colin, 1977 ; Adeline Daumard, La vie de salon en France dans la première moitié du XIXe siècle, in Étienne François, Sociabilité et société bourgeoise en France, en Allemagne et en Suisse, 1750-1850, Paris : Éditions Recherche sur les Civilisations, 1987, p. 81-92 ; Anne Martin-Fugier, La Vie élégante ou La formation du tout-Paris. 1815-1848, Paris : Seuil, 1993 ; Steven D. Kale, “Women, salons, and the State in the aftermath of the French Revolution”, Journal of women’s history, winter 2002, vol. 13, n. 4, p. 54-80 ; id., “Women, the Public Sphere, and the Persistence of Salons”, French Historical Studies, Winter 2002, vol. 25, No. 1, pp. 115-148
-
[3]
Biographies de Mathilde Bonaparte : Ferdinand Bac, La Princesse Mathilde. Sa vie et ses amis, Paris : Librairie Hachette, 1928 ; Joachim Kühn, La Princesse Mathilde 1820-1904, d’après les papiers de la famille royale de Wurtemberg et autres documents inédits, Paris, Plon, 1935 ; A. Augustin-Thierry, La Princesse Mathilde, Notre-Dame des Arts, Paris : Albin Michel, 1950 ; Marguerite Castillon du Perron, La princesse Mathilde, Paris : Perrin, 1963 ; Joanna Richardson, Princess Mathilde, London & New York: Weidenfeld & Nicolson, 1969 ; Jean des Cars, La princesse Mathilde. L’amour, la gloire et les arts, Paris : Perrin, 1988 ; Jean-Claude Lachnitt, La princesse Mathilde, in Grandeur et crépuscule des salons littéraires, Actes du colloque, Paris le 25 avril 2001, Fondation Singer-Polignac, Paris : Les Éditions de la Bouteille à la Mer, 2002 ; Jérôme Picon, Mathilde, princesse Bonaparte, Paris : Flammarion, 2005.
-
[4]
Mathilde Bonaparte, « Souvenirs des années d’exil », in Revue des deux mondes, 15 décembre 1927, pp. 721-752 ; 1er janvier 1928, pp. 76-105 ; 15 janvier 1928, pp. 359-386. 2e partie, p. 92.
-
[5]
Ibid., p. 101.
-
[6]
Ibid., 3e partie, p.386.
-
[7]
Il n’y a pas encore de biographies de Julie, mais son journal, intitulé Notes et souvenirs, a été en partie publié en La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine et son temps. Mémoires inédits (1853-1870), a cura di Isa Dardano Basso, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1975.
-
[8]
Horace de Viel-Castel, Mémoires sur le règne de Napoléon III (1851-1864), publiés d’après le manuscrit original et ornés d’un portrait de l’auteur, Paris : chez tous les libraires, 1883, vol. I, p. 34, 11 février 1851.
-
[9]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 26
-
[10]
Horace de Viel-Castel, op. cit., p. 57, 23 février 1851.
-
[11]
Ibid., p. 161, 15 juillet 1851.
-
[12]
Lettre d’Achille Jubinal à Mme Léotard, in M. Foresi, “Di un principe russo e di una principessa napoleonica”, Nuova Antologia, 1915, 177, juin, pp. 587-606, p. 593.
-
[13]
Baron Eugène Beyens, Le Second Empire vu par un diplomate belge, Bruges, Desclée de Brouwer ; Plon 1924-1926, vol. I, p. 419.
-
[14]
Pour la Cour du Second Empire, cf. Pierre de Lano, La Cour de Napoleon III : le secret d’un Empire, Paris : V. Harvard, 1892 ; Arthur-Léon Imbert de Saint-Amand, Les femmes des Tuileries. Napoléon III et sa Cour, Paris : Dentu, 1897 ; Ferdinand Bac, La Cour des Tuileries, Paris : Hachette, 1930 ; Ferdinand Bac, Intimités du Second Empire. La Cour et la Ville, d’après des documents contemporains, Paris : Hachette, 1931 ; André Bellessort, La société française sous Napoléon III, Paris : Perrin, 1932, 3e ed. ; Frédéric Lollié, Les femmes du Second Empire. La cour des Tuileries, Paris : Tallandier, 1954 ; Général de Cossé Brissac, « La vie à la Cour des Tuileries sous Napoléon III », Souvenir Napoléonien, n° 298, 1978, pp. 33-40 ; Jean-Marie Moulin, « La Cour à Compiègne sous le Second Empire », Souvenir Napoléonien, n° 300, 1978, pp. 17-23 ; Charles Otto Zieseniss, La Cour impériale, Paris : Tallandier, 1980.
-
[15]
Pour les salons du Second Empire, cf. Edmond Beau de Loménie, Les dynasties bourgeoises et la fête impériale, Paris : Sequana, 1942 ; Maurice Allem, La vie quotidienne sous le Second Empire, Paris : Hachette, 1948 ; Giacomo Cavallucci, Les derniers grands salons littéraires français, Naples-Paris : Pironti, 1952 ; Laure Rièse, Les salons littéraires parisiens du Second Empire à nos jours, Toulouse : Privat, 1962 ; K. O’Meara, Un salon à Paris, Mme Mohl et ses intimes, Paris, Plon, 1886 ; Marie-Elmina Smith, Une anglaise intellectuelle en France sous la Restauration. Miss Mary Clarke, Paris : Honoré Champion, 1927.
-
[16]
Les lettres de Thiers à Julie ont été publiées par I. Dardano Basso, « Lettere inedite di Thiers alla principessa Giulia Bonaparte Roccagiovine, Trimestre, marzo-giugno 1972, pp. 19-71.
-
[17]
Lettre de Billault à Julie de « Mardi 1857 », ibid.
-
[18]
Lettre de Julie à Billault, « Samedi minuit été 1857 », ibid.
-
[19]
Lettre de Billault à Julie de « 1858 », ibid.
-
[20]
Émile Ollivier, « Thiers et les élections de 1863 », La Revue des deux mondes, mai 1901, pp. 763-798, pp. 792-793.
-
[21]
Lettre de Julie à son mari, Museo Napoleonico de Rome, 11 décembre [1859].
-
[22]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., pp. 101-102, novembre 1858.
-
[23]
Lettre de Jean-Baptiste Henri Lacordaire à Julie, 30 janvier 1859, Museo Napoleonico de Rome.
-
[24]
Lettre de Julie à Billault de Dieppe, 18 août [1857], Archives départementales de la Haute-Loire (Nantes) 20 Fonds Billault J. Liasse 55.
-
[25]
Lettre de Julie à son mari, 17 décembre 1859, Museo Napoleonico de Rome.
-
[26]
Mathilde Bonaparte, Souvenirs des années d’exil, op. cit., Ire partie, p. 734.
-
[27]
Ms Notes et Souvenirs, 7 janvier 1863.
-
[28]
Cf. Papiers et correspondance de la famille impériale, Paris : Garnier, 1875, tome Ier, p. 68.
-
[29]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 485, et Ms Notes et Souvenirs, 22 décembre 1869.
-
[30]
Mémoires de Mathilde, manuscrits, cités par Marguerite Castillon du Perron, La princesse Mathilde, op. cit., p. 175.
-
[31]
Horace de Viel-Castel, Mémoires sur le règne de Napoléon III, op. cit., vol. III, p. 150, 25 mai 1855.
-
[32]
Mémoires de Mathilde, manuscrits, op. cit., p. 176.
-
[33]
Lettre de Thiers à Julie du 2 octobre 1860, in Lettere inedite di Thiers, op. cit., p. 41.
-
[34]
Lettre de Lacordaire à Julie, 1er décembre 1859, Museo Napoleonico de Rome.
-
[35]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 106.
-
[36]
Ibid., p. 115, 17 juillet 1859.
-
[37]
Cf. lettre de Julie à son mari, 8 janvier 1860, Museo Napoleonico de Rome. Le Pape et le Congrès avait été publié par Arthur de la Guéronnière (en accord avec l’Empereur) le 22 décembre 1859.
-
[38]
Lettre de Julie à son mari, 15-16 janvier 1860, Museo Napoleonico de Rome.
-
[39]
Cf. lettre de Julie à son mari, 18 janvier 1862, Museo Napoleonico de Rome.
-
[40]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 152, 9 février 1862.
-
[41]
Lettre de Billault à Julie, 8 juin 1862, Archives départementales de la Haute-Loire (Nantes) 20 Fonds Billault J. Liasse 56.
-
[42]
Lettre de Billault à Julie, 18 juillet 1862, ibid.
-
[43]
Lettre de Billault à Julie, 16 septembre 1862, ibid.
-
[44]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 126, novembre 1860.
-
[45]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., pp. 138-139, 17 août 1861.
-
[46]
Cf. Prosper Mérimée, « Lettres à la princesse Mathilde 1860-1870 », La Revue de Paris, 15 juin 1922, pp. 673-706.
-
[47]
Nassau William Senior, Conversations with Mr. Thiers, M. Guizot, and other distinguished persons, during the Second Empire, London: Hurst and Blackett, 1878, vol. II, p. 143, May 8th, 1857.
-
[48]
Cf. Pierre Pellissier, Prosper Mérimée, Paris : Tallandier, 2009, pp. 379-382.
-
[49]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., pp. 183-184, 10 juin 1863.
-
[50]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 194, 5 décembre 1863.
-
[51]
Cf. La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 127, décembre 1860.
-
[52]
Prosper Mérimée, « Lettres à la Princesse Julie (1863-1870) », La Revue de Paris, Ire partie, 1er juillet 1894, pp. 9-32, lettre du 27 octobre 1863, p. 13.
-
[53]
Ibid., lettre du 5 décembre [1863], p. 17.
-
[54]
Charles-Augustin Sainte-Beuve, « La Princesse Mathilde », Causeries du Lundi, 3 juillet 1862, Paris, Garnier Frères, s.d., 3e éd., tome XI, pp. 389-400.
-
[55]
Ibid., pp. 389-391.
-
[56]
Ibid., p. 396.
-
[57]
Ibid., p. 398.
-
[58]
Ibid., p. 399.
-
[59]
Le portrait, écrit en 1868, fut publié seulement plusieurs années plus tard par Le Gaulois du lundi 20 août 1894, sous le titre de « La Princesse Araminte (Julie Bonaparte) ».
-
[60]
Alfred Maury, Mémoires, Bibliothèque de l’Institut de France, Ms 2647-2656, n. 2650, vol. IV (1860-1864), p. 446.
-
[61]
Lettre d’Emmanuel Miller à Julie Bonaparte de Roccagiovine du 13 mai 1867, Institut de France, CCVI 31.
-
[62]
Edmond et Jules de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire, Paris : Robert Laffont, 1956, vol. II, 1866-1886, p. 14, 1er avril 1868.
-
[63]
Alfred Maury, Mémoires, op. cit., vol. IV, p. 447.
-
[64]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 292, 22 juin 1866, et p. 393, 13 mai 1868.
-
[65]
Julie Bonaparte de Roccagiovine, Pensées I (1859-1866), Museo Napoleonico de Rome, n° 289.
-
[66]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 213, 3 mai 1864.
-
[67]
Ibid., p. 217, 4 juin 1864.
-
[68]
Julie Bonaparte de Roccagiovine, Pensées I (1859-1866), Museo Napoleonico de Rome, Essais de critique.
-
[69]
Julie Bonaparte de Roccagiovine, Pensées I (1859-1866), Museo Napoleonico de Rome, n° 24.
-
[70]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 217, 4 juin 1864 et p. 302, 10 août 1866.
-
[71]
Ibid., p. 345, 3 avril 1867.
-
[72]
Ibid., p. 390, 22 avril 1868.
-
[73]
Ibid., p. 398, 5 juin 1868.
-
[74]
Lettre de Flaubert à Jules Duplan, samedi 14 mars 1868, éd. électronique : http://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/conard/outils/1868.htm
-
[75]
Lettre de Julie à son mari, 12 mai 1862, Museo Napoleonico de Rome.
-
[76]
Lettre de Julie à son mari, 16 avril 1862, Museo Napoleonico de Rome
-
[77]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 330, 9 janvier 1867.
-
[78]
Ibid., p. 359, 10 juin 1867.
-
[79]
Lettre de Charles Giraud à Julie Bonaparte de Roccagiovine, s.d., Museo Napoleonico de Rome.
-
[80]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 289, 1er juin 1866.
-
[81]
Edmond et Jules de Goncourt, Journal, op. cit., vol. II, 1866-1886, p. 167, 7 août 1868.
-
[82]
Alfred Maury, Mémoires, op. cit., n. 2650, vol. IV (1860-1864), p. 447.
-
[83]
Pauline de Metternich, « Je ne suis pas jolie, je suis pire ». Souvenirs 1859-1871, Paris : Tallandier, 2008, p. 163.
-
[84]
Horace de Viel-Castel, Mémoires sur le règne de Napoléon III (1851-1864), op. cit., vol. III, 1854-1856, p. 260, 15 juillet 1856.
-
[85]
Ibid., vol. IV, p. 332, 23 octobre 1858.
-
[86]
Ibid., vol. VI, 1860-1864, pp. 210-211, 21 avril 1863.
-
[87]
Cit. in Marguerite Castillon du Perron, La princesse Mathilde, op. cit., p. 184.
-
[88]
Lettre de Sainte-Beuve à Mathilde, jeudi 22 décembre 1864, in Charles-Augustin Sainte-Beuve, Correspondance générale, recueillie, classée et annotée par Jean Bonnerot, Paris, Toulouse : Privat, Didier, tome XIII, 1963, p. 677.
-
[89]
Lettre de Sainte-Beuve à Mathilde, 26 juin [1865], in Correspondance, op. cit, tome XIV, 1964, p. 254.
-
[90]
Lettre de Sainte-Beuve à Mathilde, 7 mars 1867, in Correspondance, op. cit., tome XXVI, 1970, p. 125.
-
[91]
Lettre de Flaubert à la princesse Mathilde, jeudi [février 1866], éd. électronique : http://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/conard/outils/1866.htm
-
[92]
Lettre de Flaubert à la princesse Mathilde, dimanche [mars 1867], éd. électronique : http://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/conard/outils/1867.htm
-
[93]
Edmond et Jules de Goncourt, Journal, op. cit., vol. 1, 1851-1865, p. 843, 16 août 1862.
-
[94]
Ibid., p. 901, 13 décembre 1862.
-
[95]
Ibid., p. 1184, 16 août 1865.
-
[96]
Ibid., p. 901, 13 décembre 1862.
-
[97]
Préface de Joseph Primoli à Ernest Renan, Lettres à la princesse Julie, op. cit., p. 725.
-
[98]
Edmond et Jules de Goncourt, Journal, op. cit., p. 1132, 18 janvier 1865.
-
[99]
Ibid., vol. II, 1866-1886, p. 202, 17 février 1869.
-
[100]
Ibid., pp. 39-40, 1 octobre 1866.
-
[101]
Ibid., p. 91, 27 juin 1867.
-
[102]
Ibid., p. 102, 5 août 1867.
-
[103]
Ibid., vol. I, 1851-1865, p. 1066, 13 avril 1864.
-
[104]
Ibid., vol. II, 1866-1886, p. 128, 21 janvier 1868.
-
[105]
Julie Bonaparte de Roccagiovine, Fragments I (1844-1870), Museo Napoleonico de Rome, juillet 1866.
-
[106]
Préface de Joseph Primoli à Ernest Renan, Lettres à la princesse Julie, op. cit., p. 724.
-
[107]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 272, 20 février 1866.
-
[108]
Lettre d’Hortense Cornu à Julie Bonaparte du 25 janvier 1867 (inv. 8112), Museo Napoleonico de Rome.
-
[109]
Mémoires de Madame Dosne, l’égérie de M. Thiers, Paris : Plon, 1928, vol. II, pp. 312-313.
-
[110]
Alfred Maury, Mémoires, op. cit., n. 2650, vol. IV (1860-1864), p. 424.
-
[111]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 374, 28 décembre 1867.
-
[112]
Ibid., p. 351, 18 avril 1867.
-
[113]
Ibid., p. 329, 3 janvier 1867.
-
[114]
Lettre de Napoléon Jérôme à Julie Bonaparte du 15 janvier 1864, Museo Napoleonico de Rome.
-
[115]
Lettre de Napoléon Jérôme à Julie Bonaparte du 10 février 1864, Museo Napoleonico de Rome. Cf. aussi Mémoires de Madame Dosne, op. cit., vol. II, pp. 278-280.
-
[116]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 484, 16 décembre 1869.
-
[117]
Ms Notes et Souvenirs, 5 octobre 1869.
-
[118]
Lettre de Renan à Julie d’Athènes du 16 mars 1865, in Renan, Lettres à la princesse Julie, op. cit., p. 734.
-
[119]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 258, 12 août 1865.
-
[120]
Cf. I. Dardano Basso, “Lettere inedite di Sainte-Beuve alla principessa Giulia Bonaparte e ai conti Primoli”, Studi francesi, n° 22, 1964, pp. 68-78.
-
[121]
Cf. lettre de Julie Bonaparte à Sainte-Beuve du 15 juin 1868, Institut de France, Fonds Spoelberch de Lovenjoul, 806, (D 598) tome II.
-
[122]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 353, 24 avril 1867.
-
[123]
Lettre de Sainte-Beuve à Julie Bonaparte du 16 juin 1868, copie à l’Institut de France, Fonds Spoelberch de Lovenjoul, 797 (D 593) tome III, publiée in Correspondance, op. cit., tome XVII, 1975, pp. 383-384.
-
[124]
Lettre de Julie Bonaparte à Sainte-Beuve du 17 juin 1868, Institut de France, Fonds Spoelberch de Lovenjoul, 806 (D 598) tome II.
-
[125]
Sainte-Beuve, Dossiers littéraires, Fond Spoelberch de Lovenjoul, Institut de France, 768 (D 567) XXX.
-
[126]
Lettre de Sainte-Beuve à Mathilde du 16 juin 1868, in Correspondance, op. cit., tome XVII, 1975, p. 386.
-
[127]
Cit. in Marguerite Castillon du Perron, La princesse Mathilde, op. cit., p. 191.
-
[128]
Lettre de Flaubert à Mathilde du 27 juin 1868, éd. électronique : http://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/conard/outils/1868.htm
-
[129]
Edmond et Jules de Goncourt, Journal, op. cit., vol. II, 1866-1886, p. 157, 18 juin 1868.
-
[130]
Lettre de Mérimée à Julie Bonaparte du 30 juin 1868, in Prosper Mérimée, Lettres à la Princesse Julie, cit., 2e série, pp. 263-264.
-
[131]
Lettre de Mérimée à la comtesse de Montijo du 14 juillet 1868, in Prosper Mérimée, Correspondance générale, Paris : Le Divan, 1941-1964, vol. XIV, p. 181.
-
[132]
Lettre de Mérimée à madame de Beaulaincourt du 17 juillet 1868, ibid., p. 192.
-
[133]
Lettre de Mérimée à la comtesse de Montijo du 14 juillet 1868, op. cit.
-
[134]
Lettre de Sainte-Beuve à Jeanne de Tourbey, 3 ou 8 juillet 1868, in Correspondance, op. cit., tome XVIII, 1975, p. 36.
-
[135]
Lettre de Sainte-Beuve à Jeanne de Tourbey du 11 juillet 1868, in Correspondance, op. cit., tome XVIII, 1975, p. 46.
-
[136]
Lettre d’Emmanuel Miller à Julie Bonaparte du 5 août 1868, Institut de France, CCVI 34.
-
[137]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 408, 2 août 1868.
-
[138]
Julie Bonaparte, Pensées II (1868-1889), Museo Napoleonico de Rome, n. 481.
-
[139]
Edmond et Jules de Goncourt, Journal, op. cit., vol. II, 1866-1886, p. 191, 6 janvier 1869.
-
[140]
Ibid., p. 194, 13 janvier 1869.
-
[141]
Ibid., p. 192, 6 janvier 1869.
-
[142]
Lettre de Flaubert à Mathilde de jeudi [janvier 1869], éd. électronique : http://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/conard/outils/1869.htm
-
[143]
Lettre de Flaubert à George Sand du 2 février 1869, éd. électronique : http://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/conard/outils/1869.htm
-
[144]
Lettre de Mérimée à Mathilde du 16 janvier 1869, in P. Mérimée, Lettres à la princesse Mathilde, op. cit., pp. 700-701.
-
[145]
Lettre de Sainte-Beuve à Mr de Lescure du 6 janvier 1869, in Correspondance, op. cit., tome XVIII, p. 345.
-
[146]
Lettre de Mathilde à Sainte-Beuve du 16 janvier 1869, in Marguerite Castillon du Perron, La princesse Mathilde, op. cit., p. 196.
-
[147]
Cit. in Marguerite Castillon du Perron, La princesse Mathilde, op. cit., pp. 197-198.
-
[148]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 431, 24 février 1869.
-
[149]
Lettre de Mérimée à Gobineau du 12 septembre 1869, in Prosper Mérimée, Correspondance générale, op. cit., vol. XIV, p. 612.
-
[150]
Alfred Maury, Mémoires, op. cit., n. 2651, vol. V, pp. 398-399.
-
[151]
Lettre de Hyacinthe Loyson à Julie du 20 août 1869, Museo Napoleonico de Rome, n. 1041.
-
[152]
Lettre de Hyacinthe Loyson à Julie du 6 mars 1867, Museo Napoleonico de Rome n. 1018.
-
[153]
Lettre d’Augustine-Malvina Blanchecotte à Julie du 4 octobre 1869, Museo Napoleonico de Rome.
-
[154]
Edmond et Jules de Goncourt, Journal, op. cit., vol. II, 1866-1886, p. 234, 15 août 1869.
-
[155]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 490, 5 janvier 1870.
-
[156]
Ms Notes et Souvenirs, 24 décembre 1869.
-
[157]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 501, 15 février 1870.
-
[158]
Lettre de Julie à Augusta Gabrielli du 6 janvier 1869 [mais 1870], Museo Napoleonico de Rome.
-
[159]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 491, 10 janvier 1870.
-
[160]
Ibid., p. 499, 3 février 1870.
-
[161]
Ibid., pp. 523-524, 24 juin 1870.
-
[162]
Ibid., p. 530, 8 juillet 1870.
-
[163]
Ibid., p. 531, 12 juillet 1870.
-
[164]
Lettre de Hyacinthe Loyson à Julie du 25 octobre 1870, Museo Napoleonico de Rome, n. 1044.
-
[165]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 535, 25 juillet 1870.
-
[166]
Ibid., p. 549, 27 août 1870.
-
[167]
Cit. in Marguerite Castillon du Perron, La princesse Mathilde, op. cit., p. 226.
-
[168]
La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine, op. cit., p. 550, 28 août 1870.