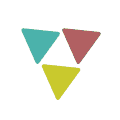1 Mme Rebecca Legendre livre dans sa thèse (Droits fondamentaux et droit international privé. Réflexions en matière personnelle et familiale) une analyse consacrée à une thématique d’une actualité aussi grande que sont importants les enjeux pour le droit international privé et la théorie générale du droit. Le travail, ayant obtenu de nombreuses récompenses scientifiques, apporte des éclaircissements cruciaux sur l’incidence des droits fondamentaux pour le droit international privé. Par la grande hauteur de vue avec laquelle est menée la réflexion, la thèse enrichit la compréhension de notions essentielles du droit contemporain, en commençant par le concept de droits fondamentaux, mais en interrogeant également le rôle du juge pour le droit international privé et pour la théorie générale du droit, et en permettant de prendre la mesure des relations entre ordres juridiques européens (droit de la Convention EDH et droit de l’Union européenne) et français.
2 L’introduction est, à l’instar de l’ensemble de la thèse, synthétique, fluide et efficace. Certaines exclusions sont sans doute moins justifiées que ce que l’auteure affirme (notamment l’exclusion des règles de compétence internationale directe et, dans une moindre mesure, les règles ne relevant pas de la matière personnelle et familiale). Méthodologiquement, ces exclusions n’en sont pas moins nécessaires pour permettre une démonstration opératoire par la suite, autour d’un objet de recherche judicieusement circonscrit. L’objectif, in fine, est ainsi de « préciser la notion et le régime des droits de l’homme, de clarifier leurs soubassements philosophiques et leurs implications méthodologiques » (p. 11). Le travail porte donc une ambition majeure, pour laquelle la confrontation du droit international privé aux droits de l’homme (notion utilisée comme synonyme de droits fondamentaux), dans le domaine personnel et familial, et à l’exclusion de la compétence internationale directe, constitue un objet d’étude particulier permettant de conduire une analyse scientifiquement rigoureuse.
3 Le défi immense que s’est donné Mme Legendre consiste à articuler les implications des droits fondamentaux pour le droit international privé autour, d’une part, d’une recherche consacrée au « problème de droit international privé », et, d’autre part, d’une recherche dédiée aux « solutions de droit international privé ».
4 La première partie portant sur les liens des droits fondamentaux avec le problème de droit international privé analyse comment ces droits fondamentaux font évoluer les données de ce problème et transforment son analyse. L’évolution des données du problème repose principalement sur le renouvellement des modes de connexion entre ordres juridiques par les droits fondamentaux et par la promotion de la mobilité internationale des personnes. En ce qui concerne les premiers, au-delà de la connexion normative, ce sont surtout les connexions conceptuelle et fonctionnelle qui méritent d’être relevées. La connexion conceptuelle des ordres juridiques permet à Mme Legendre de proposer une « définition stipulative à vocation universelle » des droit fondamentaux, entendus comme « les valeurs essentielles à l’existence et au développement de la personne humaine énoncées sous la forme de principes et inscrites dans une source supra législative » (p. 30). La connexion fonctionnelle prolonge cette définition par une concrétisation autour d’une méthodologie partagée, ou en tout cas une commune « pratique juridique des droits de l’homme dans les ordres juridiques étatiques » (p. 33). Cette pratique se décline de quatre manières principales (la validation de certaines règles, leur possible neutralisation, l’interprétation des normes et le fait de compléter les normes élaborées), par lesquelles « les ordres juridiques étatiques partagent, désormais, une pratique juridique novatrice qui met en lumière le pouvoir du juge de contrôler, au stade de leur application, les normes élaborées par le législateur » (p. 34). Par où l’on voit aussi toute l’importance de la mise en œuvre des droits fondamentaux pour leur bonne compréhension, et le rôle indispensable du juge.
5 La connexion normative s’accompagne d’une connexion juridictionnelle entre ordres juridiques. L’analyse de cette dernière appréhende les liens entre ordres juridiques résultant d’une compréhension de la juridiction dans sa fonction normative, ce qui laisse donc de côté l’analyse de l’intervention du juge dans sa fonction individuelle. Cette importance conférée à la dimension normative de l’activité juridictionnelle est révélatrice d’un parti pris important et très fertile de la recherche. Il s’agit d’appréhender la jurisprudence comme source formelle du droit et de mieux comprendre les manifestations et conséquences de cette nouvelle source du droit. Mme Legendre n’hésite ainsi pas à évoquer « le pouvoir normatif dont dispose désormais expressément le juge grâce aux droits fondamentaux » (p. 50). Les droits fondamentaux viennent ainsi encadrer l’indépendance des ordres juridiques nationaux. Mais loin de supprimer le problème de droit international privé en imposant une solution matérielle unique, les droits fondamentaux conduisent à un « repositionnement du droit international privé » (p. 47), chargé aussi du problème de coordination des différents ordres juridiques dans trois dimensions : coordination des ordres juridiques supranationaux protecteurs de droits fondamentaux, coordination horizontale des ordres juridiques étatiques et coordination verticale des ordres juridiques supranationaux et étatiques.
6 Par la connexion normative réalisée, les droits fondamentaux conduisent à des « rapprochements significatifs » (p. 48) entre ordres juridiques, par une convergence aussi bien structurelle que substantielle. Cette analyse est tout à fait juste si l’on garde une perspective normative des droits fondamentaux. Pour les solutions individuelles toutefois, les rapprochements réalisés par les droits fondamentaux ne lèvent pas toutes les inquiétudes : comment coordonner en effet la diversité des ordres juridiques si la réponse du juge répond à une logique substantielle des droits fondamentaux ? Mme Legendre modère ces inquiétudes, puisque les droits fondamentaux constituent aussi « un moyen pour affirmer et revendiquer [le] particularisme [des ordres juridiques étatiques] » (p. 53). La diversité des ordres juridiques reste donc maintenue, y compris au nom des droits fondamentaux.
7 La contribution des droits fondamentaux à la mobilité internationale des personnes est discutée plus rapidement par l’auteure. Ce que l’on relèvera surtout, c’est que, vis-à-vis des personnes ayant les moyens de bénéficier de la mobilité internationale ou européenne, les droits fondamentaux conduisent à une « dérégulation de la mobilité [qui] incite, par conséquent, à la dérégulation du droit international privé » (p. 67). Le mouvement est donc bien celui d’une libéralisation du droit international privé, et par là un renforcement du pouvoir individuel vis-à-vis d’un contrôle étatique, ce qui n’est pas sans paradoxe compte tenu du point de départ qui est un contrôle accru des droits fondamentaux. Il n’est pas certain en effet, et Mme Legendre ne le soutient nullement, que les droits fondamentaux puissent se résumer à la seule défense de la liberté individuelle.
8 Mme Rebecca Legendre étudie ensuite la transformation de l’analyse du problème de droit international privé, que ce soit au regard de la redéfinition des termes du problème ou de ses enjeux. L’intégration des exigences tirées des droits fondamentaux conduit ainsi à une confrontation de l’intérêt général, y compris en ce qu’il protège des intérêts individuels, avec l’intérêt de la personne. Et cette reconnaissance de la place qu’occupe l’intérêt de la personne dans le raisonnement et l’office du juge constitue bien un changement majeur de perspective. Parmi les implications de ce changement de perspective, le déplacement du pouvoir normatif vers le juge, qui « doit […] refaire un jugement de valeur » (p. 88) est radical. La mission du juge n’est plus, ou en tout cas plus seulement, de trancher un litige, mais de « défaire, et éventuellement […] refaire les choix assumés par la discipline et consignés dans sa réglementation » (ibid.). Cela conduit à se demander si les droits fondamentaux ne conduisent pas, purement et simplement, à la disparition du droit international privé, « l’interne et l’international [étant] envisagés en des termes et dans une configuration identiques » (p. 94). La discipline serait ainsi remplacée par une approche « intuitive » de l’internationalité, caractéristique de l’action de la CEDH. Mais le changement de perspective ne conduit pas nécessairement à un changement de paradigme, la discipline pouvant résister, par les solutions prises à l’issue du contrôle juridictionnel du respect des droits fondamentaux, au changement consistant ne plus raisonner en termes de conflit d’ordres juridiques, mais de conflit de valeurs.
9 Au regard des enjeux du problème de droit international privé, les droits fondamentaux viennent en effet, selon Mme Legendre, renforcer et compléter les objectifs du droit international privé. La cohésion de l’ordre juridique du for, la continuité des situations juridiques, et même la place de la personne humaine (autour du respect dû à l’étranger de Werner Goldschmidt) sont des objectifs fondateurs du droit international privé que les droits fondamentaux confirment, tout en en renouvelant la compréhension précise. Autour de la protection de la personne humaine, notamment, la thèse de Mme Rebecca Legendre constitue une œuvre magistrale de démonstration de l’importance de la primauté de la personne humaine pour les droits fondamentaux, et pour le droit en général. C’est ainsi « seulement dans la protection de la personne humaine que les droits de l’homme trouveront leur salut et rempliront pleinement la fonction qui est la leur » (p. 121), tout en veillant à ne pas verser dans l’individualisme et en restant dans le personnalisme. Celui-ci implique que les droits fondamentaux constituent à la fois une protection contre autrui (puissance publique et particuliers) et une protection contre soi-même, pour préserver les valeurs essentielles à l’existence et au développement de la personne humaine. Quant au droit international privé, « en assurant la primauté de la personne humaine, la discipline renoue […] avec sa dimension humaniste » (p. 122).
10 La reconnaissance de la primauté de l’intérêt de la personne risque certes de conduire à une remise en cause des équilibres traditionnels du droit international privé, notamment parce que cette primauté « est nécessairement relative » (p. 134) et repose sur « une pondération des intérêts pouvant varier en fonction des espèces » (p. 135). Mais n’est-ce pas là une des fonctions majeures des droits fondamentaux que de provoquer une continuelle remise en cause des équilibres établis, pour s’assurer de leur adéquation au regard des objectifs inhérents aux droits fondamentaux, et au premier rang de ceux-ci la protection de la personne humaine ? Mme Rebecca Legendre livre en effet un plaidoyer cohérent pour justifier la pertinence d’une telle intégration des droits fondamentaux dans le système et le raisonnement juridiques, autour du « personnalisme qui intègre à la fois une dimension individuelle et une dimension collective dans la protection des droits fondamentaux » (p. 133-4).
11 La seconde partie s’intéresse à la manière dont les droits fondamentaux affectent l’application des solutions du droit international privé. Il s’agit, tout d’abord, d’analyser comment les droits fondamentaux perturbent ces solutions, avant de voir, ensuite, comment les rationaliser.
12 La perturbation résulte de l’avènement de la technique de proportionnalité dans le droit international privé personnel et familial, à laquelle il faut reconnaître une place parmi les raisonnements à tenir en droit international privé. La proportionnalité se pose ainsi comme principe matriciel du droit international privé. L’auteure analyse ensuite la relation entre la proportionnalité et les méthodes de droit international privé, pour en relever l’incidence finalement limitée. C’est au regard des solutions de droit international privé que l’incidence de la proportionnalité se fait véritablement marquante.
13 Il est rassurant à cet égard que les droits fondamentaux interviendront souvent au profit de la continuité des situations juridiques. Au-delà de ce renforcement de solutions garantissant la continuité des situations juridiques, Mme Legendre démontre que les solutions résultant des droits fondamentaux ont une nature variable, reposant sur le concept d’obligation juridique pesant sur l’État, à l’exclusion du droit fondamental ou du droit subjectif du justiciable, qui verseraient dans des « droits à » incompatibles avec la conception équilibrée qu’a l’auteure des droits fondamentaux, selon laquelle ces derniers protègent la personne humaine, mais non l’individu.
14 Face à la variabilité de l’influence de la proportionnalité, qui résulte notamment de la relativité du contrôle concret de proportionnalité et de l’« hypercontextualisation » (p. 227) des droits fondamentaux, Mme Rebecca Legendre clôt son analyse par la rationalisation de l’application contentieuse des droits fondamentaux et de la technique de proportionnalité. Il s’agit de discuter d’abord les faiblesses et les vertus du contrôle de proportionnalité, pour ensuite formuler des propositions concrètes permettant de réduire les premières et de conserver les secondes. Les droits fondamentaux privilégient ainsi la continuité des situations juridiques internationales aux dépens de la cohésion de l’ordre interne, dans un sens de libéralisation des solutions de droit international privé.
15 Mme Rebecca Legendre identifie également les faiblesses du contrôle de proportionnalité, principalement du côté d’un manque de légitimité et d’une perte de prévisibilité. C’est ainsi notamment autour d’« un pouvoir prétorien contestable » (p. 233) que le sentiment de légitimité se dérobe. À ce titre, l’étude permet de mettre en exergue toute la contradiction dans laquelle se trouve le juge. Celui-ci doit appliquer la Convention EDH (et donc exercer son « devoir d’interpréter, de compléter et d’adapter la loi », p. 247), sans pour autant empiéter sur le pouvoir du législateur. Il s’agit d’une immixtion dans les affaires de ce dernier, toute la question étant de savoir si elle se fait dans l’intérêt du législateur, pour assurer une meilleure justice, ou aux dépens du législateur, pour remettre en cause son jugement de valeur. Or, le juge s’arroge aujourd’hui le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la loi au nom des droits fondamentaux, sans en avoir été investi par une délibération collective explicite. À ce manque de légitimité congénitale s’ajoutent les « promesses intenables » des droits de l’homme, conjuguées à leur inflation, qui condamnent les droits fondamentaux à l’ineffectivité, et par là à une défiance inévitable des justiciables. En faisant perdre la légitimité du droit inhérente au mythe de la neutralité politique du droit, « les droits fondamentaux sont porteurs d’une crise de légitimité généralisée ouvrant la voie à des sociétés désenchantées » (p. 253).
16 La technique des droits fondamentaux en droit international privé souffre donc d’une faiblesse politique majeure, à laquelle s’ajoute en outre une faiblesse juridique au moins aussi grave. Les droits fondamentaux conduisent en effet à une perte de prévisibilité des solutions, menaçant « l’autorité du droit » (p. 257). L’objectif de protection de la personne humaine, qui fonde l’intervention du juge au titre des droits fondamentaux, mérite certainement d’être davantage intégré dans les objectifs poursuivis par la loi et ses solutions, pour ne pas faire peser sur le seul juge la tâche de faire respecter cet objectif. L’insécurité pourrait donc certainement être combattue par le législateur sans priver le juge d’un rôle de garde-fou ultime au service de la défense de la personne humaine.
17 À l’inquiétant exposé des faiblesses du contrôle de conventionnalité succède une analyse des vertus du contrôle de proportionnalité, dont le mérite majeur est de démontrer la compatibilité, voire l’utilité, de ce contrôle vis-à-vis des objectifs et méthodes de droit international privé. Les droits fondamentaux permettent ainsi d’éliminer les règles abstraitement ou concrètement incompatibles avec l’ordre juridique du for, que ce soit parce que ces règles sont « odieuses », en tant que leur énoncé transgresse la conception européenne des droits fondamentaux, ou parce qu’elles sont « imparfaites », en tant que leur application leur porte une atteinte disproportionnée. De manière plus importante encore, les droits fondamentaux permettent non seulement d’identifier les situations de réalisation de la communauté de droit, mais surtout de dépasser celle-ci. Le contrôle concret de proportionnalité peut constituer ainsi un des outils d’ouverture juridique du droit français et européen.
18 Faiblesses et vertus ainsi identifiées, il ne restait plus que trouver les moyens de réaliser ces dernières, tout en parvenant à « gagner en légitimité et réussir, surtout, à ménager la sécurité juridique » (p. 271) pour surmonter les faiblesses du contrôle de proportionnalité. Il s’agit, d’abord, d’ériger l’application des droits fondamentaux en méthode de droit international privé propre, dissociée du mécanisme d’ordre public international. Il s’agit, ensuite, de corriger la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité, en cantonnant le contrôle de proportionnalité. Ce contrôle doit également être modéré, dans une triple perspective de contrôle des violations manifestes, de substitution du contrôle procédural au contrôle substantiel, et de recours à la présomption de protection équivalente des droits fondamentaux. L’exercice du contrôle doit passer selon l’auteure par une « nationalisation du contrôle » (p. 302), tout en s’accompagnant d’une meilleure rationalisation de ce contrôle, par l’adoption d’une méthodologie commune aux ordres juridiques et l’amélioration de la motivation des décisions de justice. Nationalisation et rationalisation ressortent ainsi comme moyens de rendre le contrôle de proportionnalité légitime et opportun.
19 La brève et percutante conclusion permet de revenir sur les points essentiels de la démonstration et de la construction de Mme Rebecca Legendre. Si les droits fondamentaux érodent le paradigme de droit international privé, ils n’en provoquent pas la rupture. Et tout l’enjeu est de reconceptualiser le droit international privé tout en intégrant l’humanisme comme fondement de la matière, en s’assurant de la réalisation du respect de la personne humaine. La proportionnalité, en tant que technique de réalisation des droits de l’homme, y contribue de manière décisive, surtout si l’on est capable d’en identifier et sublimer les vertus, tout en conservant ce qui fait l’essence du droit international privé, notamment l’objectif de prévisibilité des solutions, en combattant les faiblesses de la proportionnalité. Une méthodologie commune aux ordres juridiques étatiques et une meilleure motivation des décisions sont des propositions prometteuses à cette fin. Elles permettraient de « reconstruire l’équilibre entre protection des droits et autorité du droit, entre continuité des situations juridiques et cohésion de l’ordre interne et, enfin, entre juge supranational et juge national » (p. 315).
20 La thèse est décisive pour saisir l’évolution contemporaine du droit international privé, dans ce moment de redéfinition profonde de la fonction du juge face à la loi. À travers le droit international privé, c’est donc bien la théorie générale du droit qui est analysée de manière à comprendre les enjeux liés aux droits fondamentaux dans le phénomène juridictionnel. Pourtant, le droit ne se résume pas à sa réalisation juridictionnelle, et l’influence souvent décisive qu’ont les droits fondamentaux sur les solutions individuelles ne peut que pousser à accentuer la judiciarisation des relations juridiques. Ce phénomène entraîne un affaiblissement de la prévisibilité des solutions, en raison de l’individualisation de la solution par le juge sur le fondement des droits fondamentaux.
21 Les solutions proposées par l’auteure pour dompter les droits fondamentaux sont aussi stimulantes pour la compréhension d’enjeux majeurs du droit international privé et de la théorie du droit qu’elles sont opératoires et efficaces en pratique, notamment pour orienter l’action et la mission du juge. Elles permettent résolument de manier les droits fondamentaux afin de transformer l’ordre juridique français en un enfer très convenable. Mme Rebecca Legendre permet ainsi d’approfondir la compréhension du droit français à l’aune de l’intégration des exigences tirées des droits européens en matière personnelle et familiale, tout en apportant des solutions pertinentes aux questions les plus importantes restées en suspens. De nombreuses autres questions mériteront encore des réponses. Nul doute que Mme Legendre contribuera personnellement. Nul doute également que cette thèse constituera une référence pour toutes les personnes, bien au-delà du droit international privé, qui cherchent à enrichir leur réflexion autour des droits fondamentaux et leurs implications pour la théorie générale du droit.