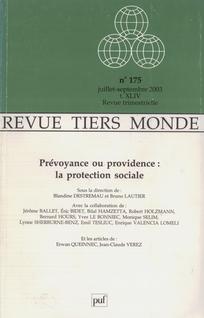1 La Turquie est confrontée depuis novembre 2000 à de sérieuses difficultés économiques. Habituée des crises, celle qui la frappe depuis deux ans est la plus forte ; il faut remonter à 1945 pour retrouver une contraction aussi sévère du PNB : – 8,5% en 2000, - 9,4% en 2001, – 6,5 % en 2002. Au cours de cette même année 2001, le paiement des intérêts a représenté 50 % du total des dépenses publiques (43 % en 2002), 65 % des revenus de l'État et 80 % des recettes fiscales. Ces charges financières sont les plus élevées en pourcentage des dépenses publiques depuis la fondation de la république. Au moment où l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne (UE) est d'actualité, le chemin qui reste à parcourir pour asseoir une économie de marché régulée présente divers obstacles.
2 La Turquie n'est pas le seul pays à être confronté à de telles difficultés. Il faut resituer le cas dans le contexte mondial de l'essor des marchés de capitaux émergents (MCE) du début des années 1980. Entre 1983 et 1993, la part des MCE dans la capitalisation boursière mondiale passe de 2,5 % à 9 % (Della Gaspera, 2001). Le succès des marchés émergents tient aux rendements élevés de leurs actifs. Mais les capitaux destinés à ces marchés sont instables ; il s'agit avant tout de placements spéculatifs à court terme qui peuvent quitter le pays d'accueil s'il y a une baisse du taux de change ou une chute des cours. En cas de perturbation, à la différence du régime de l'économie d'endettement, les risques ne sont pas mutualisés mais pris en charge par les banques et in fine par les détenteurs de titres. Ceux-ci ont une aversion pour les risques ce qui aboutit à des réactions vives, qui s'amplifient rapidement et qui, par mimétisme, aggravent les perturbations initiales. D'autre part, la globalisation engendre un « risque systémique ». Cela signifie que les marchés ne peuvent se stabiliser par eux-mêmes, ni revenir à une nouvelle situation d'équilibre. L'intervention extérieure est alors indispensable. La Turquie n'a pas échappé à ce scénario et on peut estimer que l'économie turque est « sous perfusion » depuis 1980.
3 Entre 1979 et 1980, la Turquie a bénéficié de cinq prêts d'ajustement structurel de la Banque mondiale, le plus grand nombre offert à un seul pays à cette époque (Chaponnière, 2001). En juin 1980, le FMI lui a accordé un prêt stand by équivalent à 625 % de sa quote-part, ce qui constitue aussi un record (Rodrik, 1990). La période 1980-1995 est marquée par diverses difficultés dont la crise de 1994. Plus récemment, à la fin de 1999, la Turquie a signé un nouvel accord avec le FMI, d'un montant initial de 4 milliards de dollars, et lancé un programme ambitieux (trop ?) de stabilisation. La détérioration des finances publiques avait convaincu le gouvernement de l'urgence d'un plan de désinflation. Soutenue par le FMI, la coalition au pouvoir a choisi de briser les anticipations inflationnistes en décidant une politique d'ancrage glissant de la livre turque sur un panier dollar/euro indexé sur un objectif d'inflation (hausse des prix de 20 %). Cette politique comprenait aussi un programme de réformes structurelles s'attaquant aux causes de l'inflation.
4 Si le ralentissement du rythme de l'inflation est bien réel en 2000 (la hausse des prix a été de 39 % contre près de 70 % en 1998 et 1999), les difficultés macro-économiques demeurent et ne peuvent éviter, dans un contexte de querelle politique, la crise bancaire de novembre 2000. Les opérateurs, nationaux et étrangers perdent de nouveau confiance. Dès le début de 2001, le cercle vicieux [1] des crises bancaire, monétaire et financière [1] plonge le pays dans une forte récession. Les banques sont contraintes de reconnaître leur faillite, remettant en cause de fait le plan de stabilisation signé en décembre 1999 avec le FMI et l'ancrage externe de la livre turque à l'euro et au dollar. Ces faillites ne sont pas le fruit d'une « main invisible » mais résultent, notamment, des comportements spéculatifs des banques favorisés par la libéralisation financière.
5 Dans une première partie, nous exposons les causes essentielles du cercle vicieux des crises en distinguant les causes de nature structurelle et celles de nature conjoncturelle. Dans une seconde partie, nous analysons les mesures prises et les réformes structurelles à engager, indispensables pour rompre avec le cercle vicieux des crises. Nous essayons, simultanément, de les situer par rapport au débat théorique entre orthodoxes, postkeynésiens et néo-structuralistes.
I. LES CAUSES DU CERCLE VICIEUX DES CRISES
6 Les difficultés de l'économie turque sont dues à des causes structurelles et conjoncturelles. Ces dernières peuvent être dissociées selon leur caractère national ou international.
1. Les causes structurelles
7 Les causes structurelles nous renvoient au problème des déficits budgétaire et public, au poids de la dette tant interne qu'externe, au niveau des taux d'intérêt et, enfin, au niveau de l'inflation.
Les déficits budgétaires et publics
8 L'évolution des déficits budgétaires (de l'Administration centrale, AC, stricto sensu) et l'évolution des déficits du secteur public consolidé (SPC) [1] ont atteint des niveaux élevés depuis cinq ans (tableau 1). Un déficit budgétaire révèle un excès des dépenses et/ou des recettes insuffisantes ou les deux à la fois. Du côté des recettes, la part du secteur informel dans les activités nationales est estimée à 50 % (OCDE, 1997). Ce sont autant de rentrées fiscales que l'État ne perçoit pas. Il semble par ailleurs que le secteur formel soit imposé à un taux jugé élevé de sorte que le taux de recouvrement est faible. L'impôt direct concernerait 15 % de la population (Akagül, 1998).
Évolution des soldes budgétaires du secteur public (en % du PNB)
| Année | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|
AC SPC |
– 8,5 – 13,1 |
– 7,7 – 13,1 |
– 7,8 – 15,6 |
- 12,1 – 23,3 |
– 11,5 – 20 |
– 15 – 22 |
– 12 – 12 |

Évolution des soldes budgétaires du secteur public (en % du PNB)
9 Le recours aux privatisations peut augmenter les recettes mais jusqu'ici les objectifs n'ont jamais été respectés. Diverses raisons l'expliquent : un désaccord entre les partis au gouvernement sur le choix et le rythme des entreprises à privatiser ; un contexte d'instabilités économique et politique qui repousse plus qu'il n'attire les investisseurs étrangers. L'exemple de la privatisation de Turkish Telecom en 2000 est révélateur : l'offre du capital au seuil de 20 % n'a intéressé aucun opérateur.
10 Du côté des dépenses, il convient de relever l'évolution du nombre de fonctionnaires : il a triplé entre 1970 et 1988 (1,7 million) pour revenir à 1,4 million en 1999 (Chaponnière, 2001). Il faut y ajouter les salariés des EEE au nombre de 650 000 (soit une masse salariale de 4,5 milliards de dollars en 1998). Les salaires des fonctionnaires sont indexés sur la base du taux d'inflation anticipé (cf. supra). Par ailleurs, les dépenses militaires sont élevées (entre 4 et 5 milliards de dollars par an), les dépenses de sécurité sociale approchent les 3 % du PIB par an (avant la réforme décidée en 1999-2000, l'âge de la retraite pour les salariés du secteur privé était fixé à 42 ans pour les hommes et à 38 ans pour les femmes), le soutien à l'agriculture n'a pas d'équivalent : financée à hauteur de 8,9 % du PIB en 1998, de 8,7 % en 1999 (contre 4,5 % en 1986- 1988) alors que la contribution de l'agriculture à la valeur ajoutée brute représente 15% en 1997 (OCDE, 2000), c'est un effort sans commune mesure. À titre comparatif, les pays de l'OCDE ont consacré 1,5 % de leur PIB en 1998 et en 1999 pour le secteur agricole.
11 Parmi les autres causes des déficits budgétaires, il convient de relever la prise en charge par l'État de la dette extérieure (cf. infra). L'une des raisons tient à la crédibilité que veulent afficher les autorités turques vis-à-vis de leurs créanciers, suite à l'insolvabilité de certains emprunteurs, privés ou publics. En agissant de la sorte, l'État cherche à la fois à rassurer les prêteurs et à attirer les capitaux étrangers. Le prix à payer reste toutefois excessif car les autorités sont contraintes de recourir un peu plus à l'endettement interne lequel finit par peser davantage sur les finances publiques.
Le problème de la dette
12 La dette nette consolidée du secteur public (DNSP) comprend la dette de l'administration centrale et de la Banque centrale (AC + BC) et la dette du reste du secteur public (RSP, y compris les EEE, les collectivités locales). La recapitalisation des banques d'État et la restructuration bancaire à la suite des événements de novembre 2000 et de février 2001 expliquent le ratio de 100 % pour l'année 2001 (tableau 2).
Évolution de la dette nette consolidée du secteur public (en % du PNB)
| Année | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
|
DNSP (1 + 2) ou (3 + 4) AC + BC (1) RSP (2) DEN (3) DIN (4) |
46,5 39,5 7,0 26,0 20,5 |
42,9 37,5 5,4 22,5 20,4 |
44,5 38,9 5,5 20,3 24,2 |
62,0 52,3 9,7 20,7 41,3 | 58,0 | 100,0 | 85,0 |

Évolution de la dette nette consolidée du secteur public (en % du PNB)
* En novembre.13 Le problème qui apparaît le plus aigu tient à la dette intérieure. Le financement des déficits budgétaires par des emprunts intérieurs a contraint la Banque centrale à absorber une part substantielle des ressources disponibles pour les crédits intérieurs (ce qui entraîne un effet d'éviction pour les prêts commerciaux). Le volume des remboursements ainsi requis, pour la dette intérieure de l'État de court terme, a obligé les pouvoirs publics à proposer des taux d'intérêt sur les adjudications toujours plus élevés.
14 Le problème aigu de la dette domestique tient encore à sa soutenabilité. La structure de la dette est la suivante (DREE, 2002) : 51 % est « cash », c'est-à-dire portée par les banques privées et négociable ; 49 % est non « cash », portée par les banques publiques, non négociable. Ces dettes diffèrent par leur maturité (6,4 ans pour la dette non « cash » et moins d'un an pour la dette négociable) et par leur composition (42 % de la dette négociable est à taux fixe contre 4 % de la dette non négociable). La soutenabilité de la dette publique restera une question préoccupante à court terme (dès 2003) du fait notamment que la maturité de sa part négociable est d'une durée très courte. La situation peut ainsi s'améliorer ou se détériorer rapidement. La Turquie est donc dans une situation d'« équilibre » très instable.
15 Au-delà du niveau de la dette, c'est l'engrenage entre le financement des déficits budgétaires, la dette intérieure et les taux d'intérêt qui devient préoccupant.
Le niveau élevé des taux d'intérêt
16 Depuis plusieurs années, les taux d'intérêt ont toujours été élevés (tableau 3).
Taux d'intérêt à court terme nominal (de placement, en %) et taux d'inflation de la consommation privée (IPC)
| Année | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|
12 mois IPC |
93,8 79,8 |
96,6 82,2 |
115,5 69,7 |
100 68,8 |
64 39 |
75 68,5 |
48 29 |

Taux d'intérêt à court terme nominal (de placement, en %) et taux d'inflation de la consommation privée (IPC)
17 Des taux nominaux supérieurs au taux de l'inflation favorisent les placements au sein de l'espace financier turc et attirent tant les agents nationaux que les opérateurs étrangers. De tels taux d'intérêt réels positifs facilitent, toutes choses égales par ailleurs, l'entrée de capitaux étrangers. Simultanément, ils fragilisent la position de la Banque centrale et du Trésor car une partie de la dette est détenue par des (capitaux) étrangers qui peuvent, à tout moment, retirer leurs engagements et provoquer une crise d'illiquidité. Les crises de novembre 2000 et de février 2001 vont en témoigner (cf. infra à propos des causes conjoncturelles).
18 De toute évidence, la question des taux d'intérêt est cruciale pour l'économie turque et pose de nombreuses questions. On ne peut que regretter la facilité avec laquelle les banques ont été autorisées à poursuivre leurs activités, dans un contexte de mauvaise gestion, d'anticipations peu fondées et d'incertitudes relatives à l'évolution des taux d'intérêt. Si plusieurs grandes banques s'étaient préparées à la baisse des taux d'intérêt dès le premier semestre 2000, acceptant de fait une diminution de la rentabilité, d'autres ont réagi en s'endettant davantage en devises pour compenser la baisse de leurs marges en procédant à plus d'achats de titres. Leurs positions de change se sont creusées : le solde entre leur actif et passif en devise représentait 210 % de leurs fonds propres en septembre 2000 alors que le plafond prudentiel était de 20 %. Avec 50 % de dépôts libellés en devises, tout choc externe ou relâchement fiscal annonçant une poussée de l'inflation amène les épargnants à fuir la livre turque. Pour se financer, l'État doit alors proposer des taux d'intérêt attractifs sur les titres publics, ce qui creuse davantage son déficit et sa dette. Celle-ci est devenue un fardeau (tableau 2) qui étouffe l'économie ; toute restriction budgétaire (désormais incontournable) et toute baisse des investissements publics pèsent sur la croissance. On perçoit là les mécanismes structurels (et en partie conjoncturels) qui enclenchent le cercle vicieux.
19 Relevons enfin que les banques ont aussi obtenu de la part des pouvoirs publics des garanties, ce qui peut être associé à un comportement d'aléa moral : d'une part, l'ancrage au dollar durera jusqu'en juillet 2001, éliminant tout risque de dévaluation ; d'autre part, ces mêmes banques étaient contraintes de financer les besoins de l'administration centrale avec effet d'éviction.
Le problème récurrent de l'inflation
20 Depuis le début des années 1980, le taux d'inflation en Turquie est supérieur à 50% : 51,1% en moyenne par an de 1980 à 1989, et 78,7 % de 1990 à 1999 [1]. Les causes sont multiples : une maîtrise très insuffisante des agrégats monétaires, un recours accru aux opérations d'open-market dû à l'instabilité du marché financier, une conversion des devises étrangères synonyme d'injection de monnaie, des pratiques oligopolistiques au sein du secteur privé, la dépréciation structurelle de la monnaie turque, dans un contexte d'ouverture commerciale avec les pays de l'UE (tableau 4).
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
| 81 405 | 151 865 | 260 724 | 418 783 | 624 754 | 1 087 611 | 1 600 000 |

21 Une telle évolution du taux de change a pour effet immédiat d'accroître le coût des importations (ce qui contribue à la détérioration du solde extérieur) [1] et donc les coûts de production des entreprises qui ont recours aux inputs étrangers et autres matières premières importées. Les risques inflationnistes n'en sont que renforcés. Entre mai et août 2002, la livre turque s'est encore dépréciée de 30 % vis-à-vis du dollar.
22 L'État contribue encore à alimenter le processus inflationniste d'une part, en soutenant les prix agricoles et, d'autre part, en recourant au seigneuriage. Le soutien des prix agricoles maintient un niveau de prix artificiel ; l'État achetait ainsi en 1998 les produits agricoles à partir de prix plancher supérieurs aux prix mondiaux de l'ordre de 65 %. Cette distorsion de prix, favorable aux producteurs mais défavorable aux consommateurs, se répercute sur l'indice des prix. À propos du seigneuriage, cette pratique est courante a fortiori pour les pays ne disposant pas d'un marché financier développé. Les gouvernements ont alors des difficultés à financer leurs déficits par l'émission d'obligations intérieures. Ils sont conduits à emprunter largement à l'étranger et à faire marcher la planche à billets. La création de monnaie conduit à l'inflation laquelle érode la valeur réelle des encaisses monétaires nominales. On appelle cela « taxe d'inflation » payée par les détenteurs de monnaie. Elle représente une composante des ressources réelles que les gouvernements s'attribuent en émettant de la monnaie. On appelle encore seigneuriage cette « sorte d'impôt extorqué par l'autorité qui émet la monnaie » (Guerrien, 1997).
23 En Turquie, le seigneuriage réel a représenté 1,2 % du produit réel entre 1980 et 1985 (en moyenne par an, Banque mondiale, 1988) et 1,7% à 2% selon les années entre 1995 et 1998 (Banque centrale de Turquie et OCDE, 1999).
24 In fine, les multiples causes citées entretiennent la spirale inflationniste. On pense notamment à l'accumulation et au financement des déficits publics. L'inflation est alimentée par ces déficits mais, inversement, ceux-ci se nourrissent de l'inflation. De plus, la dollarisation de l'économie [1] (de l'ordre de 50 % au niveau de l'agrégat M3, in Bastiaens, 1999) et la dépréciation structurelle de la livre turque incitent les agents à fuir la monnaie nationale pour le dollar. Avec le temps, les agents se sont accoutumés à l'inflation (Chaponnière, 2001) : ils multiplient les allers-retours entre leurs dépôts en LT, investis en titres publics, et leurs comptes en devises ; les banques réalisent de leur côté des marges confortables et les entreprises gèrent judicieusement leur trésorerie. Chaque catégorie d'agents semble ainsi s'adapter comme si l'inflation avait les vertus d'une drogue douce. Ils tentent de défendre leurs revenus réels en anticipant la prolongation de l'inflation passée (Fontaine, Lanzarotti, 2001). Comme tous les agents agissent ainsi, l'inflation se propage et maîtriser les facteurs de propagation de l'inflation apparaît incontournable car le coût ex post est élevé. Une inflation non maîtrisée, associée à des déséquilibres budgétaires et publics hors de contrôle, à un endettement public élevé et à des comptes extérieurs déséquilibrés, correspond aux critères classiques des crises financières.
25 Au-delà de la crise financière, la Turquie s'est trouvée confrontée à une crise bancaire (faillite de plusieurs banques) et à une crise monétaire (dépréciation de sa monnaie et risque d'illiquidité). Nous venons d'analyser les causes structurelles de ces crises. Elles sont profondes et inquiétantes pour l'avenir de la Turquie : profondes parce qu'elles concernent les « fondamentaux » qui sont interdépendants (déficits interne et externe, dette, taux d'intérêt, inflation) ; inquiétantes parce qu'elles perdurent et parce qu'elles ont abouti depuis la fin 2000 à une forte récession dont l'issue reste incertaine.
26 Le contexte conjoncturel international ainsi que diverses autres causes nationales (tels les séismes de 1999) ne vont qu'accentuer les difficultés.
2. Les causes conjoncturelles
27 Parmi les causes conjoncturelles, on peut dissocier celles qui relèvent du contexte international et celles qui relèvent du cadre national.
Le contexte international
28 La décennie 1990-2000 est marquée par la libéralisation financière de plusieurs pays émergents. Ces pays attirèrent une masse de capitaux sans que les instruments et les compétences pour diversifier les risques aient été réunis. Ce fut là l'origine des crises financières les plus graves depuis le krach de 1929. Le Mexique en 1994, le Brésil et l'Asie du Sud-Est en 1997, la Russie en 1998, le Brésil en 1998 furent avec la Turquie en 2000 et 2001 les foyers de crises violentes, sans omettre les turbulences argentines actuelles. La déréglementation a été trop brutale, la prévention et la surveillance insuffisantes.
29 La crise russe va affecter tout particulièrement l'économie turque. L'endettement de l'État, l'exposition massive des banques russes au risque de change (CEPII, 2000), les difficultés de recouvrir l'impôt vont contraindre le gouvernement russe à emprunter. Pour faire face à ses besoins de financement ; l'État propose des titres à des taux d'intérêt élevés. Cela attire des non-résidents mais tend également à ce qu'une partie des capitaux russes placés à l'extérieur – dont ceux placés en Turquie – soient rapatriés. Cette nouvelle situation a pour effet de limiter les possibilités d'emprunt du Trésor turc. Or, la situation interne à la fin 1998 n'est guère brillante. Les indicateurs macro-économiques (analysés supra) sont mauvais, voire médiocres. C'est dans ce contexte que surviennent les séismes d'août et de novembre 1999.
Le cadre national
30 Selon les sources disponibles [1], les pertes de richesses et de revenus dues aux séismes se situent entre 5 et 14 milliards de dollars, ce qui représente une contraction de 1 % du PIB pour la seule année 1999. Ces événements vont par ailleurs rejaillir sur les recettes touristiques, lesquelles seront de nouveau touchées par le choc du 11 septembre 2001 à New York. La baisse des recettes est estimée à 0,5 milliard de dollars pour 2001.
31 Parmi les autres causes conjoncturelles, il faut souligner le rôle des banques qui ont financé, par des emprunts à court terme, des placements à long terme et le retard pris en matière de privatisation, notamment dans le cadre du programme établi avec le FMI en 1999. Ces éléments vont engendrer une hausse des taux d'intérêt au cours des mois de septembre et novembre 2000.
32 Le cercle vicieux va alors s'enclencher : face à l'accroissement de leurs coûts et à leurs contraintes de financement, les banques ont besoin de liquidités qu'elles tentent d'obtenir par la vente d'obligations d'État. Si, dans un premier temps, la Banque centrale accompagne ce mouvement, il en va différemment à propos de certaines banques de première catégorie (OCDE, 2001) qui vont remettre en cause leurs lignes de crédit interbancaires, dès que des informations de cessation de paiements vont circuler au sein du système bancaire, suite aux enquêtes de l'agence de supervision. De facto, les opérateurs étrangers se retirent du marché de l'argent au jour le jour. La crise de liquidité n1est plus une hypothèse, elle devient réelle. La crise de confiance est perceptible et les taux au jour le jour dépassent les 100 % puis atteignent 2000 % à la fin du mois de novembre 2000. Durant la crise, l'OCDE (2001) estime que plus de 6 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale sont sortis, soit environ un quart de leur volume total. Une telle situation a par ailleurs accentué les sorties de capitaux jusqu'à ce que le FMI accorde un nouvel appui financier portant sur 10 milliards de dollars [1].
33 Ces nouveaux apports, associés à d'autres mesures telles que le contrôle de banques privées par l'Agence de surveillance bancaire (indépendante) ou l'annonce par le Trésor qu'il garantirait les dépôts et les crédits des banques turques, vont rassurer les acteurs nationaux et internationaux de sorte que les taux de l'argent au jour le jour reviennent en dessous de 100 % à la fin du mois de décembre 2000. Mais cela ne dure pas. Un conflit politique entre le président et le premier ministre en février 2001 engendre de la méfiance, les marchés anticipent l'abandon du programme et une dévaluation. Sept milliards de dollars fuient très rapidement mettant les banques d'État dans une situation de faillite technique. Le marché des changes est suspendu. En accord avec le FMI, le gouvernement abandonne l'ancrage pour laisser flotter la livre turque. Ce « choix » a pour conséquence immédiate une nouvelle accentuation de la dépréciation de la LT. Avant la crise de février 2001, on pouvait obtenir 620 000 LT pour un dollar ; en avril 2001, plus d'un million. La crise de confiance gagne la sphère financière : la Bourse d'Istanbul perd près de 20 % de sa valeur en février.
34 Depuis, l'économie turque est sous perfusion. Le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, le G7 ne sont pas restés insensibles à la situation. On peut d'ailleurs s'étonner, dans un premier temps, de l'appui financier substantiel des bailleurs de fonds. Bien entendu, la contrepartie est conséquente : aux mesures rapidement engagées, ce sont de nombreuses et fondamentales réformes structurelles auxquelles la Turquie doit faire face. Ces réformes, que l'on dissocie selon qu'elles ont été engagées ou qu'elles doivent l'être dans le court-moyen terme, ont une dimension théorique qui oppose les économistes.
II. LA NÉCESSITÉ DES RÉFORMES STRUCTURELLES ET LEUR DIMENSION THÉORIQUE
35 Tant pour des raisons structurelles que conjoncturelles, nous avons constaté que les indicateurs macro-économiques de la Turquie s'étaient détériorés au cours de ces dernières années (tableau 5). Leur niveau en 2001 est très préoccupant. Ils sont par ailleurs interdépendants. Lequel nécessite un remède prioritaire ? Il est difficile de répondre mais il apparaît que lutter contre les déficits et la dette rejaillit à moyen et long terme sur les niveaux d'inflation et de taux d'intérêt. Sans doute, est-ce le poids et la structure de la dette publique qui apparaissent le plus inquiétant. Nous distinguons les mesures prises et les réformes structurelles à engager.
Les principaux indicateurs macro-économiques de la Turquie en 2001 (en %)
|
Taux d'inflation |
Déf. Budgé taire / PNB |
Dette pu blique / PNB |
Taux d'intérêt | |
| Turquie | 68,5 | 15 | 100 | 75 |

Les principaux indicateurs macro-économiques de la Turquie en 2001 (en %)
1. Les mesures engagées
36 Elles concernent essentiellement le rôle de la Banque centrale et des banques commerciales et le budget de l'État.
Le rôle de la Banque centrale et le contrôle des banques commerciales
37 Il est convenu de renforcer l'indépendance de la Banque centrale vis-à-vis du pouvoir politique et de restructurer le réseau bancaire en renforçant le contrôle des opérations. L'objectif macro-économique est de mener une politique monétaire plus rigoureuse. De fait, le gouvernement ne pourra plus obtenir de nouveaux crédits sans l'accord de la Banque des banques. Elle-même se voit contrainte de limiter, d'une part, ses emprunts sur les marchés financiers et, d'autre part, le recours aux actifs intérieurs, afin de contrôler davantage et d'encadrer la création monétaire et les liquidités. Ces mesures peuvent apparaître tantôt excessives parce qu'elles limitent l'autonomie des décideurs publics, tantôt bienvenues parce qu'elles respectent les critères de la théorie standard favorable à une intervention minimale et à une libéralisation financière garante du respect des mécanismes autorégulateurs des acteurs et du marché.
38 Il est utile de comprendre que l'accumulation des déficits et l'évolution de la dette publique ont permis aux banques turques de prospérer dans des conditions particulières. D'une part, la plupart des banques privées qui appartiennent à des conglomérats contrôlés par des groupes familiaux, se sont livrées à des surenchères pour attirer une clientèle rassurée par la garantie de l'État sur les dépôts. D'autre part, le pourcentage de crédits liés a été supérieur au ratio prudentiel. Quant aux banques d'État, le financement de leurs pertes a maintenu les taux d'intérêt à des niveaux très élevés. Quand en 1999, le gouvernement a lancé un programme de désinflation, la chute des taux d'intérêt réduisait d'autant les marges bancaires et entamait les profits. Bien que l'ancrage de la LT éliminait le risque de change, du moins en apparence, les banques ont élargi leur position externe de change (180 % de leurs fonds propres à la veille de la crise de février 2001) pour augmenter le volume de leurs transactions, avec risque de perte sur ces positions et forte diminution de leurs fonds propres.
39 Il a fallu depuis recapitaliser les banques d'État afin qu'elles redeviennent liquides et les plus fragiles sont passées sous le contrôle de l'agence de supervision. Les banques privées doivent à leur tour surveiller leur ratio de solvabilité. La réglementation bancaire amorcée par la loi votée en 1999 a donc pour objectif principal d'éviter de futurs dérapages et autres comportements d'aléa moral. Il est souhaitable que les agents économiques puissent retrouver le chemin des investissements réels au détriment des placements financiers et les banques doivent privilégier les activités de prêts traditionnelles au détriment des titres d'emprunt d'État. De ce point de vue, la baisse des plafonds prudentiels en 1999 apparaît comme un premier signal positif.
40 Cette mesure et, plus globalement, la création de l'agence de supervision et la réglementation bancaire vont dans le sens prôné par une partie des économistes et des décideurs qui ont toujours dénoncé l'incertitude relative aux politiques de libéralisation financière. Le cas de la Turquie n'est pas isolé et s'inscrit dans le débat actuel relatif aux causes des crises bancaires et de l'instabilité financière contemporaine. Les travaux du FMI, de nature principalement macro-économique et d'inspiration orthodoxe, ont montré l'existence d'une relation entre les crises bancaires et financières et les politiques de libéralisation financière. Plusieurs études empiriques montrent que les crises bancaires ont généralement été précédées par des politiques de libéralisation financière. Kaminski et Reinhart (1996) ont tiré de telles conclusions à partir d'une étude empirique portant sur 20 pays en Asie, Amérique latine, Europe et Moyen-Orient. De même, Demirgurc-Kunt et Detragiache (1998) constatent à propos de 53 pays que la libéralisation augmente la probabilité de crise bancaire. La libéralisation rend les banques plus vulnérables aux chocs macro-économiques et l'absence ou l'insuffisance des dispositifs de supervision aggrave leur fragilité financière.
41 D'autres travaux insistent davantage sur les comportements spéculatifs des banques comme explication de leurs défaillances, lesquelles débouchent ex post sur des crises. Des économistes postkeynésiens (Minsky, 1980) relèvent que les banques font preuve d'aveuglement dès lors qu'elles spéculent à propos de gains sur des opérations purement financières non liées directement à la sphère productive. Miotti et Plihon (2001) insistent sur les fondements micro-économiques des crises bancaires. On peut ajouter que le passage de l'économie d'endettement à l'économie financière, dans les pays industrialisés puis dans les pays émergents à partir des années 1980, a accentué ces comportements bancaires : d'une part, parce que la finance directe l'emporte désormais sur la finance indirecte dans un contexte de désintermédiation, la concurrence est moins imparfaite et les banques de second rang doivent multiplier les opérations à risque ; d'autre part, parce que les innovations financières (produits dérivés, titrisation des créances) ont offert de nouvelles opportunités et renforcé la préférence pour la liquidité. Plutôt que de financer des investissements nécessaires au capital productif, les banques ont préféré favoriser les opérations spéculatives de court terme, contribuant au développement du capital financier. Guttman (1994) a relevé que, dans tous les pays qui ont procédé à une libéralisation financière, le poids du capital financier et les opérations de nature spéculative sont croissants. L'auteur cite notamment l'explosion des opérations hors bilan.
42 Le débat entre partisans et opposants à la libéralisation financière n'est pas exclusif aux libéraux et aux keynésiens ; il s'est enrichi de la réflexion des néo-structuralistes. Tout en sachant qu'il existe plusieurs courants, le terme néo-structuralisme signale une école de pensée qui s'oppose à l'approche néo-libérale et qui se distingue de l'école orthodoxe représentée par le Consensus de Washington (Fontaine, Lanzarotti, 2001). Le débat porte notamment sur la distance entre l'économie réelle et l'économie financière : la première a besoin d'investissements productifs, la seconde favorise la spéculation. In fine, c'est sur le rôle de l'État que le débat s'intensifie.
43 Nous présentons ci-après les mesures prises par la Turquie en matière de recettes et de dépenses budgétaires et nous essayons d'en présenter la dimension théorique.
L'évolution du budget de l'État : accroître les recettes, limiter les dépenses et respecter les conditions du marché
44 La Turquie, comme tout pays qui cherche à satisfaire les conditions de la libéralisation financière et qui est sous tutelle des bailleurs de fonds, a dû se résoudre à limiter les dépenses de l'État et à accroître les recettes. La méthode standard est connue : privatisation et hausse des impôts d'un côté, réduction de la masse salariale de la fonction publique ainsi que des dépenses d'investissement et de fonctionnement de l'autre. Dans le budget 2002, il est prévu que les dépenses de personnel en volume progressent de 2,7 %. Il faut donc rechercher ailleurs les économies pour une baisse globale des dépenses hors intérêt. Les investissements publics doivent stagner en volume et en % du PNB (2 %). À propos des dépenses de fonctionnement, le gouvernement a modifié la méthode d'indexation des salaires des fonctionnaires en la fixant sur le taux d'inflation passé.
45 L'autre volet relatif aux dépenses publiques concerne la politique agricole. Il est acquis que les exploitations recourant à une agriculture intensive ne recevront plus de subventions tandis que les exploitations familiales, de plus faible taille, continueront à bénéficier des aides publiques directes. En 2000, les crédits agricoles ont été plafonnés à 0,6% du PIB au lieu des 1,2% accordés en 1999.
46 Du côté des recettes, plusieurs entreprises publiques sont ou doivent être privatisées. Les performances économiques et la rentabilité de certaines d'entre elles nécessitent des restructurations. Il est également acquis de privatiser les banques d'État d'ici 2003 ce qui contraindra l'État à rechercher d'autres moyens de financement.
47 À propos des recettes fiscales, des mesures ont été prises dès 2000 : accroissement des impôts indirects sur le commerce extérieur et accroissement de la TVA intérieure. Pour 2002, l'objectif est d'accroître les revenus des impôts de 50 % en valeur.
48 Ces mesures, prises sous contrainte du FMI, diffèrent sur plusieurs points des recommandations néo-structuralistes (Berthomieu et Ehrhart, 2000). Si ces dernières accordent une grande importance au rétablissement des équilibres macro-économiques de base, les solutions proposées sont synonymes d'un ajustement graduel à travers la combinaison de politiques de restriction sélective de la demande [1] et de l'expansion sélective de l'offre. En outre, elles comprennent la question de la répartition des revenus [2]. Celle-ci est corrélée à la lutte (efficace) contre l'inflation dont on sait que les effets diffèrent selon la nature des revenus.
49 En reposant notamment sur la lutte contre l'inflation, sur la question de la répartition des revenus, sur une politique de contrôle de la demande globale (aspect keynésien), le programme de stabilisation hétérodoxe s'appuie sur le rôle et les fonctions de l'État. Une contraction du secteur public ne stimule pas, de facto, le secteur privé comme l'évoquent les néo-libéraux. À partir du modèle IS/LM, ces derniers considèrent que la réduction du déficit public est une forte nécessité annulant les effets d'éviction dus aux dépenses publiques. Les ressources financières ainsi dégagées deviennent disponibles pour le secteur privé et pour le marché dont l'efficacité est supérieure. Les néo-structuralistes pensent plutôt que les formes d'action publique peuvent stimuler directement les initiatives privées (aspect keynésien) sans supplanter « les forces du marché ». Une action sélective de l'État peut soutenir la croissance.
50 Les premières mesures prises par la Turquie, dans le cadre du programme fixé avec (par ?) le FMI, sont éloignées des inspirations néo-structuralistes et correspondent de fait aux recommandations néo-libérales. Les réformes structurelles proposées (imposées ?) sont de même nature : elles recherchent un désengagement de la puissance publique. L'idée est d'allouer les ressources à partir des mécanismes du marché. Le rôle de l'État devrait consister essentiellement à garantir les conditions indispensables à une économie de marché forte. L'OCDE (2001) s'associe à ces objectifs en dénonçant les excès budgétaires et l'omniprésence de l'État dans l'économie, comme responsables de l'inflation et d'une faible croissance.
51 Nous présentons dans le paragraphe suivant les principales réformes structurelles suggérées et/ou amorcées en essayant de les resituer par rapport aux débats entre néo-libéraux et néo-structuralistes.
2. Le programme des réformes structurelles
52 L'UE, en accordant à la Turquie le statut de pays candidat ; l'oblige à se rapprocher des structures économiques et politiques de celles du modèle européen. Si la Commission européenne, dans son rapport annuel de 2001, souligne les réformes engagées visant à éliminer les interférences politiques dans l'économie et à assainir le secteur financier (elle relève positivement la restructuration du secteur financier, la libéralisation de secteurs monopolistiques, l'accroissement de l'indépendance de la Banque centrale), elle dénonce en revanche le rôle encore substantiel de l'État dans le secteur productif. Elle relève les modestes progrès de la privatisation, un manque crucial d'homogénéité sociale et géographique, une situation de vide juridique dans de nombreux domaines législatifs (à propos du droit des sociétés, plus de 30 % de la législation européenne n'a aucun équivalent dans la législation turque, 60 % dans le domaine du droit de la concurrence et des aides de l'État).
53 In fine, tant pour les raisons dues au programme fixé avec le FMI que pour satisfaire les conditions d'adhésion à l'UE, la Turquie a fixé plusieurs réformes structurelles dont la réforme de la sécurité sociale, la réforme de l'agriculture, le programme des privatisations et, enfin, la réforme du secteur bancaire. Elles ont en commun le fait qu'elles prédéterminent les fondamentaux budgétaires.
La réforme de la sécurité sociale
54 La réforme de la sécurité sociale est un objectif hautement prioritaire du gouvernement turc. La part des dépenses sociales dans le PIB est de l'ordre de 7 % contre 25 % pour les pays européens de l'OCDE. Pourtant, le régime menace gravement l'équilibre budgétaire : le déficit de la sécurité sociale a atteint 2,7 % du PIB et a représenté plus d'un tiers du déficit budgétaire total en 1998. Le déficit est monté à 3,1 % en 1999 et à 3,3 % en 2000.
55 La principale mesure de la réforme d'août 1999 a consisté à modifier le départ de l'âge à la retraite tant pour le secteur public que privé. Pour les nouveaux arrivants, il passe à 58 ans pour les femmes et à 60 ans pour les hommes. Pour les travailleurs actuellement en activité, il passe respectivement à 52 et 56 ans, avec une période de transition de dix ans. L'autre mesure essentielle est relative à l'allongement de la durée minimale de cotisation exigée : elle est portée à 25 ans pour les nouveaux entrants et à 17 ans pour les travailleurs en activité.
56 Au-delà, il est convenu d'améliorer la couverture sociale et le respect de la réglementation. Ces réformes devraient permettre, à moyen terme, de stopper la dérive du régime des retraites. Par ailleurs, une loi relative au système d'investissement et d'épargne pour la retraite est entrée en vigueur en octobre 2001 : elle crée des sociétés de retraite équivalant à des fonds de pension. En complément au système de sécurité sociale, la nouvelle loi permet aux particuliers d'avoir un revenu complémentaire durant leur retraite.
La réforme de l'agriculture
57 L'objectif est de rationaliser la politique agricole en supprimant progressivement le système actuel d'aide à l'agriculture (qui existe depuis 1932) et en le remplaçant par un système de soutien direct au revenu ciblé sur les agriculteurs les plus démunis. À terme, la plupart des entreprises agricoles d'État doivent être privatisées et les prix de soutien devraient se rapprocher des prix du marché. Cette réforme est délicate car elle va affecter 40 % de la population.
Les privatisations
58 La volonté du gouvernement est de se désengager de la sphère économique, tout en augmentant ses recettes en vue de réduire sa dette publique. L'État doit céder des participations dans des secteurs essentiels comme les télécommunications et l'énergie. Le montant des privatisations a atteint 5,6 milliards de dollars en 2000, soit autant que le total des sommes collectées depuis le début du programme de privatisation débuté en 1986. 6,7 milliards étaient prévus en 2001.
La réforme du secteur bancaire
59 Nous avons mentionné la création de l'agence de supervision bancaire dès 1999. Il faut encore renforcer les normes comptables afin d'éviter de nouvelles situations d'insolvabilité. Renforcer les normes prudentielles apparaît tout autant indispensable de manière à comprendre des ratios de fonds propres ajustés aux risques encourus. Une fois que les conditions cadres auront été mises en place, la réforme visera à consolider le secteur privé puis à traiter le problème des banques publiques avec une nécessaire restructuration opérationnelle et financière et une restructuration du capital en vue des privatisations.
60 Le programme des réformes (dont seules les principales ont été présentées) est ambitieux. Il représente un coût économique, social et politique. Sur l'aspect économique, l'appui des institutions internationales est indispensable. Rappelons qu'en mai 2000, la Turquie a conclu un accord de prêt avec la Banque mondiale pour bénéficier du programme « Country Adjustment Strategy » pour un montant de 3 milliards de dollars, couvrant la période 2001-2002. L'essentiel de ce montant était destiné aux réformes de la sécurité sociale, du secteur bancaire, de l'agriculture et aux privatisations. Un nouveau programme de 5 milliards de dollars a été fixé pour 2001-2003. 50 % sont destinés au secteur bancaire. De son côté, le FMI a débloqué plus de 21 milliards de dollars depuis décembre 1999.
61 À propos du coût social, il faut rappeler que les crises ont accru le nombre de chômeurs de plus d'un million en 2001, faisant passer le taux de chômage de 6,6 % à 10,6 %. La classe moyenne a été particulièrement touchée, soit la population au pouvoir d'achat supérieur à la moyenne. Bien entendu, l'inflation et la dépréciation de la monnaie nationale, qui réenchérit le prix des biens importés, a diminué le pouvoir d'achat du plus grand nombre. De fait, le niveau de la demande effective, notamment les biens de consommation durable, a chuté.
62 Le coût politique des réformes est le changement de majorité depuis les élections législatives de novembre 2002. Les crises et la récession n'ont débouché ni sur une instabilité politique, ni sur une crise des institutions. L'adaptation des comportements individuels est assez surprenante : le niveau d'épargne des ménages (en 1999, le taux d'épargne brute était égal à 21,6 % du PIB), la solidarité familiale et les activités du secteur informel ont joué un rôle d'amortisseur social. Rien ne garantit que ce contexte perdurera.
63 D'un point de vue théorique, ces réformes vont dans le sens des recommandations néo-libérales. Les avocats de la libéralisation y voient la clé d'une économie saine, débarrassée de l'intervention excessive des pouvoirs publics, capable de s'intégrer dans l'économie mondiale dès lors que les prix et les taux de change reflètent les forces du marché et que le libre-échange prédomine. Si les risques d'imperfection des marchés, d'asymétrie d'information et d'aléa moral ne sont pas ignorés, la lutte qu'ils réclament ne passe pas par un recours systématique à l'État dont la capacité à régler les distorsions citées ne sont pas supérieures à celle du marché.
64 Ce point constitue l'un des différends essentiels avec les néo-structuralistes. Berthomieu et Ehrart (2000) précisent notamment le point de vue néo-structuraliste sur les privatisations. Sont-elles plus efficaces que les entreprises publiques dans les divers secteurs de l'activité économique ? Si certaines sont envisageables dès lors qu'elles concernent des entreprises productives non stratégiques, un recours systématique aux privatisations est proscrit.
65 Balkan et Yeldan (2001) considèrent quant à eux que l'intégration de l'économie turque dans l'économie financière mondiale a intensifié des problèmes déjà existants : déficits budgétaires, instabilité monétaire et rupture des liens entre le secteur réel et le secteur financier. L'impact de cette rupture sur les transferts de revenus leur apparaît fondamental. Ils rejoignent ainsi Berthomieu et Ehrhart pour qui la question de la répartition des revenus est cruciale de même que la distance entre l'économie réelle et l'économie financière. L'une des explications tient peut-être au fait qu'il y ait, en situation d'urgence, une focalisation sur le court terme (Fontaine, op. cit.). Gabriele, Boratav et Parikh (2000) soulignent aussi la controverse relative aux effets de la libéralisation financière. Ils citent notamment les travaux de Rodrik (1998) qui évoquent le problème de l'asymétrie d'information avec aléa moral et risques excessifs dus aux opérations spéculatives. On retrouve également dans les critiques émises la disparité entre le marché des biens et services et le marché financier.
66 Pour les auteurs opposés à la conception orthodoxe de la libéralisation financière, diminuer les risques relatifs aux comportements spéculateurs et essayer de rompre avec le cercle vicieux des crises passe donc par une réhabilitation (nouvelle) du rôle de l'État. En outre, pour éviter tout traitement de choc non discriminant, ils recommandent l'application de politiques graduelles et sélectives qui ont le mérite de participer à la réallocation des ressources (Fontaine, op. cit., p. 541). La situation économique, politique et sociale de la Turquie ne peut faire l'impasse sur de telles réflexions.
CONCLUSION
67 La Turquie est confrontée à une profonde récession. Le cercle vicieux des crises, dans un contexte international instable, relève de causes profondes. Ce constat laisse supposer que le rétablissement des principaux équilibres macro-économiques sera difficile et long. Les objectifs prioritaires ont été d'enrayer la hausse des prix et de stabiliser la dépréciation de la monnaie nationale. L'appui du FMI et de la Banque mondiale, qui ont débloqué rapidement plusieurs milliards de dollars (cf. supra), a été immédiat. Cela témoigne de l'urgence de la situation et des risques encourus. Sans un soutien rapide des bailleurs de fonds, le Trésor turc aurait dû emprunter à des taux d'intérêt élevés pour des maturités courtes, avec un risque de monétisation de la dette et une accélération de l'inflation pouvant dégénérer en hyperinflation.
68 À partir de l'automne 2001, la Banque centrale a cherché à lutter contre l'inflation et a adopté en conséquence sa politique monétaire, dans une période de flottement de sa monnaie. Depuis, les autorités maintiennent l'objectif de se rapprocher des grands équilibres macro-économiques. Si, à court terme, les marchés étaient convaincus que certains de ces objectifs pouvaient être respectés, les entrées de capitaux pourraient reprendre, la prime de risque des taux d'intérêt pourrait baisser, le coût de l'investissement serait moindre.
69 À long terme, le défi consiste à retrouver un sentier de croissance durable. Le signal fort que peut envoyer l'État turc tient donc à sa volonté de faire évoluer les structures économiques et à la rapidité avec laquelle il va poursuivre ses réformes. Qu'il s'agisse de la couverture sociale, des privatisations, de la politique agricole, du secteur bancaire, etc., des mesures importantes sont à prendre lesquelles vont réclamer de la patience car le décalage temporel entre la mise en place de ces réformes et les effets attendus est toujours trop long du point de vue des acteurs individuels. Infléchir les comportements, accepter une concurrence plus forte, remettre en cause quelques acquis exigent de transmettre des informations et d'expliquer les enjeux. Il n'est pas inutile de s'atteler à cette tâche, dès maintenant. Pour autant, un scénario synonyme de « thérapie de choc », sans prendre en compte les acteurs, sans tenir compte de leur pouvoir d'achat, sans se soucier du niveau de la demande effective, sans se préoccuper de la question de la répartition des revenus, apparaît à coup sûr comme le moyen de susciter des problèmes sociaux qui limiteraient l'espérance d'atteindre les objectifs économiques et qui bouleverseraient la stabilité politique.
70 Vis-à-vis des partenaires extérieurs, la Turquie ne peut ignorer l'appui du FMI et de la Banque mondiale. Elle a tiré 1 500 % de son quota au FMI, un ratio sans équivalent (800 % pour l'Argentine). Selon les estimations de la DREE (2002), les accords signés en février 2002 avec l'institution internationale pourraient porter cette quote-part à plus de 2 000 %. La crédibilité turque est engagée et sera appréciée à l'aune des prochains résultats économiques. Vis-à-vis de sa candidature à l'adhésion à l'UE, réussir à restaurer la confiance, renforcer la transparence, asseoir une économie de marché où les règles sont connues et respectées des divers acteurs, sont autant d'éléments que les partenaires apprécieront à leur juste valeur.
71 Si la situation est très difficile, elle n'est pas définitivement irréversible, à la fois pour des raisons internes mais aussi eu égard au contexte international. D'une part, les autorités turques n'ont pas cédé à la panique, ni en novembre 2000, ni en février 2001 et pas davantage depuis. La nomination, par ailleurs, de Kemal Dervis, ancien vice-président de la Banque mondiale, a représenté un signal fort, tant pour amorcer les réformes économiques structurelles indispensables que pour restaurer une certaine confiance en coupant autant que possible le « cordon ombilical » entre la sphère économique et la sphère politique. Les premières réformes engagées ont représenté un premier pas pour asseoir une économie de marché plus saine. Au niveau des institutions de Bretton Woods, des pays du G7 et des pays de l'Union européenne, il est probable que les décideurs sont davantage incités à favoriser la relance de l'activité économique, sur des bases saines équilibrées, plutôt que de constater une aggravation des déséquilibres macro-économiques renforçant la crise et amplifiant le risque d'une contagion dans la sous-région. La crise argentine ainsi que les crises précédentes de plusieurs pays émergents montrent que l'économie mondiale n'est pas à l'abri de ce type de risque. Enfin, la tragédie du 11 septembre, le conflit afghan et le contexte irakien permettent de porter un regard différent sur la situation turque. Si ces faits ont aggravé les difficultés de la Turquie, simultanément, ils lui permettent de mieux faire valoir sa position géopolitique dans la région. L'UE a intérêt à voir ce grand voisin méditerranéen sur un sentier de stabilité politique et de croissance équilibrée plutôt que confronté à diverses instabilités, notamment économiques.
Notes
-
[1]
Universités d'Artois et de Galatasaray, chercheur au CERED - Forum de Paris X - Nanterre.
-
[1]
La théorie du cercle vicieux a plusieurs versions dont le raisonnement peut être économique, sociologique, psychologique, naturel. On retiendra, pour notre part, le fait que plusieurs mécanismes économiques réagissent en chaîne, les uns vis-à-vis des autres, dans une sorte de spirale. Le cercle vicieux entretient les crises et éloigne un retour à un cycle normal.
-
[1]
Par crise bancaire, nous entendons des comportements de méfiance à l'égard des banques suite à la faillite de plusieurs banques commerciales qui étaient sous la tutelle de la Banque centrale et qui ont été placées ensuite sous contrôle (18 ont été placées sous le contrôle de l'agence de surveillance bancaire (Saving Deposit Insurance Fund, SDIF) ; par crise monétaire, nous entendons le risque d'illiquidité et la nécessité pour la Banque centrale de puiser dans ses réserves de change afin de limiter autant que faire se peut la dépréciation de la livre turque face au dollar ; par crise financière, nous entendons avec Aglietta (2001) le fait qu'un accident localisé peut se propager à l'ensemble du système financier à cause des externalités qui sont inhérentes à la présence du risque de système. Dans le cas présent, les événements cités ont entraîné la baisse des valeurs de la bourse d'Istanbul survenue dès le mois de février 2001 et la perte de confiance des acteurs étrangers. Le processus de propagation évoqué apparaît donc là sous la forme d'un manque de liquidité.
-
[1]
Les déficits du secteur public consolidé comprennent les soldes de l'administration centrale, des fonds extrabudgétaires, des collectivités locales, des entreprises économiques d'État (EEE), de la sécurité sociale et, enfin, les pertes liées au titre des obligations de services (soit les pertes des banques relatives aux prêts bonifiés consentis au nom du gouvernement).
-
[1]
Le ralentissement en 2002 s'explique par la récession et par la stabilité de la parité de la livre turque en fin d'année. La situation reste fragile : la hausse des prix cumulée a été de 12% au premier trimestre 2003.
-
[1]
La balance des opérations courantes (exportations + importations + invisibles) est passée de + 2 milliards de dollars en 1998 à – 1,4 milliard en 1999, à – 10 milliards en 2000 et à – 17 milliards en 2001. Il faut aussi relever la rareté des IDE : au cours des années 1991-2000, le solde net a été de 550 millions de dollars en moyenne, soit moins de 1 % du PNB. Les entrées brutes d'IDE ont représenté moins de 10 % des entrées de capitaux et le solde (entrées moins sorties IDE turcs) a été légèrement négatif pour le premier semestre 2002 (DREE, 2002).
-
[1]
Il s'agit d'une dollarisation officieuse dans laquelle le secteur privé utilise le dollar comme substitut de la monnaie nationale. La dollarisation officielle signifie que le dollar remplace la devise nationale comme monnaie légale.
-
[1]
Tusiad, Banque mondiale, Organisme central de planification, OCDE.
-
[1]
Qui viennent s'ajouter aux 4 milliards de dollars débloqués fin 1999. On estime que l'appui total du FMI dépasse les 21 milliards de dollars pour la période 1999-2001. Cela représente 11 % du PIB de 1999 (estimé à 190 milliards de dollars aux prix et taux de change courants).
-
[1]
Baisse de la consommation de biens échangeables par les groupes sociaux aux revenus élevés et, parallèlement, accroissement de la consommation de biens essentiels pour stimuler l'investissement.
-
[2]
Elle est très inégale en Turquie : en 1994, les 5 % de la tranche supérieure recevaient 26,4 % des revenus contre 0,85 % pour les 5 % de la tranche inférieure (Gürsel, 2000).