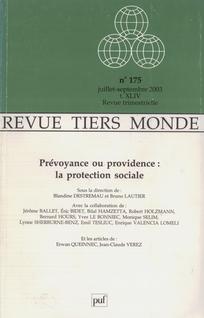1 Un développement capitaliste accéléré, mis en place et continuellement stimulé par le gouvernement communiste, caractérise le Vietnam actuel, qui épouse depuis 1986 la voie chinoise du « socialisme de marché » démarré à la fin des années 1970. Cette conjoncture est symptomatique de la globalisation en ce qu'elle efface les anciennes antinomies entre axiomes politiques et modes de production économiques et instaure un nouveau régime de domination et d'exploitation politico-économique particulièrement rentable en dépit de sa fragilité intrinsèque. Dans ce contexte, la question de la protection sociale apparaît d'autant plus pertinente qu'elle oblige à des redéfinitions essentielles des normes institutionnelles et des logiques des acteurs à la lumière des articulations passées et présentes entre dépendance, pouvoir et marché. Auparavant fiction idéologique nationale créant du lien, la solidarité se révèle aujourd'hui comme un prétexte d'extorsion financière collective ou encore de profit par l'emploi des plus faibles.
2 Pour baliser cette évolution et ces contradictions, il convient de se référer aux principes régnant auparavant dans la société vietnamienne révolutionnaire. On abordera ensuite la situation présente de la protection sociale observée dans deux champs successivement analysés : celui du travail et de l'entreprise, puis celui des soins de santé.
LA MISÈRE HÉROÏQUEMENT PARTAGÉE
3 La libération du Vietnam, au terme de guerres longues et coûteuses, a alimenté une mythologie durable sur l'héroïsme du peuple vietnamien. Le sacrifice indéniable d'une génération au service de la libération politique a permis l'installation d'un régime socialiste qui a entretenu une ambiance de lutte. Avant l'unification avec le sud, il s'agissait de maîtriser un ennemi proche. Après 1975, malgré la réunification, l'État vietnamien a poursuivi une politique de fermeture et de mise à distance du monde extérieur. La guerre avec son cortège d'atrocités et d'héroïsme a fortifié une épopée révolutionnaire qui s'est lentement effritée dans l'après-guerre, la culture politique du sud venant certainement altérer la rigueur révolutionnaire nordiste après 1975.
4 Après 1954, l'État vietnamien a été le gestionnaire attentif d'un peuple armé, tant dans les usines que sur le front. Un « peuple en lutte » selon la formule consacrée est un peuple dont l'unité et la solidarité résultent du combat. D'où l'importance de l'engagement au service de la collectivité, du sacrifice héroïque qui, en principe, limitent les fractures sociales ou les occultent. Dans un tel contexte, la société des héros se construit sur l'élimination des catégories stigmatisées que sont les traîtres, les collaborateurs, les anciens privilégiés. Une telle dynamique, nourrie par une rhétorique révolutionnaire, dresse un tableau où chacun est à sa place, à sa tâche, pour le plus grand bien de tous. La domination politique, en l'occurrence celle du parti, est légitimée par les devoirs à accomplir et elle voile aisément l'émergence d'une nomenklatura assistée d'une foule de « cadres » porteurs de la vérité idéologique, politique et sociale. Dans ce peuple héroïque, les cadres politiques ici comme ailleurs forment une classe en position favorable car, hors du front, les statuts liés au mérite politique structurent la société qui est hiérarchisée politiquement. Mais le « peuple » ainsi encadré peut relativement concevoir l'illusion égalitaire dans le sacrifice partagé.
5 Les conditions de vie sont précaires pour une bonne partie de la population qui éprouve une misère commune à des degrés divers. Sous les bombardements, la protection réside dans l'unité et l'engagement collectif organisé par l'État-parti. La protection sociale consiste alors à bénéficier des services offerts aux combattants et à leurs familles. Ces services ne visent pas à produire du bien-être (welfare) mais à entretenir l'armée des combattants, civils et militaires, attelés à la tâche. L'organisation sociale se fonde sur des devoirs et non sur des droits. La vie humaine compte moins que la victoire, militaire et industrielle. Le peuple en armes a avalé temporairement les individus. La force du régime est de convertir ce modèle en une certaine réalité. Les récits de cette époque montrent des logiques personnelles enchâssées dans le mythe politique que la guerre permanente rend réel.
6 La société vietnamienne en guerre a ainsi produit un type de lien politique et social prégnant au point de constituer un substitut à une protection sociale sans objet, dès lors que le devoir ne laisse pas de place à des droits séparés. Il n'y a pas de champ pour un « social » disjoint du politique, c'est-à-dire hors de l'État-parti. Là où règne l'oblation à grande échelle, il n'y a point de droits distincts mais un traitement anonyme, fictivement égalitaire. Cette configuration explique peut-être l'actuelle incapacité de l'État à reconnaître des droits à une population abusivement représentée par le parti et ses organisations dépendantes. L'État combattant des années 1960-1970 au Nord-Vietnam était un État mobilisé rendant impossible un État-providence, fut-il de type soviétique, car les ressources étaient accaparées par la guerre. Le problème de leur redistribution ne se posait pas, sauf en termes de gratifications modestes aux plus héroïques des héros. Ainsi la société héroïque des héros constitue-t-elle une entité idéologique suffisamment forte pour remplacer l'assistance par l'apologie du dévouement et l'abnégation qui excluent la notion des droits individuels. L'homme nouveau n'est ni un sujet ni une personne. C'est une entité idéologique abstraite, une émanation de l'État, producteur de performances économiques et militaires. Il n'a pas besoin d'être protégé car il est l'État dans lequel il se dissout.
7 Un tel modèle est évidemment formel et la société révolutionnaire laisse un espace – de fait – aux stratégies individuelles, aux jalousies, aux conflits. Ceux-ci sont néanmoins suffisamment encadrés pour interdire la revendication de droits. Comme en Chine, la figure de l'État n'est interpellée au Vietnam que très tardivement lors de révoltes paysannes récentes (mi-90) qui constituent le premier signe fort de la fracture sociale qui se développe avec l'ouverture au marché. Aujourd'hui, les médailles distribuées par l'État mobilisent moins la population qui y voit le signe d'une rhétorique révolutionnaire obsolète depuis la réunification qui a entrouvert la réhabilitation de la richesse puis, depuis l'ouverture au marché, qui s'est accompagnée du mot d'ordre : « Enrichissez-vous. » Les inégalités économiques qui se sont alors développées à grande échelle posent en des termes nouveaux au Vietnam la question de la protection sociale puisque nombreux sont ceux qui, après des décennies d'héroïsme silencieux et d'encadrement social se trouvent littéralement largués, tandis que les plus habiles capitalisent les profits.
8 Deux secteurs montrent particulièrement bien cette nouvelle question sociale au Vietnam : le travail et la santé.
ÉLECTION ET PROTECTION DANS LE TRAVAIL
9 Placée au centre des réformes économiques, l'entreprise constitue un excellent laboratoire d'observation des transformations présentes et induit une analyse des représentations et des pratiques de protection au sein desquelles se décline la protection sociale dans son acception courante issue des démocraties industrielles occidentales. Durant les longues décennies de pénuries sévères, de 1954 au début des années 1990, peu de services étaient de fait disponibles pour les employés des usines dont l'immense majorité était composée d'hommes vivant séparés de leurs épouses et de leurs enfants restés dans les villages où la situation générale était bien pire, si l'on en juge par les comparaisons spontanées des uns et des autres [1]. L'accès à ces services était entièrement tributaire de la position occupée dans des micro-univers régis par une hiérarchisation extrême politico-productiviste. La conjonction entre activisme politique et ardeur dans la productivité – qui reste un axe majeur de gestion des entreprises dans la course actuelle au profit capitaliste – était d'autant plus astreignante que l'emploi assignait à des unités totales de vie à travers l'octroi du logement et des tickets de rationnement pour soi et les siens. Dans ces conditions de quasi-captivité enjoignant à la « soumission », selon le terme même par lequel les gens tendent à se différencier de l'étranger et à s'identifier dans l'appartenance [1], les « cures de récupération » peuvent être appréhendées comme l'un des bénéfices les plus valorisés de la protection sociale : selon les usines et les spécificités de leur production, il s'agissait soit d'envoyer l'employé dans un centre de repos provincial, soit de lui offrir dans l'institution de santé de son organisation un lit et une nourriture aux rations doubles ou triples. Parce que ce privilège accaparait l'ensemble des tickets de rationnement, il impliquait l'impossibilité d'aider la famille au village et conduisait souvent, quelle que soit la gravité du cas, à refuser une offre de soins loin du lieu de travail. Les « cures de récupération » étaient proposées à ceux qui étaient dotés d'un mérite politique élevé et faisaient des envieux parmi les collègues, y compris si ces derniers auraient semblablement décliné l'invitation à un repos et à une alimentation bienfaisants dans un contexte de très grandes privations partagées et d'épuisement important.
10 Les médicaments étaient alors rares et parfois compensés par les médecins eux-mêmes par des remèdes homéopathiques. Les erreurs de prescription étaient fréquentes et les récits de mort subite d'enfants ou d'adultes après une piqûre censée « remonter » ou guérir ne sont pas exceptionnels. Aucune plainte n'était bien sûr déposée faute de pouvoir nommer l'accusation, la faute, le fautif et le destinataire d'une telle revendication. D'aucuns, hommes et femmes s'effondrent en larmes aujourd'hui au souvenir de l'être cher perdu dix ou vingt ans auparavant dans ces conditions où le refoulement des émotions était imposé. Le regret de n'avoir pas su où ni comment inscrire et désigner l'erreur des personnels médicaux hante les mémoires de tous qui rappellent que les organisations politiques (parti, syndicat, organisation des jeunes, des femmes) leur ont intimé le silence et l'acceptation.
11 Le chômage n'existait pas comme catégorie puisque chacun à la campagne comme à la ville relevait d'une unité de production – administration ou entreprise – couvrant ou régulant en principe tous les maux et les événements heureux de l'existence : mariage, naissance, décès, accident du travail, maladie, etc. Les grandes entreprises avaient leurs propres hôpitaux dont le personnel a été aujourd'hui réduit comme ailleurs. Les coopératives se situaient à l'extérieur de ce cercle formel de « protection » et leurs membres n'ont jamais eu droit à des pensions de retraite. N'évoquons pas les allocations familiales qui sont un élément important des systèmes de protection sociale dans les sociétés industrielles occidentales : dès les années 1980, le Vietnam s'engage en effet dans une politique de réduction des naissances limitant à deux le nombre d'enfants. Les femmes qui travaillent et outrepassent ces normes voient leurs salaires amputés et les sanctions peuvent aller jusqu'au renvoi. En revanche, les hommes dont les épouses sont restées au village où les pénalisations sont plus difficiles à appliquer dissimulent aisément ces transgressions qui, dès lors, n'affectent pas leur promotion politico-professionnelle. Dans les entreprises, les obligations d'avortement sont précises et il n'y a pas de limite au nombre d'actes. Les femmes avortent ainsi régulièrement, de façon répétée, vite, dans une salle éventuellement réservée à cet usage et qui ne désemplit pas, même aujourd'hui par exemple dans le cadre d'une grande entreprise publique de confection qui a reçu le prix de « héros du travail ». En effet, les femmes sont très réticentes à la prise de pilules contraceptives – disponibles sur le marché – qui, à leurs yeux entamerait leur fertilité, laquelle doit rester intacte face à l'imprévu. La simplification de l'avortement, sa banalisation apparente n'arrivaient pourtant pas à faire taire les ambivalences des femmes déchirées entre les différents ordres de valeurs de la belle-famille, du mari et de l'entreprise. Ces contradictions balançaient généralement en faveur d'une dominance masculine large faisant souhaiter un héritier mâle susceptible de maintenir l'autel des ancêtres. Au début 2000 pourtant de jeunes couples affirment qu'un enfant suffit même s'il s'agit d'une fille ; l'introduction du marché et ses corrélats de consommation et d'individualisation font en effet de l'enfant un produit d'investissement devant être choyé, car représentatif du statut socio-économique de ses géniteurs.
12 Depuis le milieu des années 1990, les transformations se sont en effet multipliées dans des directions divergentes, réduisant encore les services de cette « protection sociale » déjà minimale, tout en renforçant les armatures politiques de la domination, devenue une niche pour la surexploitation du travail dans la nouvelle conjoncture d'expansion capitaliste. Les retraites constituent un des premiers lieux de visibilité de ces transformations : les différents décrets qui se sont succédé pour débarrasser l'État et les entreprises publiques de leur abondante main-d'œuvre ont tout d'abord laissé dans un dénuement complet et sans aucune pension une masse d'ouvriers et d'employés qui, selon les cas, ont touché soit une somme d'argent soit, durant quelques années, des allocations d'invalidité. Ces gens plus ou moins jeunes (de 40 à plus de 60 ans) – qui généralement n1ont ni compris ni maîtrisé la foule des changements qui affectaient leurs conditions de subsistance – sont désormais dans l'obligation de trouver coûte que coûte des ressources ; on les aperçoit baissant la tête dans les rues aux portes des écoles ou des postes pour vendre quelques friandises mais on les retrouve surtout dans les innombrables petites entreprises privées que fondent des cadres supérieurs membres du parti disposant des réseaux de connexion officiels indispensables à leur enrichissement. Ces derniers se présentent alors comme des créateurs d'emploi faisant preuve de solidarité et d'« humanitarisme », terme dont s'est très vite emparé le gouvernement vietnamien pour attirer les fonds étrangers vers les organisations de masse reconverties pour le regard extérieur naïf en ONG issues de la « société civile ». Corollairement ceux qui ont été relégués du travail – le plus souvent sous la pression et dans l'humiliation à l'exception de ceux qui ont cru pouvoir faire fortune avec une somme d'argent qui leur paraissait alors un capital mirobolant mais qui s'est vite évaporée avec les dévaluations – voient dans ces nouveaux employeurs une aubaine qui leur évite tout simplement la faim : une certaine reconnaissance pour accepter d'exploiter une main-d'œuvre usée et rejetée se fait jour sans qu'il soit possible de considérer que les acteurs délirent en éprouvant de tels sentiments.
13 Tous ceux qui ont eu la chance de rentrer au bon moment dans une des catégories bénéficiaires d'une pension de retraite à vie touchent, en 2000, de 200 000 dgs [1] (ouvrier) à 600 000 dgs (fonctionnaire de rang élevé) ; une pension de 200 000 dgs ne permet à cette date même pas d'acheter suffisamment de riz pour une personne pour un mois et l'obligation est donc faite de chercher des revenus supplémentaires dans la revente de produits, la tenue d'une échoppe alimentaire ou encore la vente nue de sa force de travail déclinante à un atelier privé dont le tarif horaire sera très inférieur à celui d'une entreprise publique et où aucune prestation sociale ne sera due.
14 La coupure entre sphère de travail privée et publique en termes de protection sociale est néanmoins bien difficile à tracer ; donnons-en quelques exemples concrets typiques de la décennie d'expérimentation du marché : beaucoup d'entreprises publiques manipulent à leur profit les juridictions qui permettent l'utilisation d'une main-d'œuvre précaire (aux statuts fragmentés de travail journalier, mensuel, etc.) mais imposent de la déclarer, afin de lui octroyer des assurances variables, aussi minimes soient-elles. Or les cas sont fréquents d'ouvriers travaillant depuis de longues années, n'ayant signé personnellement aucun contrat de travail qu'on leur dit garanti par le directeur du personnel. Dans ce contexte de fraudes massives, les ouvriers n'ont aucun droit à la moindre couverture sociale tandis que les entreprises offrent une devanture conforme. Notons d'autre part que, dans les régulations actuelles, les accidents du travail ne sont pas couverts par l'assurance maladie et que la charité de l'entreprise est dans ce domaine la seule donne. En revanche, la rupture entre salariés permanents – de plus en plus sélectivement recrutés en petit nombre sur des bases d'investissement politique – et travailleurs précaires aux contrats variables – qui constituent aujourd'hui la norme d'embauche – est très forte : à ces derniers est interdite l'appartenance au syndicat, qui dispose entre autres de sa propre « caisse d'assurance » aidant matériellement ses membres en cas de décès ou de maladie.
15 Mais dans tous les cas – y compris celui d'assurés en règle –, la maladie est synonyme de ruine : à l'hôpital comme dans les structures de soin des institutions publiques ; en effet seuls quelques médicaments sont délivrés à bas prix, alors même que les traitements efficaces atteignent des montants élevés. De surcroît, l'ensemble du personnel hospitalier se fait rémunérer illégalement par le malade qui, s'il refuse, est tout simplement laissé à son triste sort. La marchandisation qui affecte les services de santé n1est nullement exceptionnelle ; tout en effet s'achète depuis la libéralisation économique : l'emploi pour soi et les siens auprès des acteurs clés de l'entreprise qui se définissent par leur cumul des fonctions à la tête des dispositifs de direction proprement dite, du syndicat et du parti ; les diplômes, l'accès à une pension de retraite ou à toute indemnisation, mais aussi tout document officiel falsifiable à la demande. Le refus d'obtempérer à cet « impôt » entraînerait un blocage tel de la situation de l'intéressé qu'il apparaît impensable. Corollairement aujourd'hui un impensé général touche cette généralisation du marché et l'achat semble une norme universelle partagée auquel, imagine-t-on, le Vietnam aurait autrefois échappé par défaut.
16 On ne cherchera pas dans les tontines – existant ici comme ailleurs – une solidarité compensatrice à ces nouveaux processus de monétarisation de l'existence sociale : le mécanisme même de la tontine repose sur le calcul et sur une rationalité individuelle projetée sur l'accumulation des biens. Les tontines n'intègrent donc qu'une couche moyenne de retraités et de salariés disposant de revenus réguliers et laissent de côté tous ceux qui tissent la base matérielle de leur vie au jour le jour. On ne saurait présupposer non plus que les « collectes de dons » lors des catastrophes naturelles qui ont affecté ces dernières années le Vietnam recèlent un esprit de solidarité nationale. En effet, le suivi concret de ces collectes laisse peu d'illusion sur la « spontanéité des masses » tant vantée dans les discours de l'État ; comités de quartier et institutions fixent le montant des dons obligatoires qui seront prélevés dans le cadre des contrôles quotidiens qu'assurent les représentants du parti et des organisations de masse ; seul un très grand dénuement permet d'être dispensé de ces deux « dons » dans le cas d'un individu qui travaille et chaque micro-instance tient à afficher 100% de réussite dans sa caisse remise à des échelons supérieurs qui vont évaluer le travail politique fourni. Dans cette optique, l'humanitaire d'État qui progresse rapidement au Vietnam a la double vertu de maintenir à l'extérieur et à l'intérieur du pays une continuité avec l'image antérieure d'une nation solidaire, à toute épreuve.
17 Au-delà de cette rénovation idéologique exemplaire, les champs sociaux urbains et du travail, les plus touchés par les réformes économiques, offrent à l'observation une très grande incorporation collective et individuelle des préceptes du marché ; dans cette perspective, la solidarité se joue dans la coagulation des intérêts et devient donc de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale. Ainsi à la tête de toutes les instances du pouvoir d'une grande entreprise publique trouve-t-on quelques familles dont les liens sont renforcés par les alliances de leurs descendants et la redistribution de postes de confiance, permettant outre des rémunérations importantes, des gains illicites énormes. Le monopole politique favorise de manière déterminante la concentration économique et les avantages s'étendent à l'appropriation des terrains, et d'un ensemble d'investissements rentables. Cette solidarité paradigmatique interne aux couches supérieures – cristallisée sur l'alliance et la parenté – est aujourd'hui frappante au Vietnam, tout en correspondant par ailleurs à un modèle sociologique bien repéré. Dans les couches moyennes aux ressources garanties, la famille restreinte constitue le cadre unique de prestations non monnayables (grands-parents, enfants) mais orientées sur la fabrique imaginaire d'une descendance en permanente élévation sociale et représentative d'une entité commune. Par contre, aux niveaux inférieurs de l'échelle sociale, la précarité économique s'installe au sein même des rapports d'alliance et de parenté, ouvrant la porte par exemple de façon emblématique à l'usure, à l'abandon et/ou au rejet des plus faibles (personnes âgées, femmes).
18 De ce bref tableau, on ne saurait pourtant retirer la conclusion simplificatrice que l'intégration du marché au Vietnam aurait décomposé un système antérieur de couverture sociale étatique et de solidarité organique. Fondée depuis plus de cinquante ans sur une domination politique largement internalisée dans les consciences, la société vietnamienne a vu ses principes de hiérarchisation – toujours architectoniques – à la fois se combiner et se transmuer. La période communiste orthodoxe, en renversant les hiérarchies socio-économiques au profit d'une politisation pénétrant l'ensemble des sphères, n'a jamais remis en cause la valence hiérarchique impliquant la permanence de logiques de protection. L'égalisation ne fut jamais un slogan et ces prestations sociales obéirent toujours à un mode de hiérarchisation structuré sur l'ontologie politique. À cette dernière s'est vue adjointe aujourd'hui l'accumulation économique sans pour autant qu'on puisse imaginer que se reconstituent actuellement les anciennes classes sociales en vigueur sous la colonisation. Les déclinaisons de la protection sont désormais politico-économiques, concentrant l'échange des services au sommet de la pyramide et laissant dans un désert social les plus démunis : les pauvres n1ont en effet aucune valeur politique à offrir. Un portrait robot dresserait les caractéristiques suivantes : avoir un emploi suppose à la fois de disposer des fonds pour l'acheter et d'avoir accès à un acteur local du pouvoir doté de capital politique. Si l'emploi ne garantit aucune prestation sociale, ne pas en avoir commande le renoncement à ces dernières ; au-delà du droit formel à des prestations sociales, l'accès concret à celles-ci implique ressources financières et protection politique. Sans emploi, sans revenus et sans protection politique, le chômage des descendants est une certitude.
DE L'ASSISTANCE D'ÉTAT À L'ASSURANCE
19 Dans la tradition des régimes socialistes, la santé n'a pas de prix. Elle est une production de la société. On conçoit donc que la santé soit particulièrement affectée par les changements politiques et économiques liés à l'ouverture et au développement du marché. Le besoin de protection sociale croît à mesure que les inégalités devant la santé se creusent, l'État vietnamien montrant de fortes hésitations, en particulier en ce qui concerne l'assurance maladie.
20 L'État socialiste vietnamien antérieur aux réformes économiques ne protège pas la population mais il l'encadre et dispense son assistance, en particulier aux plus méritants et exemplaires. Si un principe de protection lié à l'appartenance au peuple se conçoit, il ne se traduit pas en termes de prestations mais en termes d'ordres et d'encadrements. Le mérite politique produit les statuts et la distribution des avantages, selon une logique banale. L'État assiste donc les familles brisées, les anciens combattants, les mères héroïques (mères de héros). De telles prestations sont distribuées par la puissance publique et ne sont pas des droits. C'est l'État-parti qui assure cette redistribution, à travers les rouages locaux du pouvoir régional ou local : comités populaires, syndicat unique, front de libération. La discipline et ses excès engendrent une certaine compassion sélective mais en l'absence de sujet individuel et de droits personnels celle-ci est épisodique et à visées édifiantes. L'assistance étatique se donne à voir finalement comme une récompense liée au sacrifice et au mérite qu'il crée. Parce qu'il ne dispose que de faibles ressources et qu'il fonctionne sur la programmation des performances économiques et politiques planifiées, l'État distribue des gratifications sélectives destinées à assister, mais surtout à présenter une générosité minimale, plus symbolique que réelle. Construit sur la gestion collective du malheur politique (le colonialisme, les guerres de libération), l'État vietnamien a cimenté son unité sur la capitalisation de l'héroïsme et une mise en scène du sacrifice collectif. Ainsi, les récits de patients et de soignants vietnamiens sur l'évolution du système de santé et l'assurance maladie, de la période révolutionnaire jusqu'en 1975, convergent de façon récurrente sur le poids de la discipline collective et la pauvreté partagée. Le partage de la pauvreté ne signifie pas l'égalité mais le fait que les inégalités ne sont pas visibles, voire ostentatoires, comme elles le sont depuis les réformes économiques. Les entretiens réalisés mentionnant la prise en charge dans les années 1960 et 1970 montrent des souvenirs remémorés positivement et construits par opposition à la critique systématique dont fait l'objet le secteur public de santé après 1986.
21 Un ouvrier retraité de 66 ans précise ainsi de façon exemplaire : « En 1963, j'étais un travailleur d'élite enthousiaste. Je négligeais ma santé. À l'hôpital 108 (armée), on ne m'a rien refusé. J'étais l'enfant chéri de l'armée. Les soins étaient très bons à l'époque, l'accueil aussi. Le même accident aujourd'hui, je meurs. Puisqu'il faut payer maintenant, je vais là où je suis bien servi : dans le privé. Il faut se sauver soi-même d'abord. Emprunter ou mourir. Maintenant c'est l'argent dans la santé, dans l'éducation. Seul le club des retraités nous aide un peu dans le quartier... Le paiement d'une enveloppe pour avoir de bons soins à l'hôpital, c'est général depuis 1994. Quand je me suis cassé le col du fémur en 1995, on a proposé trois options à ma famille : pour un million de dgs des bons soins, longs, pour 300 000 dgs une qualité moyenne, pour moins un traitement médiocre et rapide. On leur a dit : Que choisissez-vous vu son âge ? » Ce discours recueilli en 1998 souligne les aspects les plus saillants des changements vécus. À cette lecture de la prise en charge médicale, il faut ajouter les représentations extrêmement répétitives de l'assurance maladie. En très grand nombre, les gens considèrent que la carte d'assurance maladie constitue un signe infamant de pauvreté qui garantit des soins médiocres, après un accueil brutal. Au point que la carte est souvent inutilisée, voire cachée. De surcroît, la grande majorité des titulaires sont les fonctionnaires et employés de l'État qui la payent par retenue obligatoire sur salaire et la considèrent souvent comme une taxe étatique. L'assurance maladie peine depuis près de dix ans à dépasser la couverture (théorique) de 20 % de la population dont le tiers est composé des élèves des écoles. La carte d'assurance maladie est donc largement envisagée comme une contrainte peu productive. Il s'agit d'un instrument sous-utilisé, jugé stigmatisant. Seule une partie des personnes habituées depuis des décennies à bénéficier d'une assistance d'État au double titre de pauvres et de personnes méritantes (anciens combattants, ouvriers médaillés) semble utiliser cette carte sans revendications critiques. La perception des inégalités sociales croissantes, de l'essor du secteur privé amènent au contraire les autres couches sociales à critiquer vivement la mise en œuvre de l'assurance maladie à partir de deux types de refus.
22 Le premier porte sur l'imposition d'un centre de soins désigné et fixé, récemment levée. Cette contrainte était largement contestée au nom du libre choix des malades trop longtemps obligés de subir une discipline bureaucratique et désormais extrêmement sensibles à la liberté de choisir qui accompagne le marché. Le second refus se focalise sur la liste restreinte de médicaments qui est offerte aux assurés pour des raisons de coût évidentes. Cette limitation est jugée attentatoire à la dignité et à la « distinction » des malades qui y voient une brimade étatique ou un effet de ségrégation. Ces deux refus manifestent une rupture complète avec l'époque antérieure de la discipline subie et du sacrifice individuel et collectif pour la nation. La violence de la contestation observée résulte dans une large mesure du poids et de la mémoire des années passées. L'unité du peuple a éclaté dès lors que le marché a ouvert la voie à une différenciation sociale et économique très rapide qui provoque l'amertume de tous ceux qui ne sont pas en position de maximiser leurs avantages. Il en résulte une concurrence pour l'accès aux biens de santé qui rend la question de la protection sociale d'une extrême acuité.
23 La carte d'assurance maladie, un moment présentée par l'État comme un acte civique, ne fait l'objet que de peu d'adhésions volontaires car le régime ne parvient pas, depuis les années 1990, à définir une politique de protection sociale ajustée aux transformations induites par le développement d'une économie de marché prédatrice en l'absence de références en termes de politique sociale. Les hésitations qui caractérisent la mise en œuvre de l'assurance maladie sont symptomatiques des contradictions du « socialisme de marché ». Dans l'enthousiasme mercantile qui régnait au début des années 1990, l'État, à court de ressources pour maintenir le système de santé en état de marche, a eu une approche comptable et financière de l'assurance maladie. La large autonomie de gestion accordée aux caisses régionales les a transformées en entreprises profitables maximisant les rentrées financières et minimisant les prestations. Cette optique a affaibli la qualité des soins distribués, sans parler de la corruption. Au milieu des années 1990, plusieurs gestionnaires provinciaux de caisses d'assurance maladie sont partis avec la caisse montrant le système dans sa nudité cynique. En l'absence d'un système fiscal performant et de toute idée d'une redistribution par l'État, celui-ci a réagi entre 1990 et 1996 comme un entrepreneur de services, les cotisations servant, dans une certaine mesure, à renflouer les finances de l'État central et des provinces.
24 Ce brutal passage de la planification de la misère au laisser-faire de la corruption s'observe aussi en Chine. Dans ces périodes d'intenses mutations où fleurit la délinquance, l'appareil d'État tire profit de sa position en transformant le pouvoir politique en pouvoir économique. Les hauts responsables de l'assurance maladie à Ho Chi Minh Ville, entendus en 1995, exposaient des projets de construction de cliniques privées en joint venture avec des sociétés d'assurance occidentales (australiennes et françaises) destinées à vendre des soins de santé sophistiqués aux « nouveaux riches » du pays et aux étrangers présents ou attendus. Ces investissements étaient réalisés avec les bénéfices de la caisse régionale, c'est-à-dire avec les cotisations des assurés dont on minimisait les prestations. On parlait de « définir les besoins des pauvres » et « d'identifier les besoins des riches » (sic) en précisant que : « Le pauvre ne doit pas être trop exigeant. » Des services pour les fortunés (climatisation, choix complet de médicaments et examens) furent installés dans plusieurs grands hôpitaux à Ho Chi Minh Ville. Aujourd'hui, dans cette ville, comme à Hanoï, des cliniques sophistiquées sont en place dans les plus grands hôpitaux. Les classes dominantes vietnamiennes et les étrangers y sont traités à des coûts élevés, conformément au projet initial. Après 1995, des compagnies d'assurance « privées contrôlées » par l'État sont nées (par ex. Bao Viet) afin d'assurer les nouveaux risques liés à l'extension du marché et du champ contractuel. Risque et contrat étaient auparavant des concepts sans signification. Un certain partage des tâches en est résulté, le gouvernement prenant conscience du danger politique et social touchant sa légitimité, en particulier après les révoltes paysannes et de minorités de la fin des années 1990 qui manifestaient le refus des oligarchies bureaucratiques et des poches d'exclusion potentiellement explosives. La politique de l'État vietnamien en matière d'assurance maladie apparaît comme une valse hésitation, ponctuée de décisions impopulaires parfois rapidement annulées, la plupart inspirées par une approche bureaucratique, maladroite, cherchant à ne pas courroucer des millions de paysans pauvres qui ne cotiseront pas volontairement, tout en redistribuant le minimum.
25 De multiples missions d'experts vietnamiens se sont rendues en Europe et aux États-Unis, rapportant des techniques étrangères probablement inadaptées que personne n'a appliquées. De nombreuses expériences pilotes ont été développées avec des ONG et ont donné lieu à une foule de rapports sans grands effets. Les diverses activités de microcrédit et les microprojets de mutualité ne constituent pas une politique sociale qui demeure suspendue aux contradictions de l'État. Celui-ci a bien perçu la nécessité d'agir avant l'émergence de mouvements sociaux qu'il fait tout pour neutraliser. Notons que, au Vietnam, peut-être encore plus qu'ailleurs, en raison de la polarisation politico-économique qui structure la société, ces microcrédits vont systématiquement et directement dans les mains des familles ayant des membres au parti, s'ajoutant à leurs revenus. En effet, les activités des ONG étrangères sont largement contrôlées par le parti. Toute rébellion de la part des étrangers sur le terrain est sanctionnée par l'expulsion de l'ONG. Les plus pauvres n'ont donc jamais accès aux microcrédits qui leurs sont destinés.
26 La dernière décision promulguée (n° 139 du 15 octobre 2002) désigne les pauvres avec des revenus inférieurs à 100 000 dgs mensuels, les montagnards et minorités, et six provinces montagneuses, comme bénéficiaires de caisses spéciales, à but non lucratif, financées à 75 % par l'État, créées par les comités populaires. Ce fond subventionnerait des cartes d'assurance et des frais médicaux. La part prise par l'État signale une prise de conscience politique centrale du danger représenté par les exclus de l'économie de marché. L'approche géographique (des zones) illustre une conception où la solidarité s'exerce entre régions plutôt qu'entre groupes sociaux, amenant à émettre l'hypothèse que l'État demeure encore dans une vision d'assistance plutôt que d'une « assurance impossible » à tout le moins très problématique. La culture du diktat, fut-il adouci, demeure plus visible que celle du contrat qui conditionne pourtant une approche assurantielle. Celle-ci requiert une confiance qui fait défaut dans la société. Lassés des slogans étatiques récités avec leurs voisins, les Vietnamiens se défient désormais de l'État comme de leurs voisins.
TENSIONS DU MARCHÉ
27 L'État vietnamien poursuit une stratégie courte de bonnes œuvres sélectives. Les moyens politiques et financiers semblent faire défaut pour affronter les mutations d'une gestion solidaire des risques largement impensable et impensée au Vietnam, plus encore qu'en Chine. Les dons forcés destinés à secourir les victimes des cataclysmes naturels sont plus proches d'une charité imposée que d'une politique sociale par défaut. Le Vietnam continue à exporter de la main-d'œuvre dans des pays étrangers au mépris de toutes les législations sociales et à tout miser sur son intégration régionale dans l'ASEAN. Ces choix mettent en présence d'une politique de protection sommaire et, à un certain point, fictive, tant qu'elle est gérée par des organisations politiques (les comités populaires). Les discours humanitaires de l'État, le développement de la Croix-Rouge, plongent dans une approche peu innovante, anachronique car assistantielle. Les conduites des acteurs sociaux demeurent dans la prédation de la richesse, à cause d'une longue privation. Les notions de répartition et de redistribution qu'on pourrait croire pertinentes à cause de leur parfum révolutionnaire apparaissent dépourvues de sens, bien qu'une partie de la population ressente le besoin de construire un lien social hors de l'argent et hors de la figure symbolique de l'État très altérée. « L'État doit penser aux moins doués » dit une institutrice. Le passage de la charité d'État à une politique de protection des populations les plus faibles suppose une « société civile » qui fait largement défaut au Vietnam. Entre les nostalgiques de l'ordre ancien – moins inégalitaire aux yeux des acteurs tant en matière de santé qu'en matière de travail, de tickets de rationnement et de logements car très peu de médicaments étaient disponibles – et la prédation quotidienne qui s'inscrit dans la logique du marché mondialisé s'installe un lourd silence. La Banque mondiale prête aux « pays pauvres » des réserves de solidarités familiales pour panser les blessures du libéralisme sauvage. Sur ce registre, le Vietnam peut être considéré comme un bon élève, particulièrement si l'on se penche sur la gestion des rapports d'alliance et de parenté dans les classes dominantes ! En effet, l'État assistait sélectivement des familles brisées par la libération mais, dans l'économie de marché et grâce aux valeurs de solidarité familiale prêtées au confucianisme, les familles réunies s'assisteraient et communiqueraient dans le consumérisme retrouvé. Cette jolie façade, discrètement culturaliste, ne résiste pas à l'examen de l'absence de traitement réservé à de nombreuses personnes, âgées, seules, retraités sans pensions, paysans sans terres... D'un côté, le réveil des héros est douloureux pour les plus héroïques d'entre eux. De l'autre, les « nouveaux riches », relevant de la matrice de l'appareil d'État, préfèrent les offrandes aux politiques sociales. Au milieu, les signaux de danger sont allumés.
Notes
-
[*]
Anthropologue, directeur de recherche IRD.
-
[**]
Anthropologue, directrice de recherche, directrice de l'UR Travail et Mondialisation (IRD).
-
[1]
Cet article s'appuie sur une série d'enquêtes ethnologiques de types différents, s'étalant sur plus de dix ans.
— B. Hours, dès 1991 dans le cadre d'une recherche financée par l'UE, a démarré des enquêtes sur l'accès aux soins et les dispositifs de santé publique. Ces enquêtes se sont poursuivies en 1993, en 1995, en 1997 et en 1998. Fondées sur des entretiens avec les malades et les personnels de santé dans des hôpitaux et des dispensaires, elles ont été étendues aux institutions devant constituer de nouvelles normes de prise en charge et de protection sociale à Hanoi et à Ho Chi Minh Ville.
— M. Selim, à partir de 1993, puis en 1995 et en 1997, a mené des enquêtes dans des entreprises publiques et privées afin de dégager les changements affectant les conditions de travail, les modes de gestion du personnel et les services différenciés de protection. De 1998 à 2000, durant deux années entières, des investigations de longue durée, fondées sur une immersion prolongée, génératrice de familiarité, de communications spontanées et d'observations directes, ont été menées dans deux sites. Le premier était une grande entreprise publique de confection ayant réussi brillamment sa mutation à l'économie de marché et ayant racheté de nombreuses usines de province en faillite. La population de cette entreprise – existant depuis près d'un demi–siècle – a été étudiée dans ses différentes franges : en activité, au chômage et à la retraite, démissionnaire et licenciée, résidant dans le quartier fermé de l'entreprise, dans des quartiers voisins et dans les villages environnants (habitat collectif et individuel). Le second site étudié était le quartier du syndicat national à Hanoi, réservé historiquement aux couches sociales les plus défavorisées et les plus méritantes en termes politiques, et comportant plusieurs entreprises très contrastées. S'est dévoilée là une extrême diversité de situations, d'itinéraires de promotion et de déclin dans un groupe très représentatif de l'ancienne « avant-garde », aujourd'hui éclatée. -
[1]
« Nous les Vietnamiens, nous sommes soumis » revient de façon récurrente dans les entretiens avec les ouvriers.
-
[1]
14 000 dgs = 1 US $ ; ces chiffres résultent des enquêtes personnelles de M. Selim.