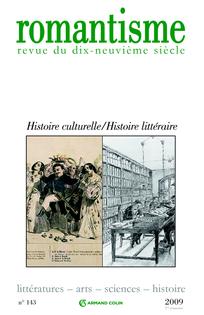1 Indéniablement, l’histoire culturelle – ou l’histoire sociale du culturel – a, depuis quelque temps déjà, solidement pris pied sur le terrain des études littéraires. Au point qu’il n’est pas exagéré de constater qu’on doit à des historiens de profession certaines des avancées les plus significatives dans des domaines qui pourraient ou devraient relever, en principe ou par tradition, de l’histoire littéraire – qu’il s’agisse par exemple des sociabilités littéraires [1], de la réception du roman-feuilleton [2], de l’édition littéraire [3], de la littérature provinciale et régionaliste [4], du récit criminel [5], des romans pour la jeunesse [6], voire de l’étude globale d’un genre littéraire [7].
2 Ce dynamisme de l’histoire culturelle du littéraire – disons la chose ainsi – a sans doute ses raisons, qui tiennent au rythme propre de la discipline, à l’arrivée de nouvelles générations de chercheurs, au succès public de cette science historique nouvelle et aussi, peut-être, à la vitalité du débat international entre historiens, qui permet une plus grande diversification des objets et des méthodes ainsi qu’un décentrement salutaire du point de vue : par comparaison, l’histoire de la littérature française, en grande partie déterminée par le regard que la collectivité nationale porte sur son propre passé culturel, a toujours du mal à sortir de son cadre hexagonal, à quelques exceptions près, et à éviter d’être prise au piège de ce jeu de miroir.
3 Mais il est une autre raison, plus profonde et théorique, qui explique les avancées actuelles de l’histoire culturelle. Lorsque l’historien prend pour objet de recherche une réalité littéraire quelconque, il s’y applique comme il le ferait de toute autre pratique culturelle, comme de toute réalité du passé n’ayant avec son présent qu’un rapport d’antériorité – même si, bien entendu, sa propre situation d’observateur doit influer sur sa manière de considérer ce passé. Au contraire, l’historien de la littérature a pour objet des textes dont une partie, au moins, appartient de plein droit à son présent de lecteur, et ce n’est d’ailleurs que la présence de ces textes, comme objets de lecture participant pleinement de la culture contemporaine, qui en fait aussi, indirectement, des objets historiques. Toute théorie de l’histoire littéraire un peu conséquente commence, comme nous le faisons à notre tour ici, par marteler cette transhistoricité de la littérature et elle a bien raison, car on n’aura jamais fini de mesurer tous les effets, aussi féconds que calamiteux selon le point de vue où l’on se place, de cette confusion des temporalités. Celle-ci a bien sûr ses causes institutionnelles : l’histoire littéraire, depuis qu’elle existe, a toujours été l’auxiliaire de la critique littéraire ou de l’apprentissage rhétorique, a donc été annexée à des finalités qui n’étaient pas les siennes. Mais, le voudrait-il vraiment, l’historien de la littérature ne peut pas, ou plutôt ne doit pas faire comme si ces textes qu’il lit n’appartenaient pas à son présent de lecteur, ainsi qu’à celui du public auquel lui-même s’adresse. C’est bien là que le bât blesse, et non pas, comme on le dit souvent, dans la valeur esthétique qu’il accorde aux œuvres littéraires et qui perturberait la qualité scientifique de son travail historique : après tout, la plupart des historiens ont autant de révérence pour les supposés chefs-d’œuvre de la littérature. Il s’ensuit aussi une démarcation, là encore inévitable, non pas entre les majores et les minores, mais, plus exactement, entre les textes qui sont encore lus et ceux qui sont sortis de la mémoire collective et sont ainsi totalement passés, sauf pour les seuls spécialistes.
4 Aussi l’histoire littéraire et l’histoire culturelle n’ont pas les mêmes objectifs et ne rencontrent pas les mêmes difficultés, et c’est pourquoi il nous a paru utile de les confronter dans Romantisme, qui s’est donné depuis l’origine pour mission d’interroger le lien, problématique mais essentiel, entre littérarité et historicité, à propos d’un siècle – le XIXe – où, jamais, les écrivains n’ont eu à ce point la conviction d’être des acteurs de l’Histoire. Cette confrontation ne doit pas, bien sûr, consister à mesurer les mérites respectifs des uns et des autres, mais, à prendre conscience des complémentarités entre les disciplines : en somme, de l’utilité, voire de la nécessité de la pluridisciplinarité. Mais la pluridisciplinarité n’est possible que si historiens et littéraires se reconnaissent un noyau commun de problématiques, d’objets ou d’apories. C’est aussi à esquisser les contours de ce noyau que peut contribuer un numéro comme celui-ci.
5 Que l’histoire culturelle serve à l’histoire littéraire, la chose est trop évidente. Ne serait-ce que parce que l’historien de la littérature n’est jamais un historien de profession, mais institutionnellement un commentateur (ou un « critique ») ayant emprunté de longs détours qui l’éloignent de son métier d’enseignant littéraire : il lui est donc bon, tout simplement, de se tenir informé du renouvellement des méthodes et des savoirs historiques. Surtout, l’histoire culturelle doit l’aider à lutter contre la grande et pernicieuse tentation de l’histoire littéraire, à refouler, encore et toujours, le monographique. Tous les historiens de la littérature soucieux de méthode ont prononcé la même mise en garde : une suite chronologiquement ordonnée de monographies sur quelques grands auteurs ne saurait constituer une histoire littéraire, elle interdit même la compréhension historique de cette réalité sociale qu’est la pratique littéraire. Mais comment faire autrement, lorsque l’histoire littéraire n’a d’autre fonction que d’aider à la lecture des textes et qu’on n’est spécialiste de littérature, en France, qu’à la condition d’être spécialiste d’un auteur ? Cela ne signifie pas, bien entendu, que les recherches monographiques ne soient pas nécessaires à l’histoire littéraire [8], mais simplement que l’historien de la littérature et le spécialiste d’un auteur, même lorsque ces deux rôles distincts sont assumés par une même personne, ne poursuivent pas les mêmes buts, et que la schizophrénie intellectuelle à laquelle conduit cette confusion des rôles exige un peu de discipline, à laquelle peut aider l’histoire culturelle.
6 Quant à l’histoire sociale du littéraire, elle peut aussi apprendre de l’histoire littéraire. Car cette transhistoricité, dont nous avons dit les difficultés presque insurmontables qu’elle créait, n’en est pas moins constitutive du fait littéraire lui-même : même considérée comme un pur objet historique, la littérature a besoin des instruments interprétatifs de l’histoire littéraire pour être réellement historicisée, parce que les catégories esthétiques qui structurent et déterminent la production des textes considérés comme littéraires relèvent d’une autre temporalité que les événements ordinaires. La compréhension historique de cette temporalité passe en particulier par ce qu’il est convenu d’appeler la « poétique historique » de la littérature qui, pour être efficace, doit être immergée autant qu’il est possible dans la réalité sociale, mais n’en a pas moins son objet propre – les formes, les modalités, les catégories concrètes de l’écriture littéraire, sous réserve, bien entendu, de s’entendre sur ces notions de « littérature » et de « littéraire ». Quant aux genres, il est urgent, au lieu d’avaliser sans examen les catégories héritées de la tradition scolaire, d’en faire sérieusement l’histoire – et de commencer, d’abord, par mener à bien l’histoire des « poétiques » des divers genres, institués ou « factuels », tâche propre des « littéraires », et qui marque un retard dont il est temps de prendre conscience.
7 Voilà donc le dialogue que nous avons voulu essayer de nouer ici. Mais il va de soi que nous ne pouvions, dans le cadre d’un numéro de revue, aller au-delà des premiers échanges. Nous avons donné d’abord la parole à deux historiens qui, à des titres divers, adoptent un point de vue surplombant sur ce dialogue scientifique : Christophe Charle, dont l’article, à la fois synthétique et pertinemment polémique, fait à lui seul l’examen des relations, nécessaires mais parfois difficiles, entre historiens et littéraires, et Edward Berenson, qui propose une autre sorte de confrontation, non plus entre deux disciplines, mais entre historiens de France et des États-Unis. Par ailleurs, à titre de premiers jalons de recherches interdisciplinaires qu’il faudrait poursuivre et compléter, nous avons choisi de réunir historiens et littéraires autour de trois notions qui nous ont paru fondamentales et déterminantes pour toute réflexion historique sur la littérature : les sociabilités – les sociabilités réelles qui conditionnent l’activité littéraire mais aussi les sociabilités représentées par les textes eux-mêmes ; les institutions sociales qui, à un titre divers, contribuent à structurer le champ littéraire ; les productions textuelles elles-mêmes, dont l’étude doit être la pierre de touche ultime de toute histoire du littéraire, quelle qu’elle soit.
SOCIABILITÉ, SOCIALITÉ
8 Les exposés présentés sous cet intitulé s’attachent à définir les mutations qui, au XIXe siècle, ont eu trait aux conditions sociables mais aussi sociales et nationales d’exercice de la littérature. Tout autant que d’histoire culturelle, il s’agira donc d’histoire sociale, mais de l’histoire sociale de l’instance culturelle sans doute alors la plus décisive. La question est traitée sous trois focales complémentaires : un exposé transversal sur les sociabilités littéraires, un autre sur le conflit sociabilité/socialité, un troisième sur cette autre forme de socialité large qu’est la Nation.
9 Guillaume Pinson envisage les sociabilités littéraires « au croisement de l’histoire culturelle et de l’histoire littéraire », démarche nécessaire, d’autant qu’en la matière les représentations comptent tout autant que les pratiques. Pour en finir avec la petite histoire anecdotique des salons et des cafés littéraires, il convient en effet d’inscrire les recherches sur les sociabilités dans cette discipline en construction qu’est l’histoire culturelle. Cette étude s’attache à montrer comment, en particulier dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les sociabilités littéraires sont prises dans un devenir à la fois médiatique et fictionnel : en témoignent la presse, mais aussi le roman réaliste qui, autour de 1900, manifeste un véritable engouement pour la mondanité, un peu paradoxal au moment où déjà commence à prévaloir la « culture de masse ».
10 José-Luis Diaz propose d’élargir le cadre des recherches sur les sociabilités littéraires en rappelant qu’elles ont intérêt à s’inscrire dans une démarche d’histoire culturelle et de sociocritique plus large. Ce n’est pas seulement les sociabilités qui doivent intéresser l’historien littéraire « culturaliste » mais, de manière plus générale, les rapports d’influence réciproque entre « littérature » et « société ». Chose décisive au début de la monarchie de Juillet, quand la presse et la littérature panoramique prennent pour objet d’étude les transformations qui affectent aussi bien les sociabilités concrètes, leur représentations changeantes que la « position sociale » des écrivains et des artistes. Et si « socialité » au singulier est opposé à « sociabilités » au pluriel, c’est que la période procède à une remise en cause des sociabilités littéraires, les anciennes (le salon) comme les récentes (le cénacle, l’école). Devenue à elle seule tout un monde, la « littérature » rêve alors d’avoir à elle seule une surface sociale transcendant les limites du seul corps des gens de lettres.
11 Anne-Marie Thiesse montre comment, durant le XIXe siècle, se forment dans l’espace européen des littératures nationales, qui, à l’origine, se développent paradoxalement dans le cadre de transferts culturels transnationaux intenses. Comme du fait de leur lutte contre l’hégémonie culturelle française, les autres pays européens ont pris à cet égard de l’avance, c’est la France qui, à son tour, doit se modeler sur eux. D’où la part si importante des influences étrangères sur le romantisme français. Lorsque l’idée de Nation est sur rails, la France attend de la littérature comme des autres pratiques culturelles une double confirmation : des valeurs communes, propres à souder la communauté nationale ; un trésor patrimonial commun aussi. Ce à quoi s’emploient tout aussi bien la notion de « monuments historiques » que la constitution d’un panthéon littéraire national. La Nation a besoin d’écrivains exemplaires, incarnations de son génie propre. Et elle joue sur deux tableaux : nationalisme culturel, mais aussi volonté de refonder sa position hégémonique perdue, en arguant d’un rapport privilégié à l’universel.
INSTITUTIONS
12 Cette partie s’intéresse aux rapports – trop longtemps négligés pour ce qui concerne le XIXe siècle – que la littérature entretient avec les institutions, que ce soit l’État lui-même, les académies ou l’appareil scolaire.
13 Françoise Mélonio nous invite, dans un texte synthétique et programmatique, à repenser les liens entre l’État et la littérature. Car l’État joue un rôle triplement institutionnel : par sa force de contrôle et de légitimation, par son rôle formateur, par son poids économique – par le biais des commandes et des rémunérations diverses. La littérature est donc, au XIXe siècle, une « affaire d’État » – ce qui ne signifie pas nécessairement mainmise étatique ou censure. Les historiens du littéraire doivent intégrer cette dimension institutionnelle, ce qui implique qu’ils acceptent le risque de la désacralisation de la littérature, ainsi que la part de « consonance » (ou de conformisme culturel) indispensable à l’invention littéraire. À condition, cependant, que cette institutionnalisation de la littérature ne vienne indûment renforcer les approches purement nationales, dans un domaine où la dimension trans-nationale (et donc comparatiste) est fondamentale – même si le nationalisme littéraire est, à bien des égards, une invention du XIXe siècle lui-même.
14 L’exposé d’Anne-Sophie Leterrier traite plus spécifiquement du rapport entre histoire littéraire et histoire des institutions culturelles. « Institutions » est pris au sens de « structures sociales établies par la loi ou le pouvoir dans le domaine du savoir », et les institutions ici visées sont des institutions savantes : académies, en particulier l’Académie des sciences morales et politiques, mais aussi le conservatoire. De telles institutions ne valent pas seulement en elles-mêmes, mais aussi par leurs pouvoirs structurants, par les formes, genres et styles qu’elles imposent. En outre, l’approche par l’institution invite à retracer des réseaux complexes. L’auteur s’en prend à l’idée reçue selon laquelle ces institutions savantes ont dans tous les cas un aspect conservateur et rétrograde, qu’elles imposent l’ « académisme ». Elle démontre que les institutions savantes sont moins monolithiques qu’il n’y paraît et qu’elles offrent un « point de vue fécond sur l’histoire des arts ».
15 Denis Pernot s’intéresse enfin quant à lui aux rapports entre littérature et institution scolaire. Rapports d’hostilité souvent, en particulier à la fin du XIXe siècle, où, après le vote des lois Ferry, les nouveaux manuels d’enseignement en arrivent, en quantité, à représenter la moitié de la production éditoriale. En conséquence, une partie des écrivains (Barrès, Bordeaux, Proust, Larbaud) et des critiques (Vanderem, Divoire, d’Alméras) font effort pour libérer la littérature des modèles que les « didactiques » imposent. Pour contrer les panthéons admis par l’institution scolaire, on leur oppose de nouvelles gloires que l’école ne reconnaît pas encore (Nerval, Baudelaire, Huysmans). À la critique des « cuistres » et des « Normaliens », tout comme à la « dissertation », on oppose la critique nouvelle (Suarès, Rivière, Thibaudet). De là une antithèse tranchée entre les auteurs de « vraie littérature » et les « manuellistes », les premiers contestant leur magistère aux seconds et s’offrant à former des débutants littéraires selon leurs propres valeurs.
PRODUCTIONS TEXTUELLES
16 C’est à la collaboration nécessaire et prometteuse de l’histoire littéraire et de l’histoire culturelle en matière de productions textuelles que s’intéresse un dernier ensemble de trois études. Et c’est aussi cette collaboration qu’elle met en œuvre, en proposant la contribution d’un historien et de deux « littéraires ».
17 Historien, Dominique Kalifa s’intéresse aux rapports changeants que l’historien a entretenus avec les « productions textuelles ». Rapports de méfiance longtemps, l’historien se fondant en priorité sur l’archive, tenant en suspicion les sources imprimées, et plus encore la littérature et ses entours. Puis est venu le temps (récent) de la reconsidération positive des sources textuelles de l’histoire, voire d’une histoire qui, par un renversement du tout au tout, s’est donnée pour mission de considérer les pratiques elles-mêmes comme des textes. De là, des conflits. La trêve actuelle en la matière permet d’envisager avec objectivité les trois modalités distinctes selon lesquelles les historiens se sont emparés des productions textuelles. 1° L’histoire matérielle de la production textuelle : livres, journaux, revues (Donald Mc Kenzie, Roger Chartier, Jean-Yves Mollier), adossée à la riche tradition de l’histoire de l’édition. 2° L’approche sociale du texte imprimé, en ses deux dimensions, écriture et surtout lecture, qui a permis de mieux apprécier les fonctions sociales, politiques et « morales » des textes littéraires, de percevoir les effets de la lecture, et d’apercevoir aussi comment les auteurs (Balzac, Sue, etc.) ont joué, en retour, de l’investissement de leurs lecteurs. 3° L’analyse et l’interprétation des « contenus » des textes, de leurs thèmes, de leur mode d’agencement et de narration, et des imaginaires qu’ils contribuent à façonner. Malgré d’évidentes chausse-trappes, les textes littéraires sont une mine dont ne peut se passer l’histoire des imaginaires sociaux (Jean Delumeau, Jacques Le Goff, Alain Corbin, Lynn Hunt). Observés en série, ils constituent un des observatoires privilégiés où saisir le « mental » (Alphonse Dupront), et en particulier les « crises de sensibilité collective » (Michel Vovelle).
18 Alain Vaillant plaide, pour sa part, pour une histoire de la communication littéraire, en tant que chantier à ouvrir dans le cadre d’une histoire culturelle de la littérature en construction. Il y a avantage, selon lui, à englober la littérature dans l’ensemble des formes de communication sociale, et aussi à prendre en considération les divers circuits changeants dans l’histoire auxquels la littérature elle-même a recours : lecture privée ou publique, envoi de manuscrits, publication périodique, édition en livre imprimé, en recueil, sous la forme d’œuvres complètes, etc. D’où le programme d’une génétique historique de la littérature qui, à côté de la génétique intratextuelle, permettrait de comprendre les processus culturels de l’invention littéraire. D’où aussi l’idée qu’il faut tenir compte d’une double mutation qui caractérise le XIXe siècle : la concurrence faite à la littérature par la « communication savante et didactique », et le développement de la culture médiatique, laquelle s’empare de la fonction médiatrice qui jusque-là avait été le cœur de la communication littéraire. Cette histoire culturelle de la communication littéraire devrait s’attacher à donner une vision moins traditionnelle de la division en genres, réagir contre le littératuro-centrisme, mais aussi faire que l’histoire littéraire se consacre plus qu’elle ne l’a fait à son domaine propre : une poétique historique de l’écriture, tenant compte de ses fondements sociologiques comme de ses prolongements médiologiques.
19 Se félicitant que l’histoire littéraire se soit délivrée de sa hantise de l’axiologie pour proposer des questionnements plus « culturalistes », Marie-Ève Thérenty pose qu’une poétique des représentations devrait être un des volets essentiels de la coopération entre histoire culturelle et histoire littéraire. Dans ce cadre, elle propose une « poétique des supports », prenant appui sur l’histoire culturelle du livre et des médias. Elle invite les poéticiens à ne pas laisser de telles questions aux seuls historiens, mais à prendre eux-mêmes la mesure de l’importance du medium dans la communication littéraire. À eux de se demander dans quelle mesure les écrivains se positionnent, non seulement par rapport à l’éventail des genres, mais aussi par rapport aux formes matérielles que ces œuvres peuvent prendre. Une telle poétique des supports pourrait se constituer selon trois angles complémentaires. 1° Attention accordée à l’énonciation typographique. 2° Prise en compte des prescriptions contraignantes émanant du champ éditorial. 3° Étude des imaginaires du support qui influent sur les textes eux-mêmes (ainsi de l’imaginaire médiatique qui travaille La Comédie humaine).
20 Ainsi qu’on le devine, ce premier ensemble d’études n’a pas la prétention de couvrir tout l’espace qu’il ouvre. Les trois champs de recherche investis pour cette fois en laissent d’autres à découvert, nous le savons bien. Rien ici, à proprement parler, pour témoigner d’une discipline pourtant fer de lance en la matière : l’histoire du livre et de l’édition (Jean-Yves Mollier), rien non plus sur l’histoire des spectacles (Jean-Claude Yon). Rien sur les bénéfices à escompter d’une histoire littéraire en prise sur l’histoire de l’art et sur des institutions artistiques telles que salons, musées, expositions. Rien sur les rapports – restant pour une large part à baliser – entre cette histoire du sensible que propose Alain Corbin et ses équivalents littéraires : ce qui, de la part des « littéraires », impliquerait d’ailleurs une historisation plus marquée de leurs « thématiques ».
21 De toutes ces pistes, soit suivies, soit pour l’instant laissées dans l’ombre, notre bibliographie propose une vue d’ensemble ; et elle renvoie à des ouvrages de synthèse qui la complètent (Françoise Mélonio, Philippe Poirrier). Après une première partie consacrée à la réflexion épistémologique particulièrement active que l’histoire culturelle tient sur elle-même, depuis une vingtaine d’années, une seconde partie propose une radioscopie des principales études d’histoire culturelle du XIXe siècle. Sa troisième et sa quatrième partie sont consacrées aux rapports entre histoire littéraire et histoire culturelle du XIXe siècle, qui sont au centre de ce numéro : considérés d’abord sur le plan programmatique, ils le sont ensuite quant à leurs réalisations concrètes. Réalisations très consistantes déjà, du moins si on considère ce champ de recherche au sens large, comme incluant les diverses « sociocritiques ».
22 À la dernière partie de cette bibliographie, nous n’avons pas cru bon d’ajouter les numéros de Romantisme qui, dès l’origine, couvrent tel ou tel des champs de recherche qu’elle dessine : car il y aurait eu presque à les nommer tous. Signe parmi d’autres que le dialogue entre littéraires et historiens a déjà un beau passé. Mais nous aimerions avoir montré qu’il a aussi des avenirs.
Notes
-
[1]
Antoine Lilti, Le Monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Fayard, 2005.
-
[2]
Judith Lyon-Caen, La Lecture et la Vie. Les usages du roman au temps de Balzac, Tallandier, 2006.
-
[3]
Jean-Yves Mollier, L’Argent et les lettres. Histoire du capitalisme d’édition (1880-1920), Fayard, 1988.
-
[4]
Anne-Marie Thiesse, Écrire la France : le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la Belle Époque et la Libération, PUF, 1991. Il est vrai que ce livre, bien que publié dans une collection d’ethnologie, est la version publiée d’une thèse d’État littéraire. Les travaux d’Anne-Marie Thiesse, qui relèvent à la fois de l’histoire littéraire, de l’histoire sociale, de l’ethnologie et de la sociologie historique, défient tout cloisonnement disciplinaire. Voir aussi de la même, à propos respectivement de la littérature populaire et de la constitution des littératures nationales : Le Roman du quotidien. Lecteurs et lectures populaires à la belle Époque, Paris, Le Chemin vert, 1984 ; La Création des identités nationales. Europe, XVIIIe-XXe siècles, Le Seuil, 1999.
-
[5]
Dominique Kalifa, L’Encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque, Fayard, 1995. Le même thème, pour une période antérieure, avec un corpus plus étroitement littéraire et, bien sûr, dans une tout autre optique et avec des résultats très différents, avait fait l’objet d’une thèse littéraire : voir Christine Marcandier-Colard, Crimes de sang et scènes capitales. Essai sur l’esthétique romantique de la violence, PUF, 1998.
-
[6]
Patrick Cabanel, Le Tour de la nation par des enfants. Romans scolaires et espaces nationaux (xixe-xxe siècles), Belin, 2007.
-
[7]
Christophe Charle, Théâtres en capitales. Naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, Londres et Vienne, 1860-1914, Albin Michel, 2008.
-
[8]
La recherche littéraire apparemment la plus érudite et la plus monographique peut être par ailleurs un modèle de microhistoire. Le meilleur exemple en est la somme que Stéphane Vachon a récemment consacrée à tous les articles d’époque portant sur la mort de Balzac, et qui permet à la fois de nous immerger dans le milieu journalistico-littéraire de 1850 et de saisir sur le vif le processus culturel de classicisation d’un écrivain : Stéphane Vachon, 1850. Tombeau d’Honoré de Balzac, Montréal/Saint-Denis, XYZ éditeur/Presses universitaires de Vincennes, 2007.