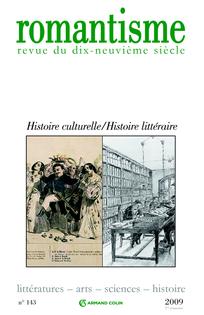AU PLUS PRÈS DE LA VIE ET DE LA CRÉATION
1 Max Milner, qui présida notre Société pendant près de trente ans (de 1972 à 1999) et siégea jusqu’au bout à son conseil d’administration, nous a quittés le 21 juin, au solstice de l’été. Dire notre gratitude à l’ami, à l’éminente figure de la critique littéraire et artistique contemporaine relève de la simple justice. L’hommage aurait à mesurer le chemin parcouru avec lui, les découvertes auxquelles il a éveillé comme critique et comme maître, attentif aux êtres et aux formes, à leur essentielle part d’ombre autant que de lumière. Mais comment épouser la manière de l’homme, en respecter la discrétion, la réserve personnelle, trouver le ton juste dont le souci ne l’a jamais quitté ? Sans doute, et ce sera ici mon ambition, en désignant la place qu’il a affectionnée et en m’y tenant à mon tour autant qu’il est possible – celle de l’interprète. Mettant l’accent sur le préfixe inter-, Max Milner définissait ce dernier comme celui qui fait communiquer les hommes entre eux, les textes entre eux, ce qu’il y a dans les textes avec ce qu’il y a à l’intérieur de nous-mêmes, et les textes avec le monde extérieur. Vaste programme que Max s’est d’autant mieux attaché à remplir qu’il excellait à tisser et à faire vivre un réseau de solidarités – démarche largement inhabituelle dans les codes universitaires et sociaux, dont l’horizon se borne souvent au succès individuel.
LE MAILLAGE DU MONDE
Tout est toujours à remailler du monde. Yves Bonnefoy, Ce qui fut sans lumière, 1987.
3 Patiente, la lecture de Max Milner est faite de sympathie et d’intelligence. Comprendre une œuvre, une époque, saisir ce que le créateur met en jeu consciemment ou inconsciemment dans sa création, est toujours le fruit d’une intense plongée. D’un congé aussi donné aux interprétations lénifiantes, aux vues superficielles. L’inquiétude qui s’exprime dans les formes, la maîtrise à laquelle prétend l’artiste, enivré parfois des artifices que lui offrent les sciences ou les techniques, ont à voir avec la crise qui nous habite, les leurres et les désirs auxquels nous expose notre condition mortelle. L’art est un révélateur, un sismographe.
4 L’interrogation, chez lui, prend du champ par rapport à l’urgence du présent. Mais loin de l’ignorer, elle en procède. Max Milner a vingt ans en 1943, et il vit à Paris la chape étouffante qui pèse sur la France occupée. Elle s’accroît des menaces qui pèsent sur la vie de son père, dont l’identité juive ne sera par bonheur jamais dénoncée. La Libération lève ces dangers. Mais le jeune adulte découvre alors, comme ses contemporains, l’étendue de la barbarie nazie, que le retour des survivants des camps d’extermination met sous les yeux de tous. L’enseignement de ses maîtres avait découvert à Max l’ouverture, les fissures que la littérature peut pratiquer dans l’accablement d’une vie fermée de tous côtés. Ses recherches, lorsqu’il se décide pour une thèse, participent d’une interrogation qui va au cœur des choses : porté par la philosophie existentialiste, il se penche, à travers la littérature, sur les abîmes de la conscience et l’origine du mal.
5 Le mouvement par lequel il choisit le XIXe siècle, et l’étudie pour sa thèse de Cazotte à Baudelaire, est révélateur. Sans remonter aux sources ultimes – mais y parvient-on jamais ? – Max élit une période charnière, à la recherche d’un tournant, d’une naissance. Le personnage du diable lui sert de guide dans la pleine complexité d’une période – avec ses courants religieux, chrétiens, autant que païens et illuministes, ses antagonismes politiques et sociaux, que cristallise la Révolution française, son entrée enfin dans la modernité esthétique que représente, à sa pointe extrême, le romantisme de Hugo, de Nerval et de Baudelaire. L’esthétique quitte sa sphère réservée pour travailler en pleine pâte historique et idéologique. L’interprète, qui bouscule les coupures tranchées (entre Lumières et Romantisme, littérature nationale et littératures étrangères) propose un maillage plus fin, accueillant aux tours et détours du réel, à ses paradoxes et renversements. Averti de la grammaire des formes, il établit une grille sur laquelle les phénomènes apparaissent sous un jour mêlé d’ombres.
Les Fleurs du Mal. Une vision du monde qui se défait, mais aussi un monde qui commence : celui qui restitue au Mal sa valeur de scandale, qui installe au centre de l’expérience humaine l’angoisse et le sentiment de l’irrémédiable, qui se refuse même à guérir par de douces paroles ou des constructions de l’esprit la blessure de l’existence. Ce monde c’est le nôtre.
7 Les lignes citées, extraites de la dernière page du Diable dans la littérature française, ouvrage récemment réédité chez José Corti qui l’avait publié en 1960, en disent beaucoup sur la fermeté de la méthode et sa portée actuelle. On se gardera certes de la rapporter toute entière aux perspectives du premier ouvrage. Les éléments fondamentaux y sont cependant déposés en germe : une pleine attention aux césures de l’histoire, autant qu’aux solidarités sans lesquelles la recherche manque son objet, égarée par des logiques trop restreintes ou des préoccupations qui lui sont étrangères. Car, paradoxalement, ce jeu de solidarités que Max Milner débusque et met en lumière s’accompagne d’une pesée toujours plus juste et plus précise du phénomène littéraire. Déjouant les pièges et les schémas anciens, il libère le regard des entraves qui le tenaient en tutelle, et, sur les pas de Baudelaire, restaure la littérature dans ses droits.
8 L’interrogation porte à terme sur la liberté et la responsabilité de l’homme. Elle s’avance d’autant plus loin qu’elle donne congé à toutes les réductions, fussent-elles religieuses, se détourne d’un regard soi-disant claudélien qui juge du degré de foi des écrivains, vainement soucieux de les déclarer ou non catholiques malgré eux. Averti de longue date des choses de l’art, Max s’en tient à celles-ci. Il chemine librement aux côtés de tous ceux qui, de Gaston Bachelard, à la génération précédente, à Jean Starobinski et Jean-Pierre Richard comme aux exégètes contemporains plus portés encore par la psychanalyse freudienne, sont à la recherche d’un déchiffrement plus fin de l’imaginaire. Max est assurément solidaire de la vague qui monte autour de la revue Poétique et, sur un autre terrain, de Michel Foucault par exemple. Mais lors même qu’il s’aide de tous les instruments aptes à lire l’imaginaire, sa critique, baudelairienne en son essence, se dépasse toujours vers un horizon moral – celui d’une communauté humaine, d’un vivre ensemble. Au point que ce n’est pas un hasard si L’Envers du visible, essai sur l’ombre (Le Seuil, 2005), en vient à se ranger sous une épigraphe de Paul Celan : « Il parle vrai qui parle l’ombre. »
9 Balayer l’œuvre de Max Milner, c’est assister à un approfondissement du champ d’investigation, de l’optique fantastique (la Fantasmagorie, puf, 1979) au thème du regard interdit (On est prié de fermer les yeux, Gallimard, coll. « Connaissance de l’inconscient », 1990), à L’Imaginaire des drogues (Gallimard, 2000), à au déchiffrement de l’ombre (L’Envers du visible) et à la représentation picturale de ce qui échappe au regard (Rembrandt à Emmaüs, José Corti, 2006). L’interprète, qui s’est formé à l’étude du XIXe siècle et y revient avec prédilection, en use comme d’un tremplin. Ses explorations le débordent largement, de l’Antiquité en amont, à l’expression la plus contemporaine (littéraire, picturale ou cinématographique), comme pour lui garder son rôle de pivot. La liberté acquise ne se retourne jamais en limite. C’est d’un élan inentamé que Max sonde Bernanos (en sa fermeté comme en ses racines et ses contradictions), Blanchot et Henri Michaux, pour ne rien dire du cinéma auquel il voue une constante passion – jusqu’à animer pendant de longues années un cinéclub à Dijon, avec son ami Pierre Demoor.
10 Les pays étrangers ne se trompent pas sur la portée de cette pensée. Max publie en Angleterre et aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Japon, tous pays dans lesquels il est traduit. Tandis que le prix Renaudot couronne L’Imaginaire des drogues, l’Italie l’élit en 2003 à l’Académie romaine dei lincei. L’accueil réservé à travers l’Europe et le monde n’entame à aucun moment l’énergie que Max investit dans la recherche collective, et dans la recherche dix-neuviémiste en particulier. Il donne des nombreux articles à la revue Romantisme, en dirige plus d’un numéro spécial. Mais surtout, il ne néglige pas la face plus modeste, sinon plus ingrate du travail, sans laquelle une revue manque à sa mission. Il rédige avec une régularité indéfectible les comptes rendus de lecture qui, de livraison en livraison, gardent à la revue son ouverture internationale et pluridisciplinaire, son statut exigeant de laboratoire de la recherche, son ambition d’embrasser la vaste coupe chronologique qui va de la Révolution française à la Grande Guerre.
LA DÉCOUVERTE DE LA BEAUTÉ
… tu pincel, dos veces peregrino/
… ton pinceau étrange et étranger.
Góngora, « le poète à un excellent peintre étranger qui faisait son portrait », dans Vingt Sonnets, trad. Zdislas Milner, 1928.
12 D’où viennent à Max Milner cette capacité d’éveilleur, cette réactivité ? Il s’en est lui-même une fois expliqué, dans la série d’entretiens qu’il a accordés à France Culture au lendemain des deux volumes d’hommage qui lui avaient été offerts pour son soixante-cinquième anniversaire (Du visible à l’invisible. Pour Max Milner, José Corti, 1988). Les émissions ont été diffusées du 3 au 7 janvier 1990, dans la série « À voix nue ». La confiance de ses amis avait sans doute joué. Ils étaient près de cinquante à avoir écrit pour lui, poètes comme Yves Bonnefoy et Jacques Roubaud, critiques autour de Jean Starobinski et de Marc Eigeldinger, de Jacques Seebacher, de Claude Duchet et Claude Pichois, mais aussi historiens, philosophes, psychanalystes, sans oublier le peintre Paul Kallos qui avait donné un cahier de dessins au trait. Porté par l’amitié, Max y dévoile, fait exceptionnel, maints aspects de sa vie et de son enfance en particulier.
13 La complexité du monde, ces entretiens lui en faisaient prendre conscience, n’était pas faite pour l’effrayer. Il baignait depuis l’enfance dans un univers pluriel. Il tenait à la Pologne, par son père, né à Varsovie. Mais, solidairement, à l’Espagne aussi, dont sa mère était originaire et où elle s’était mariée à Madrid avec un émigré polonais, rompu au français et à l’espagnol. Après deux ans en Espagne, le couple s’était installé en France, en Normandie, où Zdislas Milner avait trouvé un emploi de professeur dans un collège privé. L’univers linguistique de l’enfant était donc bariolé : il maîtrisait parfaitement l’espagnol et le français, les deux langues parlées en famille, tandis que ses oreilles étaient accoutumées aux sonorités du polonais, langue incomprise des siens et dont le père n’usait qu’aux seuls jours où se présentaient des visites ou des parents polonais. Ce maillage linguistique complexe se doublait sur le versant social, puisque le collège où enseignait son père devait à sa pédagogie d’avant-garde d’attirer un public d’élèves souvent venus de loin, et notamment de familles étrangères nobles ou aisées. La campagne normande abritait des fréquentations internationales.
14 Cette perception plurielle du sensible accompagne chez l’enfant une éducation à la beauté. La fréquentation de l’atelier de son oncle, le peintre Louis Marcoussis (dont on n’oubliera pas la naissance à Varsovie, en 1883), appartient aux souvenirs les plus vivants que l’adulte a conservés. Le goût pour l’image se fixe ainsi très tôt chez Max Milner. Notre ami lui gardera toujours une préférence. Il déclare même, dans les entretiens de 1990, que plus que la musique et la poésie, qui sont déjà installées dans une certaine étrangeté, l’image est pour lui une incitation à franchir la surface. Elle invite au passage. La préférence de l’enfant va à la couleur plutôt qu’aux formes, dont Marcoussis, élève de Braque et ami de Picasso, est pourtant un virtuose. Cependant la poésie n’est pas loin. On se souvient que c’est d’Apollinaire que Marcoussis reçut la suggestion de son nom d’artiste. Plus directement, Zdislas Milner, traducteur de Góngora, dans une version que Picasso allait illustrer, initie son fils au maître cordouan et à Mallarmé. Là où d’autres vont à Lamartine ou Musset, Max commence par la forme stricte du sonnet et l’école de l’obscur.
15 L’œuvre de Max parle d’elle-même. Qui en guette le secret le trouve accessible en plus d’une occasion. Dans l’hommage, par exemple, rendu à l’ami dans le volume Starobinski en mouvement (Champ Vallon, 2001). Le regard du Genevois, écrit Max Milner, a délivré « d’une obsession funeste » plus d’un critique, professeur et écrivain et les a « autorisés à partir à la découverte de la beauté ». Au miroir de l’admiration et de l’amour des lettres, c’est un double de lui-même que Max Milner rencontre. La réserve, la pudeur le retiennent d’en dire plus.
16 La beauté qui sollicite Max est celle que la langue espagnole confie à l’adjectif « peregrino », qui connote à la fois l’excellence et l’étranger. Le peintre que célèbre Góngora, dans un sonnet dont la traduction française hante l’esprit de Max, a travaillé « d’un pinceau étrange et étranger ». Il entre dans la beauté, telle que l’entend Max Milner et avec laquelle il dit avoir eu contact par imprégnation, un élément de surprise, une faculté naturelle à déplacer les lignes. À son école, Max ne cesse de forer plus profond.
17 Une déclaration au milieu du cercle de ses amis, en Sorbonne, en témoigne avec chaleur et humour. Ils étaient réunis, voici vingt ans, pour lui remettre les deux volumes qu’ils avaient préparés pour lui sous un titre, espéraient-ils – car leur effort avait tendu vers ce but –, qui correspondait au mieux à ses recherches d’alors. Ils entendaient l’accompagner à leur manière dans la rédaction du livre qui paraîtrait bientôt chez Gallimard, On est prié de fermer les yeux. Et voici, que tenant dans les mains l’ouvrage qui lui était offert, Max, plein de reconnaissance, déclarait de cette voix chaleureuse et modeste que plus d’un conserve dans l’oreille, et que les auditeurs de France Culture ont encore entendue en septembre dernier, qu’au fond, si passionné soit-il par l’invisible, sa vraie passion allait au visible. Au chemin qui conduisait du visible à l’invisible, il préférait sans doute le trajet inverse. Il n’allait pas cesser d’interroger la face d’obscurité qui, au sein du visible, creuse la présence.
UNE PRÉSENCE
18 Max Milner a par deux fois au moins défini le don que nous font les grandes œuvres : une présence, disait-il. Il le déclarait au colloque Bernanos qu’il avait organisé à Cerisy en 1969 (et dont les Actes ont été publiés chez Plon, en 1972) et, plus récemment, dans l’in memoriam à l’intention de son ami Claude Pichois (Année Baudelaire, 2005-2006). S’agissant d’un homme qui à aucun moment de sa longue vie n’a cessé de regarder vers l’avenir, de cheminer sur la route d’un vivre ensemble sur lequel s’interroge encore le dernier livre qu’il ait achevé, Rembrandt à Emmaüs, il n’est pas de mot plus pertinent. Généreux, Max n’était pas un homme à thésauriser, à retenir. Il demeure comme un guide, une présence, sur un chemin à poursuivre.