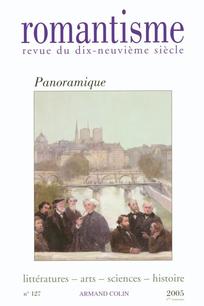1On sait que Laharpe et Constant ont les premiers parmi les modernes montré l’efficacité du langage dans l’effort des gouvernements despotiques pour domestiquer la pensée. Constant dans son Des réactions politiques de 1797 dénonce des journaux qui, toutes tendances confondues, « aveuglent » et «asservissent», «corrompent» et «dégradent» la France, en répandant à l’envi le faux, l’injuste et la calomnie [1]. La même année le traité de Laharpe intitulé Du Fanatisme dans la langue révolutionnaire montre que les mots peuvent occulter les réalités et façonner l’opinion. Il faut croire qu’il a été bien lu, puisque c’est presque un lieu commun chez les penseurs de la première moitié du xixe siècle que la captation des consciences dans la sphère politique par le jeu d’un lexique approprié. Ainsi dans La Peau de chagrin un invité du banquet Taillefer constate que le gouvernement «a senti la nécessité de mystifier le bon peuple de France avec des mots nouveaux et de vieilles idées» [2], tandis que dans Le Député d’Arcis le candidat Simon aguiche les électeurs par une séduisante invocation au «progrès» [3]. Dans le cadre de la pensée antimoderne, de telles approximations langagières sont graves: le langage, don de Dieu, est expression pure, directe, de la pensée. Il est cette pensée même, extériorisée, et non son signe. «Le genre humain à son origine a reçu d’un être supérieur à l’homme la parole, par le moyen de laquelle il connaît ses propres pensées», écrit Bonald [4]. La «corruption du langage dans la révolution», dénoncée en chœur par les contre-révolutionnaires, est un «monstrueux solécisme généralisé qui affecte la faculté d’idéer», analyse Gérard Gengembre, qui ajoute: «La Révolution fut donc aussi – surtout? – un événement linguistique.» [5] Altérer des notions reçues de Dieu et confortées par la tradition, c’est aussi ce que Joseph de Maistre avait reproché peu avant aux révolutionnaires: le contentieux linguistique entre royalistes et partisans des doctrines nouvelles est déjà présent en 1797 dans les Considérations, où est dénoncée la rupture entre le langage révolutionnaire et l’ordre naturel des choses, survenue lorsque les Conventionnels rebaptisent les jours, les mois et les hommes pour créer le calendrier républicain et imposer le titre de « citoyen». «Prostitution impudente du raisonnement, et de tous les mots faits pour exprimer des idées de justice et de vertu» [6], note Maistre qui comprend la portée pratique de cette instauration: briser l’ordre divin du langage, c’est briser l’ordre divin du monde, car la nouvelle langue n’est pas seulement ridicule, elle est aussi l’émanation du désir antisocial et antireligieux. Par cet acte inaugural, la République met en œuvre un athéisme actif: «Le calendrier de la république […] fut une conjuration contre le culte.» Refaire une langue, c’est donc transformer le monde. À cette tâche s’attellent à leur tour les polémistes ultras de la Restauration.
2Leurs journaux dénoncent l’écart entre le discours libéral et les réalités, remarquant en quelque sorte que le langage de leurs adversaires est constitué à des fins de propagande et employé souvent de manière idéologique. Il faut entendre par là que la polémique libérale sert des intérêts tout en se donnant l’illusion de la rationalité. C’est ce que le présent article vise à établir, en s’appuyant sur l’étude de deux semi-périodiques ultraroyalistes: le Conservateur, qui paraît d’octobre 1818 à mars 1820 et est fortement marqué par l’autorité morale de Chateaubriand [7], ensuite le Défenseur qui, plus inspiré par Bonald et Lamennais, lui succède jusqu’en octobre 1821. Les auteurs réunis autour de Chateaubriand dénoncent la politique inspirée par Decazes en qui ils voient, à juste titre, l’homme de l’ouverture à gauche [8]. Souvent nostalgiques de l’Ancien Régime, ils prolongent en fait la tradition du libéralisme aristocratique, volontiers frondeur, en prônant la restauration de l’indépendance et de l’influence du clergé, le développement des corps intermédiaires – famille, corporations professionnelles et communes –, enfin une interprétation quasi parlementaire (et très opportuniste) de la Charte [9]. Plus absolutiste, plus ultramontain, le Défenseur, dont l’existence coïncide avec le ministère Richelieu (20 février 1820-décembre 1821), se voue davantage aux intérêts catholiques: Bonald ne partage pas l’attachement de Chateaubriand à la liberté de la presse et au système parlementaire, et si Lamennais compte à cette époque parmi les ultras, c’est qu’il croit encore la monarchie capable de réaliser la royauté temporelle du Christ. Leur ennemi commun, c’est le parti libéral, constitué des «indépendants», ensemble hétéroclite partagé entre les nostalgiques de la Convention ou de l’Empire et les véritables individualistes libéraux. S’exprimant notamment par la voix de la Minerve, le journal de Benjamin Constant, il se structure et progresse aux élections partielles à la Chambre jusqu’à obtenir une minorité de contrôle en octobre 1818 et un plus grand succès encore en septembre 1819. Soutenant conditionnellement Decazes, il veut imposer une lecture de la Charte compatible avec les «acquis» de la Révolution: liberté de la presse, suffrage censitaire et rejet vigoureux du privilège nobiliaire, primauté de la Chambre sur les ministres.
Dans ce contexte le Conservateur et le Défenseur témoignent d’une conscience claire de la différence entre idéologie et propagande: en 1793, on se serait borné à la propagande, entreprise brutale d’information et de désinformation qui n’implique pas les confusions ni la dissimulation de l’idéologie. Celle-ci est au contraire présente lorsque, selon les ultras, la langue libérale laisse voir la perversion de ceux qui la pratiquent ainsi que la sophistication de leur conscience et de leurs valeurs [10]. Ces journaux nous font donc remonter, au-delà de l’idée d’une imposture lexicale, jusqu’au brouillage présumé des intelligences ou anarchie des idées. Le langage corrompu des libéraux est moins une arme destinée à la domination des consciences qu’un effet, un symptôme morbide, puisant son origine dans une alchimie complexe: intensification du désir, destruction de la conscience morale, dérèglement du jugement. Remontant encore d’un degré jusqu’à la racine de cette «perversion», on trouverait l’ambition exacerbée par la nouvelle société: à la réflexion linguistique et à la métaphysique du mensonge, l’ultra joint une sociologie de celui-ci en montrant que c’est la situation historique des libéraux qui les induit en erreur, tandis que, comme pris dans un cercle vicieux, ils puisent en retour dans ce langage perverti un poison toujours nouveau, achevant, de s’écarter de la raison et de démoraliser la nation…
Une langue sans référent: les mensonges factuels des libéraux
3Un des principaux thèmes de la polémique engagée par les ultras, c’est que le vocabulaire libéral est employé de manière quasiment indépendante de la réalité, qui ne lui sert plus de référent. Il transmet des représentations erronées sur le passé, l’actualité ou les objectifs politiques. Pour cela, des mots neufs ne sont pas toujours nécessaires. De vieilles notions comme celle de féodalité peuvent servir aux libéraux. Son éradication devient une bannière et une devise, rapporte d’Herbouville qui leur répond dans un article du Conservateur où, alternativement ironique et sérieux, il ridiculise leur mot d’ordre pour en désamorcer la puissance. Comme aucun gouvernement féodal n’est organisé par la Charte à laquelle il adhère, explique-t-il, il se sent aussi résolu que « le plus libéral des indépendants à combattre la féodalité» [11]. Or celle-ci, malgré ses efforts, il n’a pu la trouver nulle part. Déjà détruite en 1788, elle ne peut être l’enjeu du combat politique mené depuis lors. Quand les libéraux s’érigent en héros de la lutte contre la féodalité, ils commettent donc une absurde erreur historique. Sont-ils de bonne foi dans leur confusion entre Ancien Régime et régime féodal ? D’Herbouville semble le penser, peut-être pour mieux ironiser sur l’ignorance de ses adversaires [12]. En revanche, lorsqu’ils répandent le soupçon que le projet ultraroyaliste est de rétablir le système féodal, leur hypocrisie est manifeste: l’accusation n’a fait qu’inventer un conte à « faire peur aux petits enfants», d’abord parce qu’une telle restauration est impossible, ensuite parce que chaque ancien possesseur de fief est présenté comme un émule de Barbe-Bleue en personne [13]. D’Herbouville en a assez dit pour laisser son lecteur juger les ennemis de son parti: le mépris qu’ils ont de leur public le dispute à l’absurdité de leurs propos, qui constituent un abus de confiance évident [14].
4Le mot de progrès peut lui aussi servir de bannière aux libéraux. Mais l’argument selon lequel il y a eu progrès grâce à la Révolution est rejeté comme parfaitement vain par les publicistes du Défenseur, qui montrent que la rupture entre l’Ancien Régime et la société révolutionnée est illusoire. Par exemple les corporations ont été supprimées, puis rétablies sous les noms de syndicats ou de compagnies d’assurance mutuelles [15].
5Les libéraux nieraient tout aussi grossièrement dans leurs discours les réalités présentes, même lorsqu’ils en sont les inspirateurs. Au vote de la loi Gouvion Saint Cyr de 1817 sur le recrutement militaire, on s’étonnera que «le parti qui parlait si haut de liberté et d’égalité» instaure le recrutement forcé (tout en maintenant la fiction du recrutement volontaire) [16] : manière de tolérer la contradiction coutumière aux adversaires du royalisme, déclare Lamennais rappelant cette époque de la Révolution où «on écrivit sur les murs liberté, égalité, et jamais aucune nation ne subit le plus abject esclavage et une plus affreuse oppression» [17]. Jamais non plus les droits de l’homme n’ont été davantage méconnus que depuis qu’ils sont proclamés, écrit-il ailleurs [18], et la contradiction n’est pas moindre lorsque, selon La Rochefoucauld, les libéraux exigent de leurs adversaires une politique de «modération», eux qui se sont rendus sous la Révolution coupables de tous les excès [19].
6L’énormité des «mensonges» factuels des libéraux témoigne d’une rupture complète avec le réel. Les partisans de la doctrine de la souveraineté du peuple, déclare le comte de Saint Roman, «s’adjoignent aux sophistes qui, depuis cinquante ans, ont vécu dans une telle habitude de l’erreur, que la vérité réside essentiellement dans les propositions contraires à celles qu’ils ont soutenues» [20]. Et d’accumuler les exemples de ces inversions: «C’est par le renversement total qu’ils se sont efforcés d’opérer dans toutes les idées et dans toutes les expressions; c’est par ce renversement inouï dans l’histoire, que les cultivateurs vendéens ont reçu le nom de brigands, et les émigrés celui de rebelles; c’est par lui que ces perturbateurs insensés ont transformé les peuples en souverains, et les usurpateurs en princes légitimes; et c’est enfin par l’excès de l’impiété où pouvait les conduire cet exécrable esprit de subversion, qu’ils n’ont plus désigné le saint Roi Louis XVI que sous la dénomination de tyran.» [21] Le mensonge est si gros, semble dire Saint Roman, le mal tellement euphémisé et la vertu à tel point niée que le discours perd ses référents extérieurs.
Magicien du verbe, le libéral s’entoure de simulacres, et cet univers fictif lui compose une justification à mesure qu’il dessine une société illusoire et un adversaire fantastique. Le libéral est un nominaliste qui s’ignore: il façonne une langue à sa convenance, sans tenir compte des essences. Lui répondre, ce sera rendre leur vrai nom aux choses, refonder la langue, radicalement, à partir de l’idée bonaldienne d’un langage hérité de Dieu, d’une institution divine du langage.
La falsification des concepts philosophiques
7La presse ultra relève à côté de ces contre-vérités et contradictions des abus commis par les libéraux dans l’emploi du langage philosophique. Les exemples qu’ils relèvent veulent prouver, en fin de compte, l’inanité de l’acception issue des Lumières pour ces mots et plaident pour un transfert de sens au bénéfice d’une nouvelle définition, ultra et chrétienne: au-delà des thèmes de la propagande libérale, c’est donc la philosophie du xviiie siècle qui est visée et accusée de n’être qu’une sophistique.
8C’est ainsi que l’emploi libéral du mot «égalité» est fréquemment dénoncé. Ainsi dans cet article vigoureux de Saint-Prosper: «Égalité: mensonge fait par ambition à la crédulité des peuples; écrite au premier article du code révolutionnaire, elle est démentie par tous leurs actes.» [22] Cette définition, paradoxalement pas très éloignée du Second Discours de Rousseau, qui lit la première instauration de la propriété comme un abus de confiance, donne le ton de la critique ultra. La Rochefoucauld voit dans les notions de liberté et d’égalité le masque dissimulant le désir et les ambitions personnelles des «ultra-libéraux» [23]. D’autres encore repèrent que l’appel à l’égalité relève de la mauvaise foi chez les bourgeois libéraux qui la prêchent. La preuve, c’est qu’ils refusent à leurs domestiques cette égalité qu’ils réclament si fort pour eux-mêmes. L’égalité du siècle, ironise Rohrbacher dans un long article consacré à cette question, «consiste à être l’égal de ses supérieurs, et le supérieur de ses égaux» [24]. Le mot d’égalité dans le discours libéral ne serait qu’un outil au service du conservatisme social et de l’ambition personnelle. Ce n’est pas un vrai concept révolutionnaire mais un prétexte à contestation perpétuelle. Il est donc manifeste que le discours libéral ne tire pas sa séduction d’une quelconque solidité conceptuelle mais des connotations de son vocabulaire plus poétique que référentiel. Sa force d’attraction n’annonce pas un authentique pouvoir spirituel, et montre moins la puissance du vrai que celle des idéologies.
9Pour les ultras, le vocabulaire libéral serait bien plus à sa place sous leur plume, et on devrait se fier un peu plus à la bonne foi des royalistes, qui, conclut d’Herbouville, «ne cherchent à torturer ni les paroles ni les actions», mais «prennent les unes dans leur acception propre, et jugent les autres par ce qu’elles ont d’apparent» [25]. Il leur arrive de revendiquer la paternité de ces idées que le libéral agite et de disputer avec eux de la propriété des mots – propriété au double sens de droit de possession et d’adéquation du mot au concept vrai. Cet effort pour réinvestir le vocabulaire adverse est sensible à propos des principaux termes du débat politique. Quand leurs adversaires déclament en faveur de l’égalité, les ultras répondent que les hommes ne sont égaux que devant Dieu [26]. Seul le catholique peut donc approcher la vraie égalité, tant conceptuellement que par ses vertus, de sorte qu’il est le seul vrai libéral. «Qu’y a-t-il au monde de plus libéral que la religion?», se demande un rédacteur anonyme du Conservateur [27], développant l’idée que le christianisme est le seul libéralisme, parce qu’il est seul à commander les vertus qui, tout en élevant l’âme, rendent la société plus douce pour les humbles. C’est surtout Frénilly qui se veut le champion de la reconquête du vocabulaire ennemi. Lui aussi allègue que le vrai libéralisme est chrétien: «Cherchez les [les idées libérales] dans les dogmes de la foi chrétienne, s’écrie-t-il, c’est elle qui […] élèvera les petits dans votre esprit, et vous rendra leur égal sans sophisme.» [28] Il s’autorise ainsi à dénoncer le «vol» du nom de libéralisme par les libéraux, et appelle plus loin l’étymologie à son secours pour prouver que les idées libérales, puisqu’elles sont à prendre au sens où l’on parle d’arts libéraux, «doivent élever l’esprit, émanciper l’âme et l’affranchir de la glèbe, pour lui donner un effort plus sublime» – ce qui est précisément le sens du christianisme. Un second article de Rohrbacher réaffirmera que la vraie liberté est chrétienne, quelque usage que les libéraux fassent de cette notion [29], ailleurs encore un rédacteur anonyme du Défenseur soutient que le mot même de «philosophe» est employé à tort par ses adversaires: c’est Bossuet qui est au sens propre un philosophe, puisqu’il a enseigné les vertus… [30]!
Se réapproprier le langage de l’adversaire conduit quelquefois les ultras à assumer ses valeurs, ou celles qu’il défendit autrefois, comme lorsque les royalistes reprennent quasiment à leur compte l’idéal républicain du citoyen vertueux en dénonçant l’inaptitude à la liberté de la nation nouvelle, formée à l’école de sophistes qui l’ont rendue insolente, mais lâche, efféminée et cupide [31].
L’impuissance de la langue libérale à définir une société vraie
10Ignorant des essences, inadéquat à l’idée vraie des choses, le lexique libéral est inapte à engendrer un univers stable, à fonder un monde. Le libéral se veut l’inventeur d’institutions authentiques: illusion, pour l’ultra ! Le monarque constitutionnel est aussi dérisoirement roi que le Roi des juifs pour ses bourreaux [32], les ennemis du peuple se disent absurdement «patriotes» [33]: la société révolutionnée, copie très imparfaite de la société ancienne, est en quelque sorte privée d’être, puisqu’on n’y trouve ni vrai monarque, ni vraie noblesse pour le soutenir, ni véritable propriété capable de secourir les pauvres, ni vrais époux, ni vrais royalistes, ni vraie liberté, ni vrais prisonniers, ni même un individualisme conséquent… [34]. La féconde modernité de la critique ultra est dans cette dénonciation, tocquevillienne avant la lettre, de la vanité de la société moderne : ni corps, ni organisme mais somme d’individus, elle n’est pas une réalité propre. Ainsi Frénilly condamne l’État libéral «ne voyant dans un corps qui soutient [à savoir dans les corporations], qu’un corps qui résiste» [35], c’est-à-dire prenant pour autant d’adversaires tous les corps intermédiaires sur lesquels il devrait pouvoir s’appuyer, et remarque qu’à cause de l’éparpillement de la propriété, alors que les propriétaires d’autrefois «protégeaient le peuple en adoucissant le pouvoir», ceux d’aujourd’hui, «isolés, vains et nécessiteux», sont «occupés de leur propre misère, impuissants pour celle d’autrui» [36]. En raison de ces imperfections, la monarchie fait figure de «fantôme», note toujours Frénilly [37], la société dissoute ne conserve plus que l’apparence d’une totalité organique et vivante, par une illusion provisoire qu’entretient le vocabulaire libéral et qu’il décrit ainsi: «Quand le vice aura atteint sa perfection, l’État aura atteint son terme. Il sera debout, mais dissous et semblable à ces débris intacts qu’on trouve dans les cercueils d’Herculanum: au moment où on les touche, ils s’évanouissent et ne laissent que leur cendre. […] Ici le sol reste, il est vrai; les hommes mêmes subsistent, mais la nation cesse d’être: l’âme qui l’anima pendant des siècles s’exhale, et ne laisse sur la terre que la dépouille d’un peuple mort.» [38] Moment de décadence pendant lequel les appellations mensongères servent à entretenir l’illusion de l’être et de la vie dans une société-simulacre, société-cadavre, société inversée, où la haine se substitue à l’amour et l’intérêt au devoir.
11Peut-être parce qu’il est conscient de la fragilité conceptuelle de son idéal, le libéral brandit la vertu de modération comme un impératif, oubliant ainsi la nécessité de se référer à une doctrine cohérente. Les ultras pour leur part sont parfaitement conscients de cette manœuvre, voyant bien que le débat autour de l’emploi du qualificatif de «modéré» est celui de la place de la théorie et de la cohérence doctrinale dans la vie politique. Coriolis, dans le Conservateur, déplore en effet que l’«on rejette comme excessif ce qui n’est que vrai» [39]. Le prétexte de modération conduit à l’indifférence pour les coupables de la Révolution, quand l’indulgence du pardon vaudrait mieux. En voulant éviter une rigueur excessive envers les révolutionnaires, on fait injure aux royalistes fidèles, par l’«abus d’une modération mal comprise qui tombe dans le vice en fuyant la faute» [40]. On en arrive à promouvoir l’idée absurde d’un pardon de l’offenseur envers l’offensé. La politique d’oubli et d’union prônée par le gouvernement choque Bonald parce qu’on ne peut disposer de sa mémoire à son gré ni s’unir à des coupables notoires et non repentants: «Il y a une vérité au fond de toutes les choses, contre laquelle tout ce que peuvent faire même les gouvernements est nul de soi, et impuissant», rappelle-t-il [41], faisant écho à Frénilly, pour lequel «l’oubli chrétien est le seul vrai: c’est le pardon des injures…» [42].
Aussi la modération, le sacrifice de la doctrine à la prudence, sont-ils l’argument des libéraux, peu désireux de se repentir – et ravis de mettre Louis XVIII en contradiction avec la politique d’oubli promise par la Charte. En réaction à ceux-ci et à Decazes, intrigant et opportuniste par défaut de système, l’ultra se définit au contraire comme partisan d’une ligne stricte. Pour lui, la politique n’est jamais loin de la théologie, seule science apte à définir le vrai sens des mots. Faute d’y avoir recours, on s’expose par un flou linguistique et conceptuel à des conséquences inquiétantes: sans conception vraie de l’oubli, il n’y a ni réconciliation ni paix sociale. Le clivage qui les sépare n’est pas tant frontière entre deux lignes d’action qu’entre deux manières de comprendre l’articulation de la politique et la métaphysique. La pensée contre-révolutionnaire, connue pour l’empirisme qu’elle a voulu opposer à l’universalisme révolutionnaire, se revendique désormais de cet absolutisme de la pensée contre la flexibilité libérale. La contamination des ultras par une certaine abstraction qu’on pourrait faire remonter aux Lumières s’achève ainsi, et inversement les héritiers des Lumières paraissent gagnés par ce pragmatisme qu’on leur a souvent refusé.
Aux sources de l’illusion: la sophistique libérale joue sur la magie des mots.
12Par la séduction de leur langage, les libéraux ont fait accepter ces dérobades, ils ont métamorphosé le polémiste en illusionniste, transformé la parole politique en parole magique et l’art politique en art poétique. Inquiéter, troubler, rassurer, ensorceler, séduire, en un mot substituer les passions à une raison pourtant sans cesse invoquée, en empêcher l’exercice en brouillant les possibilités d’analyse et en saturant la conscience d’émotions, tels sont, comme nous allons le voir, quelques-uns des objectifs de cette parole.
13Si son utilisation est couronnée de succès, c’est que tous se laissent irrésistiblement abuser par le langage et ne jugent que par les mots. Coriolis le déplore: «Suivons l’abus des mots. Les esprits légers sont presque toujours dupes, et les solides n’y échappent pas toujours.» [43] De Raineville constate que dans le parti adverse les dénominations ont davantage de poids que les réalités, étant prévues pour contrôler les émotions, en jouant sur ce qu’on n’appelait pas encore les connotations: «Un des traits les plus saillants du caractère révolutionnaire, c’est la faculté d’éprouver à la fois une horreur extrême pour une institution et un amour extravagant pour telle autre qui n’est que la même chose déguisée par le nom, qui, souvent tiré d’une langue étrangère, présente la même idée.» [44] Le polémiste libéral renonce à la réflexion rationnelle pour jouer seulement sur les passions, abusant de cette crédulité «éclairée» que les ultras dénoncent avant Flaubert et son M. Homais, qui pourrait pour ses ennemis figurer le citoyen-type du monde nouveau.
14Le libéralisme aurait donc constitué une langue de bois, dans laquelle des mots flatteurs rebaptisant des réalités scandaleuses empêchent de les penser pour ce qu’elles sont et de réagir en conséquence. En langage ultra, cela s’exprime à travers les notions de magie et de camouflage: le vocabulaire libéral évoque dans l’esprit une réalité pour une autre (la liberté à la place de l’anarchie), ou en d’autres termes tend un voile entre les observateurs et les réalités. Les vocables au pouvoir magique sont parfois ceux des ultras eux-mêmes, retournés à leur profit par les libéraux ou leurs soutiens: Decazes lui-même, «l’imprudent ministre dont la puissance a pour talisman le nom du Roi», serait passé maître dans l’art de se revendiquer du roi, ce «nom sacré», «nom magique», qui le met à l’abri de tout reproche [45]. Cependant, c’est surtout le vocabulaire philosophique et celui de la Révolution qui ont valeur incantatoire: leur force persuasive est encore extraordinaire vers 1818-1821. D’Herbouville constate ainsi que la «souveraineté du peuple», cette « abstraction misérable», est un «mot magique» avec lequel on s’efforce de détruire les autres souverainetés [46]. «Le mot d’égalité est encore un de ces talismans avec lesquels on remue les masses», regrette-t-il ailleurs [47]. Jouffroy approuve Burke d’avoir dénoncé ces «formules d’enchantement: Philosophie, lumières, liberté, droits de l’homme», qui ont déjà servi naguère à dépouiller le clergé [48]. L’anarchie et la licence actuelles sont renommées égalité et liberté, et de cette manière, affirme le professeur Pardessus, sont camouflés par «l’adresse du sophisme ou l’abus du talent» ces principes pernicieux qui menacent la société [49]. Dans ce cas limite, la tromperie est complète et le terrorisme intellectuel achevé, puisqu’on ne doit même plus savoir ce que veut vraiment l’adversaire, sa langue ne servant pas seulement à dissimuler sous son éclat aveuglant des circonstances médiocres mais l’idéal et l’objectif mêmes du libéralisme.
Une autre imposture, assez longuement analysée par d’Herbouville, consiste à invoquer l’« esprit du siècle», expression qui protège comme un « talisman» tous ses utilisateurs. D’Herbouville ne veut y voir qu’un «voile imposteur» tendu sur les «passions honteuses» des libéraux [50]. Dans son esprit, son emploi relève d’un abus de langage, puisque l’expression ne saurait désigner concrètement et légitimement que la volonté générale; or la nation voulant majoritairement la paix et le repos, ce ne sont certainement pas les héritiers des révolutionnaires qui sont en droit de se revendiquer de l’esprit du siècle [51]. Mais l’utilisateur de cette notion est toujours gagnant: en se plaçant du côté de l’esprit du siècle, on se donne un air important, on se décharge de ses fautes sur les exigences du temps présent, on rejette l’adversaire dans l’infamie du passéisme et de l’ignorance. La vieille idée révolutionnaire de démocratie revêt ainsi des habits neufs, qui cachent ses souillures tout en la parant d’une aura de modernité et d’universalité… Elle se trouve armée à la fois d’une épée et d’un bouclier : parler d’esprit du siècle, ce n’est pas seulement exclure du débat les souvenirs pénibles de la Révolution et la notion de volonté générale qui pourrait être gênante, c’est passer pour honnête et compétent, c’est se protéger en alléguant les nécessités; enfin, suprême bénéfice, c’est fustiger le principe même du conservatisme, car si la démocratie n’exclut pas une certaine fixité dans les principes, l’esprit du siècle court toujours après une plus grande adéquation au temps présent [52]…
Le discours libéral vise à contrôler la sensibilité et le sens moral du lecteur
15Qu’il use de la force des connotations ou de la falsification des faits, le libéral tendrait à faire surgir des émotions, manipulant les consciences et les conduites par le contrôle des sentiments. Nous avons vu à l’instant De Raineville l’affirmer : l’horreur ou l’amour ne tiennent parfois qu’à un mot. Tout est bon pour exciter les émotions et stimuler les passions, vont montrer les polémistes. «On trompe la pitié publique» avec des «victimes volontaires» qui se font jeter en prison, gratuitement ou contre argent [53]. On calomnie ses adversaires avant de les exterminer, pour disposer en sa faveur l’opinion publique et agir sans susciter de protestation: tout révolutionnaire est rompu à ces techniques, comprend Fitz-James en méditant les Considérations de Madame de Staël : «Toujours, note-t-il, on les a vus chercher à diffamer leurs adversaires avant de leurs porter les derniers coups; par ce moyen, au moment où la catastrophe arrive, ils parviennent à émousser la sensibilité des indifférents, peuple immense qui ne fait rien, mais qui laisse faire les révolutions.» [54] C’est par exemple en les tournant en dérision qu’on isolera ses ennemis. Castelbajac y est particulièrement sensible: «Deux moyens furent employés, dès le principe de la révolution, pour égarer la multitude: on ôta aux mots leur véritable sens, pour leur donner une acception qui fût propre aux idées qu’on voulait propager, et on fut soigneux d’appliquer aux hommes dont on redoutait les vertus, un sobriquet qui les désignât à l’opinion, sous le double cachet de la haine et du ridicule. Ces moyens, pour être vieux, n’en sont pas usés; on les renouvelle chaque jour, et ce n’est pas sans succès». Autrefois, donne-t-il en exemple, on raillait avec les mots d’aristocrate et de fanatique, maintenant c’est la fonction des sobriquets comme «hommes gothiques», «ultra-royalistes»; les mots «honneur», «ambition», sont infamants; maintenant la fidélité à ses idées et à Dieu n’est pas appelée par hasard «exagérée» et «gothique», le service constant des lois monarchiques ferait reconnaître l’«ambitieux», et la Vendée aurait été pour sa part un «foyer de troubles et de factions» [55]. Inversement, les tares des révolutionnaires sont niées: «la lâcheté est appelée modération, le crime est appelé un simple mal ». Le libéral se constitue donc un ennemi fictif pourvu d’abondants ridicules pour disqualifier ses ennemis réels, et prête aux siens des vertus imaginaires: les vices ont été rebaptisés avec des noms de vertus, et inversement. Ainsi est encore une fois rendu impossible le discernement rationnel, tandis que toutes les idées du juste et de l’injuste sont interverties, et les consciences brouillées, ce qui est, selon les rédacteurs ultras, l’ultime objectif de la sophistique libérale.
Bonald a bien compris qu’au-delà du contrôle du sentiment, c’est celui du sens moral qui est visé. C’est pour cela, assure-t-il en substance, que le libéral revisite l’histoire et requalifie les événements passés ou présents, présentant la guerre civile de la Révolution comme une guerre de libération nationale qui continuerait les luttes entre Francs et Gaulois. Erreur grossière, puisque la nation était parfaitement unifiée en 1789. Erreur dangereuse surtout, car en niant la communauté d’origine du peuple français on fomente la haine [56]. Erreur de mauvaise foi enfin, dont sont complices tous les bénéficiaires d’une Révolution qui a commis trop d’excès avant d’asseoir trop de scandales pour que les coupables n’aient pas envie de soulager leur conscience [57]. L’histoire libérale, pour Bonald, est l’œuvre de pseudo-historiens qui apaisent sans vergogne le remords des élites en leur masquant les origines honteuses de leur domination.
Le résultat: détérioration de l’esprit civique par la rhétorique libérale
16Le lecteur libéral est entretenu dans ses illusions, et le royaliste lui-même est atteint par ce langage qui sape son énergie et le réduit à l’inaction en jetant le trouble dans ses idées: l’usage adroit de la langue vise à le disqualifier auprès des libéraux, mais surtout ce langage retentit dans son for intérieur, l’asservit et le paralyse en lui faisant honte de ses actes. C’est à cela que va servir la campagne de propagande en faveur de la «modération». Le Conservateur et le Défenseur réagiront en opposant vraie et fausse modération. Pour ces journaux, en louant la «modération» ou la « sagesse» comprises comme «soumission à la nécessité», on vise à amollir et tromper la vraie vertu politique, qui est lucidité et courage, de sorte qu’elle perdra sa force, doutera de ses convictions et se fera complaisante [58]. Coriolis avait déjà déploré le même glissement : au lieu de la vraie modération, «vertu qui gouverne, qui retient, qui règle toutes les passions», on prône une «langueur mortelle», la «mollesse», la «lâcheté», l’«inertie» [59]. On égare donc d’abord les esprits pour dépraver ensuite les âmes, résume le professeur Pardessus [60], on asservit les intelligences pour réguler les conduites.
L’assassinat du duc de Berry par Louvel est l’occasion de dénoncer ces réactions en cascade: comme il n’a pas manifesté le remords de son crime, cet homme est érigé en symbole des perversions et des dangers où conduisent les doctrines antimonarchiques. Il illustre le passage des opinions perverses à l’erreur de l’intellect, de là à la perversité de la conscience, et de là aux crimes commis avec une «scélératesse méthodique» qu’aucun «délire de la fureur» ne vient excuser [61]. Dans le crime de Louvel se laisse donc sentir, pour la presse ultra, le glissement de l’anarchie des idées à l’anarchie réelle, de la corruption intérieure à la destruction sociale. Des «barbares policés» sont à nos portes, dira Bonald à cette époque; et ceux-ci, ce ne sont pas encore les canuts de Lyon, mais tous ces «ignorants ennemis de toute société divine et humaine» qui, l’«esprit faux, le cœur gâté», menacent l’Europe d’une nouvelle et dernière invasion appelée à détruire monarchie et religion [62]. Pas étonnant, pour Lamennais: «une race de sauvages» s’est constituée au milieu de la civilisation, occupée uniquement «des choses matérielles et d’intérêts du moment» au-delà desquels rien n’a d’existence à ses yeux [63]. C’est encore ce qu’annonce Chateaubriand dans son article sur la morale des devoirs et la morale des intérêts [64]. L’ingratitude du gouvernement envers les émigrés, déclare-t-il, brouille les idées sur le juste et l’injuste: le mal est récompensé, la vertu punie comme une bêtise, l’innocence sanctionnée comme si elle était coupable, on encourage les passions et désespère la vertu. «Par un tel système, conclut l’auteur, un horrible ravage est fait dans le cœur humain; c’est comme si vous donniez des leçons publiques de trahison, d’injustice et d’ingratitude». La détérioration simultanée des mentalités et du climat social sera dénoncée à nouveau dans la campagne de presse menée sur le thème de l’«inquiétude» publique [65], après que ce terme à la mode aura été repris par Louis XVIII dans le discours du trône de novembre 1819. Prenant cette notion au double sens de «défiance» et d’agitation, les ultras rétorquent que le pouvoir s’est rendu responsable de celle-ci en créant une crise de la confiance en l’avenir par la part trop belle qu’il fait aux «factieux» [66], et une crise des valeurs par l’anarchie intellectuelle qu’il entretient [67]: il soulèverait l’inquiétude en ranimant les menaces révolutionnaires par les incohérences ou le caractère prolibéral de sa politique ainsi qu’en encourageant l’indifférence religieuse, offrant de fait un appui puissant à la sophistique libérale: la politique de conciliation, l’irrésolution, la timidité du pouvoir sont cause de scepticisme et d’anarchie [68]. La tête de l’État, par l’exemple de la confusion des valeurs, détruit les énergies: tel gouvernement, tel peuple.
Aux sources de l’imposture libérale: une erreur de la raison?
17S’ils s’accordent sur l’agitation entretenue par un pouvoir déboussolé en quête d’un apaisement avec les « sophistes», les ultras hésitent sur les raisons qui inspirent ces sophismes. L’erreur libérale ne leur paraît que rarement d’ordre purement intellectuel, ils y voient plutôt l’empreinte des passions sur des esprits qui les acceptent avec plus ou moins de complaisance, dans un aveuglement quasi volontaire, confinant à la folie et encouragé par des raisons sociales ou culturelles. Tels le chevalier à la Triste-Figure, «ils créent dans leur imagination, écrit d’Herbouville, des fantômes pour les combattre, et sans doute, dans cette lutte, ils sont d’aussi bonne foi que le héros de la Manche» [69]: combattant dérisoire, faisant songer à la guerre des nains qui pour Chateaubriand a succédé à la gigantomachie révolutionnaire. Au-delà d’une façon plaisante de dévaloriser la politique du temps se profile l’accusation de légèreté, de naïveté: les libéraux ne savent pas de quoi ils parlent, ils n’ont pas conscience des vrais enjeux du temps présent. Dans cet état d’hébétude farouche, ils sont peut-être de bonne foi comme veut bien l’admettre Boisbertrand: mais si leurs intentions sont pures, leurs principes sont condamnables, et il faudrait les éclairer. «Vos intentions ne font rien, […] vos maximes font tout», déclare-t-il, reconnaissant en eux des révolutionnaires à leur insu [70].
Exceptionnellement, les ultras tentent de démontrer que l’erreur commise par les libéraux est purement rationnelle, comme lorsqu’un certain L.-X. leur reproche de méconnaître la force des choses et de penser que le monde est gouverné par les seuls décrets de la volonté humaine: à leur politique ambitieuse, le publiciste objecte que «les sociétés ne se font pas par convention, mais par la combinaison et le développement des intérêts, d’après les lois immuables qui régissent le monde» [71]. Il oppose ainsi, au volontarisme libéral qui prétend affranchir l’homme du poids de l’histoire, l’idée du rationalisme historique.
L’imposture libérale comme aveuglement volontaire
18Mais la raison du libéral est-elle seule en cause? Un rédacteur anonyme du Défenseur tente d’abord d’analyser dans cette perspective leur erreur: ils soutiennent des doctrines rationnellement inadmissibles parce qu’elles sont illogiques, comme l’empirisme qui consiste à faire des inductions de la perception à la réalité, ou contradictoires, comme le contractualisme qui oublie qu’un contrat doit toujours avoir un garant supérieur aux parties contractantes, ou inconséquentes et dangereuses, comme l’individualisme qui est antisocial et réduit la loi à la force. L’erreur de logique est dans tous ces cas si énorme qu’elle doit s’expliquer par une cause extérieure à l’intelligence. Si le libéral ne voit plus vrai, c’est parce qu’il est indifférent à « tout ce qui sort du cercle des besoins physiques» et de l’« attachement passionné aux objets périssables». La passion, le souci des biens temporels le privent de la vérité. «Sa raison, absorbée par les intérêts terrestres, ne peut s’élever à des idées d’un ordre supérieur». Si sa bonne foi est ainsi surprise, c’est que joue en lui un mécanisme de persuasion. L’ultra n’hésitera pas à invoquer la Bible pour le faire admettre, rappelant que «c’est dans son cœur que l’impie a dit: il n’y a point de Dieu». L’obstacle à la vérité, que la Révélation aura permis de débusquer, est donc ce processus inconscient qui nous fait préférer nos illusions à la lucidité, l’idéologie à la vérité. Mais ne faut-il pas une étrange complaisance aux passions pour s’en laisser troubler? C’est l’avis de notre rédacteur anonyme, qui n’hésite pas à remarquer que «l’aveuglement de ces nobles champions du libéralisme est d’autant plus grand qu’il est en partie volontaire; ils vont en avant avec cette audace sans mesure, qui est l’apanage des enfants et des sots; et lorsqu’on leur oppose une vérité palpable, ils ferment les yeux pour ne point l’apercevoir » [72]. Leur complaisance dans l’erreur est manifeste pour l’ultra. Quand le libéral invoque les faits, il les dénature ou refuse l’évidence avec un mépris insensé pour les faits avérés, manquant totalement à la raison prise au sens moderne, expérimental du terme. C’est ce que pense Saint-Victor accusant le libéral de refuser la lumière [73], ou encore Fitz-James, observant que ses adversaires continuent à mentir avec un aplomb incroyable quand bien même on vient de démontrer leurs calomnies: «On les voit, armés d’un front d’airain, répéter le lendemain ce qui fut réfuté victorieusement la veille.» [74] Il y a décidément chez eux une «technique du mensonge» et leur duplicité est avérée. Henri de Bonald n’en doute pas: «l’hypocrisie a passé aujourd’hui de la religion à la politique» où elle mine les fondements des sociétés: l’histoire a tranché, on ne peut plus soutenir de bonne foi les doctrines révolutionnaires. Le souvenir du Tartuffe resurgit quelquefois, mais comme celui d’un temps presque heureux, car le libéral se rend cent fois plus dangereux que le personnage de Molière en inscrivant son hypocrisie dans le domaine public [75].
19Ainsi s’instruit le procès de la «raison» libérale: fermée aux sens et à l’expérience, procédant par paralogismes, ignare dans le domaine du droit et dangereuse, elle est le produit du non sens plutôt que du bon sens, et bientôt le discoureur est d’autant plus dupe de lui-même que l’assentiment de ceux qu’il abuse le renforce dans ses absurdes convictions: «Le bavardage ignare de ces messieurs [les libéraux] flattant la populace, ils se sont aveuglés au point de prendre leur non sens pour la raison.» [76] Plus elle est répétée, plus l’erreur paraît vérité, la conviction est en quelque sorte affaire de décibels… Le libéral ne raisonne pas mais délire, ne se trompe pas mais ment.
La «perversité intellectuelle» doit être invoquée [77], permettant de désigner l’adversaire comme un malade, avant de le rejeter dans la barbarie. Le libéral sera vu comme une figure du diable et comparé au serpent de la Genèse. Comme lui, il répand le doute et la confusion, défaut nouveau selon certains, car «en 93, au moins, les bourreaux ne se plaignaient pas d’être victimes; le crime parlait son langage, mais il le parlait sans déguisement» tandis que maintenant «ils ont créé dans l’enfer un enfer plus profond, plus ténébreux, où aucune vérité ne pénètre. La parole n’éclaire plus, elle obscurcit: elle parcourt la terre, disant au mal, tu es le bien, et au bien, tu es le mal » [78]. De la sorte, le combat des ultras relèvera de l’éternel combat du Vrai contre le Faux, du Bien contre le Mal, de Satan contre Dieu. La problématique ne sera plus seulement celle de l’affrontement entre la vérité et l’idéologie, mais aussi celle du combat entre le ciel et l’enfer, et en arrière-plan se profilera l’idée que la Révolution est renouvellement du péché d’Adam [79]. Ainsi, les termes du débat sont clairs, et les adversaires faciles à classer: le monde est divisé en deux populations pour le comte O’Mahony, populations confondues mais non unies, d’un côté les «membres de la grande société chrétienne», de l’autre une «race nouvelle» d’individus qui ne sont pas enfants de Dieu – pour l’ultra, le libéral ne peut être chrétien, et il est à peine homme, puisqu’il parle «un jargon inconnu, inouï, barbare, comme les extravagantes idées auxquelles il sert d’interprète», il est tout ténébreux, criminel, ignorant, il fait partie de ces «hommes de néant» frappés par le «mal de France» [80].
L’erreur libérale comme produit des circonstances historiques
20À l’intérieur de cette doctrine explicative, qui prend en quelque sorte au sérieux l’hypothèse du malin génie dans une perspective encore cartésienne, érigeant le jugement en acte de la volonté [81], l’école du Défenseur ajoute parfois une perspective historique. C’est la nouvelle structure sociale qui promeut d’après les ultras la manière libérale de voir. Cette raison de la «décadence des mœurs» est parfois sous-jacente quand resurgit l’idée d’une conjuration. La «corruption du langage» et l’implantation de la morale des intérêts ne seraient pas spontanées mais se diffuseraient «par le haut», servant des intérêts précis. Le glissement moral obéirait au choix d’une minorité et correspondrait à un dessein. Toute la nation serait sacrifiée aux intérêts et à la bonne conscience d’une élite corrompue. Ici encore, nous retrouvons comme source première de cette situation le nouvel état social en tant qu’il est soumis à la hiérarchie de l’argent : promu par des « intérêts illégitimes» qui «exercent dans l’État une puissante et pernicieuse influence» [82], le déclin moral résulte de leur effort pour se disculper. En voulant innocenter leurs pratiques suspectes, une poignée de corrupteurs divulguent des principes pernicieux dans toute la société. «C’est donc pour satisfaire au besoin des mauvaises consciences que l’on s’efforce d’obscurcir les notions de bien et de mal » [83], conclut le Défenseur. On élabore pour elles une nouvelle morale taillée sur mesure aux dimensions des intérêts libéraux.
21La réflexion mennaisienne sur la nature corruptrice de la nouvelle société va se poursuivre après le temps du Défenseur. Il expliquera beaucoup mieux, dans le De la religion de 1826, pourquoi la société égalitaire, qu’il appelle «démocratique» est par nature corruptrice. La seule distinction y est l’argent, et comme la soif des distinctions n’y disparaît pas, la vanité y motive et redouble irrésistiblement la cupidité. Cette quête de la fortune représentera une cause majeure de dépravation car la conscience va absoudre tout ce qui y tend: «La probité, la vertu, la religion même, prophétise Lamennais, succomberont en plusieurs, qui se mettront à raisonner avec leur conscience, à se dire que pourtant on ne doit non plus rien exagérer; qu’on a des devoirs envers les siens; que trop de roideur achèverait de tout perdre; que la sagesse conseille de se prêter aux circonstances.» [84] C’est exactement ce qu’allègue Charles Grandet dans sa lettre de rupture à Eugénie: «nous nous devons à nos enfants» [85], prétexte-t-il pour mieux se débarrasser de son amour de jeunesse et conclure un plus avantageux mariage. La sophistication de la conscience ne se traduit ici pas tant par l’invocation des enfants qu’il n’a pas encore et dont il ne se soucie sans doute pas beaucoup, que par la nature même de l’argument choisi: Charles fait naïvement appel à un devoir d’assurer leur promotion sociale, se rangeant donc sous une morale qui n’est autre que celle des intérêts… Que nous nous devions à la réussite sociale des nôtres, ce serait donc une croyance foncièrement démocratique, celle-là même que refuse Lamennais comme le produit de ce qu’il appellerait peut-être de nos jours une structure de péché. Dans les rangs de la contre-révolution, la perversité ambiante n’est donc pas un vain thème de lamentation, puisqu’elle procède à ses yeux de causes parfaitement repérables.
22Enfin, les rédacteurs du Défenseur ne manquent pas d’assigner des causes culturelles au surgissement de la nouvelle morale et du nouveau langage: ils seraient favorisés par la propagande philosophique du siècle précédent, qui, en répandant l’idée de la souveraineté de la raison individuelle, a fait disparaître ce «fonds commun de vérités reconnues» qui subsistaient autrefois, et constituaient la «foi sociale». Le conformisme intellectuel s’est substitué au sens commun. Depuis, les esprits «abandonnés à eux-mêmes» ne croient plus rien et rejettent tout, dans «une effroyable instabilité d’opinions et d’institutions». «Les devoirs dès lors ne sont plus que des intérêts, les croyances que des opinions, l’autorité n’est que l’indépendance. Chacun, maître de sa raison, de son cœur, de ses actions, ne connaît de loi que sa volonté, de règle que ses désirs, et de frein que la force.» [86]
Par delà leur ton volontiers apocalyptique, nous avons rencontré une réelle finesse politique chez les auteurs du Conservateur et du Défenseur : ils ont eu la lucidité de la haine envers leurs adversaires dont ils ont dénoncé l’effort de désinformation en attirant l’attention sur la place que tiennent les mots dans le jeu politique. La dette des ultras envers une partie des Lumières ne concerne donc pas seulement la critique de l’individualisme. Après elles, ils ont entrepris de dévaluer les mots creux, percevant nettement que l’usage politique du langage est un usage poétique, par lequel on a cherché souvent davantage à les discréditer qu’à les réfuter. Ils ont été ainsi parmi les premiers à déplorer la perversion de la parole dans les États représentatifs modernes, parole qui entraîne ou retient, fait ou défait les réputations en créant un univers fictif, voire fantasmagorique, où le paraître prend une importance extrême: l’auteur du discours libéral veut se placer du côté des valeurs à la mode. Outre qu’ils amorcent une réflexion fructueuse sur le signe dans la langue, les ultras ont aussi approché la notion d’idéologie, en proclamant que le discours libéral masque des intérêts, que la raison est un alibi facile et trompeur, et que la conscience est souvent la première dupe d’elle-même. Enfin, par leur souci du social les ultras sont fugitivement apparus parents de Rousseau et de Tocqueville, ce qui permettrait de hasarder que l’ultracisme a tissé un des fils reliant les Lumières au libéralisme, dans lequel leur postérité est paradoxalement loin d’être négligeable. Après tout, comme l’écrivait Maine de Biran, «les vrais libéraux ne peuvent être cherchés que parmi les royalistes» [87].
Notes
-
[1]
Benjamin Constant, Des réactions politiques, Flammarion, coll. «Champs», 1988, chap. 6, p. 121.
-
[2]
La Peau de chagrin, Œuvres complètes (désormais OC) de Balzac, Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», 1979, t. 10, p. 90.
-
[3]
«Enfin, Simon se présentait au choix de ses concitoyens en s’engageant à siéger auprès de l’illustre M. Odilon Barrot, et à ne jamais déserter le glorieux drapeau du Progrès ! Le Progrès, un de ces mots derrière lesquels on essayait alors de grouper beaucoup plus d’ambitions menteuses que d’idées, car, après 1830, il ne pouvait représenter que les ambitions de quelques démocrates affamés, ce mot faisait encore beaucoup d’effet dans Arcis et donnait de la consistance à qui l’inscrivait sur son drapeau» (Le Député d’Arcis, OC, t. 8, p. 736).
-
[4]
Législation primitive, Jean-Michel Place, 1988, p. 130. Voir à ce propos l’article de Jean Bastier: «Linguistique et politique dans la pensée de Louis de Bonald», Revue des sciences philosophiques et théologiques, 1974, n° 4.
-
[5]
Gérard Gengembre, La Contre-révolution ou l’histoire désespérante, Imago, 1989, p. 259. Voir aussi p. 158-163.
-
[6]
Considérations, Bruxelles, Éditions Complexe, 1988, p. 66.
-
[7]
Consulter sur ce journal Pierre Reboul, Chateaubriand et Le Conservateur (Lille /Paris, PUL/ Éditions universitaires, 1973), l’article de Jean-Paul Clément («À propos de la création du Conservateur (1816-1820)», Bulletin de l’Association Guillaume Budé, décembre 1996) et le livre de Marianne Grunspan-Grams, Chateaubriand journaliste (Presses universitaires du Septentrion, 1998).
-
[8]
Ministre influent par l’intrigue et par l’estime du roi Louis XVIII, Decazes est favorable aux grandes lois inspirées par les doctrinaires (Guizot et Royer-Collard) sur le suffrage censitaire (février 1817), l’armée (mars 1818) et la presse (avril-mai 1819), ainsi qu’à la destitution des cadres «ultras» au profit du personnel de la Révolution ou de l’Empire (notamment en janvier-février 1819). Sur la vie politique de cette période, consulter Histoire de la Restauration, 1814-1830, naissance de la France moderne, de Emmanuel de Waresquiel et Benoît Yvert, Perrin, 1996.
-
[9]
Sur la doctrine ultra, consulter la thèse de Oechslin, Le Mouvement ultra-royaliste sous la Restauration. Son idéologie et son action politique (1814-1830), Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1960.
-
[10]
Comme l’écrit Chateaubriand dans les Mémoires d’outre-tombe, «N’osant préconiser le mal sous son propre nom, on le sophistique» (Mémoires d’outre-tombe, LIII, 8, Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», 1951, t. II, p. 905).
-
[11]
D’Herbouville, «Sur l’imputation faite aux royalistes de vouloir rétablir la Dîme et la Féodalité», Conservateur, oct. 1818, 4e livraison, t. 1, p. 156.
-
[12]
Pour d’Herbouville, même le rétablissement de l’Ancien Régime n’offrirait rien de bien effrayant: les populations étaient si mélangées qu’il n’y avait plus sous l’Ancien Régime ni Gaulois ni Francs, l’égalité était complètement réalisée dès cette époque entre les hommes. C’est la propriété de la terre noble, accessible aux roturiers, et non de la noblesse personnelle, qui créait la suzeraineté dans cette hiérarchie subsistante de droits locaux à laquelle le nom de féodalité ne s’appliquait plus.
-
[13]
Ibid., p. 161.
-
[14]
Ibid., p. 157-158: «On a fait tant de choses pour égarer les esprits, on fait encore tous les jours un si grand nombre de tentatives dans les mêmes intentions, qu’il faut bien dire, même aux indépendants, à quel point on les abuse.»
-
[15]
Raineville, «Sur les corporations», Défenseur, t. 2, p. 227 (les livraisons antérieures au 3 avril 1821 ne sont pas datées). L’enseignement même est pour l’auteur aux mains d’une corporation qui s’est substituée aux corporations religieuses. Sur la survivance des corporations après l’Ancien Régime, notamment sous la forme de sociétés de secours mutuel, voir William H. Sewell, Gens de métier et révolutions. Le langage du travail de l’Ancien Régime à 1848, Aubier Montaigne, 1983.
-
[16]
Bonald, «Sur les institutions militaires», Défenseur, t. 2, p. 293.
-
[17]
Lamennais, «De l’orgueil dans notre siècle», Défenseur, t. 3, p. 581. Il s’inscrit dans la tradition contre-révolutionnaire qui dénonce les droits formels en objectant que leur proclamation est contemporaine du déclin des droits réels: Bonald, dans le «discours préliminaire» de la Législation primitive, en 1802, le remarque déjà (ouvr. cité, p. 97-98).
-
[18]
«Quiconque est lui-même son Dieu, veut être aussi son roi. Alors il n’existe ni droits, ni devoirs; la force seule commande; ses caprices, voilà l’unique loi» (Lamennais, Essai sur l’indifférence des peuples en matière de religion, t. IV, Librairie classique-élémentaire, 1823, chap. XXXV, p. 417).
-
[19]
«Après les excès de cette révolution qui a tout confondu, tout embrasé, tout détruit, […] oserait-il bien encore vanter ses résultats, et parler de modération», Vicomte de La Rochefoucauld, «À Monsieur l’éditeur du Conservateur», Conservateur, nov. 1818, 7e livraison, t. 1, p. 323.
-
[20]
Saint Roman, «Sur le faux et absurde système de la Souveraineté du Peuple», Conservateur, févr. 1820, 74e livraison, t. 6, p. 398.
-
[21]
Saint Roman, ibid., p. 398-399.
-
[22]
Saint-Prosper, «De l’égalité», Défenseur, t. 2, p. 180.
-
[23]
« Il parle de liberté, et il ne veut qu’enchaîner; d’égalité, et il n’a soif que de distinctions et d’honneurs», Vicomte de La Rochefoucauld, «À M. l’éditeur du Conservateur», Conservateur, nov. 1818, 7e livraison, t. 1, p. 323.
-
[24]
Abbé R., «Sur l’égalité libérale et l’égalité chrétienne», Défenseur, t. 3, p. 353 (l’initiale dissimule certainement Rohrbacher, vicaire à la paroisse de Lunéville). Voir aussi sur ce point d’Herbouville, «Sur l’inégalité des conditions», Conservateur, déc. 1818, 12e livraison, t. 1, p. 538: la haine de la noblesse «est l’appât qu’on jette à la foule pour la diriger vers le résultat dont les meneurs se réservent le secret et le profit». Boisbertrand ironise sur les «apôtres sans mission» qui ont fomenté la Révolution et qu’on vit «parler de liberté jusqu’à ce qu’ils aient été les maîtres, d’égalité jusqu’à ce qu’ils n’aient plus eu d’égaux»: leur secte nourrissait bien «une ambitieuse manie d’ambition» et ne «rêva d’institutions nouvelles» qu’«à son profit» («Sur les Opinions révolutionnaires», Conservateur, déc. 1818, 11e livraison, t. 1, p. 496).
-
[25]
D’Herbouville, «Sur l’imputation faite aux royalistes de vouloir rétablir la Dîme et la Féodalité», Conservateur, oct. 1818, 4e livraison, t. 1, p. 166.
-
[26]
C’est une des thèses de Rohrbacher: l’égalité se rencontre surtout chez les premiers chrétiens et dans les congrégations religieuses (p. 351), et si les hommes sont égaux, c’est «dans leur néant, leur misère et leur entière dépendance de Dieu» («Sur l’égalité libérale et l’égalité chrétienne», Défenseur, t. 3, p. 356).
-
[27]
«De la Religion considérée dans la Société», Conservateur, janv. 1820, 70e livraison, t. 6, p. 214.
-
[28]
Frénilly, «Des idées libérales», Défenseur, t. 1, p. 118.
-
[29]
Abbé R., «Liberté et indépendance libérale; liberté et indépendance chrétienne», Défenseur, t. 4, p. 332. La liberté consiste pour lui à se vaincre soi-même plutôt qu’à se libérer des devoirs et liens de subordination légitimes.
-
[30]
«Œuvres complètes de Bossuet», Défenseur, t. 4, p. 183. L’idée que le christianisme est vraiment philosophie parce qu’il est amour de la sagesse est lancée au xviiie siècle déjà contre les Lumières. Voir Didier Masseau, Les Ennemis des philosophes: l’antiphilosophie au temps des Lumières, Albin Michel, coll. «Idées», 2000.
-
[31]
La «nation nouvelle» formée par les sophistes serait «un peuple sans religion, sans foi, sans humanité, insolent et lâche, incrédule et superstitieux, efféminé et cruel, également prompt à la révolte et docile aux jougs, qui saurait servir et ne saurait être gouverné, courberait la tête sous la verge des tyrans et ne saurait souffrir ses rois» (Bonald, «Du dernier projet de la faction révolutionnaire», Défenseur, t. 4, p. 74).
-
[32]
Achille de Jouffroy, «Coup d’œil sur l’assemblée constituante», Défenseur, t. 2, p. 123. L’idée est déjà chez Barruel, en 1799, dans ses Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, t. 5, p. 140: sous la constituante déjà, le roi n’est roi que de nom, de la religion ne reste que le nom.
-
[33]
«Lettre sur Paris» (anonyme), Défenseur, t. 1, p. 329-330.
-
[34]
Voir, outre les exemples cités dans ces pages, Bonald ironisant sur la fausseté des institutions de son temps : «une royauté sans pouvoir, une noblesse sans devoirs, un clergé sans influence, une magistrature sans autorité, une administration sans considération et sans responsabilité, des institutions sans dignité…» («De la Société et de ses développements», Conservateur, janv. 1820, 68e livraison, t. 6, p. 111), ou Frénilly enseignant qu’il n’y a plus de vrai monarque, de vrai sacerdoce, de vraie noblesse, de corporations… («De quelle manière un État peut périr», Conservateur, févr. 1819, 21e livraison, t. 2, p. 345 et svtes, notamment 350-351).
-
[35]
Frénilly, art. cité, Conservateur, févr. 1819, 21e livraison, t. 2, p. 351. Les ultras sont généralement favorables aux corporations et à leur représentation nationale: la communauté d’intérêts qu’est la commune doit pour eux constituer l’assemblée primaire dans le cadre d’un suffrage universel à plusieurs degrés. Sur l’attachement des ultras aux corporations, lire Pierre Rosanvallon, Le Sacre du citoyen: histoire du suffrage universel en France, Gallimard, 1992 (IIe partie, chap. 2, 2e section «le paradoxe légitimiste»), et, du même auteur, Le Modèle politique français: la société civile et le jacobinisme de 1789 à nos jours, Seuil, 2004 (chap. 5 et 6), ainsi que Rudolf von Thadden, La Centralisation contestée: la centralisation napoléonienne, enjeu politique de la restauration (1814-1830), Arles, Actes Sud, 1989 (traduction).
-
[36]
Frénilly, ibid., p. 353. Tout cela annonce Tocqueville, pour lequel l’appauvrissement relatif et progressif des riches dans la société démocratique les rend inaptes à rester des maîtres pour les pauvres et les renvoie à eux-mêmes: «À mesure que les conditions s’égalisent, il se rencontre un assez grand nombre d’individus qui, n’étant plus assez riches ni assez puissants pour exercer une grande influence sur le sort de leurs semblables, ont acquis cependant ou ont conservé assez de lumières et de biens pour pouvoir se suffire à eux-mêmes» (Démocratie en Amérique, t. 2, IIe partie, chap. 2, «De l’individualisme dans les pays démocratiques», G-F, 1981, p. 127). C’est l’une des quatre raisons de la montée de l’individualisme dans ces sociétés démocratiques. Le chapitre 5 de la IVe partie montre la disparition dans l’Europe démocratique d’«un grand nombre de pouvoirs secondaires qui représentaient des intérêts locaux et administraient les affaires locales» (ibid., p. 369-370).
-
[37]
Frénilly, ibid., p. 348. Selon la métaphore royaliste, les corps intermédiaires sont les membres de la nation et lui donnent vie.
-
[38]
Frénilly, ibid., p. 355. Sur le modèle transformiste, Frénilly se figure ensuite un nouvel État renaissant un jour à partir des éléments différemment combinés de la France morte.
-
[39]
Coriolis, «Si ce qu’on nomme aujourd’hui modération est la modération», Conservateur, mars 1820, 77e livraison, t. 6, p. 560.
-
[40]
Coriolis, art. sans titre, Conservateur, oct. 1818, 4e livraison, t. 1, p. 172.
-
[41]
Bonald, «Sur les circonstances présentes», Conservateur, oct. 1819, 56e livraison, t. 5, p. 170.
-
[42]
Frénilly, «De quelle manière un État peut guérir», Conservateur, avril 1819, 27e livraison, t. 3, p. 31. Frénilly donne cet article dans le contexte d’une campagne de pétition lancée par les indépendants en faveur des régicides exilés. En dépit de l’article 11 de la Charte de 1814, qui a ordonné l’«oubli» sur les «opinions et votes émis jusqu’à la restauration», Louis XVIII ne veut pas grâcier en masse, pour ne pas paraître les réhabiliter ni céder à une faction. Les ultras allèguent que de toute façon le régicide n’est pas une «opinion» mais un «crime».
-
[43]
Coriolis, «Si ce qu’on nomme aujourd’hui modération est la modération», Conservateur, mars 1820, 77e livraison, t. 6, p. 560.
-
[44]
Raineville, «Sur les corporations », Défenseur, t. 2, p. 227.
-
[45]
Salaberry, «Suite des développements des principes royalistes», Conservateur, févr. 1820, 73e livraison, t. 6, p. 378.
-
[46]
D’Herbouville, «De la résistance des royalistes», Conservateur, janv. 1820, 67e livraison, t. 6 p. 56.
-
[47]
D’Herbouville, «Sur l’inégalité des conditions», Conservateur, déc. 1818, 12e livraison, t. 1, p. 539.
-
[48]
Jouffroy, «Coup d’œil sur l’assemblée constituante», Défenseur, t. 2, p. 126-127. Jouffroy, cite ici Burke dont il reprend la pensée à son compte. Lamennais lui fera écho un peu plus tard: «Appelez liberté la servitude, et la persécution tolérance, les hommes, tels que les a faits la civilisation philosophique, ne se croient libres que dans les fers» (De la religion, Éditions du Mémorial catholique, 1826, p. 94).
-
[49]
«Savants dans l’art d’appeler bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien, des apôtres de mensonge prêchant, sous le nom de liberté, les excès de la licence, sous celui d’égalité, les désordres de l’anarchie, et consacrant à la fois l’athéisme et la révolte, menacent d’une subversion totale la religion de l’État et la morale universelle, nos institutions constitutionnelles et nos existences particulières» (Pardessus, reproduction d’un discours prononcé à l’École de Droit le 17 février, Conservateur, févr. 1820, 74e livraison, t. 6, p. 389).
-
[50]
D’Herbouville, «Sur l’esprit du siècle», Conservateur, juin 1819, 38e livraison, t. 3, p. 535-551.
-
[51]
Que vaut l’argument? L’esprit du siècle est l’opinion publique éclairée plutôt que le vœu des masses paysannes…
-
[52]
D’Herbouville y reconnaît un principe glissant, propre à tout justifier, «toutes les fautes, toutes les sottises des gens en place», ainsi que «l’exagération des démagogues». Il dispense merveilleusement de rendre des comptes…
-
[53]
Art. signé T.B., «Sur les choses du moment», Défenseur, t. 2, p. 71.
-
[54]
Fitz-James, «Sur le dernier Ouvrage de Madame de Staël», Conservateur, nov. 1818, 5e livraison, t. 1, p. 204-205.
-
[55]
Castelbajac, «De l’emploi de quelques mots», Conservateur, déc. 1818, 11e livraison, t. 1, p. 512. Voir aussi l’anonyme «Lettre sur Paris», Défenseur, t. 2, p. 181, regrettant que les vrais royalistes soient affublés de sobriquets stupides comme celui de «jacobins blancs».
-
[56]
« Il ne faut pas s’étonner que la jeunesse ait pris dans ces étranges leçons des sentiments de révolte et de haine contre l’ordre établi» (Bonald, «Sur les Francs et les Gaulois», Défenseur, t. 3, p. 388).
-
[57]
Bonald, ibid., p. 389-390: «Les excès de la révolution pèsent à ceux qui les ont commis et à ceux qui désirent aujourd’hui en recueillir les fruits. C’est un héritage qu’on ne veut pas répudier; mais on voudrait faire disparaître les traces honteuses de son origine […] Ce n’est plus le peuple qu’il faut tromper, ce sont les gens habiles qui veulent être trompés, et qui, pour n’être plus les Français qui ont fait la révolution, préfèrent d’être les Gaulois qui ont souffert la conquête».
-
[58]
T.B., «De la modération», Défenseur, t. 4, p. 164.
-
[59]
Coriolis, «Si ce qu’on nomme aujourd’hui modération est la modération», Conservateur, mars 1820, 77e livraison, t. 6, p. 558 et suiv. Voir Lamennais, «La lâcheté dans le langage de ce temps s’appellera modération» (De la religion, ouvr. cité, p. 44).
-
[60]
Pardessus, reproduction d’un discours prononcé à l’École de Droit le 17 février, Conservateur, févr. 1820, 74e livraison, t. 6, p. 388.
-
[61]
Ibid., p. 389.
-
[62]
Bonald, «Sur les circonstances présentes», Conservateur, oct. 1819, 56e livraison, t. 5, p. 157-158.
-
[63]
Lamennais, «Sur un ouvrage intitulé: Du pape», Défenseur, t. 2, p. 1. On parle alors de la «matérialisation» des esprits. Pour sauver le goût des choses intellectuelles par opposition aux sciences matérielles, le Conservateur recommande d’étudier la culture grecque et latine (Conservateur, févr. 1819, 21e livraison, t. 2, p. 366). La conception de l’homme comme être spirituel plutôt que matériel engage aussi une définition du patriotisme et du rapport à la nationalité. Le sol qu’il habite n’est pas plus la patrie de l’homme civilisé, pour Bonald, que sa maison n’est sa famille. Voir Défenseur, t. 2, p. 42-43 et 102. Le patriotisme pris au sens d’attachement au territoire est pour lui un naturalisme.
-
[64]
Chateaubriand, «De la morale des intérêts et de celle des devoirs», Conservateur, déc. 1818, 10e livraison, t. 1, p. 466-478.
-
[65]
Bonald, «Sur les inquiétudes publiques», Conservateur, fév. 1820, 6e livraison, t. 6, p. 18.
-
[66]
Pour Bonald, l’avenir n’est pas assuré puisqu’on laisse courir les «opinions inquiétantes» et les «factieux», notamment par une interprétation démocratique de la Charte et la prépondérance de la gestion des intérêts sur celle de la doctrine. Bonald constate que ni la nation, soumise, ni l’Europe, pacifique, ni les finances, florissantes, ni enfin la météorologie, favorable à l’agriculture depuis deux années, n’y sont pour quelque chose, et qu’il faut donc en attribuer la responsabilité à la politique gouvernementale de bascule: «Avec un système indécis, tout est incertitude, […] avec un système faible tout est danger» («Sur les inquiétudes publiques», Conservateur, janv. 1820, 66e livraison, t. 6, p. 19). Le gouvernement ne sait pas comprimer les factions, ne se résout pas à modifier une loi électorale (dans le sens préconisé par De Serre et qui en introduisant le double vote serait plus favorable à la noblesse), plus généralement nous laisse, disent les ultras, «éprouver des inquiétudes sur notre existence sociale» (ibid., p. 24) en faisant la part trop belle aux partisans des doctrines révolutionnaires. Thème analogue chez D’Herbouville, «Sur l’harmonie sociale…», Conservateur, févr. 1819, 22e livraison, t. 2, p. 385 et suiv.: l’inquiétude de la nation viendrait de ce qu’elle sent le pouvoir monarchique incapable de durer et la révolution annoncer son retour, à causes des incohérences gouvernementales. Voir aussi Suleau, «Considérations politiques», Conservateur, févr. 1820, 74e livraison, t. 6, p. 402, et Frénilly, «De la confiance et du crédit», Conservateur, mars 1820, 77e livraison, t. 6, p. 550.
-
[67]
Voir Bonald, «Sur les circonstances présentes», Conservateur, oct. 1819, 56e livraison, t. 5, p. 158: «La grande plaie de l’Europe est l’indifférence des gouvernements à la religion, ou les craintes surannées qu’elle leur inspire; sentiments qui deviennent chez le peuple haine et mépris de l’autorité religieuse, et bientôt de toute autre autorité». On peut résumer ainsi la situation: «La faiblesse du pouvoir, cause unique de l’inconstance des peuples» (ibid., p. 171). Lamennais partage cette idée: «Plus de principes certains, plus de maximes ni de lois fixes; et comme il n’y a rien de stable dans les institutions, il n’y a rien d’arrêté dans les pensées. Tout est vrai et tout est faux. La raison publique, fondement et règle de la raison individuelle, est détruite» («De l’état actuel de la société», Défenseur, t. 1, p. 433).
-
[68]
La responsabilité du pouvoir à l’égard des progrès de l’anarchie est souvent dénoncée en termes précis. Les journaux «révolutionnaires» parlent-ils de façon flatteuse de la révolte en Espagne? Alors tous les factieux sont encouragés, avec la bénédiction gouvernementale. «Est-ce que par hasard ce qui serait révolte en France n’est pas révolte en Espagne?», se demande Castelbajac (sans titre, Conservateur, févr. 1820, 72e livraison, t. 6, p. 326): un roi est toujours un roi, une révolte toujours une révolte. Il n’y a ni distinction, ni concession à faire. Et il continue: «Misérable doctrine que celle d’un pays où ceux qui administrent ne font usage du pouvoir que pour intervertir jusqu’aux plus simples notions du juste et de l’injuste ! La société résiste pensant un temps à leurs efforts; elle trouve en elle une force d’éducation, de principes et d’habitude qui la fait vivre au milieu des éléments morts dont on l’entoure; mais enfin l’erreur porte son fruit; la corruption qui vient d’en haut gagne rapidement les classes inférieures: il s’ensuit un désordre d’idées qui établit la confusion partout, un malaise général, une inquiétude qui ne permet pas plus à l’espérance qu’elle n’ôte aux souvenirs. On ne sait plus comment on marche, où l’on va, ce qu’il faut craindre, ce qu’on peut désirer». (ibid., p. 327).
-
[69]
D’Herbouville, «Sur l’imputation faite aux royalistes de vouloir rétablir la Dîme et la Féodalité», Conservateur, oct. 1818, 4e livraison, t. 1, p. 161.
-
[70]
Boisbertrand, «Sur les opinions révolutionnaires», Conservateur, déc. 1818, 11e livraison, t. 1, p. 500.
-
[71]
De L-X., «Sur la liberté de la presse», Conservateur, févr. 1820, 72e livraison, t. 6, p. 321.
-
[72]
M., «La science des libéraux», Défenseur, t. 4, p. 174 et 178.
-
[73]
Saint-Victor, «Sur les Soirées de Saint-Petersbourg», Défenseur, t. 4, p. 197.
-
[74]
Fitz-James, «Sur le dernier ouvrage de Madame de Staël», Conservateur, nov. 1818, 5e livraison, t. 1, p. 205. Voir aussi F., «Sur un caractère de la faction révolutionnaire», Défenseur, t. 1, p. 585.
-
[75]
Bonald, «De l’hypocrisie en politique», Défenseur, 4 août 1821, t. 6, p. 445. L’anonyme «Lettre sur Paris» du Défenseur, t. 2, p. 183, souligne qu’on est «révolté [et] confondu par l’inconcevable hypocrisie» de ceux qui osent répéter en 1820 des maximes qui ont déjà été si funestes.
-
[76]
M., «La science des libéraux», Défenseur, t. 4, p. 177.
-
[77]
F., «Sur le caractère de la faction révolutionnaire», Défenseur, t. 1, p. 585.
-
[78]
Ibid., p. 585.
-
[79]
Abbé R., «Sur l’égalité libérale et l’égalité chrétienne», Défenseur, t. 3, p. 350-362: c’est une démarche luciférienne. Le programme libéral rejoue l’apparition de l’Enfer.
-
[80]
O’Mahony, «Réflexions», Défenseur, t. 2, p. 494-496. Le thème de la barbarie révolutionnaire est ainsi renouvelé.
-
[81]
Ceci dans le sillage de Bonald, qui analyse l’erreur comme préjugé: «La vérité [est] presque toujours dans nos pensées, et trop souvent l’erreur dans nos jugements, parce que nous aurions presque toujours besoin, avant de juger, d’un plus ample informé» (Législation primitive, ouvr. cité, Livre I, chap. 3, p. 129).
-
[82]
T.B., «De la modération», Défenseur, t. 4, p. 160.
-
[83]
Ibid.
-
[84]
Lamennais, De la religion, ouvr. cité, p. 44.
-
[85]
Eugénie Grandet, OC, t. 3, p. 1187.
-
[86]
Lamennais, «De l’état actuel de la société», Défenseur, t. 1, p. 435-436. Le rôle des collèges d’enseignement public, héritiers du lycée impérial, figure aussi parmi les ennemis de la jeunesse: là, «des professeurs de mensonge lui diront que l’autorité légitime n’est que l’esclavage, et que la révolte est le plus saint des devoirs» (Henri de Bonald, «Du dernier projet de la faction révolutionnaire», Défenseur, t. 4, p. 72).
-
[87]
Voir son journal d’oct. 1820, cité par Lucien Jaume dans L’Individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français, Fayard, 1997, p. 515. Les royalistes veulent en effet diminuer l’État, mais c’est en faisant le jeu des communautés.