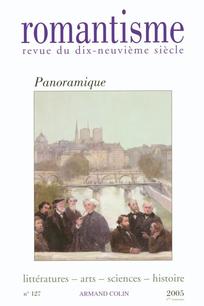1La vengeance est liée au problème de l’identité: elle restitue symboliquement ce que l’offense a soustrait. Les écrivains romantiques sont séduits par le thème de la vengeance dont la tragédie classique ne faisait qu’une affaire d’honneur et de devoir. Dans la littérature romantique française qui défend la liberté, laver l’affront n’est plus un acte dicté par les conventions sociales et littéraires. Désormais raconter une vengeance, c’est mettre au centre du récit les métamorphoses d’un individu blessé, son énergie, sa volonté, sa patience. Il se transforme sans que son identité se perde. En même temps, la vengeance entre en conflit avec la justice instituée. Elle comporte une part de révolte contre l’ordre social et impose une volonté personnelle [1].
2La vengeance de Lisbeth Fischer, apparaît comme une contre-épreuve de ses devancières «romantiques», dans la mesure où elle ne parvient pas à atteindre son objectif et n’est qu’un calcul social. La cousine Bette veut s’élever dans la hiérarchie des positions sociales. Cependant, la vengeance de Bette présente quelques ressemblances avec la vengeance du redresseur de torts romantique (le comte de Monte-Cristo par exemple) : l’action occulte du vengeur [2] et la fonction primordiale de l’argent. À cela s’ajoute la dimension politique des deux textes. Focalisé sur la justice distributive, le roman de Dumas prend clairement le parti de dénoncer les machinations sordides et les abus financiers et défend la cause des idées réformistes et révolutionnaires [3]. Ceux qui seront frappés par le vengeur fabuleux doivent expier non seulement la trahison d’un innocent mais également les crimes qu’ils ont perpétrés contre la société. La Cousine Bette est aussi un roman sur les bouleversements sociaux et la quête effrénée de l’argent. Mais une différence majeure sépare les deux textes et révèle leur différence idéologique: alors que Monte-Cristo réussit à punir les scélérats qui abusent du pouvoir dont ils se sont emparés (le vengeur romantique qui se substitue à la Providence ne saurait échouer dans sa mission), la vengeresse du roman réaliste, quant à elle, sera dominée et neutralisée par le mouvement des forces sociales, auxquelles sa vengeance semblait pourtant être d’emblée associée.
Le centre et la périphérie
3Dans la maison Hulot, Lisbeth Fischer bénéficie d’une situation toute particulière, dont l’origine tient à la nette dissociation du naturel et du social. En vertu des liens du sang, elle appartient à la famille de sa cousine Adeline, devenue baronne grâce à un mariage digne d’un conte de fées. Toutefois, en raison de son statut social et du métier qu’elle exerce – parmi les principaux protagonistes du roman, Bette est la seule à gagner sa vie en travaillant –, elle s’écarte de ses riches parents qui, eux, font partie de la noblesse impériale. Le travail n’est pas l’unique indice qui témoigne de son aliénation. À sa dégradation sociale vient s’ajouter sa virginité, qualifiée de «monstruosité» par une narration qui accorde une grande importance à la dimension érotique. Il n’est donc pas étonnant que le narrateur ait fréquemment recours au qualificatif «excentrique» lorsqu’il entreprend de décrire la vieille fille. Il ne s’agit pas seulement de la psychologie du personnage, mais aussi de la situation ambiguë de Lisbeth dans la famille Hulot.
4Si les critiques (Françoise Gaillard [4] en particulier) ont noté, à juste titre, la stratégie adoptée par Bette qui, au centre de la narration, telle l’araignée au milieu de sa toile, espionne ses victimes et tisse la trame de sa vengeance, on n’a pas suffisamment étudié, en revanche, sa marginalité. Le cousinage situe Bette à la périphérie des rapports parentaux [5]. À cela s’ajoute une sorte d’auto-exclusion: «elle se refusait elle-même à venir aux grands dîners en préférant l’intimité qui lui permettait d’avoir sa valeur, et d’éviter des souffrances d’amour propre» (CB, 84). Le retrait par rapport au centre familial, imposé et volontaire à la fois, procure à Bette une liberté d’action.
5Arrachée à la pauvreté en même temps qu’à son milieu d’origine, la Lorraine Lisbeth Fischer s’installe à Paris au moment où, au sommet de sa carrière, le baron Hulot jouit de la protection de l’Empereur. Néanmoins, la fréquentation de ses illustres cousins ne la fait pas changer fondamentalement de rang social, puisque de paysanne elle devient ouvrière en passementerie. En revanche, le travail, même s’il témoigne à certains égards de sa condition inférieure, lui assure une autonomie relative. Mais si Lisbeth se soumet à la nécessité de travailler, elle n’en accepte pas moins l’hospitalité et le soutien matériel de ses parents. En échange, elle fait preuve d’une subordination sans égale, en remplissant la fonction de domestique dans le ménage de ses hôtes, en se laissant aussi «traiter sans façon» (CB, 84) : vouvoyant les autres, elle est tutoyée en retour; flattant, elle est sans cesse raillée. La cousine Bette est toujours en retrait et spectatrice: «Dans ce théâtre qui simule la vie, comme une sorte d’univers parallèle et grossissant, remarque Nicole Mozet, Lisbeth est vouée aux coulisses, quelquefois metteur en scène, mais jamais sur le devant de la rampe» [6].
6La famille Hulot se trouve ainsi exposée sans le savoir à un regard qui traverse les apparences et fait tomber les masques. La cousine Bette accède aux secrets de chacun. D’ailleurs, elle n’a pas souvent à mettre à l’épreuve son sens raffiné de l’observation, ni à guetter, de «ses yeux noirs et pénétrants» (CB, 145) et de «son regard perçant» (CB, 84), les gestes et paroles qui dissimulent la détresse de ses parents, puisqu’ils lui révèlent volontiers leurs misères à tour de rôle. Jugeant «cette fille en apparence si faible, si humble et si peu redoutable» (CB, 152) complètement soumise à leur volonté, ils se croient prémunis contre son indiscrétion (qui, révélée, n’aurait pas manqué de mettre fin à son existence de parasite [7]). «On croyait cette fille dans une telle dépendance de tout le monde, qu’elle semblait condamnée à un mutisme absolu. Elle se surnommait elle-même le confessionnal de la famille» (CB, 85). Conseillère irremplaçable, investie de la confiance de ses hôtes, promue au rang de médiatrice des passions et des intérêts des autres personnages, toujours attentive et compatissante, Lisbeth Fischer rend sa présence chez ses cousins indispensable. Cette position double, d’exclusion et de participation à la fois, fournit les conditions favorables à l’exécution de sa vengeance. Si Adeline, du fait de ses souvenirs d’enfance, se défie de sa cousine, ce n’est nullement le cas de son mari, et encore moins du véritable patriarche de la famille, le maréchal Hulot.
7Le patriarcat qui s’exerce au sein de la famille est en même temps le principe souverain de l’organisation sociale, tout naturellement lié ici à la figure de Napoléon — le «père» disparu de toute une nation, auquel la famille Hulot doit richesse et anoblissement:
Depuis le premier jour de son mariage jusqu’en ce moment, la baronne avait aimé son mari, comme Joséphine a fini par aimer Napoléon, d’un amour admiratif, d’un amour maternel, d’un amour lâche. […] Hortense croyait son père un modèle accompli d’amour conjugal. Quant à Hulot fils, élevé dans l’admiration du baron, en qui chacun voyait un des géants qui secondèrent Napoléon, il savait devoir sa position au nom, à la place et à la considération paternelle.
9Le baron et son frère témoignent d’une confiance inébranlable envers Bette: «[N]ous sommes sûrs de toi» (CB, 301), affirme ainsi Hector. Le héros de Forzheim, à la différence de tous les autres personnages, reconnaît son droit d’identité à Lisbeth qu’il appelle «mademoiselle Fischer». Le soutien de la puissance paternelle joue un rôle central dans l’accomplissement de la vengeance, qui doit déboucher sur le mariage de Bette avec le maréchal Hulot. Un tel dénouement garantirait en effet à Lisbeth une position sociale analogue à celle de sa rivale Adeline, à qui l’union avec le baron Hulot ouvre les portes de la cour impériale. La vengeance apparaît au premier abord comme une juste compensation réclamée par Lisbeth, «immolée à Adeline». (CB, 146): « [J]e me souviens de mon enfance. Chacun son tour. Elle sera dans la boue, et moi! je serai comtesse de Forzheim» (CB, 201). Des deux adolescentes lorraines, c’est en effet Lisbeth qui travaille dans les champs, tandis qu’Adeline est dispensée de cette corvée harassante; c’est également Lisbeth qui est «mise comme un souillon», et c’est sa cousine qui est «vêtue comme une dame» (CB, 147). Cette disparité est aggravée par le mariage d’Adeline. Car il permet à cette dernière de se soustraire à sa condition de paysanne, et il lui confère le titre de baronne, alors que Lisbeth, abandonnée à son destin, continue à s’enfoncer dans une existence médiocre.
10Ayant subi les revers du sort, à la différence de sa cousine, Bette pense ainsi mériter de plein droit une compensation qui devra racheter tous les aspects de sa disgrâce. «Adeline et Hortense achèveraient leurs jours dans la détresse, en combattant la misère, tandis que la cousine Bette, admise aux Tuileries, trônerait dans le monde» (CB, 313). Bette désire l’appauvrissement de la famille comme la réparation d’une injustice: «Adeline va, comme moi, travailler pour vivre, pensa la cousine Bette. Je veux qu’elle me mette au courant de ce qu’elle fera… Ces jolis doigts sauront enfin comme les miens ce que c’est que le travail forcé» (CB, 207, je souligne). Mais les enjeux de sa vengeance semblent impliquer la redistribution du pouvoir au sein du cercle familial plus encore que l’équilibrage sur le plan du travail ou dans le registre des distinctions sociales.
11L’ambiguïté de sa situation permet à la cousine pauvre de justifier son intimité avec la maîtresse du baron, Valérie Marneffe, l’instrument de la vengeance. Lisbeth s’installe dans la maison de sa complice, sous prétexte de tenir informés ses cousins des intrigues ourdies par leur ennemie. Elle a ainsi la possibilité de poursuivre «le cours de ses vengeances avec une impitoyable logique» (CB, 200). La vengeance de Bette fait apparaître au cœur même de la narration romanesque la dissolution de la famille, conçue comme un modèle réduit de l’organisation sociale. Pour représenter une image fidèle de la société contemporaine, dit l’auteur lui-même dans l’avant-propos de La Comédie humaine, il faut considérer « la Famille et non l’Individu comme véritable élément social » [8]. L’analyse de Françoise Gaillard fait sienne la thèse de Balzac et la développe:
[C]e qui est vrai dans la crise datée de la famille Hulot, rejoint la vérité du processus social, parce qu’une même logique agit tout à la fois le particulier et le général […] la partie et le tout participent d’un ensemble régi par les mêmes lois – vision du monde structurale. La recette du grand réalisme est dans l’intuition de cette proposition élémentaire. [9]
13Sous la Monarchie de Juillet la réalité sociale est soumise au pouvoir de l’argent. C’est grâce à leur fortune que les personnages de Rouvet et de Crevel ont surpassé leurs adversaires dans la campagne électorale. C’est également au moyen d’un achat de terre, en d’autres termes d’une transaction, que l’ex-commis ajoute la particule nobiliaire à son nom [10]. Rien ne saurait exprimer plus clairement l’esprit de l’époque que les paroles sentencieuses de l’ancien négociant:
Vous vous abusez, cher ange, si vous croyez que c’est le roi Louis-Philippe qui règne, et il ne s’abuse pas là-dessus. Il sait comme nous tous qu’au-dessus de la Charte, il y a la sainte, la vénérée, la solide, l’aimable, la gracieuse, la belle, la noble, la jeune, la toutepuissante pièce de cent sous! […] Enfin, l’éternelle allégorie du veau d’or !
15L’acte vengeur se rattache ainsi aux pratiques et aux discours sociaux contemporains: il doit procurer une rétribution compensatoire.
16La vengeance de Lisbeth est une tentative pour discréditer la structure patriarcale qui gouvernait jusque-là l’économie de la famille. Si Bette veut s’enrichir, c’est pour acquérir du pouvoir: la possibilité de gérer les affaires familiales. Adeline, elle, est la gardienne fanatique de la loi du père: «Pour Adeline, le baron fut donc, dès l’origine, une espèce de Dieu qui ne pouvait pas faillir […] Après s’être bien dit que son mari ne saurait jamais avoir de torts envers elle, elle se fit, dans son for intérieur, la servante humble, dévouée et aveugle de son créateur.» (CB, 76) Bette rêve donc de soumettre la baronne à son pouvoir économique et de prendre en main le destin de toute la famille: «Elle jouissait par avance du bonheur de régner sur la famille qui l’avait si longtemps méprisée. Elle se promettait d’être la protectrice de ses protecteurs, l’ange sauveur qui ferait vivre la famille ruinée…» (CB, 313).
17Pour mettre en œuvre la vengeance Bette utilise l’érotomanie du baron. Mené habilement par Bette, il fait sa propre ruine et perd sa position politique ainsi que son pouvoir de chef de famille. Hector reconnaît lui-même son incapacité: « — Ah! voir tous les jours devant soi un père, criminel comme je le suis, il y a quelque chose d’épouvantable qui ravale le pouvoir paternel et qui dissout la famille. Je ne puis donc rester au milieu de vous, je vous quitte pour vous épargner l’odieux spectacle d’un père sans dignité.» (CB, 355) En l’absence prolongée du père, Bette arrive sans peine à usurper la place vacante au sein de la famille. Elle finit par devenir le «bon ange» (CB, 171), la «madone» (CB, 290), l’«idole» (CB, 300) du ménage. Or, cette sanctification est un élément décisif pour la suite de ses opérations. Quant au maréchal, le dernier symbole de l’ordre ancien, il ne peut se défier d’une «vraie républicaine, d’une fille du peuple» (CB, 351). Il sympathise avec Lisbeth, «car il se trouvait entre eux des ressemblances». (CB, 98). Bette, à l’abri de toute suspicion, peut, sans trahir ses véritables intentions, suggérer d’épouser le maréchal pour arracher ses parents à la crise financière: «Eh bien! songeons à l’avenir! le maréchal est vieux, mais il ira loin, il a un beau traitement; sa veuve, s’il mourait, aurait une pension de six mille francs. Avec cette somme, moi, je me chargerais de vous faire vivre tous!» (CB, 205) Avant sa fuite, même le baron, que la perspective de ce mariage scandalise pourtant sincèrement, se trouve obligé de céder aux arguments irréfutables de la vieille fille: « — Si votre frère meurt, qui soutiendra votre femme, votre fille? La veuve d’un maréchal de France peut obtenir une pension de six mille, n’est-ce pas? Eh bien! je ne me marie que pour assurer du pain à votre fille et à votre femme, vieux insensé! » (CB, 301)
La thématique du père absent et impuissant domine le roman. Si les infidélités du baron qui aboutissent à sa désertion restent au centre du dispositif narratif, ce n’est pas le seul exemple de défaillance masculine. On a noté plus haut les constantes références du texte au personnage de l’Empereur, dont la nation entière continuerait de faire nostalgiquement un père. Quant aux pères d’Adeline et de Lisbeth, ils sont tous les deux morts au service, justement, de Napoléon. Crevel, pour sa part, déshérite sa fille sans ressentir le moindre remords. Enfin, Marneffe abandonne cruellement son enfant dans un internat. La valeur négative de la figure paternelle est soulignée à plusieurs reprises. En revanche, le texte insiste beaucoup sur les bienfaits de la maternité – celle réalisée d’Adeline, qui lui vaut la vénération de ses enfants, et celle de Lisbeth, plus despotique à l’égard de Wenceslas: «La vieille fille déployait la tendresse d’une brutale, mais réelle maternité. Le jeune homme subissait comme un fils respectueux la tyrannie d’une mère.» (CB, 108) Elle développe un sentiment maternel (dont la prive le mariage d’Hortense avec le jeune artiste) à l’égard de sa complice: «Elle adorait d’ailleurs Valérie, elle en avait fait sa fille, son amie, son amour ; elle trouvait en elle l’obéissance des créoles, la mollesse de la voluptueuse; elle babillait avec elle tous les matins avec bien plus de plaisir qu’avec Wenceslas.» (CB, 200)
Sur la scène socio-politique, la nouvelle forme de pouvoir, l’argent, est incompatible avec la chaste figure féminine dont Adeline Hulot est le symbole. Les temps ne sont plus à la vertu authentique. La baronne est inadaptée à son temps: elle échoue lorsqu’elle tente de se prostituer pour sauver sa famille de la ruine. C’est la courtisane arrogante, Valérie Marneffe, qui triomphe. Quant à Lisbeth Fischer, elle représente une autre espèce de femme, sorte d’androgyne d’une «mâle et sèche nature» (CB, 195), qui a «des qualités d’homme» (CB, 84). Le célibat, tenu pour une anomalie sexuelle, constitue en réalité un capital d’énergie que la cousine Bette met au service du mal :
La Virginité, comme toutes les monstruosités, a des richesses spéciales, des grandeurs absorbantes. La vie, dont les forces sont économisées, a pris chez l’individu vierge une qualité de résistance et de durée incalculable. Le cerveau s’est enrichi dans l’ensemble de ses facultés réservées. Lorsque les gens chastes ont besoin de leur corps ou de leur âme, qu’ils recourent à l’action ou à la pensée, ils trouvent alors de l’acier dans leurs muscles ou de la science infuse dans leur intelligence, une force diabolique ou la magie noire de la Volonté.
Les diaboliques
18La ruine financière des Hulot, le départ humiliant du baron et le mariage détruit d’Hortense, tous ces cataclysmes dont la vieille fille est l’instigatrice ne sauraient suffire à apaiser sa rancune. Elle rejette les avis de sa complice Valérie, qui juge que la «vengeance est complète»: «Tant que je ne serai pas madame la maréchale, je n’aurai rien fait.» (CB, 262) Son projet ne peut se réaliser que dans la mesure où il provoque un aveuglement général et que Lisbeth Fischer, comme le dit Michel Butor, «bénéficie d’un manteau d’invisibilité» [11]. Il est d’une importance capitale qu’elle demeure la «pauvre fille» qui n’a d’identité que par rapport à ces parents: elle n’est que «la cousine, nommée Bette par abréviation» (CB, 81). Les autres ne pensent à elle que lorsqu’ils ont besoin de ses services. Bette est donc visible seulement quand elle est utile; superflue, elle devient transparente. Et c’est justement quand elle est ignorée que surgit la vraie nature de «cette fille de souffre et de feu» (CB, 148), comme la duchesse de Sierra-Leone, dans La Vengeance d’une femme [12]. Lisbeth mérite bien le qualificatif de diabolique que Barbey d’Aurevilly rendra célèbre quelques trente ans plus tard. La scène où elle apprend la trahison de ses parents, qui ont arraché le jeune sculpteur à ses griffes [13], est révélatrice à cet égard:
[U]ne affreuse convulsion faisait trembler ses membres. Elle avait glissée sa main crochue entre son bonnet et ses cheveux pour les empoigner et soutenir sa tête, devenue trop lourde; elle brûlait! La fumée de l’incendie qui la ravageait semblait passer par ses rides comme par autant de crevasses labourées par une éruption volcanique. Ce fut un spectacle sublime.
20Mais c’est un sublime infernal, un «sublime à l’envers», pour reprendre l’expression du narrateur des Diaboliques. Du reste, Bette est le seul personnage du roman à résister au pouvoir de l’église. Même l’insensible Josépha rend hommage à Dieu en signe de respect pour l’adoration qu’Adeline voue à son mari. Valérie elle-même implore le pardon et accepte la foi religieuse sur son lit de mort. Mais la manifestation du sentiment pieux laisse Bette indifférente. Elle accueille froidement, avec mépris, le spectacle que lui offre l’agonie de sa complice, se livrant à la miséricorde de Dieu. En dépit de l’imminent échec de sa vengeance, elle ne cède pas aux exhortations de la courtisane: « — Moi! dit la Lorraine, j’ai vu la vengeance partout dans la nature, les insectes périssent pour satisfaire le besoin de se venger quand on les attaque! Et ces messieurs, dit-elle en montrant le prêtre, ne nous disent-ils pas que Dieu se venge, et que sa vengeance dure l’éternité!…» (CB, 432). La vengeance est donc, selon Bette, une nécessité vitale, une loi naturelle, voire transcendante. De même dans la nouvelle de Barbey d’Aurevilly, la duchesse de Sierra-Leone refusera le repentir.
21Vautrin, «cet homme vraiment diabolique» [14], est l’unique personnage de La Comédie humaine qui soit de taille à déjouer les manœuvres de la vieille fille, à dérégler le mécanisme de sa vengeance [15]. À l’instar de Lisbeth, qui agit indirectement, en manifestant sa volonté par le biais de sa complice Valérie, Vautrin opère par délégation. Le dénouement de la vengeance se décide donc «dans la partie que jouait mame Nourrisson contre Madame Marneffe» (CB, 406). Les traits masculins qu’accuse l’émissaire femelle de Vautrin instaurent d’emblée une symétrie avec la virilité de la cousine Bette. Si le portrait de Lisbeth évoque l’image de l’enfer, celui de Madame Nourrisson s’y associe sans équivoque. Son apparence monstrueuse produit un effet si intense sur Hulot fils, qu’il ne peut pas s’empêcher de s’écrier : «Le diable a une sœur.» (CB, 388) Quant au baron Montès – le «pion nécessaire» (CB, 406) au complot tramé par Madame Nourrisson –, Jacques Neefs a très justement analysé le fonctionnement narratif de ce personnage qui surgit dans l’espace diégétique au moment exact où Bette a pris le contrôle total de la situation [16]. La fonction du baron brésilien (dont le caractère «se rapprochait beaucoup de celui de Lisbeth» (CB, 397)) consiste à déloger la parente pauvre de sa position dominante dans l’organisation de l’espace romanesque.
22Au bout du compte, le dispositif vengeur qui s’appuie sur la circulation de l’argent sera bloqué par les spéculations de Victorin. Grâce à ses placements immobiliers, le fils réussit à tirer la famille de l’embarras pécuniaire où son père l’avait mise. À l’opposé du baron Hulot, qui montre du génie dans la quête permanente de l’argent, mais une incompétence totale dans sa gestion, le jeune avocat, représentant du nouvel ordre politico-économique, saura éviter la ruine par ses opérations foncières: «Les appartements acquéraient du prix par le changement du centre des affaires. […] Les deux immeubles de produit entièrement loués devaient donner cent mille francs par an. […] C’était la manne tombée du ciel » (CB, 367).
23Le pouvoir démesuré du capital dans La Comédie humaine, qui s’attache à démasquer les rouages de la mécanique sociale fondée sur la corruption, est stigmatisé ici avec une ironie mordante. Fidèle aux idées qu’il développe dans ses romans précédents, Balzac dénonce l’impuissance des lois en les confrontant à l’omnipotence de l’argent. En vain Victorin s’obstine-t-il à chercher une solution légale pour remédier à la crise qui menace de disloquer l’union familiale; il ne rencontre que des obstacles infranchissables, résultant, selon une thèse chère à Balzac, des contradictions profondes que révèle dans sa conception même le système législatif. Homme de loi, Victorin doit ainsi contourner la Justice afin d’épargner le déshonneur au clan Hulot. Son acte criminel ne va pas sans une transaction qui permet à l’avocat de se procurer les services illicites de la société secrète gérée par Vautrin.
— Oui, reprit-elle [Madame Saint-Estève], vous voulez que cette madame Marneffe abandonne la proie qu’elle a entre les dents! […] Un jour, dans trois mois, un pauvre prêtre viendra vous demander quarante mille francs pour une œuvre pie, un couvent ruiné dans le Levant, dans le désert ! Si vous êtes content de votre sort, donnez les quarante mille francs au bonhomme!
25Double défaite de la loi donc: faillite de la fonction paternelle, et défaillance de l’appareil judiciaire. N’est-ce pas logique, dès lors que l’écriture en tant qu’expression par excellence de la loi [17] subisse elle aussi, un échec? En effet, quelle que soit la forme qu’elle adopte dans le roman, l’écriture cause presque toujours un préjudice irréparable. Consciente de cette force négative, la méfiante Valérie exige de ses amants la destruction des lettres compromettantes qu’elle leur écrit. C’est au moyen d’une lettre, qu’elle met au point le piège destiné à perdre le baron Hulot. Le baron, quant à lui, laisse sans réponse les dépêches de l’oncle Fischer. Coupable de détournements de fonds, dont l’origine est la passion excessive d’Hector pour les femmes, il préfère le suicide au scandale. C’est ici par défaut que l’écriture conduit à la mort d’un innocent. Le scandale n’échappe pas pour autant à la presse. Dans sa forme journalistique, l’écriture provoque une seconde mort — celle du maréchal qui reçoit «le coup mortel […] par un papier» (CB, 353). Véritable actant romanesque, l’écriture noue des intrigues et résout des conflits: c’est par le billet de Josépha qu’Adeline apprend la déchéance complète de son mari. Du reste, ce dernier finit par devenir écrivain public pour être en mesure de satisfaire ses ardeurs sexuelles.
26L’impact de l’écriture sur le dispositif narratif se concrétise dans la lettre de change par laquelle elle s’articule le plus clairement à la vengeance de Bette. Conséquence directe des machinations ourdies par la vieille fille, les fatales souscriptions d’emprunt persécutent le baron et menacent l’unité familiale. La reconnaissance de dette que Lisbeth arrache à son protégé, et dont elle se servira dans une ultime tentative pour compromettre le mariage d’Hortense, constitue un autre exemple représentatif de l’énergie destructrice que détient en puissance l’incarnation scripturale de l’argent. Aussi pourrait-on suggérer que la vengeance est susceptible de se produire dans la mesure où elle s’associe à l’écriture. De ce point de vue, «le courage d’apprendre à lire, à compter et à écrire» (CB, 81) dont fait preuve la paysanne lorraine, s’intègre de manière cohérente dans la mise en place du système vengeur. C’est aussi la surenchère dont fait l’objet l’écriture à travers la lettre de Valérie, adressée au jeune artiste et achetée à prix d’or par Madame Nourrisson, qui déclenchera la vengeance du Brésilien et mettra fin à celle de Lisbeth.
27Certes, la thèse selon laquelle la cousine Bette prend sa revanche semble séduisante: après tout, Lisbeth ne parvient-elle pas à tromper ses parents, à dissimuler sa haine sous le masque de son contraire, l’amour familial ? Une telle interprétation, cependant, met en cause les principes mêmes qui «réglementent » le fonctionnement de la vengeance. Car c’est incontestablement le dévoilement du vengeur devant l’offenseur qui valorise le succès de ses opérations. Le vengeur, dont le droit de punir n’est pas reconnu par ses victimes, demeure un malfaiteur ordinaire qui cherche moins à se dédommager d’une perte qu’à causer un préjudice à son ennemi et la vengeance prend, dans ce cas, l’allure d’un geste sans autre fondement que sa propre finalité. L’absence de dévoilement permet de dire que la vengeance de Bette n’arrive pas à excéder la phase médiane du projet. Bette meurt, en fait, sans assouvir sa haine qui «s’accrut de toutes ses espérances trompées» (CB, 353). Tout au plus se consolera-t-elle d’avoir préservé intact son secret, d’avoir, au-delà de la mort, égaré ceux qui la pleurent, «la regrettant comme l’ange de la famille» (CB, 448).
28Bette prend le parti de se taire pour ne pas révéler son humiliant échec. Non seulement elle ne réussit pas à réaliser son ambition mais elle est de surcroît réduite au silence. Paradoxalement, l’exécution de la vengeance elle-même contribue à la mort précoce du maréchal. «Cette mort, arrivée quatre jours avant la dernière publication de son mariage, fut pour Lisbeth le coup de foudre qui brûle la moisson engrangée avec la grange. La Lorraine, comme il arrive souvent, avait trop réussi.» (CB, 353)
C’est donc l’excès qui provoque la déviation du cycle vengeur, car Bette «allait trop loin dans sa vengeance» (CB, 375). Sur le plan narratif, il en résulte que l’évolution de l’intrigue, organisée entièrement autour de l’acte vengeur, ne peut plus être alimentée par les actions de son agent principal. Le personnage de la cousine Bette redevient alors marginal, tel qu’il était avant la mise au point de la vengeance. Lisbeth Fischer retrouve la situation de spectatrice impuissante dans laquelle elle était confinée au début du roman.
La vengeance avortée inaugure une nouvelle situation narrative entraînant des changements dans la composition. Il s’opère une redistribution, au sein du récit, des rôles entre les acteurs du «drame» (CB, 186). Le ressort dramatique se déplace tout naturellement du côté des autres personnages. Inutile au développement narratif, Lisbeth peut disparaître jusqu’à son effacement complet. L’absence étonnante du rôle titre au fil de huit chapitres est d’autant plus significative que Bette ne refait surface que pour expirer. D’ailleurs, sa mort est anticipée par un pronostic médical : «elle ne vivra pas longtemps, elle est poitrinaire, je le sais» (CB, 173). La description parcimonieuse de son agonie, résumée en un seul paragraphe où le narrateur refuse même de lui céder la parole, ne vient que confirmer sa parfaite «inutilité» désormais. C’est la conscience de son échec, scellé catégoriquement par la réintégration du père prodigue dans le cercle familial, qui précipite sa fin.
Un dénouement équivoque
29Si la mort de Lisbeth Fischer reste secondaire, c’est que, comme il a été suggéré plus haut, au cœur de la narration romanesque prime le mode de gestion familial, intimement lié aux changements structurels qui atteignent toutes les composantes de la société. L’institution familiale, lieu privilégié du théâtre social balzacien, se trouve contrainte de réorganiser sa structure pour la conformer aux exigences des mœurs nouvelles. Les contingences d’ordre idéologique au même titre que le complot suscitent la crise familiale. «La vengeance de la cousine Bette – affirme André Lorant – n’est pas aussi arbitraire, car son rôle consiste essentiellement à aider le destin de ses victimes et non à inventer leur perte.» [18] Lisbeth ne peut pas prétendre, à l’opposé de Madame Nourrisson – «Voici quarante ans, monsieur que nous remplaçons le Destin» (CB, 387) – altérer le sort de ses parents. Face à la toute-puissance des forces sociales affectant toute conduite particulière, l’action de Bette apparaît très limitée. De toute façon, l’éclatement de l’union familiale, analogue à la désintégration de l’Empire napoléonien, et sa recomposition, conformément au modèle institué par l’Empire de l’argent, se seraient inévitablement produits. «Le plaisir à la fonction réaliste – remarque Françoise Gaillard – trouve peut-être son fondement en ce rabattement de l’Histoire sur les passions humaines qui est la seule façon d’apprivoiser le réel, la seule façon de maîtriser dans, et par, l’imaginaire les processus évolutifs du social.» [19]
30L’univers fictif de La Cousine Bette transpose le réel social à l’échelle réduite de la passion individuelle. Ce sont les faits extra-littéraires qui déterminent les tenants et les aboutissants du récit romanesque et lui confèrent ainsi sa vraisemblance. L’acte vengeur tend à signaler, pour emprunter l’expression de Fredric Jameson, une coupure dans la société française, à la veille de la révolution de 1848 [20]. D’ailleurs, le temps de l’écriture rejoint ici le temps historique: le roman de Balzac situe l’intrigue à l’époque de sa production. La vengeance de Bette et sa défaite sont parallèles à une transformation sociologique: la fin de l’ancien ordre aristocratique et le triomphe de la bourgeoisie. L’acte vengeur perd son caractère individualiste et s’incorpore à l’ensemble des phénomènes sociaux. Il fonctionne comme un alibi de la mimésis réaliste.
31À y regarder de plus près, en effet, on remarque que la haine de la vieille fille répond à un motif illusoire car, l’ayant arrachée à la misère et lui ayant «procuré son indépendance à Paris, où elle vivait à sa guise», la famille Hulot «n’en rougissait jamais» (CB, 83). C’est Bette elle-même qui s’attribue le rôle de victime. L’affront ne subsiste que dans son imagination. À ce titre, en ruinant et en humiliant ses parents les uns après les autres, Lisbeth ne se venge pas de préjudices réellement éprouvés; elle agit en proie à une jalousie nourrie des malheurs dont son apparence extravagante et son statut social l’ont accablée et qui l’ont condamnée à une vie isolée et austère au sein même d’une famille riche. L’offense étant irréelle, l’acte vengeur ne peut qu’avorter. La Cousine Bette démythifie, comme les romans antérieurs de Balzac, l’illusion d’une réussite individuelle en contradiction avec la dynamique des forces sociales. La vengeance de Lisbeth Fischer, concomitante des transformations qui remuent la société française de la première moitié du xixe siècle, se donne à lire comme une « vengeancetype», destinée à faire la synthèse de ces transformations et à en analyser les effets.
32Rien de plus cohérent que cette démonstration du réalisme sociocritique de Balzac. Cependant, mettre l’échec de la vengeance au compte de nouveaux rapports sociaux susceptibles d’expliquer les enjeux sociologiques du dispositif romanesque, reviendrait à dévaloriser le pouvoir narratif de Vautrin et à ramener son rôle à celui de simple exécutant d’une volonté supérieure. Or Vautrin, le personnage le plus romantique et le plus contradictoire de La Comédie Humaine, incarne l’esprit de révolte à qui le pouvoir légal doit s’allier pour se donner l’apparence de le maîtriser. En fait, la récupération spectaculaire de l’ancien forçat par l’appareil judiciaire, loin de mettre fin à son activité secrète, ne fait qu’illustrer l’inefficacité de la loi face à la volonté de subversion. Vautrin adhère au dispositif pénal en même temps qu’il se soustrait à son contrôle. En retrouvant ce personnage et sa situation exceptionnelle, le récit bascule dans le mythique. La position singulière de deus ex machina que Vautrin occupe vis-à-vis du système légal est, toutes proportions gardées, équivalente à celle de Bette à l’égard de la famille Hulot.
33Le registre romantique de La Cousine Bette, l’un des romans les plus réalistes de Balzac, s’impose avec d’autant plus de force à l’analyse qu’il trouve son expression ultime dans le personnage du baron brésilien – le responsable direct de la mise en échec de la vengeance «réaliste». Montès est en effet doté des traits les plus excessifs du héros romantique: exotisme, fortune fabuleuse, force physique exceptionnelle, caractère énigmatique, savoir mystique. La dimension romantique du personnage se fait sentir également dans sa nette opposition à la loi officielle: «Je ne suis pas de ce pays-ci, moi! Je vis dans une capitainerie où je me moque de vos lois…» (CB, 414). Le simple recensement des caractéristiques du héros met en valeur sa parenté avec le comte de Monte-Cristo. Une sorte de synthèse paronomastique crée une fusion entre Monte (Cristo) et (Edmond) Dantès. Le parallèle semble d’autant plus s’imposer que le Brésilien reprend à la lettre les paroles sacramentelles («Je suis bien certain d’être l’envoyé de Dieu» [21]) du surhomme dumasien, se substituant à la Providence pour sceller le sort de ses ennemis: «Je serai l’instrument de la colère divine! » (CB, 423). D’ailleurs, dans Le Père Goriot, Vautrin s’était déjà approprié le «rôle de la Providence» [22]. Le déterminisme social balzacien est donc nuancé par le rôle attribué, dans la tradition romantique, à l’individu exceptionnel, qui peut manipuler les forces sociales.
Si l’impasse à laquelle aboutissent les efforts de Lisbeth répond clairement au credo de La Comédie Humaine, le dénouement même du récit fait ressortir un déplacement par rapport au code mimétique balzacien. Dans La Cousine Bette, la solution du conflit passe par la conjonction provisoire de deux pôles diamétralement opposés: le système des lois sociales et l’acte ultra-romantique de Montès; les extrêmes se touchent en épousant la même cause. Médiateur de cette alliance étrange, le personnage polyvalent de Vautrin permet à Balzac d’accomplir un tour de force magistral en conciliant et en synchronisant les deux registres idéologiques, incompatibles en apparence. Sans compromettre ni la rigueur analytique du roman, ni l’unité de composition des Études de mœurs – et c’est par là même que le génie de Balzac se révèle pleinement –, la vision globale gouvernant l’écriture romanesque est volontiers brouillée. Sous ce rapport, il sera nécessaire d’examiner ailleurs la troublante fusion des régimes réaliste et romantique mis délibérément en œuvre par La Cousine Bette.
Notes
-
[1]
Une œuvre comme Colomba de Mérimée, qui met en scène un héros réticent face à la vengeance rituelle et collective, dont on veut le charger, se situe à l’intersection de ces deux régimes antagonistes et constitue, de ce fait, un texte équivoque, oscillant entre les modes classique et romantique de représentation littéraire. J’ai évoqué cette question dans «Colomba: la vengeance entre le classicisme et le romantisme» (Revue d’Histoire Littéraire de la France, 5, 2000, p. 1311-1336).
-
[2]
De même que Monte-Cristo accomplit son œuvre dans le secret absolu, sans que ses victimes soupçonnent la source des malheurs dont elles sont frappées, la cousine Bette opère une «sape souterraine» (Balzac, La Cousine Bette, Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», vol. VII, 1977, p. 201. Les citations dans le texte renverront désormais à cette édition).
-
[3]
Comme le remarque François Taillandier dans la préface du Comte de Monte-Cristo: «Les camps politiques sont nettement tranchés: Danglars, Villefort, Fernand Mondego, les trois scélérats du roman (Caderousse n’est qu’un misérable), doivent leur réussite à la Restauration, plus précisément à Charles X, plus abhorré encore que Louis XVIII. À l’inverse, l’excellent Morel est bonapartiste; Faria rattache le roman à la cause progressiste de l’indépendance italienne; Haydée au combat philhellène qui enthousiasma l’Europe des années 1820» (Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, Le Livre de poche, t. I, 1995, p. 17).
-
[4]
Voir l’article de Françoise Gaillard: «La Stratégie de l’araignée», Balzac et « Les parents pauvres», études réunies et présentées par Françoise van Rossum-Guyon et Michel van Brederode, SEDES, 1981, p. 179-188.
-
[5]
Bette n’est pas sans savoir l’insuffisance des rapports de cousinage qui déterminent sa position fragile au cœur de la famille Hulot. Ainsi déclarera-t-elle à son ancien protégé et futur mari d’Hortense, qui échappe à sa tutelle: «Je croyais que vous abandonniez votre vieille amie, votre institutrice, tandis qu’au contraire vous allez être mon cousin; désormais vous m’appartiendrez par des liens, faibles, il est vrai, mais qui suffisent aux sentiments que je vous ai voués!…» (CB, 171).
-
[6]
Nicole Mozet, «La Cousine Bette, roman du pouvoir féminin», Balzac et «Les Parents pauvres», ouvr. cité, p. 39.
-
[7]
Balzac dote du même trait le personnage principal de son roman Le Cousin Pons – texte «jumeau de sexe différent» (l’expression est de Balzac) de La Cousine Bette –, qui «achète» sa vie de pique-assiettes en acceptant le rôle de confident: «Pons était d’ailleurs partout une espèce d’égout aux confidences domestiques, il offrait les plus grandes garanties dans sa discrétion connue et nécessaire, car un seul mot hasardé lui aurait fait fermer la porte de dix maisons; son rôle d’écouteur était donc doublé d’une approbation constante; il souriait à tout, il n’accusait, il ne défendait personne; pour lui tout le monde avait raison.» (Le Cousin Pons, Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», vol. VII, 1977, p. 493). La ressemblance est encore plus frappante si l’on compare au passage cité les paroles de Bette adressées à Crevel: « — Ma situation, répondit Bette, m’oblige à tout entendre et à ne rien savoir. Vous pouvez causer avec moi sans crainte, je ne répète jamais un mot de ce qu’on veut bien me confier. Pourquoi voulez-vous que je manque à cette loi de ma conduite? personne n’aurait plus confiance en moi.» (CB, 161)
-
[8]
Balzac, «Avant-propos» de La Comédie humaine, Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», vol. I, 1976, p. 13.
-
[9]
F. Gaillard, loc. cit., p. 184.
-
[10]
De fait, parmi les protagonistes de La Cousine Bette il n’y a guère de véritables aristocrates au sens propre du terme, puisque les Hulot font partie de la noblesse impériale. Il faut tenir compte cependant de la distinction entre les titres nobiliaires mérités par le service dans les institutions de l’Empire napoléonien et ceux acquis par la bourgeoisie. Le seul aristocrate authentique, Wenceslas Steinbock, est un étranger en exil. Voir à ce titre les commentaires de Rivet sur l’influence néfaste des étrangers dans le domaine du commerce (CB, 113).
-
[11]
Michel Butor, Répertoire II, Minuit, 1964, p. 196.
-
[12]
La duchesse de Sierra-Leone est le personnage central de la Vengeance d’une femme, la sixième et dernière nouvelle des Diaboliques de Barbey d’Aurevilly. Elle se venge de son mari, le duc le plus puissant d’Espagne, en se prostituant sous un déguisement et en révélant ensuite sa véritable identité à ses clients. Le but ultime de la vengeance consiste à faire rayonner l’histoire de sa déchéance afin de déshonorer publiquement son époux.
-
[13]
Cette trahison qui libère chez Bette le désir de vengeance plus qu’elle ne l’engendre est importante à maints égards. Wenceslas n’est pas seulement l’objet de son affection, lui permettant de matérialiser à la fois ses instincts maternel et sexuel, mais une «créature» qu’elle s’approprie («Vous m’appartenez! lui dit-elle») pour pouvoir exercer son sens naturel de la domination. «Mademoiselle Fischer prit ainsi sur cette âme un empire absolu. L’amour de la domination resté dans ce cœur de vieille fille, à l’état de germe, se développa rapidement. Elle put satisfaire son orgueil et son besoin d’action.» (CB, 116) Mais, ce qui est plus significatif encore dans le cadre de cette analyse, c’est que l’artiste représente pour Bette une sorte d’amortisseur qui absorbe les accès de la haine viscérale qu’elle cultive secrètement envers ses parents. «Elle se vengeait sur ce jeune homme de ce qu’elle n’était ni jeune, ni riche, ni belle.» (CB, 119) Dépossédé de cette présence «salutaire», Lisbeth donne alors libre cours à son impulsion vengeresse.
-
[14]
Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes, Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», vol. VI, 1977, p. 813.
-
[15]
Nombreux sont les exemples, où le personnage de Vautrin, incarnation mythique du Mal dans l’œuvre de Balzac, est nettement associé à la figure de Satan. Relevons-en quelques-uns, parmi les plus éloquents: «Accompagnées de cheveux rouge-brique et courts qui leur donnaient un épouvantable caractère de force mêlée de ruse, cette tête et cette face, en harmonie avec le buste, furent intelligemment illuminées comme si les feux de l’enfer les eussent éclairées» (Le Père Goriot, Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», vol. III, 1976, p. 217). Dans la lettre qu’il rédige avant de se suicider, Lucien va jusqu’à attribuer une origine satanique au pouvoir que détient Vautrin et qui lui permet de régner sur la vie de ses victimes: «Vous descendez d’Adam par cette ligne en qui le diable a continué de souffler le feu dont la première étincelle avait été jetée sur Ève. Parmi les démons de cette filiation, il s’en trouve, de temps en temps, de terribles, à organisations vastes, qui résument toutes les forces humaines…» (ouvr. cité, vol. VI, p. 789). Aussi Vautrin lui-même exige-t-il de ses complices qu’ils lui obéissent corps et âme, «comme on se donne au diable» (ibid., p. 504), «comme on doit servir le diable» (ibid., p. 587).
-
[16]
Jacques Neefs, «Le Foyer de l’histoire», Balzac et «Les Parents pauvres», ouvr. cité, p. 174.
-
[17]
Voir à ce sujet l’étude de Uri Eisenzweig sur L’Étranger de Camus où le rapport écriture/loi est interrogé sous ses différents aspects et dans ses multiples implications (Les Jeux de l’écriture dans L’Étranger de Camus, Lettres Modernes, 1983).
-
[18]
André Lorant, «Les Parents pauvres» d’Honoré de Balzac. Étude historique et critique, Genève, Librairie Droz, 1967, p. 46.
-
[19]
F. Gaillard, loc. cit., p. 186.
-
[20]
S’inspirant de la lecture de Barbéris, F. Jameson remarque: «J’ai été notamment très frappé par l’observation de Barbéris, dans les Mythologies balzaciennes, qu’il faut voir quelque chose comme une «coupure» dans la production de Balzac vieillissant, une coupure qu’il situe aux alentours de 1844 et qui est caractérisée autant par la disparition de personnages aristocratiques que par l’avènement d’un nouveau monde social qui ne prendra pleinement conscience de lui-même qu’avec la révolution de 1848 et le Second Empire.» (F. Jameson, «Balzac et la question du sujet», Le Roman de Balzac: recherches critiques, méthodes, lectures, études réunies par Roland Le Huenen et Paul Perron, Montréal, Didier, 1980, p. 66)
-
[21]
Le Comte de Monte-Cristo, ouvr. cité, t. II, p. 468.
-
[22]
Le Père Goriot, ouvr. cité, p. 144.