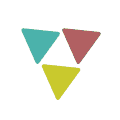1Le mouvement pétitionnaire de 1873-1874 en faveur de la restauration de la monarchie traditionnelle s’inscrit dans un contexte général confus et incertain. Certes, en juillet 1873, le quart nord-est du territoire français était enfin libéré de l’occupation des armées allemandes et, en septembre, l’indemnité de guerre était soldée. Cependant, au traumatisme collectif et durable de la défaite militaire s’ajoutait celui de la Commune de Paris, l’ensemble impressionnant durablement les esprits. La paix revenue, le soulagement ressenti par l’opinion publique demeurait fragile. Il était fâcheusement contrebalancé par le caractère provisoire des institutions du pays qui inquiétait nombre de Français. La croissance ralentie de l’économie française depuis 1860 contribuait à l’entretien de la morosité ambiante en même temps qu’elle déclassait progressivement la France au sein du groupe des puissances industrielles [1]. Si les effets de « la crise brutale qui touch[a] à partir du printemps 1873 l’Allemagne, puis l’Autriche et la Grande-Bretagne » n’affectèrent pas immédiatement l’ensemble de l’économie de la France, cette crise se révéla toutefois par des signes avant-coureurs de type sectoriel. Ainsi, les exportations françaises connurent « dès cette époque, une nette dégradation » [2]. Nous verrons que l’atonie du commerce apparaît comme le premier et récurrent argument dans la rhétorique des pétitionnaires.
2En octobre 1873, la publicité autour de la préparation d’une restauration, annoncée comme imminente et certaine, avait ravivé et augmenté les tensions politiques. La surprise fut de taille lorsque la lettre de Salzbourg du 27 octobre, publiée dans le quotidien légitimiste L’Union et qui affirmait l’attachement du comte de Chambord au drapeau blanc, déchira brutalement l’image d’une union monarchique recouvrée en levant toute ambiguïté sur les intentions du prince en exil, en même temps qu’elle hypothéquait sérieusement les chances de son retour sur le trône de France. Cet événement suscita des réactions notamment dans le camp républicain qui vit dans ce refus du prince d’accepter les termes de la modernité post-révolutionnaire proposés par une droite « fusionniste » improbable un ressort inespéré pour anéantir toute entreprise de restauration. La riposte royaliste ne se fit pas attendre. Alors que la session parlementaire s’ouvrait le 5 novembre 1873 par la discussion du projet de loi sur la prorogation des pouvoirs de Mac-Mahon, le peuple royaliste faisait irruption dans l’espace politique. « On veut le Roi ! » [3] Ainsi, il appelait de ses vœux pressants la restauration du comte de Chambord, Henri V, au moyen du pétitionnement qui fut érigé, d’abord de manière empirique, en tactique politique au service d’une stratégie de changement de régime.
La pétition : une pratique ancienne, entre mode d’expression et mode d’action [4]
3« La pétition ne se laisse pas définir aisément. » [5] La pétition est cependant un moyen d’expression politique et une pratique anciens [6], souvent de type individuel, mais qui entre aussi dans les « répertoires de l’action collective » [7]. Très schématiquement et très sommairement, elle part de la base de la société (le peuple) vers le sommet (la puissance souve- raine) soit pour en obtenir justice, soit dans l’intention de lui imposer une réforme [8]. « L’histoire de la pétition est celle d’une oscillation permanente entre deux pôles. D’un côté, elle fut longtemps une “supplique” humblement adressée au roi par le citoyen pour obtenir réparation de ce qu’il considérait comme une faute de la puissance publique. D’un autre côté, elle devint, dans les moments de crise politique, un instrument utilisé collectivement par des groupes pour faire adopter de nouvelles lois, voire même pour faire modifier la constitution. » [9] Il est arrivé que les deux aspects soulignés ici par le juriste Pierre Magnette fussent entremêlés, comme dans le cas des quelque 17 millions de Soviétiques déplacés vers l’est entre l’été 1941 et la fin de 1942. Dès 1945, mécontents d’être empêchés de rentrer chez eux par les autorités soviétiques, ils réagirent notamment en leur adressant des pétitions. Nicolas Werth montre que derrière ces pétitions, outre le retour dans leurs régions d’origine, de grandes espérances agitaient les anciens combattants (suppression des kolkhozes, davantage de liberté d’expression, abolition des lois de 1940-1941 criminalisant les relations de travail) et prolongeaient cette demande initiale de justice [10]. Chaque groupe social (paysans, intellectuels, ouvriers) avait ses attentes propres. De même, nous verrons que la restauration de la monarchie royale demandée par les pétitionnaires de 1873-1874 portait en filigrane des revendications pratiques liées à leur quotidien (fixation du régime politique, conservation de la religion catholique, retour de la paix et de la prospérité), mais dans une approche d’un roi thaumaturge à l’égard d’un corps social réputé malade. Le « caractère surnaturel longtemps attribué à la puissance royale », cette « royauté mystique » [11], transpire de nombre de pétitions de 1873-1874. Au-delà de la restauration d’un régime monarchique, elles appelaient au retour de la royauté historique et de son « Roi légitime » [12].
4En outre, si ce mouvement pétitionnaire s’inscrit aux confins de deux voies, de deux champs d’application de la pétition : recours juridique et moyen de mobilisation politique, le premier fut ici le simple outil du second. Les pétitions furent l’expression collective d’espérances ou de vœux individuels, concrétisant enfin « l’idée de s’ériger en acteur collectif » [13]. L’utilisation de ce mode d’action politique pourrait s’apparenter à une expression de la démocratie directe au regard des mécanismes classiques de la délégation politique des pouvoirs. Si nous retenons l’hypothèse d’une autonomie relative des pétitionnaires dans leur démarche, il semble qu’ils aient individualisé et personnalisé leur action, à la fois comme pour mieux en marquer la légitimité et affirmer ou rendre visible leur opinion politique. Curieusement, à travers leur demande, des royalistes, jusque-là individus anonymes et passifs, se montraient en quelque sorte des « citoyens critiques » [14] et actifs, y compris pour les « crucisignataires », à l’égard d’institutions non conformes à leurs vœux.
5Par ailleurs, la pratique pétitionnaire peut répondre à des formes et des dénominations diverses selon l’époque, le lieu et la source [15]. Ce n’est pas non plus une pratique limitée à l’espace géographique français [16]. La pétition peut aussi être l’expression d’ensembles socioculturels variés plus ou moins explicitement engagés à défendre un intérêt réputé général ou le « bien commun » [17]. Elle répond souvent à des revendications que nous appellerons catégorielles [18]. Pour le xixe siècle, nous y trouvons aussi bien un « parti » politique [19] qu’un groupe sexué [20], ou encore une population spécifique autoconstruite à la faveur d’une conjoncture, comme dans le cas des jeunes hommes qui contractèrent des « alliances incongrues » pour échapper à la conscription, et notamment aux levées terribles des années 1809 et 1813 [21]. Les signataires de 1873-1874 appartenaient à un groupe distinct assez clairement identifiable malgré une complexité sociologique interne [22] : celui des royalistes. Ces pétitionnaires du xixe siècle avaient en commun la capacité d’user désormais d’un droit de type constitutionnel ou fondamental, et de s’en servir comme d’un outil tactique [23].
6Effectivement, le droit de pétition avait d’abord été inséré par les constituants dans le « Règlement à l’usage de l’Assemblée nationale », le 29 juillet 1789 [24]. Il avait ensuite été inscrit dans l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, laquelle fut ensuite placée en préambule de la Constitution du 3 septembre 1791. « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. » [25] « L’histoire politique de l’Assemblée constituante permet de constater l’irruption, puis l’évolution du pétitionnement sur la scène politique nationale », souligne Yann-Arzel Marc. Le pétitionnement « devient un véritable acteur de la Révolution » [26]. De même en 1873-1874, où il s’affirme comme un acteur de la crise politique et institutionnelle. Le marbre constitutionnel moderne était désormais gravé du principe pétitionnaire, lequel subirait rapidement « plusieurs restrictions » [27] au gré de la conjoncture. Le débat législatif du printemps 1791 l’associa pleinement au principe de la liberté d’expression, le faisant balancer entre « un droit public et un droit politique » [28]. Aujourd’hui, les constitutionnalistes sont encore partagés entre ceux qui y voient un appel à la justice de la puissance publique, et ceux qui la considèrent comme un moyen populaire d’influer sur la politique du Gouvernement ou de faire modifier la loi. Cette problématique de dualité politique est historique ; elle est ancrée dans les premiers temps de la Révolution [29].
7Le droit de pétitionner évolua sous les différents régimes successifs de la France. La question de sa nature de « droit politique » qu’il portait intrinsèquement effraya parfois des parlementaires. Sous la Restauration [30], à propos de la loi sur les élections, Jacques Mestadier – défenseur constant des prérogatives royales – s’alarma, lors de la séance du 14 janvier 1820 à la Chambre des députés, du danger des pétitions adressées « contre l’initiative du Roi consacrée par la Charte » [31]. Il les dénonçait comme n’étant « autre chose que des professions de foi politiques », en somme des menaces pour l’ordre social. Non sans effroi, le député de la Creuse avait vraisemblablement à l’esprit les paroles de Le Chapelier à propos du « droit de pétition, cette espèce d’initiative du citoyen pour la loi et les institutions sociales » [32]. Sous la monarchie de Juillet [33], le fait pétitionnaire s’exprima également et pleinement à la faveur des circonstances politiques, tantôt pour réclamer une réforme électorale, tantôt afin d’obtenir une modification constitutionnelle ou encore pour demander la mise en accusation d’un ministre. La pétition entrait alors dans la composition des « répertoires de l’action collective » des groupes contestataires, comme action légale et expression d’une démocratie participative – une forme de participation directe dans l’esprit du projet de loi de Condorcet [34]. Il s’agit parfois, pour une opposition parlementaire, d’influer sur le vote à venir d’un projet de loi en vue de le retoquer. Le vaste mouvement pétitionnaire de mai 1850 illustre parfaitement ce cas de figure. Après des victoires républicaines aux élections partielles de mars-avril 1850, la réaction conservatrice fut immédiate. Une « nouvelle loi électorale » [35] fut élaborée et adoptée le 31 mai 1850. Elle privait du droit de vote près de trois millions d’électeurs. Si « tout le jeu politique fut changé » [36], si elle marqua l’évolution conservatrice du régime, le mouvement pétitionnaire qui tenta de la contrarier « en seulement trois semaines » n’en fut pas moins impressionnant sur un plan quantitatif : « environ 500 000 signa- tures sur plus de 70 000 pétitions collectées sur l’ensemble du pays » [37]. Celui de 1873-1874 n’atteindrait pas ces sommets.
8Enfin, le pétitionnement est avant tout un acte militant qui engage le signataire [38] et l’expose presque autant que l’initiateur de la pétition – s’ils sont différents – à l’appréciation publique. Pétitionner, c’est en quelque sorte sortir de l’anonymat par un acte individuel qui s’inscrit dans une démarche collective. C’est aussi un élément actif de l’expression politique qui pallie l’absence de droits politiques positifs : ainsi, des femmes dépourvues du droit de vote pétitionnèrent en 1873-1874. La pétition est à la fois un mode d’expression et un mode d’action, qui prend toute sa valeur par le nombre des signataires, leur qualité et leur poids dans la société (à différentes échelles) et la conscience personnelle de leur engagement (la liberté du signataire face à la pression du groupe). Nous pouvons alors nous interroger sur la force des « croix » apposées par ceux qui ne savaient pas écrire – et par effet de la validité de leur « signature ». La « crucisignature », quand elle n’est accompagnée d’aucune mention, reste la marque politique de la minor pars du peuple muet qui ne cesse d’interpeller l’historien.
9Nous proposons ici une première approche de ce mouvement pétitionnaire de 1873-1874, circonscrite à la France métropolitaine. Nous avons tenté de donner une photographie d’un légitimisme populaire en action, à un moment réputé décisif de son histoire, ainsi qu’une analyse des thèmes de son discours. Cette photographie révèle l’interclassisme de la société royaliste en même temps qu’elle montre une nouvelle irruption du pays légal royaliste dans le combat politique [39].
À l’origine du mouvement pétitionnaire de 1873-1874
10Au début de l’automne 1873, l’idée d’une irruption du peuple monarchiste sur la scène politique se lisait dans les colonnes de L’Assemblée nationale de 1872. « Enfin, nous dirons que l’opinion publique des conservateurs a également ses devoirs à remplir ; il ne faut pas plus d’indécis et de tièdes hors de l’Assemblée que dans l’Assemblée ; tout citoyen qui croit le maintien de la république funeste aux intérêts généraux et privés du pays ; qui regarde la monarchie comme étant la seule institution capable de nous éviter le retour de terribles catastrophes, tous ces citoyens doivent, dans toutes les occasions, affirmer leurs convictions, donner leur appui moral, et au besoin, matériel, à la représentation nationale et à son gouvernement. » [40]
11La France légitimiste avait-elle l’ambition de faire entendre sa voix et d’influer sur les tractations parlementaires ? Il semblerait. Le déclenchement du mouvement pétitionnaire fut-il pour autant une initiative des rédactions royalistes prises comme leaders d’opinion ? L’idée du pétitionnement populaire comme moyen d’action politique fut-elle lancée par cette même presse ? Existait-il enfin une unité stratégique au sein de la presse légitimiste ?
12Quelques jours plus tard, Alexandre de Saint-Chéron, le président du comité de rédaction de L’Assemblée nationale de 1872, n’alla pas jusqu’à appeler les royalistes à pétitionner pour que la restauration monarchique se fît, car il récusait ce procédé qu’il jugeait subversif et révolutionnaire [41]. Néanmoins, l’amplitude du mouvement pétitionnaire qui naquit le mois suivant le fit changer d’opinion : « La question de la monarchie posera et s’imposera avec une impérieuse nécessité. Tel est le motif [sic ! ?] qui nous décide à donner notre concours au pétitionnement en faveur de la royauté […]. » [42] Le même constatait avec surprise dans son éditorial du samedi 15 novembre 1873 : « Le mouvement des pétitions, pour le rétablissement de la monarchie, prend des proportions inattendues. » [43] Ce mouvement semble avoir surpris la presse royaliste qui, en dehors de L’Assemblée nationale de 1872, ne paraît pas avoir eu d’idées préconçues sur ce type d’action, ni vraiment et clairement appelé le peuple royaliste à entrer dans l’espace politique avant la diffusion de la lettre de Salzbourg. « Il y a un mouvement royaliste, et ce mouvement grandit chaque jour. Il faut le faire savoir, il faut y aider » [44], lançait sur le ton de l’urgence Adrien de Riancey dans La France nouvelle du 10-11 novembre. Le 8 novembre précédent paraissait dans ses colonnes la première information traitant des pétitions, à propos de celle que 60 industriels et commerçants parisiens venaient d’adresser au général Changarnier en faveur de la restauration monarchique. Dans son numéro du 6 novembre, L’Union s’en était fait la première l’écho. « Nous apprenons qu’une lettre à M. le général Changarnier, président de la commission des Neuf, et demandant la restauration de la monarchie au nom des intérêts du commerce parisien, se couvre en ce moment de signatures. » [45] La presse légitimiste était soudain comme aspirée par un mouvement ascendant qu’elle n’avait pas créé.
13Le mouvement de 1873-1874 paraît être né des rodomontades du représentant de la Seine [46], siégeant au centre gauche, Jean-Baptiste Drouin qui se targuait de représenter le commerce de la capitale et venait d’affirmer qu’après une étude approfondie, il avait pu se convaincre que le commerce parisien tenait la restauration monarchique pour une calamité. Dans une lettre de réaction en date du 30 octobre 1873, 40 commerçants et industriels de Paris lui avaient répondu qu’il avait « été induit en erreur ». « Vous pouvez vous en assurer en prenant connaissance d’une pétition demandant le rétablissement de la monarchie, couverte de plusieurs milliers de signatures appartenant au commerce et à l’industrie parisienne, et que nous avons déposée entre les mains de votre collègue, M. le marquis de Plœuc, nommé en même temps que vous et par les mêmes électeurs. » [47] Le mouvement pétitionnaire trouve ainsi son origine dans les milieux du commerce, de la petite industrie et de l’artisanat de Paris, et dont la mécanique des réseaux dans les provinces fut aussitôt mise en action. Une partie de la presse royaliste relaya bientôt l’événement. En outre, le mouvement bénéficia de l’exemple des républicains qui s’effrayaient assez d’une prochaine restauration monarchique pour envoyer à l’Assemblée des adresses réclamant l’établissement de la République [48]. Le comte de Chambord n’ignorait pas leur démarche [49].
14Une minorité de feuilles s’abstint de donner dans ses colonnes toute information concernant le mouvement, laissant apparaître des divergences au sein du courant légitimiste et une polémique quant à la tactique à adopter pour favoriser la restauration. La Gazette de France semble être restée muette sur le sujet des pétitions monarchiques. La Décentralisation de Lyon et La Gazette du Languedoc, entre autres, n’adhéraient pas à la stratégie majoritaire et se taisaient aussi. Cette position fut dénoncée par L’Union sous la plume cinglante d’Adrien Maggiolo : « La France royaliste a compris que le silence serait une défection. » [50] Une polémique naquit à propos d’un sous-entendu de Maggiolo sur l’alignement de journaux sur la position de La Décentralisation [51]. L’un d’eux, L’Indépendance bretonne, y réagit vivement dès le surlendemain sous la forme d’une mise au point sans ménagement. « Nous n’avons pas l’habitude de nous abriter derrière nos confrères de Paris ou de province. […] Nous avons refusé de nous associer au pétitionnement parce que nous savons fort bien que le mouvement pétitionniste est généralement désapprouvé par les députés royalistes, comme étant inopportun et s’écartant du domaine politique possible. » [52] Si l’éditorialiste Louis d’Étampes lançait un « Vive le Roi ! », son quotidien tenait une ligne prudemment « septennaliste » depuis la publication de la lettre de Salzbourg. La rupture était consommée entre les « septennalistes », qui envisageaient la restauration de la monarchie après une phase préparatoire mac-mahonienne admise, et les légitimistes intransigeants – ou « unionistes » – qui espéraient qu’un événement ramènerait le comte de Chambord au plus tôt. Leur adhésion au mouvement pétitionnaire s’inscrivait dans cette idée quasi providentialiste.
Méthodologie et aspects généraux du « pétitionnement royaliste » [53]
15L’Union et la presse « unioniste » des provinces reproduisaient presque dans chacune de leurs éditions une liste de pétitions adressées par des Français aux membres de l’Assemblée nationale [54], demandant le rétablissement de la monarchie traditionnelle. Elles étaient principalement écrites à l’attention des représentants de la circonscription de résidence des signataires [55]. Les commettants usaient parfois d’intermédiaires symboliques et historiques, appréciés pour leurs qualités éminemment monarchiques et leur rôle actif dans le processus de restauration, à l’image du général Changarnier [56]. Les suppliques développaient des thèmes devenus classiques autour des vertus attribuées à la monarchie traditionnelle : le salut de la France [57], la justice sociale, la paix et la clôture de l’ère révolutionnaire, la prospérité des activités industrielles [58], le prestige de la France. La démarche pétitionnaire en faveur de la restauration du roi Henri V n’était pas une innovation en 1873-1874. Déjà en 1871, après que les élections législatives eurent constitué une majorité monarchiste, quelques pétitions étaient parvenues à l’Assemblée nationale, comme pour légitimer le vote du 8 février [59]. Au cours de l’année 1872, d’autres pétitions avaient été envoyées sur le même thème [60], de manière sporadique, a priori sans rapport avec l’actualité législative et politique prioritaire du moment – dont l’omniprésente question de la dissolution de l’Assemblée.
16A contrario, pour la période 1873-1874, les pétitions furent nombreuses [61], marquées du sceau de la tactique politique et concentrées sur une période relativement brève. L’écrasante majorité de ces pétitions portait un vœu collectif, de quelques personnes à plusieurs centaines. Elles étaient généralement déposées par le représentant de la circonscription, qu’il siégeât sur les bancs de la droite ou sur ceux de l’extrême droite, ou, à défaut, par un élu légitimiste d’un autre département [62]. Nous avons opéré le dépouillement systématique des rôles de l’année 1873 à partir du 1re janvier, afin de repérer si une ou plusieurs séries de pétitions en faveur de la restauration avaient été enregistrées par le bureau de l’Assemblée nationale. Une telle constatation faite sur les trois premiers trimestres nous aurait conduit à supposer une mise en condition préalable des parlementaires par l’opinion royaliste. Il n’en fut rien, mis à part quatre pétitions individuelles [63]. L’absence de série au cours de la période considérée renforce notre hypothèse de départ : le mouvement pétitionnaire fit irruption dans l’espace politique à la suite de la lettre des industriels et commerçants parisiens contre les assertions du représentant Drouin et comme contrecoup de la lettre de Salzbourg du 27 octobre adressée à Charles Chesnelong dans laquelle le prince refusait de « devenir le Roi légitime de la Révolution » [64]. Ce dernier avatar du laborieux processus de restauration monarchique conduisit le peuple royaliste à construire de manière empirique sa tactique politique, afin de pénétrer et de peser dans le débat constitutionnel, même au-delà des votes des 19 et 20 novembre. La presse « unioniste » l’y poussait [65].
17Dès lors, un premier bornage chronologique du champ d’investigation se précisait autour de la Toussaint 1873 qui marquait le départ du mouvement pétitionnaire. Nous avons par ailleurs rapidement conclu que prendre en compte la date figurant sur la pétition nous exposait, pour certaines, à l’absence de date, et pour la plupart, à un décalage et à des approximations diachroniques. Nous avons considéré qu’elles prenaient effet lorsque l’administration parlementaire les enregistrait officiellement sans présupposer de leur sort [66]. Répétons que les pétitions données dans la presse et que nous n’avons pas retrouvées aux Archives nationales n’ont eu pour nous qu’une valeur indicative quant à leur contenu. Nous les avons exclues de notre corpus documentaire de traitement statistique, faute de pouvoir les utiliser systématiquement de manière satisfaisante (absence ou irrégularité des données sociologiques ou spatio-temporelles).
18Le premier dossier de pétition – de type collectif – arriva de Quintin (Côtes-du-Nord) et fut enregistré le 10 novembre 1873 [67]. C’est notre date post quem. Dans son Journal, le comte de Chambord notait à la date du « 11 novembre. Mardi » : « De nombreuses pétitions se signent à Paris dans le haut commerce et dans les départements pour demander à la Chambre de proclamer sur le champ la monarchie légitime », et d’ajouter avec une lucidité empreinte d’amertume : « mais les députés n’y font aucune attention, les centres parce qu’ils n’en veulent pas et la droite parce qu’elle est tout à fait découragée et mécontente de l’insuccès de ses négociations » [68].?Le comte de Chambord semble avoir eu connaissance du mouvement pétitionnaire qui, à cette date, n’a pas encore de visibilité à Versailles, la première vague importante n’atteindrait les bureaux de l’Assemblée que deux semaines plus tard. La « spontanéité » du peuple royaliste et son irruption dans l’espace politique n’étaient pas du goût des parlementaires monarchistes qui n’entendaient probablement pas se laisser voler l’initiative ou se faire forcer la main sur le sujet délicat de la restauration monarchique [69].
19Le dernier dossier de pétition – collective – que nous avons retenu fut inscrit au rôle le 17 décembre 1874, en provenance du département de la Mayenne [70]. C’est notre date ante quem. Jusqu’au vote de l’amendement Wallon du 30 janvier 1875 qui établirait la République et ruinerait les espérances royalistes, les rôles ne portent aucun dossier de pétition réclamant la restauration monarchique. Entre août 1874 et janvier 1875, la rareté des pétitions et les écarts diachroniques très importants entre celles-ci nous conduisent à constater l’extinction progressive mais prononcée du mouvement, lequel avait du reste connu un premier effacement en avril 1874 (aucune pétition enregistrée). La reprise pétitionnaire au mois de mai ne s’était nullement confirmée en juin et en juillet, quand bien même des adresses étaient ensuite parvenues sporadiquement au bureau [71]. Aussi, l’échantillon d’analyse porte sur une période d’environ quatorze mois, établissant une première estimation de travail de 274 dossiers de pétitions. Se posait aussi à nous la question de la valeur des documents dans la durée. S’inscrivaient-ils dans la permanence d’une requête uniforme et absolue ? Ou leur contenu a-t-il subi des variations à la mesure des débats politiques et des décisions parlementaires ? L’origine des pétitions (43 départements) appelait un essai de représentation cartographique [72], nous dévoilant des pôles régionaux traditionnels et forts de l’expression légitimiste : le Midi languedocien, le Nord et l’Ouest armoricain et vendéen.
20Notre corpus s’est ainsi constitué au rythme du dépouillement des archives parlementaires, jusqu’à épuisement significatif du nombre des pétitions. Nous nous sommes également heurtés à l’écart entre les sources pour un même objet. De la Toussaint 1873 au début de l’hiver 1874, le dépouillement des rôles d’enregistrement nous a donné 274 dossiers de pétitions – dont 15 individuels, quand le recensement des dossiers eux-mêmes nous en fournissait 261 – dont 13 individuels. Encore devons-nous préciser que quatre dossiers de pétitions tirés des cartons ne figurent pas au nombre de ceux qui sont émargés dans les rôles. Des dossiers ont dû être égarés, de même que nous n’avons pas trouvé des pétitions publiées dans la presse royaliste. Un choix heuristique s’imposait. Pour établir une tendance générale du phénomène, nous avons décidé de travailler sur le comptage des rôles, en ajoutant les dossiers isolés non émargés, soit un total de 278 dossiers de pétitions [73]. Concernant le comptage des signatures, seuls les 261 dossiers furent bien sûr exploités. En outre, si nous étions d’abord partis sur la base de pétitionnements collectifs, nous avons fini par inclure les quelques pétitions individuelles, selon le constat qu’elles s’inscrivaient pleinement dans le mouvement revendicatif engagé.
21Enfin, quelle fut l’ampleur du mouvement royaliste de 1873-1874 ? Ou, plus simplement, combien de noms ou de signatures de pétitionnaires se trouvent dans ces 261 dossiers ? Ce comptage résulte d’un travail long et méthodique, que la qualité des sources a parfois rendu délicat. Nous avons compté 55 898 pétitionnaires, avec un double travail de vérification qui a réduit notre marge d’erreur à ± 0,3 %. Il nous a été difficile, voire impossible de discerner les doubles ou triples signatures pour en donner ici une estimation sérieuse. Quoique, en petit nombre, elles existent. Les « crucisignataires » représentent autour de 1 % des signataires, essentiellement dans l’Ouest, où le mouvement fut particulièrement dynamique [74].
22Cette mobilisation du peuple royaliste fut aussi le fruit d’investissements. Le « parti légitimiste » – qu’il convient de distinguer du prince [75] – mit en effet en jeu des moyens financiers qui permirent la production d’un matériel pétitionnaire élémentaire sous la forme d’imprimés types prêts à être diffusés massivement, pour être remplis et signés par les populations [76]. Cette mobilisation fut enfin confrontée à la procédure de légalisation des pétitions par les autorités légales, dont le défaut pouvait alors mettre en péril les efforts accomplis.
Deux points techniques : les modèles de pétition et la légalisation des signatures
23Dans le département du Morbihan, le modèle le plus répandu – selon nos sources – de texte qui circulait était construit ainsi : « À Messieurs les Députés du Morbihan à l’Assemblée nationale [77]. Messieurs les Députés, [l]es soussignés, convaincus que la Monarchie héréditaire et traditionnelle peut seule conjurer les périls de la situation et mettre un terme aux souffrances du commerce, de l’agriculture et de l’industrie ; [q]ue cette solution est non seulement la plus désirable pour tous, mais encore la plus simple et la plus facile à réaliser au milieu des complications actuelles, [v]ous demandent de rétablir, dans le plus bref délai, la Royauté en la personne de Henri V, héritier légitime de la Couronne de France. » [78]
24Dans le Nord, un autre imprimé type circulait sous la forme d’un « supplément à LA VRAIE FRANCE du 16 Novembre 1873 ». Le quotidien régional henriquinquiste de Lille mit tout son poids dans la campagne pétitionnaire au même titre que Le Courrier douaisien. « Prière aux vrais Conservateurs de signer cette pétition et de la renvoyer immédiatement dans nos bureaux[.] Lille, le 15 novembre 1873. Pétition à l’Assemblée nationale[.] Messieurs les Députés, [l]es soussignés, convaincus que les intérêts industriels et commerciaux de notre pays souffrent, et souffriront de plus en plus du maintien du provisoire, sous quelque forme qu’on tente de le prolonger, ont l’honneur de vous solliciter de vouloir bien user de toute votre influence pour le rétablissement immédiat de la Monarchie. » [79]
25Citons aussi un autre texte type parmi les modèles qui furent imprimés dans le département du Gard, un des foyers régionaux traditionnels de l’expression légitimiste. « Messieurs les Députés, [l]es Royalistes d…, s’unissent aux Royalistes du département du Gard, pour vous demander de proclamer la Monarchie et d’appeler notre Roi légitime Henri V. Agréez, Messieurs les Députés, l’hommage de notre plus respectueux dévouement. » [80]
26Deux sur trois réclamaient le retour du roi légitime (le comte de Chambord) quand le troisième demandait que la monarchie fût proclamée. La nuance est certes mince et subtile. Si, pour les Nordistes, la restauration monarchique sous-entendait que le chef de la maison de Bourbon recouvrât son trône, la personne du roi demeurait claire- ment au centre des préoccupations bretonnes et languedociennes. L’attachement à la personne du roi semble l’emporter sur le sentiment forcément plus diffus du régime, fût-il la royauté. De là à parler d’un véritable culte voué au comte de Chambord, d’une religion royale, il n’y a qu’un pas que de longue date certains avaient franchi passionnément [81]. Nous en trouvons l’expression en filigrane dans ces pétitions populaires. Pourtant, il nous semble que le comte de Chambord n’encourageait pas une telle dévotion royale. N’écrivait-il pas, en octobre 1873 : « Ma personne n’est rien ; mon principe est tout » [82] ? Son charisme personnel et les efforts de la propagande royaliste depuis un demi-siècle comptèrent probablement pour beaucoup dans la formation de cette situation. Le roi du petit peuple [83], le roi de tous les Français [84], ainsi qu’il le revendiquait, recevait à travers ce mouvement pétitionnaire l’hommage royaliste d’une France populaire.
27Si la production imprimée de modèles au texte réclamatif stéréotypé révéla les moyens mis en œuvre par le parti légitimiste, il reste un point que nous voulons souligner : la légalisation des signatures. Point de détail technique et juridique sans doute, mais qui revêtit une importance certaine dans le cadre des questions et des débats parlementaires. Il existait en effet un règlement touchant aux pétitions adressées à l’Assemblée nationale qui fut modifié par une décision de la Chambre le 3 juillet 1873, et que nous ne pouvons développer ici. Notons simplement que la nouvelle mouture de son article 90 encadrait plus strictement leur traitement : la légalisation (apposition du visa d’une autorité administrative) [85].
28Dans leur grande majorité [86], les signatures des pétitions légitimistes ne furent pas légalisées par l’autorité administrative de base ; à savoir le maire de la commune ou, à défaut, un adjoint. Dans quelques cas, des particuliers s’y substituèrent naïvement, sans effet [87]. Outre le fait, au demeurant classique, que la valeur des signatures pouvait être contestée au regard d’une toujours possible production intentionnelle de faux (selon divers procédés) afin de gonfler le volume pétitionnaire, les pétitions aux signatures non légalisées étaient enregistrées au bureau de l’Assemblée nationale sans qu’il fût possible d’y donner suite. Elles n’étaient légalement pas recevables. La conséquence politique immédiate pour la cause royaliste était grave dans la mesure où les efforts des députés et des journaux des départements échouaient lamentablement à porter massivement – et de manière efficace – le courant pétitionnaire jusqu’à son but : faire proclamer la restauration de la monarchie traditionnelle par l’Assemblée nationale au bénéfice d’une majorité de droite monarchiste. L’ignorance de nombreux maires semble avoir été contre-productive, comme ce fut le cas pour Amédée de Boissieu (maire de Varambon, Ain) ou pour un sieur Lasnier (maire de Campénéac, Morbihan) qui figurent parmi les pétitionnaires, mais ne légalisèrent pas leur pétition [88] !
29A contrario, nous avons trouvé, noyées dans des liasses épaisses de pétitions aux signatures non légalisées, des adresses dûment visées par des autorités officielles comme à Bondues (Nord), mais que les employés du bureau de l’Assemblée nationale ont rejetées, peut-être faute d’avoir correctement inventorié les dossiers [89]. Résultat d’une négligence ? Volonté manifeste d’atténuer le mouvement pétitionnaire légitimiste ? C’est cette dernière hypothèse qui paraît l’emporter lorsque nous regardons la pétition de la commune de L’Ile d’Arz (Morbihan), dûment légalisée par son maire, tandis que le dossier porte la mention manuscrite du président de la 23e commission : « Il n’y a lieu à examen, faute de légalisation. » [90] Du côté des chefs royalistes, la précipitation qui pourrait expliquer cette erreur pratique ressort de certains témoignages. « N’ayant pas eu le temps de faire signer la campagne, qui toute désire le rétablissement de la Royauté Légitime dans la personne du Roi Henri V, ces quelques signatures des plus notables expriment les vœux de toute la population. » [91] Face à cette offensive de l’opinion monarchiste, bonapartistes [92] et surtout républicains s’engagèrent aussi plus avant sur le terrain pétitionnaire qu’ils avaient déjà investi.
Le contre-feu républicain
30Les pourparlers au sein de l’Assemblée en vue de la restauration monarchique, puis les pétitions monarchiques elles-mêmes ne furent pas sans susciter des réactions immédiates, notamment dans le camp républicain. « […] Considérant qu’une fraction de citoyens a l’intention de restaurer par un vote de l’Assemblée nationale, une royauté renversée par la révolution de 1789 et celle de 1830. Les électeurs soussignés en nommant leurs députés n’ont pas voulu leur donner la mission de restaurer n’importe quelle royauté : Ils veulent le maintien de la République. En conséquence, Monsieur le Président, les soussignés viennent protester contre toute restauration qui sera faite sans la volonté du peuple. » [93] La prose républicaine suivait une construction et une phraséologie juridiques à base d’articles successifs (un par proposition) introduits par de pompeux mais classiques « considérant que » [94]. S’agissait-il d’impressionner davantage les députés ?, de donner plus de poids à l’argumentaire ? Nous pouvons imaginer que la pétition échappait alors à une partie des signataires dans l’impossibilité de saisir le propos, voire incapable de le lire. Le message, généralement fort court, était soumis aux lois de l’oralité et de la confiance dans la communauté et ses leaders. De son côté, la prose légitimiste usa volontiers et à l’envi de la formule « convaincus que » [95]. Face à la référence républicaine à la mécanique quasi superhumaine de la loi, les royalistes mettaient en exergue à leur vœu de restauration la conviction de la foi. Certes, le comte de Chambord évoqua à plusieurs reprises dans ses manifestes aux Français ses considérations pour la loi [96], mais selon une philosophie de la transcendance fortement imprégnée de culture chrétienne, d’héritages coutumiers et du temps long de l’articulation des possibles.
31Les pétitions républicaines n’avaient rien de révolutionnaire au sens où les sectateurs de Louis Blanc, Malon, Varlin et autres envisageaient la transformation radicale de la société [97]. Des éléments de la petite bourgeoisie, des notables et des patrons de l’Isère exprimèrent dans les pétitions leur choix d’une république conservatrice et, au demeurant, chrétienne. « Commerçants, industriels, ouvriers, agriculteurs, nous sommes tous intéressés à ce que notre pays soit calme et tranquille. La République seule peut nous donner l’ordre et la liberté […]. Nous avons la ferme croyance qu’elle nous redonnera le calme et la prospérité […]. [La] voix du Peuple est la voix de Dieu. » [98] Revendiquer la paix sociale, la tranquillité de vie et la stabilité des institutions comme des facteurs favorables aux affaires économiques, voilà une antienne également partagée par les deux camps ; ce qui leur retire du coup toute validité argumentaire originale. Des habitants du Morbihan ne disaient pas autre chose. « Les soussignés, convaincus que la Monarchie héréditaire et traditionnelle peut seule conjurer les périls de la situation et mettre un terme aux souffrances du commerce, de l’agriculture et de l’industrie […]. » [99] De même, les quelque 700 pétitionnaires montpelliérains qui réclamaient Henri V pour garantir la prospérité de leurs affaires et assurer le « Salut de la France » [100].
32Ces vœux communs – aux deux sens du terme – aux royalistes et aux républicains traduisent bel et bien les soucis matériels et les réalités quotidiennes qui durent compter pour quelque chose dans cet élan pétitionnaire des populations royalistes. Sinon, comment comprendre cet appel au retour du roi des propriétaires et des agriculteurs de l’Hérault [101] inquiets de la conjoncture [102] et de leur avenir [103] ? « Les transactions sont nulles, les vins restent invendus ou ne peuvent être enlevés et de là il résulte une grande gêne pour le propriétaire et le cultivateur. Un pareil état de choses ne peut se prolonger plus longtemps sans amener de grandes catastrophes. » [104] La morosité économique rendait plus sensibles encore à une lecture providentialiste des événements les populations royalistes, jusqu’à attendre de la restauration monarchique une solution pérenne à tous leurs problèmes. À Saint-Jean-du-Marillais (Maine-et-Loire), les signataires disaient ainsi être « persuadés que la prospérité de l’agriculture, du commerce et du travail, qu’en un mot, le bonheur et le salut du pays » dépendaient du retour d’Henri V [105].
33En janvier 1874, des industriels fusionnistes également attiraient l’attention sur la mauvaise conjoncture qui mettait leurs « intérêts en péril », réclamant que l’Assemblée y remédiât par « l’établissement de la Monarchie du chef de la Maison de France, ayant à ses côtés ses cousins d’Orléans ». En abordant plus loin la question du drapeau – la pierre d’achoppement de l’échec d’octobre 1873, ils développaient consciemment l’idée selon laquelle le cœur du débat portait sur la nature fondamentale du régime, dépassant en cela le simple champ revendicatif de l’économique pour se placer entre l’idéologique et le symbolique. « Le Roi à son drapeau ; nous tenons, nous aussi, à nos marques de magasin et de fabrique. » [106] La comparaison est frappante. Elle expose un sentiment de malaise – réel ou calculé – des acteurs économiques face à l’incertitude sur la nature du pouvoir présent et à venir. Elle traduit ce besoin de confiance et de stabilité pour prospérer.
Les thématiques mises en œuvre : le « salut de la France » et l’antirépublicanisme
34Arrêtons-nous sur le thème du « salut de la France » qui constitue un champ commun remarquable aux républicains et aux royalistes, à la fois parce qu’ils le partagèrent formellement, et qu’il présentait une ambivalence sémantique telle que chacun pouvait y trouver les éléments constitutifs de son propre mythe pour projeter la finalité de son « salut de la France ». Entre la capitulation de Paris (28 janvier 1871) et le traité de paix de Francfort (10 mai 1871), un élan patriotique avait aussi animé les publicistes républicains qui sacrifièrent au registre du « salut de la France » [107].
35Catholiques dans leur écrasante majorité, les partisans de la monarchie traditionnelle associèrent – souvent malgré eux – le discours du « salut de la France » avec la théologie augustinienne du salut. L’influence d’une littérature catholique de propagande, qui y puisa des arguments forts pour exprimer cette doctrine pessimiste et eschatologique, n’était pas étrangère à ce travail des esprits. Cette mécanique est compréhensible dans la mesure où les hommes influents de ce « parti » soutenaient la doctrine de « l’inséparatisme » [108], suivant en cela le comte de Chambord [109]. Cet « inséparatisme » du politique et du religieux renvoie à l’alliance du trône et de l’autel, à la restauration d’une monarchie traditionnelle, royale, héréditaire et chrétienne. Par sa configuration constitutionnelle et parlementaire, cette monarchie ne s’articule aucunement sur l’idée d’un retour à l’Ancien Régime, mais le parallèle – sinon l’amalgame – fut aussitôt fait et habilement exploité par les républicains et une partie des orléanistes au bénéfice d’un courant anticlérical et matérialiste ascendant [110].
36Le « salut de la France » des suppliques légitimistes semble prendre parfois un tour radicalement eschatologique lorsque les pétitionnaires invoquent la « France [qui] attend la fin du provisoire » institutionnel [111]. En Ille-et-Vilaine, les « soussignés, convaincus que le salut de la France est dans le retour du Roi, et ne peut être que là, supplient l’Assemblée nationale de proclamer Henri V » [112]. « Les soussignés de la Commune de Rocheservière[,] Vendée, convaincus que le salut de la France est dans le retour immédiat du Roi, et ne peut être que là, supplient l’Assemblée nationale de proclamer la Monarchie légitime et héréditaire. » [113] Une foi religieuse trempée mêlée à un amour quasi mystique pour le roi transpire bel et bien de certains documents.
37L’ironie et l’agressivité à l’encontre du régime républicain ne sont pas absentes des adresses légitimistes qui expriment un parti pris brutal et péremptoire sur le mode d’un rejet clairement exprimé de la République. « Les soussignés, convaincus qu’on est suffisamment renseigné sur les bienfaits de la République ; qu’il est prouvé par les faits [sic], au témoignage même de Mr Thiers, qu’en France la République tourne toujours au sang ou à l’imbécillité, tandis que la Monarchie héréditaire assure, avec la stabilité, la grandeur de la France et le bien-être des particuliers. » [114] Si l’argumentation paraît quelque peu pauvre et fragile, ce texte se révèle néanmoins une démarche originale dans un corpus documentaire relativement homogène où les modèles écrits ou inspirés par des cadres du parti légitimiste ont assurément circulé dans les provinces. Les 113 signataires de Soullans (Vendée) écrivaient leur royalisme, probablement sincère et ancien. Différemment d’autres pétitionnaires de l’Ouest, ils suppliaient les députés de « voter le retour de la Monarchie, par le rappel du Roi Henri V ». [115] Le « rappel du Roi » qui régnait dans l’exil depuis plus de quarante ans, après avoir été chassé de son trône par l’usurpation de Louis-Philippe, puis empêché de s’y rasseoir par la révolution de 1848 et le coup d’État de Louis Bonaparte. Pour les signataires de Soullans, si Henri V n’avait pas effectivement régné, il n’avait cessé jamais d’être « le Roi ». Nous y décelons l’expression d’un royalisme populaire, un substrat culturel latent qui saisit là une opportunité pour se manifester.
38À cet antirépublicanisme de populations de l’Ouest répondait celui de certains Artésiens. Des ruraux de la commune de Willeman (Pas-de-Calais) disaient leur peur de la République qu’ils assimilaient volontiers à la tourmente révolutionnaire, en donnant un long argumentaire. Les deux pétitions de Willeman se distinguent des cinq autres (élaborées sur le même modèle) par leur construction originale. Elles furent transmises au bureau de l’Assemblée nationale par le député du Pas-de-Calais, Adolphe de Partz de Pressy. « Nous, les habitants des campagnes nous avons peur de la république, de quelque nom qu’elle s’appelle ; car nous savons aujourd’hui, mieux que jamais qu’elle traîne après elle, l’instabilité et le désordre et par conséquent, le chômage et la misère !… […] À nos yeux, ce gouvernement ne peut être que la royauté ; elle seule, à notre avis, peut affermir l’ordre, rendre le commerce florissant et assurer du pain au pauvre ouvrier. » Ces populations rurales, saisonnièrement ouvrières pour les industries textiles et les mines, souffraient des difficultés conjoncturelles en cette année 1873, voyaient leur niveau de vie baisser, mais craignaient aussi de retrouver les affres révolutionnaires (représentations de la Commune). Le fait est assez remarquable dans un département qui s’était montré d’un indéfectible bonapartisme sous le Second Empire, y compris au moment du plébiscite du 8 mai 1870 [116]. Devons-nous y déceler un effet de la stratégie des chefs bonapartistes en faveur de l’alliance conservatrice [117] ?
39L’avènement du comte de Chambord était souhaité par des populations ouvrières pour qui, outre le fait classique qu’elles considéraient le roi comme « vrai père du peuple », il incarnait l’espérance sociale et le relèvement économique des classes laborieuses. Le roi, « vrai patron de l’ouvrier, peut nous rendre avec la sécurité, la prospérité, la confiance, la circulation de l’argent et le travail qui sont notre vie et celle de nos familles » [118]. En somme, les pétitionnaires ne réclamaient pas le retour d’un expert en économie, mais plutôt celui du roi thaumaturge. Des petits patrons du Maine-et-Loire formulaient des vœux similaires, attendant du retour du roi la reprise des affaires, sans omettre de rappeler leur rôle éminemment social. « [Eh] bien, Messieurs [les députés], nous humbles fabricants d’une modeste commune de Maine-et-Loire, dont douze cents habitants reçoivent de nous le travail qui leur fournit le pain de chaque jour, nous venons jeter devant vous le cri de détresse, de l’extrême misère ! » [119]
40Du côté républicain, si certains répondirent simplement à l’offensive royaliste, d’autres menèrent leur propre campagne de pression auprès des parlementaires en faveur de l’instauration institutionnelle définitive de la République. La réclamation de « la fin du provisoire » était commune à bon nombre de pétitions royalistes [120]. Du côté adverse, on posait comme postulat salutaire mais incontournable que le régime républicain était « le seul capable de pacifier les partis » [sic] et surtout de « ramener la confiance et d’assurer l’avenir » [121], sans étayer leurs assertions – comme leurs adversaires du reste – par la moindre argumentation construite et solide. La vertu même du nom de République semblait devoir satisfaire les esprits quelque peu critiques ou modérément sceptiques. Des pétitions royalistes ne réclamaient-elles pas qu’il fût mis un terme à « l’état provisoire […] de nature à porter le plus grand préjudice à tous les intérêts » [122], quand les républicaines considéraient que « le provisoire énerv[ait] le pays et compromet[tait] tous les intérêts […] » [123].
41Ces vœux similaires nous conduisent à considérer l’opposition réelle des deux camps sur le plan fondamental de la triple conception de la nature – pour ne pas dire l’essence – du pouvoir (transcendance monarchique et immanence démocratique), de l’origine du pouvoir (légitimité héréditaire et légitimité élective) et des articulations dans les expressions du pouvoir (constitution, fonctions régaliennes, parlementarisme). Ils impriment aussi un petit pas dans la construction progressive – entamée sous la Restauration – d’une opinion politique élargie [124], à laquelle nous tenterons maintenant de donner des visages.
Prolégomènes à une sociologie des pétitionnaires
42Des sondages préliminaires, effectués dans quelques dizaines de pétitions, nous ont permis de dégager quelques axes forts dans l’esquisse d’une approche sociologique, notamment par le biais des métiers et des activités économiques ou encore des positions sociales de populations signataires. Malheureusement, il est très délicat d’exprimer ces résultats car les données statistiques élémentaires pour les zones géographiques considérées sont lacunaires ou grossières (population totale, population masculine, mouvements migratoires, électeurs) [125]. Ajoutons que tous les signataires d’une même pétition n’écrivaient pas leur profession ou leur position à côté de leurs nom et paraphe. Dans le grand Ouest bocager, nombre de signataires ne savaient ni lire ni écrire. Un rédacteur (le maire, une personnalité royaliste locale) inscrivait alors les noms qui étaient marqués d’une croix. Ainsi, les 34 noms écrits sur la pétition de la commune de La Chapelle-Basse-Mer (Loire-Inférieure) renvoient à 18 signatures et 16 croix [126]. Par ailleurs, chaque nom inscrit correspond-il réellement à un signataire volontaire ? Dans le cas des pétitions légalisées par le maire –à défaut par un adjoint, la proportion des noms apposés sans consentement devait être très faible, car l’autorité municipale était censée vérifier que chaque nom correspondait bien à un de ses administrés et que celui-ci s’exprimait librement. Si, pour les petites communes où les maires étaient notoirement royalistes, le doute subsiste, l’écart doit être marginal. Bien sûr, ajouter un ou plusieurs noms pour faire meilleur poids demeure une tentation humaine que nous devons envisager. Il y eut, a contrario, une poignée de maires qui refusèrent de légaliser les signatures de la pétition qui leur était présentée, comme à Gennes (Ille-et-Vilaine) concernant 44 noms [127]. Sommes-nous ici en présence d’un maire « bleu » rétif au milieu d’une population revendicative « blanche » ? Ce refus était-il l’expression d’une circonspection ou d’un opportunisme ? Faute d’éléments, nous ne pouvons répondre.
43Avant de tenter un inventaire des métiers et des professions déclarées par les signataires, soulignons trois points d’ordre général. Le premier est que la population concernée par notre champ d’investigation s’avère quasi exclusivement masculine. Nous avons cependant trouvé quelques exceptions, comme à Toulouse, où des femmes signèrent aussi des pétitions adressées aux députés de la Haute-Garonne [128]. Dans les Pyrénées-Orientales, en Bretagne, d’autres femmes signèrent la pétition ; certaines étant à la tête d’une affaire comme une dame « Clonerec marchande épicière » ou encore « Jeanne Le Gal cultivatrice » [129]. Le deuxième nous rappelle que l’engagement royaliste en milieu rural était aussi un phénomène familial. Dans des pétitions en provenance de petites communes, des noms de famille reviennent à plusieurs reprises avec des prénoms différents ou sans prénoms. Souvent, noms et/ou signatures se suivent. Il est alors fort probable qu’il s’agit d’individus de la même famille qui exprimèrent collectivement leur royalisme : Capelier, Delannoy, Mahieu à Quesnoy-sur-Deûle (Nord) ; Despont, Maupas, Méric à Toulouse (Haute-Garonne) ; Cochard, Desmars, Tessier à Prinquiau (Loire-Inférieure) ; Chiron, Roussière, Soulard au Petit-Bourg-des-Herbiers (Vendée). Le royalisme de ces populations de Midi-Pyrénées ou de Bretagne traduit un héritage culturel partagé par la famille et transmis sur plusieurs générations depuis 1830 au moins. Le troisième point exprime les rapports de solidarité obligée entre employeurs et employés. À côté de la signature d’un notaire, nous trouvons celle d’un clerc de notaire ; à côté de celle d’un avoué, figure celle de son clerc ; le maître charpentier et l’ouvrier charpentier se côtoient [130]. Si les populations paysannes traditionnelles de l’Ouest armoricain et bocager étaient bien encadrées par une noblesse terrienne enracinée comme elle dans un terroir historiquement marqué par les clochers et les châteaux [131], un peuple royaliste des villes bretonnes existait bel et bien, avec ses ouvriers, ses artisans, ses boutiquiers et ses bourgeois. Les nuances régionales et surtout locales d’un royalisme populaire se dessinent à travers le mouvement pétitionnaire. Un constat identique peut être dressé pour le Languedoc (Gard [132], Hérault). Derrière les « notables » se profilait un peuple royaliste parfois fruste mais bien réel. Les premiers jouaient pour les pétitions le rôle de moteur et d’encadrement qu’ils tenaient dans les sociétés du village ou du quartier. Leur action probablement intéressée permet à l’historien d’approcher le « peuple muet ».
44Le mouvement, spontané autant que circonstanciel, fut rapidement vivifié par les cercles royalistes de province où circulaient les pétitions [133]. Il fut relayé par la presse royaliste « unioniste », qui ouvrit les portes de ses rédactions aux signataires [134], et encadré par des députés « unionistes » actifs [135]. Ces élus royalistes de février 1871 appartenaient pour une grande partie d’entre eux à la noblesse des provinces [136]. Sans eux, le mouvement pétitionnaire n’aurait pas pu bénéficier des impulsions et de l’entraînement qui furent les siens jusqu’à l’été 1874. À côté des noms de grandes familles (La Rochefoucauld-Bisaccia, La Rochejaquelein, Lur-Saluces, Maillé), nombre de représentants de lignages provinciaux parfois antiques s’illustrèrent lors de cette campagne [137]. Outre le fait – normal étant donné leur fonction – qu’ils déposèrent les pétitions qui leur étaient adressées au bureau de l’Assemblée nationale, certains députés légitimistes, tel François Dahirel, arpentèrent leur circonscription en hommes de terrain pour porter la parole du roi et collecter les signatures [138]. La tactique des cadres du parti légitimiste visait à produire partout où cela leur était possible un vaste mouvement populaire afin d’affirmer, face aux républicains – mais aussi face aux bonapartistes, l’existence d’un large peuple légitimiste comme base – sinon comme justification – d’une restauration monarchique. En regard de l’« appel au peuple [139] », les légitimistes avançaient l’appel du roi (« La parole est à la France [140] ») auquel devait répondre l’appel du peuple (il prit ici la forme d’un mouvement pétitionnaire).
45Mais quelle était concrètement cette France populaire et royaliste ? La géographie du phénomène pétitionnaire se lit à une échelle locale que notre essai de cartographie, basé sur le découpage départemental, rend sommairement mais exhaustivement. De même, les documents ne nous fournissent que partiellement des éléments propres à instruire un inventaire des métiers et des qualités de ces milliers d’individus d’un peuple habituellement anonyme et que l’espérance et l’opportunité conjuguées de redonner un roi à la France firent sortir momentanément de l’ombre. Notre approche sociologique sera modeste et prudente, d’autant plus que les métiers exercés que les intéressés déclarèrent souffrent parfois d’imprécision. « Marchand » est ainsi un terme générique aux réalités multiples, tout comme « propriétaire » qui peut se décliner en fonction de la nature des biens et de leur valeur. Répétons aussi que dans un ensemble de noms ou de signatures, la profession ou la qualité de l’intéressé n’a pas toujours été mentionnée ou, quand elle l’a été, n’est pas lisible. Cela nous a conduit à éliminer de nos sondages des dizaines de pétitionnaires.
46Il existe enfin un rapport patent entre les arguments des pétitionnaires et la mention de leur profession ou qualité. Nous l’avons dit, les commettants – y compris les républicains – revendiquaient haut et clair leur besoin de paix, d’ordre et de stabilité, afin de « mettre un terme aux souffrances du commerce, de l’agriculture et de l’industrie » [141]. Les populations « blanches » ou « bleues » qui signèrent ces pétitions adhéraient, au moins pour ce coup, à un esprit conservateur commun qui redoute pareillement les émotions et les révolutions qui remettent en cause l’équilibre social et les intérêts économiques définis selon des idéologies propres et dans lesquels chaque camp trouvait son compte. « Nous vous adjurons de maintenir la République qui seule peut nous assurer l’ordre, la paix, la prospérité et nous préserver de révolutions nouvelles » [142], demandaient des républicains des Pyrénées- Orientales par le biais de leur député Emmanuel Arago. Des royalistes vendéens faisaient écho à cette prévention : « [Nous] croyons toujours qu’un régime à courte échéance ne saurait mettre fin aux anxiétés de notre pays, sans cesse menacé de révolutions nouvelles, et nous vous demandons instamment de profiter de la discussion des lois constitutionnelles pour rétablir la royauté. » [143] Or, la profession ou la qualité inscrite à côté du nom ou de la signature – en guise de « signature », trois fois sur quatre, le nom et le prénom sont simplement écrits – semble bien traduire un mouvement politique et social, sinon entraîné par les forces industrielles du pays, au moins placé sous leurs auspices. Des royalistes de Montauban se plaignaient de la mauvaise conjoncture, en invoquant le retour du roi thaumaturge et en affichant les préceptes bénédictins d’une regula moderne – peut-être plus fantasmée que réelle : ora et labora. « Nous, au contraire, nous le vrai peuple qui travaille et qui prie […]. » [144]
Éléments quantitatifs et géographiques pour une approche sociologique
47Regardons cette France des métiers et des positions par département avec une focale différente. Nous avons établi un corpusculum de 43 dossiers de pétitions répartis sur 19 départements [145] pour lesquels un relativement grand nombre de pétitions apportaient des éléments sociologiques utilisables (fonction, métier, profession) [146]. Au total, nous avons relevé dans cet échantillon 1 681 noms ou signatures utilisables. Le département qui donne la plus grande diversité de métiers et de qualités est le Nord avec environ 69 catégories professionnelles revendiquées par les signataires sur un échantillon de 6 dossiers de pétitions [147]. Viennent ensuite le Gard avec quelque 61 catégories sur 2 dossiers, le Morbihan avec 54 catégories sur 5 dossiers, la Vendée avec 46 catégories sur 7 dossiers et la Sarthe avec 40 catégories sur 1 dossier.
48Prenons l’exemple du département du Gard qui, avec 45 dossiers déposés au bureau de l’Assemblée nationale sur les 278 du corpus, arrive nettement en tête pour le nombre des pétitions sur la période considérée. Cependant, les pétitions où sont indiquées la profession ou la qualité des personnes de manière significative par rapport au nombre total des signataires sont peu nombreuses. Dans le manuscrit daté de « Sumène le 15 9bre 1873 », pour 247 des 520 pétitionnaires, il est fait mention de la profession [148]. La précision du métier ou de la position sociale du pétitionnaire revêt une importance première, dans la mesure où l’appel pressant au retour du roi correspond souvent à une préoccupation d’ordre économique. « L’agriculture, le commerce, l’industrie souffrent, les ouvriers laborieux des campagnes, aussi bien que ceux des villes, réclament un gouvernement stable et fort, basé sur le droit et la justice, et qui puisse faire renaître en France l’ordre et la sécurité ainsi que le travail. » [149] « La gravité des circonstances, le découragement de l’agriculture et du commerce, et, par-dessus tout la crainte de l’avenir, nous forcent à élever la voix. » [150] « Le Gouvernement monarchique étant le seul qui puisse nous assurer la tranquillité et mettre un terme aux souffrances du Commerce, de l’Agriculture et de l’Industrie, les signataires prient Messieurs les Représentants du [illisible] de rétablir la monarchie traditionnelle. » [151] Les commettants attendaient bien du retour du roi une opération quasi miraculeuse qui eût mis fin à la morosité économique ambiante. Ils craignaient avant tout pour leurs intérêts (activité, biens, fortune).
49Aussi n’est-il pas étonnant de voir au premier rang des signataires profilés les populations d’exploitants agricoles et d’artisans. Le terme générique de « cultivateur » apparaît 515 fois dans notre corpusculum, sans compter les « laboureur », « agriculteur », « fermier » et autres précisions professionnelles qui feraient significativement augmenter la part du monde agricole [152]. En 1873, le territoire d’un département fortement mobilisé comme la Loire-Inférieure – avec 44 dossiers de pétitions légitimistes sur la période [153] – était voué à plus de 98 % aux activités agricoles. De même, plus de 95 % du territoire départemental du Morbihan était consacré à l’agriculture (38 dossiers), et presque 95 % de celui de la Vendée l’était aussi (21 dossiers). Pour le Morbihan par exemple, six dossiers donnent des professions. Nous y avons repéré comme étant des travailleurs de la terre 324 signataires (soit 68 %), contre 153 représentants d’autres secteurs économiques. L’Ouest paysan des traditions chouanne et vendéenne répondait une fois encore à l’appel du roi. À l’inverse, une autre région de culture royaliste ancienne, le Gard, ne compte qu’un peu plus de 25 % de travailleurs de la terre parmi les signataires [154]. Toutefois, nous l’avons dit, ce département offre une palette plus riche de catégories socioprofessionnelles.
50Les prolétaires à proprement parler sont peu nombreux [155] : environ 0,5 % répartis dans cinq départements. Les professions subalternes comme les « commis » ou celles qui sont à statut particulièrement non qualifié comme les « chiffonniers » « journaliers » ou les « ménagers » comptent pour 2 % des professions sondées (43 % de ces 2 % émanent du Morbihan et la Vendée). La domesticité, globalement peu représentée (0,9 % des professions sondées), est concentrée dans des départements de l’Ouest (Finistère, Mayenne, Morbihan et Vendée pour 75 % de l’échantillon). Deux pétitionnaires se déclarent « sans profession » (Gard, Nord). Il semble que les chefs légitimistes aient fait feu de tout bois pour augmenter le nombre de signatures. Lorsque les circonstances ne leur permettaient pas de les recueillir, il était parfois fait mention en marge du document, comme dans le bro an Oriant, de tous ceux qui n’avaient pas pu signer pour donner davantage de poids à leur mouvement [156].
51Les gens des métiers constituent, après les travailleurs de la terre, le deuxième groupe par ordre d’importance numérique des signataires [157]. Le prolétariat des usines était encore peu nombreux et, lorsqu’il entrait en politique ou en syndicalisme, il était majoritairement acquis aux courants révolutionnaires [158]. Notre échantillon rassemble un large éventail des métiers d’arts et d’industries indispensables à la vie des terroirs dans une France agricole répondant encore majoritairement à une logique proto-industrielle dans la relation ville-campagne. Le patron d’une entreprise industrielle, nommé communément « fabricant » [159], entre pour 1 % dans notre échantillon, avec une poignée de puissants minotiers. Il donnait du travail annuellement ou saisonnièrement aux populations rurales des environs et s’enorgueillissait alors, comme ces « Fabricants de la Tourlandry » cités plus haut, ou ces « Fabricants de la commune de Melay » [160]. Le signataire se qualifiait parfois d’« industriel » [161], voire de « manufacturier [162] », un terme, un brin désuet, mais qui traduisait bien la configuration particulière de l’industrie française. Néanmoins, la main-d’œuvre de manufactures ou d’usines s’avère peu représentée, y compris dans notre corpus général de 278 dossiers de pétitions. Nous avons toutefois rencontré quelques « contremaîtres d’usine ». Dans notre corpusculum, le gros des gens de métiers était constitué d’artisans [163]. Parmi les métiers les plus représentés, nous trouvons 58 menuisiers soit 13,4 % des artisans (mais seulement 3,4 % de l’ensemble des signataires de l’échantillon), 39 meuniers (8,9 % ; 2,3 %) ; 33 cordonniers (7,5 % ; 2 %), 30 maçons, 28 tisserands, 22 charpentiers, 20 tailleurs, ou encore 18 sabotiers. Chaque métier est présent dans la moitié des 19 départements. Parmi les métiers artisanaux de bouche, les boulangers se dégagent avec 16 signatures qualifiées (3,7 % ; 1 %), également présents dans un bon tiers des départements concernés. Plus de 50 corps de métiers différents donnent un éclairage sociologique sur la pénétration du légitimisme dans les couches laborieuses.
52Les représentants des classes bourgeoises apparaissent nettement. Une des expressions les plus classiques en est le « propriétaire » qui pèse à peine plus de 11 % (188 individus) des signataires à profil déclaré et dont la catégorie est présente dans 17 des 19 départements de nos 43 dossiers de pétitions [164]. Celle des « rentiers » ne figure que dans le Morbihan et dans le Nord où elle représente tout de même 7 % des professions ou des qualités indiquées. Les métiers du commerce sont également bien représentés, avec plus de 10 % des professions déclarées, en allant du « courtier de commerce » à l’« épicier » en passant par le générique « marchand » ou le très modeste « employé de commerce ». « Négociant » apparaît 93 fois. Dans les Bouches-du-Rhône, les activités liées au négoce et à l’industrie sont surreprésentées (respectivement 60 % et 23 % des signatures renseignées) dans les sources. À la tête des légitimistes de ce département, nous retrouvons le puissant armateur marseillais Henry Bergasse. Nombre des personnalités signataires étaient d’anciens juges au tribunal de commerce de la cité phocéenne [165].
53Les professions à caractère « intellectuel » ou qui nécessitaient d’avoir fait des études de manière évidente entrent pour un peu moins de 4,5 % (y compris les membres du bas clergé) dans notre échantillon [166]. Elles regroupent les professions de santé (docteur en médecine, pharmacien), les spécialistes du droit (avocat, juge, notaire), le corps enseignant (instituteur, professeur), les représentants du monde des lettres et de la presse (écrivain, journaliste), les étudiants ou encore les cadres directoriaux d’entreprise. Le bas clergé (curé, recteur, vicaire paroissial) réputé, notamment en Bretagne, pour son royalisme militant et son « inséparatisme » est peu représenté : 24 signataires qualifiés (1,4 % de l’échantillon). Quant aux militaires en activité, il s’agit de traces, ce qui paraît normal pour l’époque. Nous n’avons trouvé que deux cas déclarés : « Rougnon François (soldat) » et « J. Lebel conscrits » [167]. Les 13 autres cas clairement identifiés sont des ex-militaires : 4 hommes du rang, 3 sous-officiers, 6 officiers (dont un seul issu de « La Royale »). 46,7 % de ces signatures proviennent du Morbihan, et à plus de 53 % de départements bretons [168]. L’ensemble de la catégorie des militaires compte pour environ 0,9 % de notre échantillon de population. Enfin, la police est une catégorie représentée par un seul individu repéré dans une pétition arlésienne sous la signature « Armand ex-agent de police » [169].
54Cette approche sociologique ayant mis en lumière la diversité des pétitionnaires, nous pouvons nous interroger sur les effets de ce mouvement de 1873-1874, sur sa « postérité [170] ». De quelle manière les pétitionnaires s’inscrivirent-ils dans un combat politique ? Quel fut l’impact du mouvement sur les débats et les décisions parlementaires ? Quelle « postérité » ces pétitions eurent-elles ?
Effets et résultats d’un mouvement populaire
55De manière générale, le mouvement pétitionnaire légitimiste de 1873-1874 consacre l’expression politique du peuple royaliste avant d’appeler l’ensemble de ses forces à se mobiliser, ce en quoi il se distingue fondamentalement de l’« appel au peuple » des bonapartistes. Le césarisme demandait au peuple de valider sa légitimité par voie plébiscitaire, à l’issue d’un coup de force. En quête de légitimité, César opérait au moyen d’un « discours de légitimation » : le Gouvernement « se donn[ait] pour nature la délégation par le peuple de sa puissance, le représentant étant susceptible d’animer les volontés du peuple [éternel mineur] » [171]. Pour les royalistes, la légitimité du pouvoir monarchique – cette « transcendance du souverain dans l’immanence du monde » [172] – résidait dans la personne du roi par transmission patrilinéaire de manière historique. Cette légitimité était pour eux quasi consubstantielle de la monarchie royale. C’est ainsi que l’entendaient des pétitionnaires d’Hazebrouck, priant les députés du département du Nord « de rétablir la Monarchie légitime héréditaire » [173]. Mais quel en fut l’effet ?
56Nous avons également vu que la pétition était un outil de tactique politique ancien. Quelle que soit l’échelle sociogéographique, elle consistait souvent pour une élite à faire parler la base, la masse des individus habituellement « muets », dans le dessein de contrebalancer le pouvoir des corps intermédiaires en scellant l’alliance du roi et du peuple. Le mouvement pétitionnaire de 1873-1874 diffère de ce schéma. Pour les esprits les plus engagés et les plus royalistes, l’expression spontanée – bien que provoquée de manière fortuite – d’un royalisme populaire fut le vecteur de leurs revendications politiques qu’une partie de la presse, des cadres du parti et de certains parlementaires de l’extrême droite relayèrent au moment où la question de la prorogation des pouvoirs du maréchal de Mac-Mahon était posée. Il ne s’agissait pas tant pour eux d’obtenir cette prorogation que de faire voter par l’Assemblée nationale la restauration monarchique quand même. Le premier effet de ce mouvement fut donc le mouvement lui-même : l’entrée en politique d’un peuple royaliste. D’une certaine façon, cette mise en forme d’un royalisme populaire « de masse » prolonge l’idée du ministre de la Police de la Seconde Restauration, le comte Decazes, de « royaliser la nation, nationaliser le royalisme » [174], afin de mettre un terme à la rivalité des deux France nées avec la Révolution et de sauver ainsi la monarchie. À cette différence que s’il s’était alors agi d’une alliance entre Louis XVIII et les deux chambres, autrement dit l’expression d’une opinion publique censitaire restreinte, à l’automne 1873, c’était la partie royaliste de la nation française dans ses déclinaisons populaires qui appelait de ses vœux l’alliance de l’Assemblée et de l’esprit public. En somme, un mouvement « de masse » s’inventait acteur de l’espace politique pour royaliser les institutions de la France. Plus encore, en un demi-siècle, les termes de l’opération avaient changé. Les pétitionnaires invitaient les parlementaires à sceller un nouveau pacte d’alliance, mais cette fois entre Henri V et le peuple des « classes laborieuses, ces ouvriers des champs et des villes, dont le sort a fait l’objet de [ses] plus vives préoccupations et de [ses] plus chères études » [175].
57Apprécions ensuite l’impact de ce mouvement pétitionnaire sur la décision parlementaire. Le 5 novembre 1873, lorsque l’Assemblée nationale reprit ses débats, l’extrême droite était désemparée après la lettre de Salzbourg. Qui songeait alors aux pétitions qui se signaient ? Charles Combier et Ernest de La Rochette qualifièrent la missive de décevante au regard de la responsabilité du prince vis- à-vis de la France. Louis Buffet lut à la tribune une proposition préparée par le général Changarnier prorogeant le mandat du maréchal de Mac-Mahon pour dix ans. Deux cent trente-sept députés la signèrent. Contre l’avis de sa minorité royaliste qui réclamait un mandat décennal mais sans le titre de « président de la République », incapable de trancher, la commission parlementaire formée ad hoc ramena la durée de la pro-rogation à sept ans, sacrifiant ainsi au provisoire d’un régime conservateur sans nom – contre le vœu du peuple royaliste tel qu’il s’exprimait dans nombre de pétitions [176].
58Lorsqu’il lut la copie de la lettre de Salzbourg qui lui avait été transmise officieusement, le maréchal de Mac-Mahon aurait eu ce mot : « Il ne reste plus maintenant qu’à voter pour dix ans la prolongation de mes pouvoirs. » [177] Le marquis de Dreux-Brézé qui rapporte cette anecdote y voyait le signe que les adversaires de la restauration auraient travaillé le vieux militaire pour le rallier à leur point de vue. Cette phrase pourrait aussi bien traduire un enregistrement passif de l’évolution d’une situation dont il s’était volontairement tenu à l’écart. Le maréchal de Mac-Mahon figure l’archétype du conservateur intégral. Les chefs du parti légitimiste s’étaient fait violence pour accepter que leurs députés votassent la prorogation des pouvoirs du président, comme un pis aller temporaire raisonnable nourri de l’espoir qu’une très prochaine restauration monarchique remettrait tout en ordre. « Pas plus que vous je ne comprends la prolongation à terme fixe des pouvoirs du Maréchal et ne serais disposé à la consacrer par un vote. Mais autant que vous et moi se sentent tristes les députés de la droite, nos amis, qui se croient dans la nécessité de ne pas refuser cette prolongation. » [178] Le marquis de Dreux-Brézé n’hésitait pas à borner sévèrement le sens d’un vote des députés monarchistes en faveur de la prolongation de ses pouvoirs : « Quels que soient l’énergie du gouvernement, les pouvoirs qu’on lui confère, l’entente actuelle des divers groupes de la droite, ma pensée, je vous l’avoue, même en face d’un vote favorable à la prorogation, n’est pas que cette décision de la Chambre sorte une œuvre durable. » [179] L’objectif du comte de Chambord restait invariablement la restauration de la monarchie traditionnelle. Si besoin était, le mouvement pétitionnaire le confortait dans cette idée.
59Arrivé le 9 novembre à Versailles, le comte de Chambord avait décidé d’y rester jusqu’au vote de l’Assemblée. Il partageait ses journées entre la lecture de la presse, celle des comptes rendus de séances à la Chambre, l’ouverture et la rédaction de son courrier, l’assistance à l’office religieux et les entretiens avec ses intimes partisans. Le prince dut connaître assez tôt le résultat des élections partielles du dimanche 16 novembre 1873 et le renforcement qu’en retira à la Chambre le parti républicain [180]. Les monarchistes perdaient davantage de terrain à chaque scrutin partiel. Le comte de Chambord avait-il conscience que le temps jouait contre la Restauration ? Vraisemblablement. Sa venue en France laisse supposer qu’il espérait un dénouement rapide et favorable, probablement un rejet de la proposition de prorogation des pouvoirs qui lui aurait permis de se poser aussitôt en recours à l’instabilité politique résultant de cette décision [181].
60La loi constitutionnelle fut votée en plusieurs fois. Le 19 novembre vers 23 heures 40, les députés adoptèrent la prorogation du mandat du maréchal de Mac-Mahon sous la forme du septennat par 383 voix contre 317. C’était l’article premier qui conférait au chef de l’exécutif le titre de « président de la République ». Les centres mouvants avaient fait la différence, sans prendre en considération les pétitions monarchistes qui s’accumulaient. D’ailleurs, d’un simple point de vue pratique, le pouvaient-ils ? Le 20 novembre, à 2 heures du matin, une courte majorité de 68 voix emporta l’ensemble de la loi (378 voix pour, 310 voix contre). Le comte de Chambord fut informé du résultat final à son lever. Dans la soirée du 21 novembre, le prince quittait la France une fois encore. Dans la semaine, les deux ministres légitimistes démissionnèrent du gouvernement, cependant que les pétitions continuaient à affluer à Versailles. Le mouvement pétitionnaire avait été lancé trop tardivement [182] pour espérer opérer un effet décisif sur les députés, et il ne fut pas assez massif ni durable pour les impressionner sur une question si grave. Nous serions tentés de reprendre ici la conclusion de valeur plus générale de Jacques Leclerc : « Bien souvent, même, les pétitions paraissent en quelque sorte trop faibles pour les résultats qu’on voudrait obtenir. » [183] La nouvelle du vote de la prorogation fut bientôt connue des populations. L’effet de surprise passé, elle suscita des réactions invariables de fidélité royaliste dans les pétitions [184]. Le comte de Chambord attendait-il du mouvement pétitionnaire un effet de levier populaire ? Aucun document ne permet de l’affirmer, mais il désespérait désormais des députés royalistes. « Il n’y a plus rien à faire avec les pauvres polit[iques]. » [185]
61Quant à la « postérité » de ces pétitions, nous ne donnerons ici que quelques résultats d’investigation généraux. Nous avons suivi une typologie en quatre points sur le sort des pétitions [186], telle qu’elle apparaît dans la procédure parlementaire et les indications des rôles d’enregistrement [187] : le passage à l’ordre du jour ou en question préalable (la pétition est évacuée en raison du faible intérêt qu’elle suscite), le dépôt de la pétition au bureau des renseignements (ultérieurement, elle pourrait être potentiellement utile), son renvoi à une des commissions de l’Assemblée nationale (elle ferait l’objet d’une reprise éventuelle complète ou partielle sous forme d’amendement à un acte législatif), son renvoi au(x) ministre(s) compétent(s) (approuvée par les députés, elle mérite un examen approfondi).
62La ventilation des 278 dossiers de pétitions considérés s’opère selon les « décisions de la Chambre » mentionnées dans les rôles : « non légalisée » (163 dossiers), « ordre du jour » (37), et seulement 6 « renvoyé[s] à la commission des lois constitutionnelles conformément à l’article 92 du règlement ». Pour 68 dossiers, aucune décision n’a été portée sur le rôle, mais un « rapporteur » a été désigné par la commission. Curieusement, six dossiers de pétitions « non légalisée[s] » bénéficièrent d’un rapporteur. Nous remarquons aussi que les commissions qui se prononcèrent « massivement » pour la désignation d’un rapporteur, voire un renvoi « à la commission des lois constitutionnelles », étaient présidées par un légitimiste, Dahirel, et par un député de centre droit plutôt favorable à la restauration de la monarchie, Bonald [188]. Néanmoins, nous ne pouvons pas démontrer l’influence de leur présidence sur la « postérité » des pétitions qu’ils eurent à traiter. Les règles de tri des pétitions semblent avoir été respectées, comme l’indique une résolution écrite de la 24e Commission : « La commission décide qu’elle n’examinera pas les pétitions dont les signatures ne sont point légalisées. En vertu de cette décision, elle renvoie à la questure les pétitions dont les Nos suivent […]. » Le but était de ne pas commettre de « maladresses » qui auraient compromis les chances de restauration monarchique, ce que laisse clairement entendre la suite de cette note : « Il a été décidé pour ce qui concerne les pétitions (signatures légalisées) demandant le rétablissement d’Henri V qu’elles seraient renvoyées à la commission des lois constitutionnelles. La commission a pris cette résolution, afin de ne pas ouvrir incidemment une discussion d’une telle importance et qui ne peut tarder à se produire à propos de la présentation des lois constitutionnelles. » [189] Seul légitimiste à avoir voté contre la prorogation des pouvoirs, Dahirel veilla scrupuleusement à la régularité du travail de sa commission.
63Au final, le très petit nombre de dossiers de pétitions (6) qui furent présentés à la commission des lois constitutionnelles ne pouvait pas influer sur le débat relatif au régime politique de la France. Le processus législativo-administratif de traitement des pétitions se révèle avoir été, pour le coup, un tamis au maillage particulièrement fin. De plus, le manque de rigueur des pétitionnaires royalistes, l’essoufflement rapide du mouvement et la « lenteur » du traitement législativo-administratif des pétitions contribuèrent notablement à l’échec du mouvement pétitionnaire de 1873-1874.
En guise d’épilogue : « Dieu et le Roi » quand même [190]
64La question du drapeau avait profondément divisé le pays comme elle avait fait éclater la fragile union des droites monarchistes née de la rencontre du 5 août, un acte à la fois de réconciliation et de soumi- ssion [191]. Le duc de Broglie déplorait avec amertume le mouvement pétitionnaire. « [Dans les provinces], au contraire, c’étaient les concessions un instant arrachées au comte de Chambord qui avaient attristé les fidèles ; et sa dernière lettre, bien loin d’être blâmée, paraissait une protestation héroïque contre l’esprit révolutionnaire et un noble désaveu des faiblesses auxquelles les intrigues orléanistes avaient voulu l’entraîner. » [192]?Après – et malgré – le vote du 20 novembre, le pays réel légitimiste demeurait drapé sans complexe dans « l’étendard d’Arques et d’Ivry » [193], paré de toutes les vertus. « Le drapeau d’Henri V ne représente rien qui nous effraie : nous savons qu’il porte dans ses plis, la liberté, la prospérité et le progrès. » [194] La marque d’une nostalgie remplaçait parfois un argumentaire solide. « Nous soussigné du département de la Seine vous prions de déposer sur le bureau de l’assemblée cette pé[ti]tion que nous faisons tous d’un commun accord pour demander le rétablissement du roi henri cinq sur le trône et du drapeau blanc sous lequel nous avons été élevé […]. » [195] Cette pétition, a priori conduite par des hommes d’âges mûrs, renvoyait peut-être à la perception fausse mais commune selon laquelle « c’était mieux avant ». D’autres pétitionnaires rendaient publique leur adhésion à la lettre de Salzbourg qui traduisait selon eux les vertus supérieures de son auteur. Le roi et le pays réel auraient été trahis par une partie du pays légal. « Lors de la magnifique lettre de ce prince, plusieurs représentants ont osé la repousser… Nous, au contraire, […] nous le désirons à cause de cette même lettre, nous le voulons et, plus fort que jamais, nous nous attachons à lui. » [196] C’est un de ces témoignages émouvants de foi chambordienne [197]. Au-delà de simples positions politiques, les quelque 56 000 signatures du mouvement pétitionnaire de 1873-1874 présentent un pan d’une opinion publique française encore balbutiante.
65Le drapeau blanc des pétitionnaires était l’emblème de leur identité métapolitique du moment, avec cet « inséparatisme » qui mêlait royalisme politique et foi catholique [198]. Des pétitionnaires conféraient une mission quasi apostolique aux parlementaires. « [I]l y a dix-huit siècles, douze hommes pleins de foi ressuscitèrent le monde, que quelques-uns d’entre vous, Messieurs, proclament à la Tribune la Royauté vraie, et Dieu fera le reste. » [199] Pour eux, le comte de Chambord avait une vocation presque christique ; il était la monarchie et le protecteur de la religion [200]. Ainsi, 201 dossiers de pétitions demandaient expressément le retour ou la restauration du roi Henri V (72,3 %) – sous ses différentes désignations [201], cinq dossiers fusionnistes en provenance du Lot- et-Garonne réclamaient Henri V avec à ses côtés ses cousins d’Orléans [202], tandis que les autres mentionnaient le rétablissement de la monarchie. Cette doctrine « inséparatiste » s’exprima à l’Assemblée. Un petit groupe d’irréductibles [203], emmené par le vicomte d’Aboville et Gabriel de Belcastel [204] et qui avait refusé d’institutionnaliser le provisoire républicain par un vote d’abstention remarquable, n’avait pu expliquer son choix à la tribune. L’agitation et l’excitation du moment l’en empêchèrent. Peut-être en fût-il contrarié par quelque habile manœuvre de précipitation de la procédure législative ? Ces hommes avaient alors rédigé un court texte à l’adresse de leurs collègues qu’ils firent paraître dans L’Union. « Convaincus que la Monarchie nationale et chrétienne est le seul moyen de salut du pays, et que vous pourriez la faire si vous le vouliez, nous ne pouvons nous résoudre à dire à la France, par le vote du projet de loi, que nous lui offrons un instrument nécessaire et efficace de conservation sociale. » [205] Ils avalisaient ainsi la poursuite de la campagne de pétitions dans un esprit « inséparatiste ».
66Ils rêvaient d’une nouvelle alliance de l’autel et du trône. En 1874, cette idée impliquait aussi la défense de la religion, « des intérêts de l’Église » et du pape [206]. Le ministre des Affaires étrangères, le duc Decazes de Glücksberg, prit ombrage des manifestations en faveur du rétablissement du pouvoir temporel du pape à l’initiative de l’extrême droite ultramontaine. Ces irréductibles menaient concomitamment un combat de principe contre l’établissement définitif de la République. Le 16 mai 1874, ils votèrent contre le gouvernement de Broglie, préférant une alliance de circonstance avec les bonapartistes et les républicains au respect d’une union avec ces droites jugées plus conservatrices que réellement monarchistes et chrétiennes. La politique retorse du duc de Broglie qui privilégiait le rapprochement des centres conservateurs – tout en se défiant d’une partie du centre gauche – lui fut fatale [207]. L’extrême droite prit une petite revanche sur les manœuvres passées du vice-président du Conseil qui avaient fait échouer la restauration de la monarchie avec Henri V. Elle opta pour la « politique du pire » [208]. Au lieu de saper le régime provisoire de 1871, elle favorisa l’établissement de la République honnie. Finalement, elle contribua malgré elle à « mettre fin au provisoire » ainsi que les pétitionnaires royalistes l’avaient réclamé, mais en faveur de la République et du drapeau tricolore. De ce point de vue, nous pouvons dire que le mouvement pétitionnaire se solda par un échec politique complet. D’un autre côté, il a montré l’existence d’une France légitimiste, certes minoritaire, mais attachée à sa foi, à son principe et à son roi. En cela, si elle a pu à cette occasion se compter, « montrer combien [étaient] nombreux dans [ses] rangs, les partisans de la Monarchie légitime » [209], elle dut probablement s’enorgueillir d’une petite victoire symbolique.
67La lettre de Salzbourg et le drapeau blanc avaient été portés haut par les petites voix du peuple de la légitimité monarchique qui avaient résonné en vain aux oreilles des députés comme un défi à la modernité postrévolutionnaire, selon le credo « inséparatiste » de l’amour de Dieu et du roi. « Nous demandons le rétablissement dans son entier de ce Droit, le seul vrai, dont Dieu est l’auteur et qui se personnifie dans le Roi. N’hésitez pas, messieurs, ne vous comptez pas ! Si Dieu est avec nous, qui sera contre vous ? » [210]
La France légitimiste demande la restauration de la monarchie. Géographie départementale des dossiers de pétition(s) (nov. 1873-déc. 1874)

La France légitimiste demande la restauration de la monarchie. Géographie départementale des dossiers de pétition(s) (nov. 1873-déc. 1874)
Numéro-chronologie des dossiers de pétition(s) légitimistes pour la restauration d’Henri V (10 nov. 1873-17 déc. 1874)

Numéro-chronologie des dossiers de pétition(s) légitimistes pour la restauration d’Henri V (10 nov. 1873-17 déc. 1874)
Notes
-
[1]
Voir à ce sujet François Crouzet, « Essai de construction d’un indice de la production industrielle française au xixe siècle », Annales. Économies. Sciences. Civilisations [désormais Annales esc], 25e année, no 1, janvier-février 1970, p. 56-99 ; « Encore la croissance économique française au xixe siècle », Revue du Nord, t. IV, no 214, juillet-septembre 1972, p. 271-288 ; Maurice Lévy-Boyer, « La croissance économique en France au xixe siècle. Résultats préliminaires », Annales esc, 23e année, no 4, juillet-août 1968, p. 788-807 ; « La décélération de l’économie française dans la seconde moitié du xixe siècle », Revue d’histoire économique et sociale, vol. XLIX, no 4, 1971, p. 485-507 ; Histoire de la France industrielle, Paris, Larousse, 1996, 550 p. ; Jean-Claude Toutain, « Le produit de l’agriculture française de 1700 à 1958, 2, La croissance », dans Cahiers de l’Institut de science économique appliquée. Histoire quantitative de l’économie française (2), Jean Marczewski (dir.), Série af, no 2, suppl. no 115, juillet 1961, 283 p.
-
[2]
Francis Démier, La France du xixe siècle. 1814-1914, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Points Histoire », 2000, p. 338. L’auteur interprète le « risque de déclassement de la France » comme une interaction de crises (agricole, démographique, militaire).
-
[3]
« On veut le Roi ! C’est sous ce titre que nous plaçons les pétitions royalistes […]. Le pays veut la Monarchie, il commence à le crier très haut ; il faudra bien qu’on se rende aux vœux du pays. » (La Gazette d’Auvergne no 268, du mercredi 12 novembre 1873, p. 1, col. 3)
-
[4]
Le fait pétitionnaire a donné lieu à des journées d’études : le samedi 11 mars 2006, à Lyon (Institut d’histoire du christianisme/resea-larhra, Université Lyon-III), sur les « Suppliques et pétitions de l’époque moderne à nos jours » ; le mardi 23 octobre 2007, à Paris (Archives nationales de France), intitulée « L’individu face au pouvoir : les pétitions aux assemblées parlementaires » ; le vendredi 25 mars 2011, à Marne-la-Vallée (laboratoire acp, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée), sur le thème « Changements de régime et mouvements pétitionnaires » et au cours de laquelle nous avons donné une communication sous le titre de « “On veut le Roi !” Le mouvement pétitionnaire royaliste de 1873-1874 ». Voir aussi le travail de collecte des pétitions et de construction d’une base de données mené par le laboratoire Analyse comparée des pouvoirs (acp) de l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée : « Enquête no 1 : Les pétitions adressées aux assemblées (Chambre et Sénat) de 1815 à 1940 ». L’équipe du laboratoire acp est composée de Fabienne Bock et Thierry Bonzon pour la Troisième République et la Grande Guerre, Mathilde Larrère et Frédéric Moret (responsable) pour la monarchie de Juillet, et Philippe Grandemange pour le traitement informatique des données (pétitions).
-
[5]
Yann-Arzel Marc, La Naissance du droit de pétition. Contribution à l’histoire de la démocratie représentative, thèse de doctorat, Paris-I, 2004, p. 17.
-
[6]
Pour le Moyen Âge, voir notamment : Claude Gauvard, « Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au xive siècle », dans Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, André Gouron et Albert Rigaudière (dir.), Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 1988, p. 89-98 ; Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (xiie-xve siècle), Hélène Millet (dir.), coll. de l’École française de Rome, no 310, Rome, 2003, 434 p. ; Sophie Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V. 1328-1380, Paris, De Boccard, 2003, 529 p., en particulier p. 268-307.
-
[7]
Charles Tilly, La France conteste : de 1600 à nos jours, Paris, Fayard, coll. « L’Espace du politique »,1986, 622 p. L’auteur donne en deux tableaux les « Caractéristiques du répertoire de l’action collective en France entre 1650 et 1850 – une sorte de typologie des formes de contestation – sans mentionner la pétition (p. 544-545).
-
[8]
« La requête [requeste ou petitio], véritable système de gouvernement, permet d’associer le royaume à l’impulsion et à l’initiative de la loi. Elle pèse de tout son poids pour influencer, orienter la législation décidée par le pouvoir royal. » (Sophie Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V. 1328-1380, op. cit., p. 307).
-
[9]
Pierre Magnette, « Vers une citoyenneté européenne directe ? Pratiques du droit de pétition dans l’Union européenne », Revue internationale de politique comparée, 2002, no 1, vol. 9, p. 66. Pour la construction juridique du droit de pétition, voir le travail ancien mais fondamental de Jacques Leclerc, Le Droit de pétition. Étude de droit public comparé, thèse de doctorat, Châtillon- sur-Seine, impr. Ernest Leclerc, 1913, XII-218 p. Récemment, ces travaux ont été en partie renouvelés en science politique par Jean-Gabriel Contamin, Contribution à une sociologie des usages pluriels des formes de mobilisation. L’exemple de la pétition en France, 2 vol., thèse de doctorat, Paris-I, 2001, 816 p.
-
[10]
Nicolas Werth, « Le Grand retour, urss 1945-1946 », Histoire@Politique. Politique, culture, société, no 3, novembre-décembre 2007, 11 p. (édition électronique).
-
[11]
Marc Bloch, Les Rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, nouvelle édition, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1993, p. 19.
-
[12]
an, C-4212, dossier de pétition(s) [désormais d. p.] no 6428 ; C-4260, d. p. no 6124, 6204, 6245, 6265 ; C-4271, d. p. no 6059, 6063, 6118…
-
[13]
Christine Fauré, « Doléances, déclarations et pétitions, trois formes de la parole publique des femmes sous la Révolution », Annales historiques de la Révolution française [désormais AhRf], no 344, avril-juin 2006, p. 20. L’auteur constate combien les « pétitions collectives de femmes […] sont peu fréquentes » sous la Révolution, et que cette idée « n’est pas familière à l’époque » ou « en tout cas ne se traduit guère sur le plan de l’expression ». Le dernier tiers du xixe siècle semble avoir enregistré une notable évolution, au moins en ce qui concerne les pétitionnaires royalistes.
-
[14]
Nous empruntons cette expression à Pippa Norris dans Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance, Pippa Norris (dir.), Oxford, Oxford University Press, 1999, 324 p.
-
[15]
Gisela Naegle donne et analyse un riche échantillon terminologique tiré des sources médiévales (xive-xve siècle) dans « Vérités contradictoires et réalités institutionnelles. La ville et le roi en France à la fin du Moyen Âge », Revue historique, 2004/2, no 632, p. 727-762.
-
[16]
Jane Burbank, « Litiges civils dans la Russie rurale des années 1905-1917 », Genèses, mars 2003, p. 24-49 ; Mark S. R. Jenner, « L’eau changée en argent ? La vente de l’eau dans les villes anglaises au temps de l’eau rare », xviie siècle, 2003/4, no 221, p. 637-651 ; Carola Lipp, « Culture et mobilisation politiques en période de révolution. L’exemple du mouvement pétitionnaire d’Esslingen de 1848-1849 », Revue d’histoire du xixe siècle [désormais RhXIX] no 15, 1997/2, p. 49-65.
-
[17]
Voir les subtilités dialectiques du « bien commun » dans les « mémoires » des villes de France mises en relief par Gisela Naegle, « Vérités contradictoires et réalités institutionnelles. La ville et le roi en France à la fin du Moyen Âge », op. cit.
-
[18]
Nous avons adopté cette dénomination par commodité. Elle ne renvoie pas systématiquement à une réalité homogène.
-
[19]
Jean Charlot, Les Partis politiques, Paris, Armand Colin, coll. « U2 », 1971, 256 p., et en particulier p. 11-20. « […] [Le] “parti” représente dans toute la première partie du xixe siècle, et encore en 1869, une “tendance”, une “opinion”, qui cristallise les idées d’une classe ou d’un groupe social, plus ou moins distingué des autres. (p. 12) Cette appréciation reste valide en 1873. Voir aussi plus récemment Raymond Huard, La Naissance du parti politique en France, Paris, Presses de la fnsp, 1996, 383 p. « Pour les pétitionnaires, l’instauration du suffrage universel a permis de pacifier le champ politique en apprenant aux masses le sens de la légalité. Contre le parti de l’ordre qui y voit une source de désordre, ils insistent au contraire sur la fonction pacificatrice du suffrage universel. » (François Jarrige, « Une barricade de papiers : le pétitionnement contre la restriction du suffrage universel masculin en mai 1850 », RhXIX, no 29, 2004, p. 53.)
-
[20]
Suzanne Desan, « Pétitions de femmes en faveur d’une réforme de la famille », AhRf, no 344, avril-juin 2006, p. 27-46. Odile Krakovitch, « Les pétitions, seul moyen d’expression laissé aux femmes. L’exemple de la Restauration », dans Femmes dans la cité (1818-1871). Actes du colloque de Paris des 20 & 27 novembre 1992, Alain Corbin, Jacqueline Lalouette & Michèle Riot-Sarcey (dir.), Grâne, Créaphis, 1997, p. 347-372.
-
[21]
Jennifer Heuer, « “Réduit à désirer la mort d’une femme qui peut-être lui a sauvé la vie” : la conscription et les liens du mariage sous Napoléon », AhRf, no 348, avril-juin 2007, p. 25-40.
-
[22]
Stéphane Rials, Le Légitimisme, Paris, puf, coll. « Que sais-je ? », 1983, 125 p., « Chapitre ii. Les sociétés légitimistes », p. 23-33.
-
[23]
Voir la communication de Mathilde Larrère, « Les stratégies pétitionnaires au xixe siècle », journée d’étude du laboratoire acp sur les pétitions du 30 mai 2008.
-
[24]
Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs & politiques des chambres françaises imprimé par ordre du corps législatif [désormais Ap], Jérôme Mavidal & Émile Laurent (dir.), première série (1789 à 1799), t. VIII, Assemblée nationale constituante du 5 mai 1789 au 15 septembre 1789, Paris, la de Paul Dupont, 1875, LXIV-731 p. ; « Règlement à l’usage de l’Assemblée constituante. Chapitre v. Des pétitions. 1o– Les pétitions, demandes, lettres, requêtes ou adresses seront ordinairement présentées à l’Assemblée par ceux de ses membres qui en seront chargés » (p. 302).
-
[25]
Les Constitutions de la France depuis 1789, présentation par Jacques Godechot, Paris, Flammarion, 1979, p. 34. La constitution du 3 septembre 1791 porte : « Titre premier. Dispositions fondamentales garanties par la Constitution. […] La liberté d’adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement » (ibid., p. 36).
-
[26]
Yann-Arzel Marc, La Naissance du droit de pétition. Contribution à l’histoire de la démocratie représentative, op. cit., p. 424.
-
[27]
Christine Fauré, « Doléances, déclarations et pétitions, trois formes de la parole publique des femmes sous la Révolution », op. cit., p. 17. Jacques Leclerc, Le Droit de pétition. Étude de droit public comparé, op. cit., p. 72-92 (une histoire des restrictions dans une perspective comparatiste européenne).
-
[28]
Ibid., p. 62-71.
-
[29]
Yann-Arzel Marc, La Naissance du droit de pétition. Contribution à l’histoire de la démocratie représentative, op. cit., p. 95.
-
[30]
Pour la période, lire Jean-Pierre Dionnet, Le Droit de pétition durant la Restauration. 1814-1830. Contribution à l’histoire socio-politique française du xixe siècle, 3 vol., thèse de doctorat, Poitiers, 2001, 1400 p. Couvre la Restauration et le régime de Juillet : Benoît Agnes, L’Appel au pouvoir. Essai sur le pétitionnement auprès des chambres législatives et électives en France et au Royaume-Uni entre 1814 et 1848, 2 vol., thèse de doctorat, Paris-I, 2009, 847 p.
-
[31]
Ap, deuxième série (1800 à 1860), t. XXVI, p. 32 & 29.
-
[32]
Ap, première série (1787 à 1789), t. XXV, p. 680.
-
[33]
Christelle Barré, « Les pétitions envoyées à l’Assemblée nationale entre 1834 et 1836 », mémoire de maîtrise, Centre de recherches historiques Jean-Bouvier, Paris-VIII, 1997, 174 p. ; Pascal Mgonbo, « Les pétitions populaires à la Chambre des députés sous la monarchie de Juillet (1830-1835). Contribution à l’étude du régime représentatif », Revue de recherche juridique. Droit prospectif, 1999, no 1, 24e année, 77e numéro, p. 251-274.
-
[34]
Christophe Premat, « Populisme et démocratie semi-directe : la dénaturation des procédés référendaires en France et aux États-Unis », Amnis, no 5, 2005, § 1-24 (édition électronique). L’auteur y oppose une « démocratie à tendance référendaire » (Condorcet) à l’idée d’une « volonté générale plébiscitée par tous » (Rousseau). Il rappelle que le marquis « a ainsi affirmé à plusieurs reprises le droit d’initiative populaire direct et indirect dans le projet de Constitution qu’il présente devant la Convention le 29 septembre 1792 », lequel incluait à la fois le mode consultatif descendant (référendum) et le mode réclamatif ascendant (pétition). Anne-Cécile Lemercier explique la genèse et l’échec du projet en France dans « Le référendum d’initiative populaire : un trait méconnu du génie de Condorcet », Revue française de droit constitutionnel, 55, 2003, p. 483-512.
-
[35]
François Jarrige, « Une barricade de papiers : le pétitionnement contre la restriction du suffrage universel masculin en mai 1850 », op. cit., p. 53.
-
[36]
Maurice Agulhon, 1848 ou l’Apprentissage de la République. 1848-1852, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Points Histoire », 1973, p. 151.
-
[37]
François Jarrige, « Une barricade de papiers : le pétitionnement contre la restriction du suffrage universel masculin en mai 1850 », op. cit., p. 53.
-
[38]
Sylvie Ollitrault, « Les écologistes français, des experts en action », Revue française de science politique, vol. 51, nos 1-2, février-avril 2001, p. 105-130 ; « De la caméra à la pétition Web : le répertoire médiatique des écologistes », Réseaux, 17 (98), 1999, p. 119-153. Ainsi que le montre S. Ollitrault pour les écologistes, le militant moderne a recours à la pétition pour acter publiquement son engagement politique. Les moyens techniques évoluent, mais, dans l’esprit, la différence avec son prédécesseur de 1873-1874 est quasi nulle.
-
[39]
Signèrent ès qualités : un « membre du conseil général » du département des Côtes-du-Nord (an, C-4271, d. p. no 5970 non légalisé, datée de « Quintin (Côtes-du-Nord), le 3 9bre 1873 »), Henry Paranque, juge au tribunal de commerce de Marseille (an, C-4271, d. p. no 6044, pétition datée de « Marseille, 10 Novembre 1873 »), le maire de la commune de Cour’ch, dans le Finistère (an, C-4271, billet manuscrit du d. p. no 6057, sans date). Le mouvement pétitionnaire en faveur de la libération de la duchesse de Berry (hiver 1832-1833) constitue un précédent pour des autorités légales d’opinion royaliste.
-
[40]
L’Assemblée nationale de 1872 no 168, du mercredi 1re octobre 1873, extrait d’un article d’Alexandre de Saint-Chéron intitulé « Nos devoirs », p. 1, col. 1.
-
[41]
« On connaît les procédés que la nation des nouvelles couches sociales met en usage pour faire rentrer les assemblées dans le néant. Cela va du pétitionnement à l’insurrection, à la révolution spontanée » (L’Assemblée nationale de 1872 no 171, du samedi 4 octobre 1873, p. 1, col. 4-5, nous soulignons).
-
[42]
L’Assemblée nationale de 1872 no 212, du vendredi 14 novembre 1873, p. 1, col. 1.
-
[43]
L’Assemblée nationale de 1872 no 213, du samedi 15 novembre 1873, p. 1, col. 1.
-
[44]
La France nouvelle politique et littéraire no 668, des lundi et mardi 10 et 11 novembre 1873, p. 1, col. 4. Une rubrique ad hoc fut créée : « Le mouvement royaliste », et qui s’éteignit dans la première semaine de décembre 1873. Nous avons constaté le même phénomène dans le reste de la presse légitimiste concernée, avec la disparition des recensions entre la dernière semaine de novembre et la première de décembre (Le Drapeau français [Perpignan], L’Écho de Fourvières, L’Espérance du peuple [de Nantes], La Gazette d’Auvergne, La Guienne, La Liberté de Caen, Le Publicateur [de Vendée], Le Roussillon, L’Union…). L’Univers catholique n’était pas en reste avec sa rubrique : « Les Pétitions monarchiques ».
-
[45]
L’Union no 310, du jeudi 6 novembre 1873, p. 1, col. 4.
-
[46]
Représentant est le terme approprié pour désigner les membres de l’Assemblée nationale de 1871 à 1876. Nous utilisons aussi celui de député par commodité et parce qu’il est parfois employé dans les sources.
-
[47]
L’Union no 310, p. 1, col. 3. Le texte publié dans le quotidien est suivi de 40 noms. Nous n’avons pas trouvé l’original de cette pétition « initiale » aux Archives nationales.
-
[48]
an, C-4271, d. p. no 5961, département de la Seine, dont une série datée de « Paris, Le 22 Octobre 1873 ». an, C-4259, d. p. no 5960, pétition datée de « Meuvy le 26 octobre 1873 ».
-
[49]
« Les Gauches se remuent et font sig[n]er des adresses c[ontre] le retour de la monarchie […]. » (Archivio di Stato di Lucca, Archivio dei Borboni di Francia, carton no 10, dr. no 3, « Journal de M. (?), 1852-1881 », [désormais aslu, abf, jm] « 1873. Journal de Mgr », « 27 [octobre]. (lundi) », Cette copie du journal du comte de Chambord fut écrite par le père Eugène Marquigny entre janvier 1884 et début août 1885. Le contenu nous a été confirmé dans Henri comte de Chambord, Journal (1846-1883). Carnets inédits, texte établi et annoté par Philippe Delorme, Paris, François-Xavier de Guibert, coll. « Histoire essentielle », 2009, p. 581.
-
[50]
L’Union no 326, du samedi 22 novembre 1873, p. 1, col. 2.
-
[51]
Une partie de la presse royaliste ne comprenait pas la position du directeur de La Décentralisation, Charles Garnier. En effet, en tant que président du congrès de la presse provinciale légitimiste, il venait de jouer un rôle fédérateur à propos d’une adresse d’allégeance au comte de Chambord initialement signée par 85 journaux royalistes de province (voir La Presse du mardi 30 septembre 1873, p. 1, col. 4) pour le dernier anniversaire du prince.
-
[52]
L’Indépendance bretonne. Journal catholique, politique, littéraire, commercial, maritime et agricole no 1198, du lundi 24 novembre 1873, p. 3, col. 3-4.
-
[53]
La Guienne no 23567, du jeudi 20 novembre 1873, p. 1, col. 6.
-
[54]
« À Messieurs les Députés de l’Assemblée nationale. […] Chartres, le 14 novembre [1873] » (L’Union no 321, du lundi 17 novembre 1873, p. 1, col. 3).
-
[55]
« Messieurs les députés de la Loire-Inférieure » (L’Union no 315, du mardi 11 novembre 1873, p. 1, col. 4, télégramme en provenance de Nantes, en date du 10 novembre 1873). « À Messieurs les députés d’Ille-et-Vilaine » (L’Union no 317, du jeudi 13 novembre 1873, p. 1, col. 2).
-
[56]
« À Monsieur le général Changarnier, président de la Commission des neuf » (L’Union no 311, du vendredi 7 novembre 1873, p. 1, col. 3).
-
[57]
Depuis 1870, la propagande avait largement donné le la sur la thématique du « salut de la France » pour influer sur les populations, y compris les illettrés. Puisés dans la palette d’une production non négligeable, nous trouvons : docteur Auguste Labat, République et monarchie ou le Salut de la France, Paris, typ. A. Hennuyer, 1871, 15 p. (partisan d’une monarchie constitutionnelle censitaire avec Henri V) ; Henri Lemoine, La Fusion salut de la France, Lorient, impr. centrale Eug. Grouhel, 1871, 35 p. (henriquinquiste) ; Étienne Pigelet, À la patrie en deuil. Le salut de la France, Bourges, typ. de E. Pigelet, 1871, IV-28 p. ; Alexandre de Saint-Albin, Le Sacré-Cœur. Salut de la France, Poitiers, H. Oudin, 1873, 35 p. (tenant de l’inséparatisme catholico-royaliste)
-
[58]
Dès l’époque de l’attente fébrile de la naissance d’un héritier mâle (1816-1820), cette idée avait animé la politique de (re)conquête de l’opinion publique des Bourbons. Le « Berceau de parade du duc de Bordeaux » en est l’exemple même. Conçu comme une barque (la France) avec en proue l’allégorie de la Renommée (femme ailée figurant l’opinion publique) portant haut une corne d’abondance, il est paré sur ses flancs de médaillons représentant les arts et les sciences, autant de symboles de paix, de confiance en la dynastie renaissante et de prospérité économique (musée des Arts décoratifs, Inv. mob nat gmec 38).
-
[59]
Malgré des variantes dans leur formulation, des pétitions réclamaient la restauration du roi Henri V. D’après notre sondage sommaire pour 1871 dans les Archives nationales, Série C « Assemblées nationales », C-4390, Rôle des pétitions adressées à l’Assemblée nationale, session de 1871 : d. p. no 32 du 16 février (Paris), no 991 du 27 mai (Vienne), no 1011 du 29 mai (Ille-et-Vilaine), no 1063 du 1re juin (Paris), no 1104 du 4 juin (Indre-et-Loire), no 1229 du 12 juin (Pyrénées-Orientales), no 1360 du 20 juin (Marseille), no 1599 du 3 juillet (Loir-et-Cher), no 1610 du 3 juillet (Seine-Inférieure). Pour le second semestre de 1871, nous n’avons trouvé aucune mention de pétition de ce type.
-
[60]
an, C-4391, rôles no 9 à 16 : 5 dossiers de pétition(s) collective(s) et 4 de pétition(s) individuelle(s).
-
[61]
an, C-4391 & 4392, Rôles des pétitions adressées à l’Assemblée nationale, sessions de 1873 et 1874 ; en particulier du 23e au 31e rôle, d. p. no 5970 à 6895.
-
[62]
La pétition d’habitants de Carpentras (Vaucluse) fut déposée par le député de la Haute-Garonne, Gabriel de Belcastel, le 27 novembre. Celle d’habitants de Lyon (Rhône) fut remise le 2 décembre par le député d’Ille-et-Vilaine, Du Temple de La Croix. Celle d’habitants de Fougères (Ille-et-Vilaine) fut portée par le député du Morbihan, Armand de Cintré.
-
[63]
an, C-4391 : 20e rôle, d. p. no 5765 enregistré le 26 mai et no 5784 (5 juin) ; 21e rôle, d. p. no 5839 (26 juin) et no 5848 (27 juin).
-
[64]
L’Union no 304, du vendredi 31 octobre 1873, lettre du comte de Chambord à Charles Chesnelong datée de « Salzbourg, 27 octobre 1873 », p. 1, col. 1.
-
[65]
« N’oublions pas, d’ailleurs, que le provisoire actuel est maintenu jusqu’au vote des lois constitutionnelles, par conséquent, l’expression des sentiments royalistes reste libre encore, et nous ne pouvons qu’engager nos amis à continuer le mouvement des pétitions » (La France nouvelle no 678, du samedi 22 novembre 1873, p. 2, col. 1). Les pouvoirs du maréchal de Mac-Mahon venaient d’être prorogés l’avant-veille, en place d’une restauration monarchique, mais sans établir constitutionnellement de régime républicain.
-
[66]
Force nous a été de constater qu’au sein d’une même liasse, l’écart entre les dates de rédaction ou de signature (il est presque impossible de discerner entre les deux) des différentes pétitions pouvait être parfois de quelques jours (an, C-4260, d. p. no 6246, entre le 13 et le 15 décembre 1873 pour celles qui sont datées), voire de quelques semaines (an, C-4260, d. p. no 6275, entre le 24 novembre et le 24 décembre 1873).
-
[67]
La pétition porte la date de « Quintin, (Côtes-du-Nord), le 3 9bre 1873 ». Suivent 31 signatures (an, C-4271, d. p. no 5970).
-
[68]
aslu, abf, jm, « 1873. Journal de Mgr. Voyage en France », « 11 [novembre]. (mardi) ». Voir aussi comte de Chambord, Journal (1846-1883). Carnets inédits, op. cit., p. 586.
-
[69]
C’est ainsi qu’il faut probablement entendre la position de L’Indépendance bretonne (voir supra).
-
[70]
AN, C-4392, d. p. no 6895.
-
[71]
Entre le 6 et le 23 juin, aucune pétition ne fut inscrite sur les rôles. Un groupe de trois adresses apparaît à la fin de juin, suivi, quasiment un mois plus tard, d’un dernier « paquet » de quatre pétitions. Sur ces sept derniers dossiers parvenus, deux étaient des œuvres collectives (an, C-4392, d. p. no 6679 et no 6735, enregistrées respectivement le 24 juin et le 20 juillet). D’août à décembre 1874, trois dossiers pétitionnaires seulement sont mentionnés. Une pétition individuelle en provenance de La Réunion (an, C-4392, d. p. no 6784, arrivée le 7 août) dont l’origine ultramarine – unique en son genre dans nos sources ! – l’exclut de notre corpus. Deux adresses, celle d’un Tarbais arrivée le 19 septembre (an, C-4392, d. p. no 6822) et celle de 85 habitants de la Mayenne enregistrée le 17 décembre (an, C-4392, d. p. no 6895), sont prises en compte du fait que le choix du régime n’avait pas encore été entériné, et malgré leur caractère tardif qui les détache notablement de la vague principale. Chez quelques royalistes, l’espoir demeurait.
-
[72]
Steven D. Kale, Legitimism and the Reconstruction of French Society. 1852-1883, Baton Rouge & London, Louisiana State University Press, 1992, XVIII-374 p., précisément « Map VIII Petitions in 1873 for Reestablishment of Monarchy », p. 53, où l’auteur a donné une cartographie départementale des pétitions, mais sur la base d’un corpus de sources incomplet. Nous proposons en annexe 1 un essai de cartographie de cette géographie des dossiers de pétitions à partir d’un corpus exhaustif, mais avec une approche méthodologique différente.
-
[73]
Voir notre essai de représentation graphique en annexe 2.
-
[74]
L’annexe 3 donne la répartition géographique du nombre de signatures pour 42 des 43 départements du corpus.
-
[75]
Le comte de Chambord tenait la royauté au-dessus des partis. « On se dira que j’ai la vieille épée de la France dans la main, et dans la poitrine ce cœur de Roi et de père qui n’a point de parti. Je ne suis point un parti et je ne veux pas revenir pour régner par un parti » (Lettre du comte de Chambord à un membre de l’Assemblée nationale en date du 8 mai 1871 et publiée dans L’Union no 111 du samedi 13 mai 1871, p. 1, col. 1 & 2).
-
[76]
Selon nos sondages dans la masse des pétitions, les républicains développèrent localement leur pétitionnement davantage au moyen d’imprimés normalisés. Ainsi, dans le département du Var où 62 pétitions d’un même modèle totalisèrent quelque 520 signatures collectées entre le 12 et le 15 novembre dans cinq communes, qui furent déposées le 17 à Versailles par deux députés du cru.
-
[77]
Les députés royalistes du Morbihan, élus entre février 1871 et avril 1873, appartenaient, pour quelques-uns, au courant modéré (Audren de Kerdrel, Bouché, Pioger, Savignac), et, pour la majorité d’entre eux, à l’extrême droite (Dahirel, Fresneau, Du Bodan, Gouvello, Jaffré, Kéridec, La Monneraye, Martin d’Auray).
-
[78]
an, C-4259, d. p. no 6042 (3 exemplaires), no 6054 & no 6086 (5 exemplaires) ; C-4260, d. p. no 6244 & no 6266.
-
[79]
an, C-4259, d. p. no 6068 (2 exemplaires) ; C-4260, d. p. no 6119 (4 exemplaires) & no 6256 ; C-4211, d. p. no 6355 ; C-4271, d. p. no 6005 (98 exemplaires touchant toute la conurbation lilloise !).
-
[80]
an, C-4260, d. p. no 6265 & no 6247 (4 exemplaires).
-
[81]
« On dirait le pontife de la légitimité, le grand-prêtre de la religion monarchique célébrant la puissance et l’éternité de son dogme devant un peuple qui l’oublie et se fourvoie […] » (Jean Léonce Dubosc de Pesquidoux, Le Comte de Chambord d’après lui-même, Paris, V. Palmé, 1887, p. 91, commentaire du manifeste du 25 octobre 1852 ). Stéphane Rials, « Contribution à l’étude de la sensibilité légitimiste : le “chambordisme” », dans Les Mélanges offerts à Pierre Montané de La Roque, vol. 2, Toulouse, Presses de l’iep, 1986, p. 633-646 ; et particulièrement « II. Aspects du chambordisme : une religion royale », p. 639-646.
-
[82]
L’Union no 304, du vendredi 31 octobre 1873, lettre du comte de Chambord à Charles Chesnelong datée de « Salzbourg, 27 octobre 1873 », p. 1, col. 1.
-
[83]
Au lendemain de l’épisode de la Commune, le comte de Chambord s’adressait aux Français dans un manifeste daté de « Chambord, 5 juillet 1871 ». « Ce sont les classes laborieuses, ces ouvriers des champs et des villes, dont le sort a fait l’objet de mes plus vives préoccupations et de mes plus chères études, qui ont le plus souffert de ce désordre social » (L’Union no 166, du samedi 8 juillet 1871, [p. 1, col. 1 & 2]).
-
[84]
« Appliquez-vous surtout à faire appel au dévouement de tous les honnêtes gens sur le terrain de la réconciliation sociale. Vous savez que je ne suis point un parti, et que je ne veux pas revenir pour régner par un parti : j’ai besoin du concours de tous, et tous ont besoin de moi » (L’Union no 274, du mercredi 1re octobre 1873, lettre du comte de Chambord au comte de Rodez-Benavent, datée de « Frohsdorf le 19 septembre 1873 », p. 1, col. 3).
-
[85]
an, C-I-420, Assemblée nationale, « Procès-verbaux des séances de l’Assemblée nationale. 19 mai-31 décembre 1873 », notamment la « Séance du Lundi 23 Juin 1873 ».
-
[86]
Environ 71 % des dossiers de pétitions enregistrés au bureau de l’Assemblée nationale ne contiennent aucune adresse légalisée par une autorité administrative (mention, signature et cachet officiel).
-
[87]
« Pour attestation des soixante-quinze adhésions ci-dessus. Le Secrétaire de la Rédaction : [suivent le cachet de “L’Ordre et la Liberté-Caen” et la signature] » (an, C-4272, d. p. no 6183, manuscrit no 23).
-
[88]
an, C-4272, d. p. no 6515 & 6207.
-
[89]
an, C-4271, d. p. no 6120 qui porte au dos la mention suivie de la signature de l’officier municipal : « Vu par nous adjoint au maire de la Commune de Bondues pour légalisation des signatures ci-dessus. Bondues, le 19 novembre 1873. » Dans la même liasse, la pétition d’habitants d’Auchy connut le même sort. « Vu par nous Maire de la commune d’Auchy pour légalisation des signatures apposées ci-dessus. Auchy le 20 9bre 1873. Le Maire [signature]. » Nous avons trouvé d’autres cas de ce type (voir an, C-4271, une pétition dans le d. p. no 6047, une autre dans le d. p. no 6108, etc.).
-
[90]
an, C-4272, d. p. no 6139. Paulin Bienvenue était représentant centre droit du Finistère, membre de l’Union des droites, président de la 23e commission des pétitions de l’Assemblée nationale.
-
[91]
an, C-4271, d. p. no 6048, pétition d’habitants de la commune de Muzillac (Morbihan).
-
[92]
La démarche pétitionnaire relativement modeste des bonapartistes dès l’automne 1873 fut surtout l’œuvre du très dynamique député de la Charente-Inférieure, le baron Eugène Eschassériaux. Sa tactique laisse perplexe. Il déposa les pétitions des habitants des communes de Saint-Émilion, Saint-Étienne-de-Lisse (Gironde) et Marcelcave (Somme) au bureau de l’Assemblée nationale le 11 juillet 1874 alors que les adresses girondines avaient été légalisées respectivement le 12 et le 22 décembre 1873 ! (an, C-4261, d. p. no 6715, pétition datée de « Septembre-Octobre 1873 ») Préféra-t-il les réserver pour un moment plus opportun plutôt que de voir leur effet anéanti par le nombre des pétitions royalistes ? La motion demandant d’user de l’appel au peuple pour déterminer la forme du régime pour la France et portée par Eugène Rouher fut largement repoussée le 19 novembre 1873 par l’Assemblée nationale malgré le renfort des républicains plébiscitaires. Voir Thierry Truel, « Le spectre impérial au début de la IIIe République : entre fantasmes et réalités », Parlement[s]. Revue d’histoire politique [désormais PRhp], 2008, hors-série no 4, p. 149-155.
-
[93]
an, C-4259, d. p. no 5962, pétition datée de « Pont-Remy, Le 2 novembre 73. » Cent cinquante-deux signatures d’habitants « électeurs » de cette commune de la Somme exprimaient leur rejet de la solution monarchique en général et de la restauration d’Henri V en particulier (référence à la royauté deux fois renversée).
-
[94]
Ibid., et an, C-4259, d. p. no 5960, pétition datée de « Meuvy le 26 octobre 1873 ». La diffusion du langage juridique renvoie à l’essor de ces jeunes républicains des « classes moyennes juridiques » qui cherchaient à acquérir une position sociale (Christophe Charle, « La bourgeoisie de robe en France au xixe siècle », Le Mouvement social, [désormais lms], no 181, 1997, p. 53-72). Voir aussi Laurent Willemez, Des avocats en politique (1840-1880). Contribution à une socio-histoire de la profession politique en France, thèse de doctorat, Paris-I, 2000, 698 p.
-
[95]
Par exemple : « Les soussignés, convaincus que la Monarchie héréditaire et traditionnelle peut seule conjurer les périls de la situation et mettre un terme aux souffrances du commerce, de l’agriculture et de l’industrie ; […] » (an, C-4259, d. p. no 6042, pétition datée de « Rohan le 18 novembre 1873 »). La formule fut copiée dans d’autres pétitions, comme dans celle d’habitants du canton de Saint-Jean-Brévelay (an, C-4259, d. p. no 6086).
-
[96]
« On dit que la monarchie traditionnelle est incompatible avec l’égalité de tous devant la loi. Répétez bien que je n’ignore pas à ce point les leçons de l’histoire et les conditions de vie des peuples. » (Lettre du comte de Chambord du 8 mai 1871, op. cit. (n. 75), p. 1, col. 2.) « Il ne s’agit de rien moins que de reconstituer sur ses bases naturelles une société profondément troublée, d’assurer avec énergie le règne de la loi […]. » (L’Union no 304, du vendredi 31 octobre 1873, lettre du comte de Chambord à Charles Chesnelong datée de « Salzbourg, 27 octobre 1873 », p. 1, col. 1)
-
[97]
Bernard H. Moss, The Origins of the French Labor Movement. 1830-1914. The Socialism of Skilled Workers, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1976, XIII-217 p.
-
[98]
an, C-4259, d. p. no 5964, pétition datée du « Pont-de-Chaix le 2 novembre 1873 » qui comptait 92 signatures d’habitants de la commune plus 3 d’habitants de communes contiguës.
-
[99]
an, C-4259, trois pétitions enregistrées sous le no 6042 : « Moustoir-Ac le 18 9bre 1873 » (81 signatures), « Rohan le 18 novembre 1873 » (44 signatures), et celle de la commune de Serent (38 paraphes) qui n’est pas datée.
-
[100]
an, C-4259, d. p. no 6061, pétition datée de « Montpellier le douze novembre 1873 », [fol. 1]. Huit pétitions émanant d’autant de communes suivent un modèle rédactionnel similaire.
-
[101]
Le département de l’Hérault était occupé à hauteur de 30 à 39 % (tranche médiane au niveau national) par des propriétés foncières de plus de 100 ha (grande exploitation). Le faire-valoir (propriétaires exploitants) direct représentait plus de 90 % de la population occupée dans l’agriculture. L’Hérault était au premier rang national pour la surface viticole (226 000 ha). Voir la publication du ministère de l’Agriculture, Direction de l’Agriculture, Atlas de statistique agricole. Résultats généraux des statistiques agricoles décennales de 1882 et de 1892, Paris, Imprimerie nationale, MDCCCXCVII, 8 p.-xx planches ; et aussi celle du ministère des Finances, Direction générale des Contributions directes, Document statistique sur les cotes foncières de propriétés non bâties et les cotes personnelles-mobilières, Paris, Imprimerie nationale, 1896, 139 p.
-
[102]
La France de 1873 est principalement rurale et agricole. Cette année fut marquée par de mauvaises récoltes. « Cette crise est d’autant plus grave qu’elle a un caractère régional marqué, mais qu’aucune région n’y échappe » (Albert Broder, L’Économie française au xixe siècle, Paris, Ophrys, coll. « Synthèse et Histoire », 1993, p. 120). Par exemple, en 1873, le département de l’Hérault connut une chute importante dans ses productions d’avoine, de blé et de vin (de nombreux renseignements sur la décennie 1870 se trouvent dans la publication du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, Direction du Travail, Service de recensement, Album graphique de la statistique générale de la France. Résultats statistiques du recensement de 1901. Mouvement des populations. Résumé rétrospectif de l’annuaire statistique, Paris, Imprimerie nationale, MDCCCCVII, VII-280 p.).
-
[103]
Il est vrai que la valeur de la production viticole – nous avons dans ce département une majorité de viticulteurs – qui connut un pic en 1869 avait significativement baissé depuis : plus de 25 fr./hl. en 1869 à moins de 19 fr./hl. en 1873 (Pierre Barral, Les Agrariens français, de Méline à Pisani, Paris, A. Colin, 1968, p. 70).
-
[104]
an, C-4259, d. p. no 6061, pétition datée de « Capestang, le 21 novembre 1873 ».
-
[105]
an, C-4260, d. p. no 6187, pétition datée « Au Marillais le 12 décembre 1873 ».
-
[106]
an, C-4272, d. p. no 6321.
-
[107]
[anonyme] Nécessité de la République. Le salut de la France, Paris, E. Dentu, janvier 1871, 34 p. ; Hippolyte Destrem, Perte ou salut de la France. Quarante ans de décadence. République rénovatrice, Paris, E. Lachaud, 1871, 142 p.
-
[108]
Voir l’analyse pionnière que Philippe Levillain a proposée et développée à propos du concept d’« inséparatisme » (opposé à celui de « séparatisme ») dans Albert de Mun. Catholicisme français et catholicisme romain du Syllabus au Ralliement, Rome, École française de Rome, 1983, p. 572-577.
-
[109]
« Je ne ramène que la religion, la concorde et la paix ; et je ne veux exercer de dictature que celle de la clémence ; parce que dans mes mains, et dans mes mains seulement, la clémence est encore la justice » (lettre du comte de Chambord du 8 mai 1871, op. cit. (n. 75, p. 1, col. 2).
-
[110]
Ce qui amena rapidement le comte de Chambord à dresser un amer constat. « En être réduit en 1873 à évoquer le fantôme de la dîme, des droits féodaux, de l’intolérance religieuse, de la persécution contre nos frères séparés ; que vous dirais-je encore, de la guerre follement entreprise dans des conditions impossibles, du gouvernement des prêtres, de la prédominance des classes privilégiées ! Vous avouerez qu’on ne peut pas répondre sérieusement à des choses si peu sérieuses. À quels mensonges la mauvaise foi n’a-t-elle pas recours lorsqu’il s’agit d’exploiter la crédulité publique ? » (L’Union no 274, du mercredi 1re octobre 1873, lettre du comte de Chambord au comte de Rodez-Benavent, datée de « Frohsdorf le 19 septembre 1873 », p. 1, col. 3).
-
[111]
an, C-4260, d. p. no 6250, pétition en provenance de Tréguier (Côtes-du-Nord), enregistrée le 26 décembre 1873.
-
[112]
an, C-4260, d. p. no 6275, pétition légalisée « En Mairie, à Izé, le 24 novembre 1873 », avec quelque 335 signatures.
-
[113]
an, C-4260, d. p. no 6271, pétition arrivée au bureau de l’Assemblée nationale le 30 décembre 1873.
-
[114]
an, C-4260, d. p. no 6130, pétition datée de « Soullans Le 30 9bre 1873 ».
-
[115]
Ibid.. Le mot est souligné dans le manuscrit.
-
[116]
Bernard Ménager, Les Napoléon du peuple, Paris, Aubier, coll. « Historique », 1988, 445 p. « Les plébiscites de 1851-1852 et 1870. % “oui” par rapport aux inscrits » pour le département du Pas-de-Calais : 81,1 ; 82,2 ; 83,7 (annexe 4, p. 432-434).
-
[117]
Sur l’alliance des bonapartistes et des monarchistes en 1873, voir l’analyse de Patrick André, Les Parlementaires bonapartistes de la Troisième République (1871-1940), 2 vol., thèse de doctorat, Paris-IV, 1995, 636 p.
-
[118]
an, C-4261, d. p. no 6679, pétition légalisée en « Mairie de Besançon, le 22 Juin 1874 ».
-
[119]
an, C-4259, d. p. no 6067, pétition des « Fabricants de la Tourlandry 14 9bre 1873 ».
-
[120]
Certaines pétitions imprimées qui circulèrent notamment dans le département du Var portent les vœux des signataires selon un modèle unique. « Les soussignés réclament : 1o La fin du provisoire ; 2o L’organisation définitive de la République » (an, C-4259, d. p. nos 6006, 6022, 6037, soit un total de plus de 3 300 signatures).
-
[121]
an, C-4259, d. p. no 6006, pétitions d’habitants des communes de La Seyne, Rochebaron, Besse, Vidaubon et Garéault (Var) légalisées entre le 12 et le 15 novembre 1873.
-
[122]
an, C-4259, d. p. no 6265, pétition datée d’« Hazebrouck le 15 9bre 1873 ».
-
[123]
an, C-4259, d. p. no 6074, pétition de la commune de Roquebrusanne (Var), en date du 17 novembre 1873. La pétition réclamait d’ailleurs « l’organisation définitive de la République », considérant – à juste titre – que le fonctionnement des institutions provisoires sur un mode républicain depuis février 1871 entérinait de fait le régime.
-
[124]
Nous avons approché dans cet article l’opinion publique royaliste à partir de la réalité des pétitions comme objet d’analyse. À propos du concept sociopolitique d’opinion publique, le débat reste vif entre les « artificialistes » qui font un sort à toute préexistence et à toute latence de l’opinion publique (derrière Pierre Bourdieu, « L’opinion publique n’existe pas », Les Temps modernes, no 318, 1973, p. 1292-1309) et les « objectivistes » qui tiennent l’opinion publique comme une réalité mesurable (après Science et théorie de l’opinion publique. Hommage à Jean Stoetzel, Raymond Boudon, François Bourricaud & Alain Girard (dir.), Paris, Retz, 1981, 316 p.). Voir les stimulants travaux de sociolinguistique de Laurence Kaufmann et notamment « L’opinion publique : oxymoron ou pléonasme ? », Réseaux, no 117, 2003, p. 257-288. Voir aussi le passionnant débat épistémologique entre Brigitte Gaïti, « Comment écrire une histoire qui tient ? À propos de l’opinion publique », lms, 2010/1, no 230, p. 145-150, et Gabriel Galvez-Behar, « Le constructivisme de l’historien. Retour sur un texte de Brigitte Gaïti », 2009/4, lms, no 229, p. 103-113.
-
[125]
Nous avons utilisé un recensement du ministère de l’Agriculture et du Commerce (Service de la Statistique générale de France) Annuaire statistique de la France. Première année. 1878, Paris, Imprimerie nationale, MDCCCLXXVIII, XXVI-590 p. qui donne de nombreux éléments pour 1871-1873. Cet annuaire nous a permis d’évaluer, dans une certaine mesure, le poids numérique des signataires par rapport à une population globale donnée. Malheureusement, pour l’essentiel, il s’agit d’un rapport pour quelques agglomérations, arrondissements ou départements.
-
[126]
an, C-4212, pétition no 6458, légalisée en « Mairie, à la Chapelle Basse Mer, le 19 xbre 1873 ». Malgré une tendance séculaire à la baisse (Lire et écrire. L’alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry, 2 vol., François Furet & Jacques Ozouf [dir.], Paris, Éditions de Minuit, coll. « Le Sens commun », 1977 ;?James Smith Allen, In the Public Eye. A History of Reading in Modern France, 1800-1940, Princeton, Princeton University Press, 1991, XV-356 p.), l’illettrisme restait une constante dans les départements de l’Ouest breton. Le traitement sur un siècle (1803-1902) d’un échantillon de la population française, à partir de « l’enquête des 3 000 familles » dont le patronyme commence par tra, a montré, sur la base de la « signature au mariage », la permanence d’un illettrisme élevé – les deux sexes confondus – dans le département de la Loire-Inférieure (Jean-Pierre Pélissier & Danièle Rébaudo, « Une approche de l’illettrisme en France. La signature des actes de mariage au xixe siècle dans “l’enquête sur les 3 000 familles” », Histoire & mesure, 2004, vol. XIX, nos 1/2, p. 161-202).
-
[127]
Une note manuscrite datée de « Moutiers 5 Xbre 1873 » accompagnait la pétition aux signatures non légalisées de la commune de Gennes. « Monsieur le Maire de Gennes n’a pas voulu consentir à légaliser la pétition de cette Commune, ni à motiver son refus » (an, C-4260, d. p. no 6275).
-
[128]
an, C-4212, d. p. no 6547 enregistré au bureau de l’Assemblée nationale le 25 mars 1874. an, C-4271, d. p. no 6072 arrivé à Versailles le 27 novembre 1873.
-
[129]
Voir an, C-4271, d. p. nos 6046, 6069, 6072 & 6075.
-
[130]
Voir an, C-4271, d. p. no 6005.
-
[131]
Les hobereaux locaux signaient souvent les premiers : « Comte de Beaumont » (C-4271, d. p. no 6033 Vendée), Cte de Bressay » (C-4271, d. p. no 6043, Vendée), « Cte du Pontavice » (C-4272, d. p. no 6173, Ille-et-Vilaine).
-
[132]
Voir l’étude de Brian Fitzpatrick, Catholic Royalism in the Department of the Gard. 1814-1852, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, XI-216 p. Si l’étude porte sur la période antérieure, les grandes lignes de son analyse restent valables pour le début des années 1870.
-
[133]
L’énergie des cercles royalistes de province dérangeait les représentants de l’État qui allaient parfois jusqu’à faire pression sur eux. « On écrit de Marseille qu’à l’occasion du pétitionnement monarchique et après avis de M. le commissaire central, qui invitait à suspendre ce mouvement d’opinion, M. Limbourg, préfet des Bouches-du-Rhône, s’est cru autorisé à déclarer formellement au président du Cercle de Provence que M. le ministre de l’Intérieur lui avait donné des ordres pour s’opposer au pétitionnement. Nos amis de Marseille ne se sont pas laissés intimider. Ils sont sur un terrain légal et continuent à affirmer énergiquement leurs opinions » (La Guienne no 23564, du lundi 17 novembre 1873, p. 1, col. 4).
-
[134]
À propos de la pétition des commerçants et industrielles de Paris, L’Assemblée nationale de 1872 informait ses lecteurs : « Cette pétition se signe dans les bureaux de l’Assemblée nationale, de l’Union et de l’Univers » (L’Assemblée nationale de 1872 no 211, du jeudi 13 novembre 1873, p. 2, col. 4-5).
-
[135]
Hippolyte de Lorgeril, représentant de l’Ille-et-Vilaine, qui se distingua bien qu’ayant voté le septennat. Le marquis Paul de Franclieu, représentant des Hautes-Pyrénées, qui vota contre la prorogation des pouvoirs de Mac-Mahon.
-
[136]
« Sur l’ensemble des quelque 675 élus du 8 février 1871 – chiffre excluant les 15 sièges de l’Algérie et des colonies, ainsi que les 75 se trouvant vacants à la suite du choix fait par les personnalités élues dans plusieurs départements –, on compte 225 nobles, soit 33 %, presque exactement le tiers des sièges pourvus ; 72 départements sur 89 comptent au moins un élu noble, ce qui est un chiffre qui ne sera jamais plus atteint » (Jean Bécarud, « Noblesse et représentation parlementaire. Les députés nobles de 1871 à 1968 », Revue française de science politique, vol. XXIII, no 5, octobre 1973, p. 976)
-
[137]
Entre autres députés, nous trouvons : vicomte Henri de Saintenac (Ariège), marquis Paul de Pontoi-Poncarré (Eure-et-Loir), vicomte Émile de Kermenguy (Finistère), Édouard de Cazenove de Pradines (Lot-et-Garonne), Hippolyte de Kéridec (Morbihan), Jules de Limairac (Tarn-et-Garonne), Édouard de La Bassetière (Vendée). Tous n’appartenaient pas au groupe des Chevau-légers.
-
[138]
À Rondoullec (Morbihan), l’abbé Jean-Michel Le Cam, après avoir dressé un petit récapitulatif chiffré des signatures, écrit ce commentaire à l’attention de son député : « Que Monsieur Dahirel nous permette de lui offrir nos encouragements félicitations bien méritées pour sa conduite dans la soirée du 20 Nov. » (an, C-4259, d. p. no 6086 ; comme à chaque fois, nous avons respecté fidèlement le texte, barré dans le document original). Le député légitimiste participait ou animait des banquets, des débats et des réunions dans les communes de sa circonscription.
-
[139]
Pour approcher « l’appel au peuple » comme une composante essentielle du populisme, lire : Vingtième siècle. Revue d’histoire, numéro spécial Les populismes, no 56, octobre-décembre 1997, 269 p. et en particulier Paolo Pombeni, « Typologie des populismes en Europe (19e-20e siècles) », p. 48-76 ; Le Peuple, cœur de la nation ? Images du peuple, visages du populisme (xixe-xxe siècle). Actes du colloque tenu à l’université de Caen-Basse Normandie le 14 novembre 2003, Alexandre Dorna & Michel Niqueux (dir.), Paris, L’Harmattan, 2004, 247 p., et en particulier Alexandre Dorna, « Le charisme au cœur du populisme », p. 41-62. L’essai de Roger Dupuy, La Politique du peuple. Racines, permanences et ambiguïtés du populisme, Paris, Albin Michel, 2002, 255 p. Pour une typologie des différentes formes de « l’appel au peuple », voir Paul A. Taggart, Populism, Buckigham, Open University Press, 2000, 128 p. Une mention particulière pour le beau livre de Clarisse Coulomb, Les Pères de la patrie. La société parlementaire en Dauphiné au temps des Lumières, Grenoble, pug, 2006, 540 p. qui montre un développement de l’idée d’« appel à l’opinion publique » dans la magistrature dauphinoise au cours du second xviiie siècle, au temps où elle était restreinte (p. 374-387).
-
[140]
Lettre du comte de Chambord du 8 mai 1871, op. cit. (n. 75), p. 1, col. 1 & 2.
-
[141]
an, C-4259, d. p. no 6042, pétition datée de « Rohan le 18 novembre 1873 ».
-
[142]
an, C-4259, d. p. no 5968, texte « Fait à Perpignan le trois Novembre mil huit cent soixante treize (1873) ».
-
[143]
an, C-4211, d. p. no 6310, pétition datée « À St Vincent de Puymaufrais, le 24 Xbre 1873 ».
-
[144]
an, C-4271, d. p. no 6079 arrivé au bureau de l’Assemblée nationale le 28 novembre 1873. Cette devise ne figure pas textuellement dans la Règle de saint Benoît ; c’est une synthèse de différentes prescriptions. Ces Montalbanais avaient bu le lait romantique de ce siècle de redécouverte du Moyen Âge (Maïté Bouyssy, « Qui veut une forme ? Le néogothique sans rivages », Sociétés et représentations, no 20, 2005/2, p. 5-22 ; Nathalie Pineau-Farge, « Fabuleux Moyen Âge : la réinvention du Moyen Âge au xixe siècle », Histoire et images médiévales, hors-série no 11, décembre-janvier 2006-2007, p. 32-57).
-
[145]
Alpes-Maritimes, Basses-Pyrénées, Bouches-du-Rhône, Côtes-du-Nord, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Ille-et-Vilaine, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Nord, Pyrénées-Orientales, Sarthe, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse et Vendée.
-
[146]
Nous avons pris le risque d’écarter les pétitions dans lesquelles l’activité professionnelle ou la qualité était donnée pour moins de 10 % des signataires. Ailleurs, certaines nous ont probablement échappé ou encore, répétons-le, étaient simplement illisibles.
-
[147]
Certaines pétitions constituent des liasses imposantes comme les 143 pièces comptant quelque 2 300 signatures d’habitants du Nord et où figure leur métier ou leur qualité pour environ 48 % des signataires (an, C-4271, d. p. no 6005).
-
[148]
an, C-4271, d. p. no 6082.
-
[149]
an, C-4271, d. p. no 6117, « Pétition monarchique » déposée à Versailles le 4 décembre 1873.
-
[150]
an, C-4271, d. p. no 6070, pétition datée d’« Héric près Nantes 15 novembre 1873 ».
-
[151]
an, C-4271, d. p. no 6060, pétition datée de « St Pierre de Maillé (Vienne) 19 9bre 1873 ».
-
[152]
Certains documents donnent des associations de métiers ou de qualités liées au travail de la terre comme « propriétaire cultivateur », « fermier cultivateur » (an, C-4271, d. p. no 6069, pétition de la « Paroisse de Cruguel », Morbihan).
-
[153]
En tête des départements pétitionnaires, nous avons recensé : le Gard (45 dossiers de pétitions), le Morbihan (38), la Loire-Inférieure (44), la Vendée (21), le Maine-et-Loire (14) et l’Ille-et-Vilaine (14).
-
[154]
Les deux pétitions que nous avons intégrées à notre échantillon statistique comptent respectivement 95 et 417 signatures dont 277 (54 %) donnent le métier ou la qualité de l’individu : les communes d’Aujargues et de Sumène (an, C-4271, d. p. no 6076 & 6082).
-
[155]
Nous avons rattaché le groupe des « ouvriers » à la catégorie des « gens de métiers ».
-
[156]
« Tous nos paysans demandent la Monarchie, mais comme ils sont occupés aux travaux des champs on ne les trouve pas chez eux pour signer la pétition. Plouhinec le 21 9bre 1873. » « Commune de Melléan. 23 signatures. Tous les autres habitants adhèrent de grand cœur (700 habitants) mais ils ne savent pas signer. [signé] Vte du Noday. Penhoët le 21 novembre 1873. » « À ces soixante signatures qui seules dans cette commune [de Persquen] peuvent par elles-mêmes manifester leur intention, s’unissent 900 autres qui ne signent, mais qui à l’unanimité adhèrent à la présente pétition. » « Un grand nombre d’habitants de Radenac ne sachant signer ont témoigné le regret de ne pouvoir ainsi manifester leur adhésion. Radenec 16 9bre 1873. [signé] Dahirel. » (an, C-4271, d. p. no 6048).
-
[157]
Les gens des métiers correspondent pour l’écrasante majorité d’entre eux à la catégorie socioprofessionnelle actuelle des artisans et des commerçants, ces dirigeants de très petites entreprises à noyau familial employant moins de dix salariés et que nous retrouvons ici (par défaut de définition officielle française de la tpe, nous avons adopté ce seuil d’effectifs d’après la recommandation 2003/361/ce de la Commission européenne du 6 mai 2003).
-
[158]
« Même au début de la IIIe République, la faiblesse du prolétariat d’usine reste frappante. En 1881, les ouvriers constituent 41,3 % de la population active, contre 40,8 % pour les patrons et 14,4 % pour les employés (au sens large du terme). […] Encore faut-il préciser que la plupart d’entre eux sont employés dans de très petites entreprises » (Gérard Noiriel, Les Ouvriers dans la société française. xixe-xxe siècle, Éd. du Seuil, coll. « Points Histoire », Paris 1986, p. 13).
-
[159]
Avec parfois un qualificatif renvoyant à une production spécifique : « fabricant de nonettes » et « fabricant de toiles » à Lille (an, C-4259, d. p. no 6068) ; « fabricant de flanelle » dans la Mayenne (an, C-4260, d. p. no 6242).
-
[160]
an, C-4259, d. p. no 6067, pétition des « Fabricants de la Tourlandry 14 9bre 1873 » à laquelle fut jointe celle des « Fabricants de la Commune de Melay le 14 9bre 1873 ».
-
[161]
an, C-4271, d. p. no 6618 en provenance de la Vendée, d. p. no 6005 (Nord), d. p. no 6051 dont une adresse datée de « Valenciennes ce 15 9bre 1873 », d. p. no 6120 de « Tourcoing ».
-
[162]
an, C-4271, d. p. no 6005, adresse signée par des habitants de communes du département du Nord.
-
[163]
438 signataires qualifiés (métier ou activité).
-
[164]
Nous avons regroupé la catégorie générique déclarée de « propriétaire » et celles de « propriétaire agriculteur » (Morbihan), « propriétaire cultivateur » (Mayenne), « propriétaire négociant » (Nord, Tarn-et-Garonne), « propriétaire commerçant » (Tarn-et-Garonne).
-
[165]
À côté d’Henry Bergasse, nous lisons la signature d’Henry Paranque, juge en activité au tribunal de commerce de Marseille et fabricant de bougies. Nous y trouvons aussi le directeur de la Compagnie des Salins du Midi.
-
[166]
Les disparités remarquables entre les 17 départements que souligne notre échantillon sont fortement tributaires des mentions portées à côté du nom ou de la signature par les rédacteurs des pétitions. Dans l’unique pétition des Alpes-Maritimes, 100 % des mentions font état de métiers à caractère intellectuel : avocat, docteur en médecine, instituteur libre, licencié ès lettres, pharmacien (an, C-4212, d. p. no 6461, pétition datée de « Cagnes [Alp. Marit.] ce 10 février 1874 »). Dans l’unique pétition du Tarn (arrondissement de Gaillac), personne, si ce n’est peut-être les trois curés qui devaient avoir suivi le séminaire, n’exerçait de métier « intellectuel », ou nécessitant un quelconque diplôme, ou encore appelant une certaine formation intellectuelle (an, C-4261, d. p. no 6548, pétition datée de « Novembre 1873 »).
-
[167]
an, C-4271, respectivement d. p. no 6076, en provenance d’Aujargues (Gard), et no 6058 (Morbihan).
-
[168]
Relevons quelques particularités, comme deux anciens zouaves pontificaux ou encore cet « ancien offer supérieur de l’armée de Charles V » (an, C-4271, d. p. no 6024).
-
[169]
an, C-4272, d. p. no 6337. Nous soulignons.
-
[170]
Expression utilisée par Pascal Mgonbo, « Les pétitions populaires à la Chambre des députés sous la monarchie de Juillet (1830-1835). Contribution à l’étude du régime représentatif », op. cit., p. 259.
-
[171]
Juliette Glikman, « Vœu populaire et bien public (1852-1870) », PRhp, hors-série no 4, Paris, 2008, p. 86-87.
-
[172]
Alain Boureau, Le Simple Corps du roi. L’impossible sacralité des souverains français. xve-xviiie siècle, Paris, Les Éditions de Paris, 2000, p. 17.
-
[173]
an, C-4259, d. p. no 6265, adresse datée d’« Hazebrouck le 15 9bre 1873 ».
-
[174]
Ap, deuxième série (1800 à 1860), t. XIX, 804 p. ; « Chambre des députés, séance du [lundi] 15 décembre 1817 », p. 785. Voir aussi l’analyse de Benoît Yvert, « Decazes et la politique du juste milieu. Royaliser la nation et nationaliser la royauté (1815-1820) », dans Revolution und Gegenrevolution. 1789-1830. Zur geistigen Auseinandersetzung in Frankreich und Deutschland, Roger Dufraisse & Elisabeth Müller-Luckner (dir.), München, R. Oldenburg, 1991, p. 193-210.
-
[175]
Manifeste daté de « Chambord, 5 juillet 1871 » publié dans L’Union no 166, du samedi 8 juillet 1871, [p. 1, col. 1 & 2]. Il faut entendre le terme de « classes laborieuses » employé par le comte de Chambord de manière générique, c’est-à-dire l’ensemble des forces productrices et génératrices de richesses confondant les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les cultivateurs de manière générale et les divers types d’ouvriers à proprement dit (y compris les prolétaires).
-
[176]
« […] [Les] intérêts industriels et commerciaux de notre pays souffrent et souffriront de plus en plus du provisoire […] » (an, C-4259, d. p. no 6068, adresse datée de « Lille, 15 novembre 1873 »). « Les soussignés réclament 1o La fin du provisoire […] » (an, C-4260, d. p. no 6189 du 17 novembre 1873). « Le provisoire nous affaiblit tous les jours davantage […] » (an, C-4212, d. p. no 6358, pétition du « 11 novembre 1873 »). « La prolongation du malaise paralysant les affaires […] » (an, C-4271, d. p. no 6044, adresse datée de « Marseille 10 Novembre 1873 »). « Ni Provisoire ni République ne peuvent garantir le lendemain » (an, C-4272, d. p. no 6319, souligné dans le manuscrit).
-
[177]
Marquis de Dreux-Brézé, Notes et souvenirs. Pour servir à l’histoire du parti royaliste. 1872-1883, 4e éd. augmentée, Paris, Perrin, 1899, p. 148 & note 1 de la page 147.
-
[178]
Marquis de Dreux-Brézé, Notes et souvenirs. Pour servir à l’histoire du parti royaliste. 1872-1883, op. cit., circulaire aux présidents des comités royalistes, « Paris, le 8 novembre 1873 », p. 294.
-
[179]
Ibid., p. 293-294.
-
[180]
Dans l’Aube, le général Saussier battait largement le candidat bonapartiste. Plus significatif encore : dans la Loire-Inférieure – un département qui avait majoritairement voté pour les droites en février 1871, le général Letellier-Valazé domina nettement son concurrent de la droite (82 953 voix contre 48 780).
-
[181]
« Je reste c[e]p[en]d[an]t enc[ore] à Versailles j[us]q[u’]à ce q[u’]il y ait q[uel]q[ue] ch[ose] de décidé sur la prorog[ation] des pouv[oirs] q[ui] est incertaine, afin d’être là, si elle est rejetée, en vue des événem[en]ts. » (aslu, abf, jm, « 1873 Journal de Mgr. Voyage en France », « 12 [novembre]. (mercredi) ») Voir aussi comte de Chambord, Journal (1846-1883). Carnets inédits, op. cit., p. 587.
-
[182]
Bien que nombreuses à avoir été signées et datées de la troisième semaine de novembre 1873, soulignons que 95 % des pétitions furent enregistrées au bureau de l’Assemblée nationale après le vote du 20 novembre (an, C-4391 & 4392).
-
[183]
Jacques Leclerc, Le Droit de pétition. Étude de droit public comparé, op. cit., p. 167.
-
[184]
« L’ajournement de la proposition du rétablissement de la Monarchie légitime héréditaire, dans la Maison de France, nous a plongé dans la stupéfaction. L’époque si impatiemment attendue de la rentrée de la Chambre faisait entrevoir une ère de bonheur qui nous comblait de joie. […] Le seul remède à nos maux est la Monarchie légitime de la Maison de France, dont le Chef, le Comte de Chambord, est si désiré par nos populations, sous le nom de Henri V, roi de France » (an, C-4261, d. p. no 6618, adresse datée du « 4 mai 1874 »).
-
[185]
aslu, abf, jm, « 1874 Journal de Mgr », « 15 [janvier]. » Voir aussi comte de Chambord, Journal (1846-1883). Carnets inédits, op. cit., p. 592. À l’exception de 8 représentants, l’extrême droite avait voté la prorogation.
-
[186]
Nous retrouvons pour notre période la typologie observée par Jeannine Charon-Bordas, Les Archives des assemblées nationales (1787-1958). C//1 à C//14628. Introduction au répertoire numérique publié en 1985, Paris, Archives nationales, 2008, p. 14-17.
-
[187]
Nous avons principalement utilisé les rôles d’enregistrement des pétitions (an, C-4391 et C-4392), le répertoire des pétitions rapportées avec les conclusions (an, C*-II-531), les procès-verbaux des séances des commissions des pétitions de l’Assemblée nationale (an, C*-II-483 à 486). Il est à noter que parfois les mentions pour une même pétition varient selon les registres : dans le registre C*-II-484, presque toutes les pétitions visées par la 24e commission et réclamant la restauration de la monarchie ont un rapporteur, à la différence du registre C-4391.
-
[188]
François Dahirel, député du Morbihan, présida la 24e commission des pétitions, et le vicomte Victor Étienne de Bonald, député de l’Aveyron, la 28e.
-
[189]
an, C*-II-484, « 24e Commission des Pétitions », « Séance du 12 Mars 1874 », feuillet volant autographe inséré dans le volume.
-
[190]
an, C-4272, d. p. no 6320. Les pétitionnaires bretons terminaient par : « Vive Henri V ! Dieu et le Roi. »
-
[191]
En une sorte de révision de l’antique rite d’hommage lige féodo-vassalique, le comte de Paris remit le pouvoir que son grand-père avait usurpé en août 1830 dans les mains de son dépositaire légitime, le comte de Chambord. Pour les légitimistes ardents, le mal n’était pas réparé ni la faute expiée, mais l’ordre des choses était rétabli afin que la chaîne des temps monarchiques fût renouée.
-
[192]
Albert de Broglie, Mémoires du duc de Broglie. 1821-1901, 2e éd., vol. 2, Paris, Aux armes de France, 1941, p. 240.
-
[193]
L’Union no 304, du vendredi 31 octobre 1873, lettre du comte de Chambord à Charles Chesnelong datée de « Salzbourg, 27 octobre 1873 », p. 1, col. 1.
-
[194]
an, C-4272, d. p. no 6226, adresse datée de « Chanteloup 1re Xbre 1873 », département des Deux-Sèvres.
-
[195]
an, C-4212, d. p. no 6370, manuscrit aux signatures non légalisées.
-
[196]
an, C-4271, d. p. no 6079, pétition signée par des habitants de Montauban.
-
[197]
« Aussi ce fut avec un cri d’admiration que fut accueillie, dans tous les rangs de la société, malgré la divergence des intérêts, cette lettre incomparable du Roi objet de nos désirs et de nos vœux […] » (an, C-4271, d. p. no 6057, « Adresse à Messieurs les Députés conservateurs du Finistère à l’Assemblée nationale »).
-
[198]
Parmi de nombreux exemples, citons « Les membres du Cercle Catholique de la Persévérance » de Montpellier (an, C-4272, d. p. no 6188).
-
[199]
an, C-4212, d. p. no 6428, « Saintes le 6 février 1874 ».
-
[200]
an, C-4271, d. p. no 6045 ; C-4272, d. p. no 6377.
-
[201]
Chef de la maison de Bourbon, comte de Chambord, Henri V, représentant de la royauté légitime, roi légitime.
-
[202]
an, C-4272, d. p. no 6185, 6288, 6319, 6321 et 6327.
-
[203]
Auguste d’Aboville, Gabriel de Belcastel, Albert de Cornulier-Lucinière, Théobald Dezanneau, Jean-Marie Du Temple de La Croix, Charles de Franclieu, Herman de Tréville.
-
[204]
Le député de la Haute-Garonne fut un actif pourvoyeur de pétitions. Modestement pour son département (deux pétitions), il servit néanmoins de courroie de transmission efficace pour les pétitionnaires d’autres départements (Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales, Tarn, Vaucluse). Son collègue et député des Hautes-Pyrénées, le marquis de Franclieu, n’eut sur ce plan rien à lui envier (cinq pétitions d’habitants du Maine-et-Loire).
-
[205]
L’Union no 325, du vendredi 21 novembre 1873, p. 1, col. 3 ; lettre datée de « Versailles, 19 novembre 1873 ». Nous soulignons.
-
[206]
an, C-4272, d. p. no 6233, pétition de Saint-Nazaire datée de « L’Immaculée Conception le 14 Décembre 1873 ».
-
[207]
Alan Grubb, The Politics of Pessimism. Albert de Broglie and Conservative Politics in the Early Third Republic, Newark, University of Delaware Press, 1996, XII-427 p.
-
[208]
Jean-Marie Mayeur, Les Débuts de la Troisième République. 1871-1898, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Points Histoire », 1973, p. 31.
-
[209]
an, C-4272, d. p. no 6226, pétition des Deux-Sèvres, « Chanteloup 1re Xbre 1873 ».
-
[210]
an, C-4272, d. p. no 6048, pétition en provenance de « Le Gacilly (Morbihan) Novembre 1873 ». Nous soulignons cette phrase tirée du Nouveau Testament : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (Rm 8, 31.) Cette parole de saint Paul illustre la théologie du salut de l’homme par la foi – plus tard élevée au rang de doctrine par saint Augustin. Reprise ici par les pétitionnaires, elle correspond pleinement à la phase « inséparatiste » de la doctrine chambordienne en même temps qu’elle l’alimente (Philippe Levillain, Albert de Mun. Catholicisme français et catholicisme romain du Syllabus au Ralliement, op. cit. ; Stéphane Rials, Le Légitimisme, op. cit., p. 41-43).