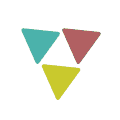Introduction
1Depuis les années 1990, le mouvement trotskyste belge – et, spécifiquement, sa composante portant aujourd’hui le nom de Ligue communiste révolutionnaire (LCR, en néerlandais Socialistische Arbeiderspartij - SAP), section belge du courant principal et « tronc historique » de la Quatrième Internationale [1] – est réduit à un courant politique quasiment inconnu du grand public. L’actuelle LCR est la descendante directe de la Ligue révolutionnaire des travailleurs (LRT, en néerlandais Revolutionaire Arbeiders Liga - RAL) des années 1971-1984. Il s’agit de nos jours d’une organisation de taille modeste, comptant peu en tant que telle dans le paysage politique belge, notamment du point de vue électoral. Cependant, ses militants, pris individuellement, sont impliqués sur une série de terrains du mouvement social et ont développé une expertise sur des thèmes particuliers qui leur permet, à intervalles réguliers, de peser sur l’actualité et les débats de société.
2Marginal, le mouvement trotskyste l’a été, et l’est toujours, à plus d’un titre en Belgique. Dans son ensemble, le mouvement trotskyste international est d’ailleurs marginal au sein du courant politique se réclamant du marxisme, lui-même minoritaire au plan mondial. Les trotskystes belges de la Quatrième Internationale ont généralement vécu dans l’ombre de sections plus importantes, notamment celle de leurs camarades français (aujourd’hui rassemblés au sein du Nouveau parti anticapitaliste - NPA, qui constitue toujours à l’heure actuelle l’une des composantes les plus importantes de la Quatrième Internationale).
3 Ceci permet d’expliquer le peu d’intérêt des spécialistes du mouvement ouvrier pour l’histoire des trotskystes en Belgique. L’activité de ceux-ci, notamment leur travail clandestin au sein du Parti socialiste belge (PSB) et dans la Jeune Garde socialiste (JGS) pour y former une tendance de gauche plus radicale au cours des années 1950 et 1960, est évoquée dans quelques publications [2]. Mais, jusqu’à présent, le mouvement trotskyste belge dans son ensemble n’a fait l’objet que de travaux de fin d’études (par ailleurs souvent réalisés par des étudiants eux-mêmes engagés dans ce mouvement). Une exception notable est la publication d’une synthèse, dans le Courrier hebdomadaire, du monumental mémoire de Marc Lorneau [3]. Cette publication constitue par ailleurs l’un des derniers travaux réalisés dans les années 1970 et 1980 et qui, pris ensemble, constituent en quelque sorte une série, donnant une base historiographique au mouvement trotskyste belge et couvrant l’essentiel de son existence [4].
4 Cette petite vague de travaux a été le fait d’une génération qui n’avait pas vécu Mai 68 et qui éprouvait un intérêt pour une période, les années 1970, ayant vu « une génération de militants se réappropri[er] un programme, une bannière, une référence qui semblaient jusque-là n’avoir été qu’un épiphénomène (…) mis à l’écart par la roue de l’histoire » [5]. Plus largement, elle est survenue dans une période durant laquelle a été érigée l’historiographie de Mai 68 et de ses suites et durant laquelle, en outre, s’est progressivement édifiée une représentation des années 1970 comme une époque d’intense effervescence contestataire et de politisation aiguë, à laquelle aurait succédé un temps de désengagement et de résignation [6]. Il est vrai que plusieurs éléments plaident en faveur d’une telle vision des choses, particulièrement l’apparition, dans les années 1970, des nouveaux mouvements sociaux, qui ont profondément modifié le champ des luttes sociales en y intégrant de nouvelles pratiques et de nouvelles revendications [7]. Cependant, si les études de type socio-économique pointent effectivement le nombre élevé de conflits sociaux et leur ampleur à cette époque, elles révèlent également le caractère souvent défensif de ces conflits, ce qui dénote avec la vision d’une société à la veille d’une révolution [8]. Sans remettre fondamentalement en question cette caractérisation des années 1970 comme un « âge d’or des luttes » [9] – à laquelle sont par ailleurs liés des enjeux idéologiques et politiques évidents –, il convient donc de la nuancer, en veillant à rester à distance à la fois de l’historiographie dominante, qui ne voit souvent dans la période qu’une expérience de défoulement collectif, et de l’historiographie militante, qui est centrée sur la justification a posteriori des perspectives [10].
5Comment un groupe révolutionnaire insignifiant, sorti de l’anonymat au début des années 1970, s’est-il inscrit dans cette période nouvelle ? Quels ont été les apports, les changements opérés par les différentes générations militantes ? Pour éclairer ces questions, la présente étude pose deux hypothèses initiales, dans la continuité de celles émises par Florence Johsua [11]. D’une part, et certainement dans le cas d’une organisation restreinte comme la LRT des années 1970, les militants influent sur leur organisation, bien au-delà des discussions théoriques sur la ligne à adopter, par leurs interactions et leurs pratiques, en fonction de contextes militants et de backgrounds différents. D’autre part, cet « intellectuel collectif » qu’est le parti pèse sur les pratiques militantes par un effet-retour. Ce travail constitue donc une tentative de cartographier les configurations d’acteurs qui ont investi la LRT, afin de comprendre l’histoire de la construction d’une organisation révolutionnaire dans une période de profond remaniement des cadres d’engagement dans la vie politique.
6Le concept de « génération » a longtemps eu mauvaise presse auprès des historiens. À bien des égards, sa polysémie continue à inspirer de la méfiance alors que, dans le même temps, les chercheurs tentent de le circonscrire pour en faire un instrument efficace au service de la compréhension du passé [12]. Au surplus, la génération s’entend autant comme un objet d’étude que comme un outil analytique : repère temporel sans existence sociale autonome, il est reconstitué après-coup par la classe d’âge qui s’en réclame afin de fonder une mémoire collective et de se définir par rapport aux autres [13]. Pour autant, ce sentiment d’appartenance à un collectif, fondé sur la participation commune à des événements considérés comme fondateurs, pèse évidemment sur les schémas de pensée et sur l’action des acteurs en présence.
7 Notre étude étant consacrée à un objet social très circonscrit (un petit parti révolutionnaire ayant compté quelques centaines d’individus), il nous est possible d’éviter la difficulté de définir une réalité sociale comportant des disparités importantes qui rendrait le concept inopérant, difficulté régulièrement pointée par les sociologues des générations [14]. Du reste, il sera fait référence ici à des générations politiques au sens où l’entend Annie Kriegel, c’est-à-dire délimitées par la date d’adhésion à l’organisation politique plutôt que par l’âge [15]. Ces deux réalités se recoupent évidemment, et certainement dans le contexte des années 1970 où les confrontations entre générations (au sens démographique, cette fois) ont été vécues comme particulièrement aiguës par les contemporains [16]. Ceci semble constituer une raison supplémentaire de faire de la génération une unité de mesure de l’évolution de la culture politique de courant trotskyste durant cette période.
8L’analyse amène à distinguer trois vagues successives de militants ayant contribué à perpétuer l’organisation trotskyste en apportant une série de thématiques, d’analyses et de pratiques ou en en rejetant d’autres. Les interactions qu’ont entretenues ces vagues au long des années 1970 constituent une clé de compréhension importante de la façon dont s’est façonnée la LRT. Cependant, il convient également d’interroger les relations entre militants en fonction de la place occupée par ceux-ci dans l’organigramme de la LRT et des différentes interprétations du rôle de « révolutionnaire professionnel » qui coexistent au sein de celle-ci. Ces dynamiques n’ont rien d’étanche ; au contraire, elles sont étroitement liées. Ainsi, si le noyau dirigeant intègre généralement des représentants de chaque génération, il est par le fait même le premier lieu où s’organise le conflit entre perspectives anciennes et nouvelles, perspectives qui sont le plus souvent portées par des représentants typés des différentes générations militantes en présence. La victoire ou la défaite d’une perspective au sein de ce noyau ne peut se comprendre en termes étroitement politiques : elle consiste aussi et indissolublement en la victoire ou la défaite d’une génération porteuse, de par son expérience, de ces perspectives et d’une conception du travail militant qui leur est liée. Et ce qui commence dans le noyau dirigeant se répercute ensuite dans toute l’organisation, à travers les moments forts que constituent les congrès (qui doivent trancher les conflits, fixer les perspectives et renouveler les instances de direction aux divers niveaux) mais aussi et surtout au cours des mois qui suivent ces congrès et au cours desquels se joue la mise en application des décisions prises lors de ceux-ci. À chaque moment-clé, la victoire d’une perspective nouvelle est inséparable de l’affirmation d’une génération militante nouvelle et du déclin, voire de la disparition, de la génération qui l’a précédée et qui s’identifiait aux anciennes perspectives.
9 Pour appréhender l’histoire de cette formation politique qu’est la LRT – celle des perspectives politiques qu’elle s’est données à divers moments, de ses engagements comme de ses tournants, de ses succès comme de ses échecs –, il convient donc de comprendre ces relations entrecroisées et mouvantes.
10 Le présent Courrier hebdomadaire est tiré d’un mémoire de fin d’études en Histoire [17]. Parmi les sources sur lesquelles il s’appuie, figurent les documents d’archives conservés dans les fonds « Archief van de Belgische Trotskistische Beweging » de l’Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging (AMSAB) et « Ligue révolutionnaire des travailleurs (LRT) » de l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES), les archives personnelles de divers particuliers et des témoignages oraux [18].
1. Le mouvement trotskyste belge avant la création de la LRT (1921-1971)
11Le mouvement trotskyste belge ne surgit pas du néant à l’orée des années 1970. Bien que resté ultra-minoritaire, il possède des racines profondes dans le mouvement ouvrier. Ce passé influe la socio-genèse d’un trotskysme qui se réinvente dans l’après-Mai 68. Il convient donc de revenir brièvement sur l’héritage dont se réclame la LRT lorsqu’elle est fondée en 1971.
1.1. La genèse du trotskysme belge
12Le trotskysme est déjà en germe dans l’une des deux tendances qui, en 1921, fonde le Parti communiste de Belgique (PCB) [19]. En effet, celui-ci se constitue au départ de deux groupes politiquement très hétérogènes. L’un est composé d’activistes antimilitaristes et anarcho-syndicalistes venant principalement d’Anvers. Les conceptions politiques de ces activistes sont caractérisées par l’antiparlementarisme et l’importance accordée à l’action directe ouvrière. Leur chef de file est le peintre bruxellois Édouard (dit War) Van Overstraeten. L’autre composante fondatrice du PCB est emmenée par Joseph Jacquemotte, qui a d’abord organisé une tendance de gauche plus radicale au sein du Parti ouvrier belge (POB) autour du journal Les Amis de l’Exploité. Ce groupe est caractérisé par des positions plus modérées, certainement concernant l’importance de l’action parlementaire. Dès les origines, ces deux tendances s’affrontent sur une série de questions organisationnelles classiques des partis révolutionnaires d’inspiration léniniste (parti de cadres versus parti de masse, exercice du droit de tendance, organigramme du parti, etc.).
13Dès le milieu des années 1920, les militants du PCB débattent et prennent position dans la lutte qui a lieu en Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) entre, d’une part, l’opposition de gauche de Léon Trotsky et, d’autre part, la troïka formée par Grigori Zinoviev, Lev Kamenev et Joseph Staline. La tendance Van Overstraeten défend la première, tandis que la tendance Jacquemotte affirme sa position à la direction du PCB en se faisant l’alliée de la seconde.
14En URSS dès 1923, en effet, des militants du Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS) au pouvoir se sont regroupés au sein d’une opposition de gauche officiellement dénommée « fraction bolchévique-léniniste » pour s’opposer au courant stalinien qui domine le parti. L. Trotsky, vétéran de la Révolution d’Octobre, président du soviet de Petrograd et organisateur de la défense de la ville contre les partisans du tsarisme, en est la figure la plus éminente. Sur le plan de la politique intérieure russe, cette opposition de gauche au sein du PCUS se dresse contre la bureaucratisation du parti et des institutions soviétiques. Elle critique également les zigzags de la politique économique, qui commence par favoriser les classes supérieures de la paysannerie puis impose aux paysans la collectivisation des terres quelques années plus tard. Sur le plan international, l’opposition dénonce l’attitude du Comité syndical anglo-russe, regroupant les directions des Trade Unions et des syndicats soviétiques, qui abandonne les mineurs britanniques en grève pendant plusieurs mois en 1926. Elle s’oppose également au soutien apporté par l’Internationale communiste (IC, également appelée Troisième Internationale ou Komintern) au Parti nationaliste chinois (Kuomintang, KMT), qui conduit à un véritable massacre du mouvement communiste en Chine (1925-1927).
15Les membres de cette opposition de gauche, que leurs adversaires baptisent rapidement « trotskystes », basent leurs critiques sur un internationalisme intransigeant et sur leur conviction que la révolution doit rapidement s’exporter pour garantir la survie du régime soviétique. J. Staline, au contraire, met en avant la formule « Construire le socialisme dans un seul pays », ce qui suppose de normaliser les relations de l’URSS avec les pays capitalistes et donc de renoncer à renverser leurs régimes. Bien que L. Trotsky et ses partisans soient finalement défaits par le courant stalinien, les positions de la fraction bolchévique-léniniste sont discutées dans les partis communistes de par le monde, malgré les efforts de partisans de J. Staline pour limiter le débat.
16Jusqu’en 1927, année au cours de laquelle l’opposition de gauche est exclue du PCUS [20], les communistes belges débattent également des thèses trotskystes [21]. En Belgique comme dans de nombreux autres pays, les partisans de l’opposition de gauche sont loin d’être complètement isolés [22]. La tendance trotskyste du PCB manque d’ailleurs de peu d’emporter la direction du parti [23], mais elle est contrainte de se détacher de celui-ci et doit se constituer en une organisation autonome dès 1928 – année au cours de laquelle, par ailleurs, L. Trotsky est expulsé d’URSS [24].
17Dès lors, l’histoire de la mouvance trotskyste belge s’inscrit dans celle des recompositions du mouvement ouvrier international. Elle est traversée par de multiples questions, comme celle de la position à adopter vis-à-vis de l’URSS ou vis-à-vis des « réformistes » du POB. Les trotskystes belges se demandent aussi quelle place occuper dans les stratégies de front populaire initiées par la Troisième Internationale. Faut-il, comme le propose L. Trotsky dès 1934, adopter une tactique « entriste » et militer au sein des partis ouvriers de masse ? Dans les années 1930, ces questions divisent le courant trotskyste en une multitude de groupes qui dépassent rarement le cadre du cercle de discussion sur les thèmes ouvriers. Tous ces groupes ont en commun la défense du principe de révolution socialiste mondiale, une conception de la stratégie révolutionnaire qui donne à la classe ouvrière la direction du mouvement et un attachement aux principes léninistes d’organisation. Ces caractéristiques fondent le socle politique de ce que l’on appelle aujourd’hui le trotskysme mais, à cette époque, une multitude d’autres thèmes divisent les partisans de L. Trotsky. Au nombre de ceux-ci, la question de la fondation d’une nouvelle internationale ouvrière suscite des débats houleux : constatant l’impossibilité de régénérer la Troisième Internationale fondée par Lénine, L. Trotsky entreprend en 1938 de fonder une nouvelle organisation internationale de façon à fédérer ses partisans sur le plan mondial. Celle-ci prend naturellement le nom de Quatrième Internationale [25].
18 Parmi les groupes trotskystes qui se créent alors en divers endroits de la Belgique, seul le Parti socialiste révolutionnaire (PSR) de Walter Dauge, issu d’une période d’entrisme dans le POB carolorégien, parvient, peu avant la Seconde Guerre mondiale, à se créer une assise dans le Hainaut parmi les mineurs de la région et à y concurrencer la présence des communistes orthodoxes [26]. L’invasion de la Belgique en mai 1940 et l’occupation du pays par les troupes allemandes du IIIe Reich sont fatales à cette formation (qui, en juillet 1941, prend le nom de Parti communiste révolutionnaire - PCR). Son leader lui-même, jouant un jeu trouble avec les forces politiques collaborationnistes, est abattu en 1944 [27]. Pour l’ensemble des militants de la mouvance trotskyste belge, la désorganisation du parti et la difficulté d’entretenir des liens avec une internationale à peine née et en crise dès l’assassinat de L. Trotsky en août 1940 signifient également l’isolement, la clandestinité, souvent la déportation et la mort dans les camps de concentration nazis [28]. En outre, la campagne de diabolisation menée par le camp stalinien les confronte également à l’hostilité des résistants communistes. Il n’est pas exagéré de dire que, pris entre les feux de l’occupant allemand et ceux des Partisans armés (branche armée du PCB), le courant trotskyste belge est alors menacé de disparition.
19À la sortie de la guerre, les principaux organisateurs du PSR, Walter Dauge, Léon Lesoil ou Abraham Léon, ont disparu. C’est le jeune militant bruxellois Ernest Mandel qui entreprend de renouer des liens entre les noyaux de militants survivants.
1.2. L’entrisme dans la social-démocratie après la Seconde Guerre mondiale
20La vingtaine de militants qui entreprend de reconstruire une organisation trotskyste belge au sortir de la Seconde Guerre mondiale est confrontée, à l’instar des autres groupes trotskystes en Europe continentale, à la question de son isolement dans le mouvement ouvrier. Une discussion s’engage au sein de la Quatrième Internationale sur l’opportunité de militer au sein de partis ouvriers importants, communistes ou sociaux-démocrates, afin de rompre cet isolement. Cette proposition émane des cercles dirigeants, principalement du dirigeant de la section française, Michel Raptis (dit Pablo). Elle est reçue avec hostilité par une partie du mouvement trotskyste et provoque à terme la première scission importante de la Quatrième Internationale : en 1953, les sections anglophones et une partie importante de la section française rompent avec la Quatrième Internationale et fondent une organisation dissidente. La section belge, suivant la proposition avancée par Pablo, met en œuvre dès 1950 la tactique baptisée « entrisme sui generis » et choisit d’intégrer le Parti socialiste belge (PSB) [29].
21Quelques lignes sont nécessaires pour préciser la portée de cette tactique, tant elle constitue un marqueur important de l’identité politique des militants trotskystes belges de cette période.
22Historiquement, la tactique entriste a été proposée par L. Trotsky en 1934. À cette époque, et dans le cadre d’une montée de l’extrême droite en Europe occidentale mettant en danger le mouvement ouvrier, il avait estimé nécessaire, pour les militants français de sa tendance encore faiblement organisée, de sortir de l’isolement dans lequel ils se trouvaient après leur départ ou leur exclusion du Parti communiste français (PCF). Il avait mis en avant la perspective d’une entrée dans le parti « social-démocrate », la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO), d’autant que, à l’intérieur de celle-ci, se dessinaient des courants qui, sous l’influence de nouvelles générations, tendaient à se radicaliser. Il s’agissait alors de s’insérer, au sein d’une organisation de masse de la classe ouvrière, dans la discussion portant sur la stratégie visant à battre les mouvements fascistes ou présentés comme tels, afin d’y défendre le mot d’ordre de « front unique » avec le PCF. Selon L. Trotsky, ce mot d’ordre avait été mis à l’ordre du jour depuis la grande manifestation antifasciste à Paris du 12 février 1934, qui avait vu les cortèges séparés des deux grands partis ouvriers converger aux cris de « Unité ! » [30]. Au sujet de cette tactique il écrivait : « Ce front unique, nous devons être dedans pour le féconder sinon, en quelques mois, il sera dévoyé » [31]. Qualifié d’entrisme « à drapeau déployé », ce type d’entrisme consistait donc à intervenir dans la SFIO en tant que tendance se réclamant ouvertement et publiquement du trotskysme. Il était considéré comme une tactique à court terme, la perspective étant de sortir rapidement de la social-démocratie à la tête d’une tendance gagnée aux positions marxistes révolutionnaires.
23 En Belgique, L. Trotsky avait également soumis la même proposition à l’Opposition communiste de gauche (OCG, formation représentant son courant dans ce pays), qui l’avait brièvement adoptée. Mais, déjà à cette époque, les trotskystes belges n’avaient pas appliqué les prescriptions de L. Trotsky sur le principe de l’entrisme public, qui suppose une possibilité de faire entendre largement ses propositions politiques au sein du parti qui est rejoint. Aucune garantie du droit de tendance n’avait alors été demandée à la direction du POB. Bien au contraire, les trotskystes avaient fait profil bas en suspendant leur organe de presse, La Voix communiste. Malgré ces concessions, ils avaient été rapidement exclus du POB, en 1936 [32].
24 La tactique entriste décidée par la Quatrième Internationale au seuil des années 1950 est d’une tout autre nature. À ce moment, la direction abandonne ses espoirs d’une poussée révolutionnaire internationale à la fin de la guerre et enregistre la division profonde du mouvement ouvrier entre des partis sociaux-démocrates, globalement alignés sur la politique états-unienne, et des partis communistes, rigoureusement alignés sur Moscou. Selon Pablo, cette division et l’impuissance du mouvement ouvrier qui en découle ouvrent un espace pour une stabilisation et une nouvelle phase de développement du capitalisme international et, en conséquence, pour une relance du réformisme dans la classe ouvrière. Dans ce contexte, le mouvement trotskyste, exsangue et absolument insignifiant au sein du mouvement ouvrier international, doit à nouveau sortir de l’isolement. Il lui faut retrouver rapidement un lien avec le reste du mouvement ouvrier politiquement organisé. Pablo est également d’avis que l’évolution de la situation mondiale et la montée croissante des tensions entre Est et Ouest finiront par provoquer des scissions à la gauche des organisations ouvrières de masse, partis sociaux-démocrates et communistes. Afin de pouvoir peser politiquement sur ces futures scissions, il est décidé d’entrer dans ces partis par la tactique dite de l’entrisme sui generis, qui est adoptée en 1951 lors du troisième congrès mondial de la Quatrième Internationale.
25Cette nouvelle forme d’entrisme diffère en deux points de celle des années 1930. D’une part, faute de luttes de classes de grande ampleur trouvant une expression dans l’émergence de courants évoluant vers la gauche dans les partis visés, l’entrée des trotskystes dans les partis socialistes (et parfois dans les partis communistes, comme en France et en Italie) ne peut se faire « à drapeau déployé » mais de manière clandestine. D’autre part, la possibilité d’une confrontation frontale entre les États-Unis et l’URSS s’éloignant dès le début des années 1960 et, avec elle, la perspective de scissions de gauche au sein des partis socialistes et des partis communistes, l’entrisme devient une tactique de longue durée, dans l’attente de nouveaux mouvements de radicalisation parmi les travailleurs.
26En 1951, les militants trotskystes belges entrent donc clandestinement au PSB. Leur objectif est d’y recruter les « meilleurs éléments et cadres ouvriers » [33] évoluant à gauche, afin d’accélérer un mouvement devant conduire un large pan de la social-démocratie à rompre avec le réformisme au gré de l’évolution de la situation internationale. Il s’agit de s’emparer des fonctions de responsabilité, de préférence celles qui permettraient à une tendance de gauche plus radicale de se développer ou celles qui seraient le plus à l’abri de mesures répressives de la part de la direction. La liaison des militants est assurée par une structure parallèle, sobrement dénommée durant cette période Section belge de la Quatrième Internationale (SBQI). La génération de militants qui met cette tactique en pratique se forge une solide culture du secret. Il est ici question de mensonge par omission, d’utilisation de pseudonymes, de réunions visant à préparer et doubler les réunions des instances officielles où les trotskystes exercent une influence. Cette action est menée avec une prudence qui les prive parfois d’une adhésion capitale [34].
27Cette tactique ne semble toutefois pas absolument homogène. Le militant trotskyste et futur député Pierre Le Grève rapporte dans ses mémoires que son affiliation à la section d’Uccle du PSB s’est faite à visage découvert, du moins sans cacher sa tendance politique [35]. Il est évidemment permis de penser que sa carrière militante antérieure, connue dans la gauche bruxelloise, l’empêchait de pratiquer l’entrisme de la même façon que ses camarades. Quelques jours après son adhésion, une motion d’exclusion a été déposée contre lui mais a été rejetée par la section uccloise.
28La première phase du projet entriste se déroule donc par une intégration sans véritable problème dans les sections locales du PSB. Une attention particulière est apportée aux organisations de jeunesse, stratégie qui permet aux trotskystes de s’emparer progressivement des organes de direction nationale de la Jeune Garde socialiste (JGS) qui, entre 1953 et 1964, passe aux mains de leurs militants. Sous l’impulsion des trotskystes, cette organisation historique mais déclinante du mouvement socialiste renoue avec un certain développement [36]. Les militants de la SBQI y trouvent à la fois un vivier de recrutement pour leur organisation clandestine et un porte-voix pour faire connaître des positions critiques à l’égard du PSB. La principale de ces contestations est l’opposition à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), créée en 1949 et dont le socialiste belge Paul-Henri Spaak est le secrétaire général de mai 1957 à avril 1961. S’appuyant également sur un réseau de sympathie avec les syndicalistes de la mouvance renardiste de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) [37] et les militants les plus à gauche au sein du PSB, la SBQI sert par ailleurs de colonne vertébrale à la rédaction des hebdomadaires La Gauche et Links, grâce auxquels ils animent une tendance au sein du PSB.
29 Durant la petite quinzaine d’années que durera l’entrisme au sein du PSB, le secret d’une structure dans la structure restera étonnamment bien gardé. Certes, la direction du PSB se rendra bien compte de la radicalisation de la JGS et des progrès de son aile gauche. Mais ce ne sera qu’à la fin de l’année 1964 que sera officiellement éventé le projet entriste, lorsque, en septembre et octobre, deux articles paraîtront dans La Voix socialiste, journal lancé par la direction du PSB pour faire contrepoids aux journaux de l’aile gauche. Un ancien militant JGS de Bruxelles, Michel Georis, gagné brièvement à la SBQI, y dénoncera les menées trotskystes et le noyautage du parti.
30Les résultats de l’entrisme au PSB culminent avec les congrès de décembre 1958 et de septembre 1959. Lors du congrès de 1958, une aile gauche groupée autour du comité de rédaction de La Gauche reçoit l’appui du courant renardiste pour contester l’absence de référence explicite au programme de réformes de structure de la FGTB [38]. Pour la SBQI, c’est le moment où la direction du PSB prend la mesure de l’influence de son aile gauche et où elle commence à envisager les procédures qui vont lui permettre d’endiguer ce phénomène. Le congrès de 1959 voit l’aile gauche du PSB se rassembler autour de la revendication centrale de la mise en œuvre du programme économique de la FGTB comme condition à la participation à un futur gouvernement (le PSB étant alors dans l’opposition au niveau national). Un amendement à ce sujet, soumis au cours du congrès, recueille l’approbation d’un quart des délégués, malgré l’appel explicite du président du parti, Léo Collard, à s’y opposer [39].
31Cette brève période constitue le plus haut degré d’unité entre les différentes composantes de l’aile gauche du PSB. Par la suite, les désaccords se multiplient entre La Gauche et André Renard. Le premier d’entre eux se révèle à l’occasion de la grève du Borinage de février 1959. Cette grève spontanée s’oppose à la suppression de subventions au secteur charbonnier et à la fermeture à terme de la moitié des sites miniers. Partie de la Centrale des mineurs de la FGTB, elle se transforme rapidement en une grève générale régionale. Elle reçoit le soutien de La Gauche qui lui donne une perspective d’élargissement à tout le pays. Mais A. Renard s’engage alors dans la voie de la concertation et bloque la diffusion de l’hebdomadaire. À la suite de cet incident, Jacques Yerna (par ailleurs l’un des fondateurs de La Gauche en 1956) quitte son poste de collaborateur d’A. Renard dans le service « Conseil d’entreprises » de la FGTB nationale [40]. Un deuxième désaccord survient en mai 1960, lorsqu’A. Renard appuie, à rebours de l’aile gauche de la FGTB dont la Centrale générale des services publics (CGSP), la signature du premier accord interprofessionnel, dit « Accord de programmation sociale ». La Gauche dénonce la clause empêchant les organisations syndicales de poser de nouvelles revendications à l’échelle interprofessionnelle endéans les trois ans, ce que l’on qualifie habituellement de paix sociale [41].
32 La rupture est définitive à l’occasion de la grève de 1960-1961 menée en réaction à la loi d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier (dite loi unique) [42], projetée par le gouvernement Eyskens III (constitué du Parti social-chrétien et du Parti libéral). Lorsque le Comité de coordination des régionales wallonnes, structure créée par A. Renard pour coordonner les mouvements de grève au niveau wallon, met en avant la revendication de l’établissement du fédéralisme comme objectif de la grève, La Gauche, sans rejeter cette revendication, exprime son inquiétude sur son potentiel de division entre grévistes wallons et flamands et lui préfère la revendication de marche sur Bruxelles, qui doit, dans l’esprit des trotskystes belges, politiser plus profondément la grève afin de la transformer en confrontation avec la structure même du pouvoir. Malgré un abandon par La Gauche du mot d’ordre de marche sur Bruxelles sous la pression des renardistes, le journal est contraint de quitter les presses de La Wallonie, le quotidien de la FGTB qui l’avait hébergé jusqu’alors. Cette rupture avec l’essentiel du courant renardiste coupe les militants de la SBQI d’un allié de poids au sein du mouvement socialiste et les isole de la majeure partie de la gauche syndicale au sein de la FGTB.
33Cet affaiblissement donne à la direction du PSB la marge nécessaire pour contrer sa tendance de gauche. À la fin de l’année 1961, le droit de tendance est remis en question lors d’un congrès de la fédération bruxelloise. Fin 1962, des militants de la tendance de gauche (dont Émile van Ceulen, régulièrement élu par la fédération de Bruxelles pour siéger au conseil général du parti) voient leurs mandats non reconduits au terme du congrès régional bruxellois. P. Le Grève est exclu provisoirement du PSB en septembre 1963, au motif qu’il a fait campagne contre les lois sur le maintien de l’ordre [43].
34Les élections communales du 11 octobre 1964, qui se soldent par un recul pour le PSB, donnent l’occasion à la direction du parti d’en finir avec le noyautage trotskyste qui influence l’ensemble de son aile gauche et dispose également de liens avec le Mouvement wallon. Le bilan des élections est attribué au manque de cohésion dans la famille socialiste et aux membres qui critiquent les décisions majoritaires. Cette rhétorique fonctionne d’autant plus facilement que La Gauche n’a pas appelé à voter pour le PSB ; le journal a repris l’appel du Mouvement populaire wallon (MPW) [44] invitant à apporter sa voix aux candidats qui, à gauche, se positionnent pour les réformes de structure et pour le fédéralisme. La direction du PSB prévoit donc de faire voter, lors de son congrès des 12 et 13 décembre, l’incompatibilité entre la qualité de membre du parti et la fonction de dirigeant du MPW ou de collaborateur des journaux La Gauche et Links [45].
35 Pour la SBQI, il s’agit de l’opportunité attendue de créer une organisation « centriste » [46] à la gauche du PSB. C’est en tout cas l’avis d’E. Mandel, qui écrit : « Tout laisse supposer que le congrès du PSB des 12-13 décembre 1964 mette fin à l’orientation que nous avons suivie depuis de longues années, et ce dans les meilleures conditions qu’on aurait pu espérer dans les circonstances actuelles : avec une tendance largement unie, syndicalistes du MPW et Wallons, Bruxellois et Flamands de la tendance de gauche s’orientant vers un nouveau parti socialiste de gauche » [47]. Mais le congrès se solde par un large vote en faveur de la direction. Le projet initial, qui était de sortir au moment opportun de la social-démocratie avec une part conséquente de sa base afin de mettre « fin [au] contrôle réformiste sur le mouvement de masse de ce pays » [48], se solde donc par une éjection du PSB, avec un petit millier de membres issus de la JGS, du MPW et des équipes de La Gauche et de Links.
1.3. L’entrisme dans les partis centristes et la radicalisation de la jeunesse
36La stratégie entriste n’est pas abandonnée avec la sortie du PSB. Les militants exclus s’organisent rapidement dans de nouvelles formations politiques, où les trotskystes jouent un rôle dominant mais toujours en cachant l’existence d’une structure parallèle.
37La constitution, en janvier 1965, de la fédération liégeoise du Parti des travailleurs de Wallonie – qui devient le Parti wallon des travailleurs (PWT) en juin 1965 en se constituant à l’échelle régionale – et celle, en février de la même année, de l’Union de la gauche socialiste (UGS) à Bruxelles inaugurent une nouvelle phase de l’entrisme, cette fois au sein de nouveaux partis « centristes ». En Flandre, les perspectives de regrouper une avant-garde conséquente dans une nouvelle formation politique sont en revanche nettement plus limitées, d’autant que l’équipe de rédaction de Links – peu investie par les militants trotskystes, qui ne sont qu’une poignée en Flandre [49] – ne joue pas le rôle unificateur que peut jouer celle de La Gauche dans la proposition d’une perspective pour les exclus. La majorité de l’équipe de rédaction de Links préfère en effet se rendre aux conditions de la direction du PSB et les autres dissidents flamands se dispersent. Le petit groupe de militants que parviennent à assembler les trotskystes flamands se constitue en octobre 1965 en Socialistische Beweging Vlaanderen (SBV), basé surtout à Gand et à Anvers et qui édite le journal Socialistische Stem. En décembre 1968, suite à une fusion avec un groupe de militants issus du mouvement étudiant, le SBV deviendra les Revolutionaire Socialisten (RS), et son journal prendra alors le nom de Rood [50].
38Ces différentes formations (PWT, UGS et SBV) se fédèrent au sein de la Confédération socialiste des travailleurs (CST, en néerlandais Socialistische Arbeiders Konfederatie - SAK) à la fin du mois d’octobre 1965. Même au sein de cette structure, la Quatrième Internationale n’apparaît pas ouvertement : si les militants des organisations membres de la CST savent qu’il y a des individus se réclamant du trotskysme dans leurs rangs, leur structuration en une organisation parallèle n’est pas connue.
39Durant six ans, les trotskystes dominent politiquement la CST, mais ils ne parviennent ni à la transformer en une organisation ouvertement affiliée à leur courant, ni à la développer en ce petit parti ouvrier de masse qu’ils espéraient construire. Tout au plus maintiennent-ils des noyaux militants locaux parfois importants, comme dans la région liégeoise autour de la délégation syndicale FGTB des aciéries Thomas de Cockerill à Ougrée ou à Bruxelles autour de P. Le Grève. En mai 1965, celui-ci devient d’ailleurs le premier (et, à ce jour, l’unique) député de tendance trotskyste de l’après-guerre, élu sur la liste de cartel PCB-UGS. Paradoxalement donc, c’est dans cette brève période de paralysie politique que le mouvement trotskyste belge obtient son succès électoral le plus important.
40Dans l’intervalle, le travail au sein de la JGS porte également ses fruits : l’organisation de jeunesse du PSB radicalise ses positions politiques sous l’influence de sa direction trotskyste. Le 21 mars 1965, lors de son congrès national à La Louvière, elle met un terme à dix ans de tensions croissantes avec la direction du PSB en proclamant son autonomie [51]. Cela s’opère, il est vrai, au prix de son caractère d’organisation large. Sous l’impulsion des jeunes cadres trotskystes, les adhésions s’étaient multipliées : avant son congrès de 1965, la JGS comptait quelque 1 500 membres sur le papier, organisés dans des sections couvrant l’ensemble du territoire wallon [52]. Durant le second semestre de l’année 1965, la JGS voit ses effectifs dégringoler à environ 500 membres. Six ans plus tard, on en dénombre 200 au maximum. C’est donc la majorité des effectifs de la JGS qui a rejoint le Mouvement des jeunes socialistes (MJS), la nouvelle organisation de jeunesse créée par le PSB en novembre-décembre 1964 (en réaction contre l’orientation jugée extrémiste de la JGS) [53].
41 La fusion de la JGS « autonome » avec la Fédération des étudiants socialistes de Belgique (FESB) [54], en 1968, achève de transformer sa composition sociale : d’organisation majoritairement composée de jeunes travailleurs, elle devient une organisation de jeunes étudiants et de lycéens.
1.4. La JGS autonome, terrain d’expérimentation d’une nouvelle génération militante
42Si les structures destinées aux adultes mises sur pied par les trotskystes au lendemain de leur expulsion du PSB déclinent rapidement, la JGS se trouve par contre relativement à l’aise dans le contexte de radicalisation de la jeunesse qui caractérise le « Mai 68 belge » [55]. Affirmant son profil révolutionnaire, la JGS est particulièrement active dans les principaux mouvements contestataires de la période et devient officiellement sympathisante de la Quatrième Internationale après son congrès de 1969. La JGS s’illustre notamment dans le soutien à l’indépendance du Viêt Nam, dans le mouvement pacifiste contre l’arme atomique et dans les grèves étudiantes des universités de Gand, de Bruxelles ou de Liège.
43Durant cette période allant de 1965 à 1969, la JGS et le mouvement trotskyste belge en général sont marqués par deux événements constitutifs de l’identité politique d’une nouvelle génération militante.
44En octobre 1966, la JGS organise à Liège une manifestation internationale de soutien au Front national de libération du Sud-Viêt Nam (FNL). Au-delà du succès de cette manifestation au regard de la petite organisation qu’elle est devenue, la rencontre avec les militants de la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR) française a un impact certain sur le noyau dirigeant de la JGS. La JCR, qui vient d’être fondée en avril 1966 par quelques jeunes militants trotskystes exclus du PCF, a rapidement crû en nombre et en influence, se faisant une place sur la scène politique française par son activisme et par son soutien aux luttes de libération au Viêt Nam et en Amérique du Sud. Cette croissance rapide dans un contexte d’hostilité ouverte des communistes orthodoxes et ce profil radical donnent une aura particulière aux trotskystes français aux yeux des militants belges. Ceux-ci vont dorénavant tenter de reproduire le succès français sur leur terrain d’action. À la suite de cette première rencontre, la direction européenne de la Quatrième Internationale décide de profiler davantage ses organisations de jeunesse. Une « Conférence des organisations de la jeunesse d’avant-garde d’Europe occidentale » se tient à Bruxelles les 11 et 12 mars 1967 ; conçue à l’origine comme une réunion visant à coordonner le soutien au FNL en Europe, elle est aussi l’occasion d’une discussion approfondie sur les stratégies mises en œuvre par les 11 organisations de jeunesse représentées, dont la JCR et la JGS. Cette conférence débouche sur l’organisation d’un meeting et d’une manifestation internationale de soutien au FNL à Berlin, le 17 février 1968, où E. Mandel prend la parole aux côtés d’Alain Krivine et de Rudi Dutschke [56]. La manifestation voit, selon les termes de La Gauche « vingt mille jeunes porteurs de drapeaux rouges et de drapeaux FNL, affichant les portraits de Rosa Luxembourg, de Karl Liebknecht, à côté de ceux de Che Guevara et de Hô Chi Minh [qui] ont parcouru (…) le centre de Berlin, où l’on n’avait plus vu de drapeau rouge depuis trente-cinq ans » [57].
45 Ainsi, une nouvelle génération de cadres, plutôt issue des milieux universitaires, est poussée en avant par les dirigeants européens de la Quatrième Internationale, dont l’Italien Livio Maitan, le Français Pierre Frank et le Belge E. Mandel sont les plus influents. En Belgique, cette génération s’aguerrit par sa participation aux expériences d’« assemblées libres » qui ont lieu dans les universités au cours de l’année 1968 mais surtout, dans le soutien qu’elle offre à la grève des mineurs du Limbourg durant les mois de janvier et février 1970 [58]. Cette grève est emblématique par sa longueur (six semaines, en plein hiver), sa radicalité et le débordement des structures syndicales qui s’y opère.
46 Pour les militants de la Socialistische Jonge Wacht (SJW), l’aile flamande de la JGS, la grève des mineurs du Limbourg a tout de la crise prérévolutionnaire. C’est une grève massive, qui paralyse tout le bassin houiller de Campine avec 21 000 mineurs en grève. C’est une grève offensive, qui rompt les accords de programmation sociale pour réclamer une augmentation supérieure à ce qui a été discuté paritairement entre patrons et directions syndicales (le slogan le plus populaire de la grève est « 15 % maintenant »). Mais c’est surtout une grève qui s’organise contre l’avis des syndicats, en se trouvant des directions alternatives (dont la plus influente est le « comité permanent de grève »). Les trotskystes y voient la possibilité d’une politisation de la grève et d’une élévation du niveau de conscience des grévistes vers une contestation globale de la société.
47 Il s’agit donc de s’investir dans le mouvement pour le soutenir et le développer et pour établir une tête de pont dans la classe ouvrière flamande. L’une des thèses du congrès de 1969 qui a officialisé l’orientation vers la Quatrième Internationale est de faire de la JGS la première pierre d’un parti révolutionnaire devant partir de la périphérie de la classe ouvrière (la jeunesse radicalisée) vers le centre de celle-ci (les ouvriers d’industrie). La JGS s’engage donc dans la grève des mineurs limbourgeois de 1970 avec cette optique. Elle est présente constamment aux piquets de grève afin d’y diffuser ses positions via ses tracts et La Gauche, qui titre sur la grève durant toute la durée de celle-ci. Elle collabore constamment à l’action du comité permanent de grève, établissant une permanence dans les locaux mêmes de ce comité mais en gardant une autonomie d’action. Elle contribue à étendre le soutien à la grève parmi les étudiants et apporte aussi son soutien logistique, s’occupant de louer les cars pour les déplacements en manifestation, de ronéotyper les tracts, etc. L’apport de la JGS est aussi stratégique. Ainsi, elle incite le comité permanent de grève à lancer des appels à la grève de solidarité à destination des mineurs de Wallonie – appel qui est relayé par le PWT – et à se solidariser avec les grèves des mineurs qui ont lieu au même moment en Suède et dans les Asturies. Au moment où il est question de faire venir du charbon de l’étranger pour alimenter les hauts-fourneaux, La Gauche lance un appel vers les dockers et les cheminots pour qu’ils refusent de décharger ce charbon destiné à briser la grève.
48 Dernier volet de son activité, la JGS veut aussi jouer un rôle d’explication dans ses tracts, en replaçant la grève dans le contexte général de la situation du secteur charbonnier, de l’économie belge et du système capitaliste. Incontestablement, l’implication de la JGS dans la grève des mineurs du Limbourg de 1970 constitue une étape dans la maturation de la génération militante qui anime l’organisation à cette époque. La JGS ne reste pas dans une position de critique de la direction du mouvement : elle parvient à participer, par l’entremise de sa collaboration avec le comité permanent de grève, à son orientation. Elle peut aussi s’y forger une expérience directe de la lutte ouvrière. Enfin, elle peut commencer à prendre confiance en elle et à prendre conscience de la spécificité de la période qui s’ouvre et dans laquelle elle va devoir militer. Même si l’implication de la JGS ne se solde pas par le recrutement de grévistes – au contraire du Studentenvakverbond (SVB, organisation étudiante flamande maoïste), qui la surclasse en popularité [59] –, la SBQI analyse cette séquence comme un succès puisque, pour la première fois depuis les années 1930, le mouvement trotskyste est en prise avec une lutte ouvrière d’ampleur.
49Ici se noue sans doute la véritable sociogenèse du trotskysme belge dans sa déclinaison « mandeliste » [60]. La génération montante, forte de ses succès de masse et poussée par la direction européenne à prendre un rôle dirigeant, se montre extrêmement critique vis-à-vis de la génération précédente, qu’elle présente comme « contaminée par l’entrisme ». En retour, la génération de l’entrisme se crispe et critique l’aventurisme de la jeune génération. C’est que les deux générations sont marquées par deux périodes et donc par deux cultures politiques extrêmement différentes. La première a connu l’entrisme et a construit la JGS dans les années 1950 et au début des années 1960 puis a servi de cadre au sein de la CST dans une période de recul des luttes. La seconde a été recrutée dans la foulée de la radicalisation de la jeunesse à la fin des années 1960, dans une période de luttes sociales intenses avec un caractère nouveau : il ne s’agit plus de contester seulement l’ordre économique et social mais également l’ordre ancien dans la perspective d’un conflit générationnel. La ligne de fracture générationnelle entre les deux groupes, dont les expériences et les contextes militants divergent fortement, est donc renforcée par le climat des luttes des années 1960. La table rase s’opère aussi au sein des organisations révolutionnaires contre les pratiques anciennes jugées périmées, et ce malgré une idéologie et des symboles communs fortement sollicités.
50 La génération des années 1950-1960 a été définie comme la génération « anticolonialiste » [61]. En effet, c’est bien dans la solidarité avec les luttes de libération coloniale, Algérie et Indochine, que la poignée de militants trotskystes de cette époque forge son expérience. Les figures emblématiques de cette époque sont l’infatigable organisateur Georges Dobbeleer, le théoricien Ernest Mandel, Guy Desolre et bien sûr Pierre Le Grève, qui est devenu la figure du soutien à l’indépendance de l’Algérie en Belgique. Durant cette période, le soutien au Front de libération nationale (FLN) algérien dépasse de loin la simple propagande. C’est que la section française de la Quatrième Internationale, le Parti communiste internationaliste (PCI) de P. Frank, opte, lors de son congrès de novembre 1955, pour le soutien au FLN en présence d’un délégué de ce mouvement. Dès ce moment, les militants de la SBQI apportent un soutien logistique à l’organisation : l’édition du bulletin du FLN en France, Révolution algérienne, leur est confiée. Ils convoient des militants, les hébergent et, à l’occasion, leur fournissent des armes [62]. Toutes ces activités ne sont pas le seul fait des trotskystes : ceux-ci fonctionnent en réseau avec une série d’autres mouvances et individus comme les chrétiens et socialistes de gauche ou les groupes Esprit [63] (par lesquels est passé G. Dobbeleer).
51La clandestinité de ce type de réseau amène naturellement à une pratique militante du secret et du cloisonnement. Combinée au travail entriste au sein du PSB, celle-ci est de nature à marquer profondément les pratiques militantes ultérieures du sceau de la prudence. Progression pas-à-pas et construction patiente du parti homme par homme, au terme d’un long processus de discussions politiques menées discrètement : voilà l’univers militant de cette génération, qui mène son action exclusivement au sein du mouvement ouvrier socialiste (PSB et FGTB). Sa sphère d’influence se situe dans ce cadre et, si elle n’est pas toujours d’extraction ouvrière, ses liens avec la classe ouvrière industrielle sont réels, en premier lieu par des liens avec les anciens militants du PSR de W. Dauge de l’entre-deux-guerres, dont quelques mineurs de Charleroi qui sont encore militants ou sympathisants de la SBQI. André Henry en particulier, ouvrier verrier de la région de Charleroi et fils de militant trotskyste, incarne cette filiation avec le daugisme. Mais la nature – et, du reste, l’objectif – du travail entriste ainsi que l’activité de cette génération dans la grève de 1960-1961 ont mis aussi les militants de cette époque en contact avec des syndicalistes renardistes de la sidérurgie liégeoise, parmi lesquels Louis Goire, auxquels s’ajoutent des travailleurs du textile à Mouscron et des dockers anversois. Cette génération est donc faite de révolutionnaires rompus au travail au sein des organisations de masse socialistes, marqués par les mobilisations ouvrières sous l’égide des structures traditionnelles. Bien sûr, ceux-ci agissent pour développer la démocratie syndicale et le débordement de l’appareil par les travailleurs en grève le cas échéant. Mais l’exemple marquant de mobilisation ouvrière pour cette génération est la grande grève de 1960-1961. Or, aussi massive et radicale qu’ait été cette grève, on n’y a pas vu la base s’opposer à la direction de façon organisée. Au contraire de la génération suivante, les trotskystes des années 1950 et 1960 ne peuvent pas envisager concrètement « l’agitation pour un syndicalisme de lutte » en dehors des syndicats traditionnels. Enfin, au moment de l’entrée en activité de la nouvelle génération, on peut les penser d’autant plus enclins à la prudence que la sortie du PSB est analysée comme un échec.
52 Pour sa part, la seconde génération, celle qui vient à l’action politique aux alentours de 1968, est aussi portée par la solidarité avec l’Indochine, devenue Viêt Nam. Mais cet élément est loin de constituer le seul vecteur de sa radicalisation. Si la situation internationale, les luttes de libération et la Guerre froide jouent évidemment un rôle dans la définition de sa culture militante, le marqueur déterminant est l’apparition du « peuple adolescent » [64], dont cette génération est une expression. Elle vit son enfance dans une société de consommation établie, qui lui accorde d’ailleurs une reconnaissance et une place en tant que marché émergent. Elle vit la massification de l’enseignement et la prolongation de la scolarité : un monde en mutation rapide, où la jeunesse se forge sa propre culture et où les références politiques des aînés, surtout dans leurs prolongements tactiques, ne paraissent pas pouvoir faire sens. Cela est d’autant plus vrai aux yeux de cette nouvelle génération que la « remontée des luttes ouvrières » – telle qu’analysée en 1970 par le président de la JGS, François Vercammen – voit l’affaiblissement des structures traditionnelles du mouvement ouvrier et l’essor de luttes autonomes où les syndicats jouent un rôle direct de frein (les aînés sont d’ailleurs critiqués pour avoir tardé à voir cette hausse de la combativité ouvrière).
53 Dès lors, c’est l’ensemble des mécanismes de la société et des institutions qui sont contestés par la jeunesse de cette époque. Il n’est plus seulement question de l’exploitation de l’homme par l’homme ou de l’extorsion de la plus-value, mais de l’aliénation des hommes de toutes conditions par un système aveugle. Il en résulte une prédilection pour les questions culturelles et sociétales par-delà les questions économiques : vivre, habiter, consommer autrement et ne pas seulement travailler et produire autrement. De là, découlent une certaine distanciation et, dans tous les cas, une méfiance certaine vis-à-vis des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier et, surtout, une extension des terrains d’engagement qui doivent traverser l’économique et le politique pour atteindre le culturel.
54 À ces divergences de vue déjà essentielles entre générations, s’ajoute, en conséquence de ce qui précède, une opposition entre les visions que ces générations peuvent avoir de leur engagement. Pour la nouvelle génération de militants, il n’est plus question de s’engager pour un avenir lointain, de lutter « à contre-courant » (selon l’expression des premiers trotskystes, conscients de leur isolement). La nouvelle génération voit le changement social à portée de main. Il ne s’agit plus seulement de construire ce qui pourrait être l’instrument d’émancipation des exploités mais de réaliser cette émancipation. L’engagement militant est donc total, sans ménagement. La promiscuité militante favorise une grande proximité idéologique, phénomène renforcé par l’idée que, à l’approche de la révolution, chaque décision tactique revêt une importance vitale.
55 Comme nous allons le voir, cette hétérogénéité de la culture militante engendre des désaccords sur les formes d’action et les priorités, ce qui pèse rapidement sur la définition du projet politique de l’organisation trotskyste au moment où la SBQI estime nécessaire de réorienter son travail politique en apparaissant publiquement.
2. La création de la LRT (1971) : la jeune génération aux commandes et l’hétérogénéité politique en héritage
56À la suite de la grève des mineurs du Limbourg, une vague de grèves sauvages secoue la Belgique durant les années 1970 et 1971 [65]. Les revendications et les moyens d’action des grévistes sont divers, mais plusieurs grèves ont pour caractéristique commune de déborder les structures syndicales officielles, avec l’organisation en comités de grève autonomes. Parmi les exemples les plus emblématiques de la période, on peut citer les grèves menées dans les usines suivantes : Michelin à Sint-Pieters-Leeuw (février et juin 1970) [66], les Forges de Clabecq (juin 1970), Cockerill Yards à Hoboken (avril et juillet 1970), Caterpillar à Gosselies (juin 1970), Citroën à Forest (novembre 1970), La Vieille-Montagne à Balen (janvier à mars 1971) et les chantiers navals Boel à Tamise (septembre 1971). La jeune direction de la LRT trouvera là un contexte particulièrement favorable à l’action et à la construction d’une organisation révolutionnaire.
57 Dans chacune de ces grèves, les trotskystes interviennent de la même façon que lors de la grève des mines limbourgeoises : agitation dans les universités, distribution de tracts et de journaux devant l’usine, établissement de liens avec le comité de grève et propositions tactiques. À partir de 1971, ils parviennent à constituer des groupes de sympathisants dans certaines entreprises en lutte ; baptisés « Unité dans la lutte », ces groupes contribuent à relayer les positions trotskystes à l’intérieur. Cependant, dans la plupart des cas, l’influence des militants trotskystes se limite à participer aux comités de soutien qui sont fréquemment constitués à l’extérieur de l’usine et favorisés par les comités de grève : il s’agit pour ceux-ci d’une façon intéressante de bénéficier de l’aide des groupes radicaux qui fleurissent à cette période, tout en les maintenant à l’extérieur des instances de décision des grévistes.
58 Cette agitation sociale, mais aussi la difficulté de gérer l’ensemble des structures dans lesquelles elle est impliquée, décide la SBQI à engager un processus de fusion afin de créer une organisation se revendiquant publiquement du trotskysme. Dans ce cadre, il est décidé que la JGS, organisation officiellement sympathisante de la Quatrième Internationale, fera une proposition de fusion aux composantes de la CST après discussions communes sur le programme et les structures d’organisation. Le 19 mai 1970, une lettre en ce sens est adressée aux Revolutionaire Socialisten (RS, précédemment SBV), au PWT et à l’UGS.
59 Une année est nécessaire pour réaliser cette fusion, tant les divergences politiques sont importantes non seulement au sein de la CST – dont les membres sont loin d’être tous gagnés au socialisme révolutionnaire – mais également entre les militants de la SBQI. Cependant, les 30 et 31 mai 1971, au terme de cycles de discussions engageant toutes les structures de la CST et de la JGS à tous les niveaux, le congrès de fondation d’une nouvelle organisation a lieu à Liège [67]. Il rassemble 200 délégués des organisations constitutives de la fusion : la JGS, les branches régionales de la CST (PWT, UGS et RS), ainsi que des comités « Unité dans la Lutte ». Des représentants des sections de la Quatrième Internationale dans les pays voisins sont également présents. Le nouveau parti prend le nom de Ligue révolutionnaire des travailleurs (LRT, en néerlandais Revolutionaire Arbeiders Liga – RAL), et la JGS devient son organisation de jeunesse. C’est à cette époque la plus grande organisation trotskyste en Belgique depuis le PSR, bien que ses effectifs se montent tout au plus à 400 membres [68]. Par ailleurs, pour la première fois depuis 1950, la Quatrième Internationale dispose en Belgique d’une section ayant pignon sur rue.
60 Le congrès de fondation dote la nouvelle organisation d’un comité central de 35 membres qui, lors de sa première réunion, élit à son tour un bureau politique (instance qui sera parfois dénommée direction nationale). La composition de celui-ci confirme la volonté de laisser la nouvelle génération aux commandes de l’organisation : l’âge des membres du bureau politique est compris entre 17 et 38 ans. La majorité d’entre eux sont des militants venus récemment à l’organisation trotskyste. Trois d’entre eux seulement ont connu la période de l’entrisme au sein du PSB, mais tous ont été des militants de la SBQI avant la fondation de la LRT. En termes de composition socio-professionnelle, on y retrouve des étudiants et des intellectuels, professeurs ou employés d’administration mais aucun ouvrier.
3. Premier mouvement (1971-1974) : le difficile processus de construction d’une organisation sur le modèle bolchevique
61Couplée à la récurrence de conflits liés à la question communautaire, l’agitation sociale du début de la décennie 1970 donne lieu à une actualité touffue, dans laquelle les opportunités d’apparition sont légion pour la LRT. Cependant, envisageant avec une certaine crispation la construction d’un parti révolutionnaire sur le modèle léniniste, la jeune direction éprouve des difficultés à édifier le cadre qui pourrait lui permettre de développer son organisation.
3.1. Homogénéiser l’organisation dans un contexte de remontée des luttes
62 Une « remontée des luttes ouvrières » : c’est ainsi que les trotskystes belges analysent la période qui s’ouvre au moment où ils décident de constituer une organisation publique se réclamant officiellement de leur courant, la LRT.
63 En effet, les années 1970 s’ouvrent sur une multiplication des conflits sociaux à caractère « offensif ». Une vague de grèves spontanées se développe, souvent dans des secteurs n’ayant guère de tradition de concertation sociale ou employant des travailleurs jeunes et immigrés, moins liés à la discipline syndicale et donc plus prompts à rompre les conventions collectives. Les actions dans ces secteurs d’activité ont un effet d’entraînement sur les anciennes implantations d’industrie lourde : des grèves aux Ateliers de constructions électriques de Charleroi (ACEC), à la Fabrique nationale (FN) à Herstal et dans les usines Cockerill et Prayon succèdent aux grèves des mineurs du Limbourg, des travailleurs de Citroën ou de Volkswagen. Elles se caractérisent par un haut degré d’auto-organisation des travailleurs, par un désaveu des directions syndicales, qui éprouvent souvent des difficultés à reprendre pied, et par des affrontements parfois très durs avec les forces de l’ordre [69]. Les revendications des grévistes concernent le partage de la croissance (primes d’effort ou primes de haute conjoncture) mais aussi les conditions de travail, avec une tendance à remettre en question les rapports de travail au sein de l’entreprise (protestations contre l’autoritarisme de la direction ou revendication du contrôle ouvrier). La propagation rapide de ce mouvement, y compris dans les services publics, amène La Libre Belgique à parler de « contagion générale » [70].
64 Le monde patronal réagit à ce phénomène par une attitude de raidissement qui se caractérise souvent par la non-reconnaissance des porte-parole des grévistes – parfois également non reconnus par les syndicats –, par un refus de la négociation et par le licenciement des meneurs. Il est aidé en cela par des gouvernements de coalition (gouvernement Eyskens IV et V réunissant sociaux-chrétiens et socialistes en 1968-1972, puis gouvernements Leburton I et II composés des socialistes, des sociaux-chrétiens et des libéraux en 1973-1974) qui n’hésitent pas à faire intervenir la gendarmerie pour disperser les piquets ou à tenter de limiter l’exercice du droit de grève par la voie légale. C’est le cas d’un projet de loi sur les milices privées porté par le ministre de la Justice, Alfons Vranckx (PSB), et visant à interdire les « groupes dont les agissements coordonnés tendent à troubler l’ordre ou la sécurité publique ou à menacer la liberté d’expression par le recours à la force ou à la violence » [71]. Présenté au Parlement en 1973, ce projet est interprété par la gauche comme une tentative de museler la contestation. Durant l’année 1974, le retournement de la conjoncture économique permet au patronat de pousser le mouvement social dans une position défensive. Les syndicats reprennent l’entière main sur les conflits sociaux et les grèves spontanées se font plus rares. Les revendications évoluent vers la défense de l’emploi et des prestations sociales.
65 Parallèlement, la Belgique entre à cette époque dans une période de refontes successives de son système institutionnel. À la fin de l’année 1970, une révision constitutionnelle met fin à la structure unitaire du pays. Les partis traditionnels se scindent progressivement en deux ailes linguistiques distinctes : le Parti social-chrétien (PSC-CPV) est scindé de facto en 1972 et le Parti de la liberté et du progrès (PLP-PVV) cesse définitivement d’exister comme une entité nationale en 1977. Si le PSB ne se scinde qu’en novembre 1978, ses ailes francophone et flamande organiseront des congrès séparés dès 1976. L’intégration de partis à vocation régionaliste ou communautaire (Rassemblement wallon - RW, Volksunie - VU, Front démocratique des francophones - FDF) à la scène politique contribue à modifier profondément le paysage politique belge. La question linguistique, sur fond de laquelle se joue aussi la question du redéploiement économique de la Belgique et de ses régions, participe également à une certaine instabilité politique. Entre 1970 et 1974, la Belgique connaît une dissolution des Chambres, deux démissions de gouvernement et trois remaniements. Tous ont pour origine ou toile de fond la question communautaire. Après les gouvernements Eyskens IV et V et Leburton I et II, le pays est gouverné par le gouvernement Tindemans I (associant sociaux-chrétiens et libéraux), qui devient bientôt Tindemans II (suite à l’arrivée du RW), à partir de 1974.
66 La LRT fait donc son apparition dans un contexte politique mouvant, dominé par un débat peu propice au développement d’une organisation dont le terrain de prédilection est la question sociale. Cependant, l’agitation sociale de la première partie de la décennie lui donne l’illusion d’une radicalisation rapide et profonde de la société devant aboutir à une crise révolutionnaire. Cette analyse n’est d’ailleurs pas l’apanage de la seule LRT : elle est portée par toute la Quatrième Internationale, dont E. Mandel est le théoricien et le dirigeant le plus influent. Du reste, c’est l’analyse que font de la période la plupart des organisations et groupes se réclamant du paradigme révolutionnaire qui éclosent et se renforcent partout en Europe à cette époque. Dès lors, il s’agit pour tous ces groupes de gagner l’influence nécessaire pour apparaître comme le pôle révolutionnaire capable de prendre la direction de la classe ouvrière. Dès sa création, la LRT est consciente qu’elle est lancée dans une course de ce type avec ses concurrents, notamment ceux d’obédience maoïste dont le principal est l’organisation flamande Alle Macht aan de Arbeiders (AMADA, qui a succédé au SVB), qui se dote en 1975 d’une branche francophone sous le nom de Tout le pouvoir aux ouvriers (TPO) [72].
67La LRT est également consciente de son extrême hétérogénéité. En effet, les divergences politiques ne se cristallisent pas uniquement autour des anciens entristes et de la nouvelle génération JGS. Une série d’autres couches militantes doivent encore être gagnées au programme et à la méthode de la LRT. C’est certainement le cas des groupes d’ouvriers, ralliés par le travail au sein du PWT, dont celui emmené par le délégué syndical emblématique L. Goire, de l’usine Cockerill à Ougrée, qui se sent en décalage avec le profil radical de la LRT. C’est aussi le cas des étudiants gagnés dans la foulée de Mai 68, qui s’accommodent mal de la discipline militante.
68 Les jeunes dirigeants de la LRT engagent donc, dès les premiers mois de l’organisation, une campagne interne de formations politiques à destination de la base. Ils tentent aussi d’unifier les pratiques et d’implanter durablement le modèle léniniste dans le parti : processus de décision par le biais du « centralisme démocratique » (qui suppose le respect strict, par l’ensemble des militants, des décisions adoptées par la majorité après une période de débats contradictoires) et, surtout, soumission de tous les aspects de la vie des militants aux impératifs de construction du parti dans une perspective de formation de « révolutionnaires professionnels ». Couplé à l’inexpérience des tâches organisationnelles quotidiennes – qui entraîne dysfonctionnements et retards – et à un style très directif, ceci engendre les critiques d’une série de couches militantes, dont les vieux trotskystes, peu enclins à l’indulgence, mais aussi les plus jeunes, rétifs à la discipline d’organisation. Des initiatives sont prises pour unifier politiquement la LRT au moyen du bulletin intérieur. Le sixième numéro du bulletin, qui est non daté mais que l’on peut estimer avoir été écrit à la fin de l’année 1971, est tout entier consacré à l’importance de la Quatrième Internationale et du fait de revendiquer l’étiquette « trotskyste ». Cela en dit long sur l’état des divergences à l’intérieur de la LRT, et ce malgré les nombreuses discussions préparatoires qui se sont tenues avant la fusion. Par ailleurs, une série de membres pressentis pour encadrer le travail du parti sont envoyés en formation dans le cadre d’un stage international.
69 La stabilisation du cadre de la LRT et l’acquisition d’une routine d’organisation semblent connaître quelques difficultés durant les quatre premières années d’existence de la ligue. Le manque de sérieux dans le travail et le manque de régularité dans la tenue des commissions sont souvent pointés du doigt. La LRT doit également maintenir en vie ce qui devient la presse d’organisation de la LRT, les hebdomadaires : La Gauche et son pendant néerlandophone, Rood. Cela s’avère un défi constant vu la faiblesse de son cadre. Durant toute l’existence de la LRT, du reste, le financement et le fonctionnement du journal s’avèrent difficiles. En novembre 1971 déjà, le bureau politique est confronté à « la défaillance du plus grand nombre des membres » [73] de l’équipe de rédaction francophone et à la nécessité de la recréer [74].
70 Les militants de la LRT compensent cependant la faiblesse organisationnelle par leur activisme, ce qui leur permet à plusieurs reprises d’influencer, de diriger ou d’initier des campagnes couronnées de succès : campagne de soutien à l’Irish Republican Army (IRA) au début de l’année 1972, à la lutte de libération du peuple vietnamien en octobre de la même année et, surtout, mouvement lycéen contre le projet de réforme de l’armée [75] porté par le ministre de la Défense nationale, Paul Vanden Boeynants (PSC), comprenant une suppression du sursis de service militaire pour les étudiants [76]. À partir de leurs positions lycéennes, les jeunes militants de la LRT parviennent à créer un Front national lycéen, qu’ils dominent politiquement et auquel ils obligent leurs concurrents politiques (principalement AMADA et la Jeunesse communiste) à adhérer. Le mouvement contre le « plan VDB » qu’ils arrivent à créer est énorme par sa durée et par l’ampleur de la mobilisation. Au paroxysme de celle-ci, le Front national lycéen peut se vanter d’avoir fait descendre dans la rue 176 000 lycéens dans toute la Belgique et d’avoir réussi à mettre des centaines d’écoles en grève, dont beaucoup sont occupées par les élèves. Le mouvement se solde par une victoire, certes provisoire : le projet de loi est retiré en mai 1973 pour être réintroduit [77], sans les mesures les plus contestées toutefois, en septembre de la même année.
71 En 1974-1975, la LRT a également l’occasion de peser sur la lutte que les étudiants et le personnel des universités mènent contre la décision des ministres de l’Éducation nationale, Pierre Humblet (PSC) et Herman De Croo (PVV), de revoir les normes de financement des universités. Bien que numériquement faible, la SJW (aile flamande de la JGS) est à cette époque à la tête d’une tendance influente au sein du Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS). Durant les années 1974 et 1975, la SJW et le mouvement étudiant d’AMADA, le Marxistische-Leniniste Beweging (MLB, en français Mouvement marxiste léniniste - MML), se livrent une lutte intense pour la direction du VVS. Forte de sa collaboration avec l’organisation étudiante Centrum voor Vorming en Aktie (CVA), résultant d’une fusion entre une organisation de jeunes chrétiens de gauche et un groupe d’étudiants tiers-mondistes, la SJW parvient à former une tendance qui enlève la direction au MLB lors du congrès du VVS de décembre 1974 [78].
72 Ceci met la SJW en position d’initier un Front national étudiant (FNE) avec les organisations représentatives des étudiants à Bruxelles, à Liège et à Louvain. Ce FNE se met en lien avec les délégations syndicales de personnel universitaire dans lesquelles la LRT détient des positions (principalement à l’ULg avec Jean Roosen, mais aussi à l’ULB et à la VUB). Une première journée d’action nationale est organisée le 20 novembre 1974, qui regroupe quelque 15 000 étudiants et travailleurs. C’est le point de départ d’une grève commune des étudiants et du personnel, qui dure jusqu’à deux semaines en ce qui concerne l’ULg et qui, là où la LRT exerce une influence, s’organise avec des assemblées générales du personnel. Le 9 décembre 1974, une deuxième journée d’action nationale rassemble 20 000 étudiants. Mais le même jour, la CGSP rompt le front commun avec les étudiants et trouve un accord avec le gouvernement Tindemans II concernant les modalités d’application du plan, ce qui est dénoncé par La Gauche [79]. En définitive, l’influence de la LRT n’est pas en mesure de contrecarrer la décision de la direction syndicale de s’engager dans la voie de la concertation. Néanmoins, l’opération est jugée bénéfique, puisque la LRT pense pouvoir lancer un travail de structuration d’une tendance syndicale à l’ULg et l’ULB, tandis que des cercles JGS sont renforcés à l’ULB, à l’ULg et à la KUL.
3.2. L’inscription dans le paysage politique et les relations avec les autres formations de la gauche radicale
73Dans le paysage politique foisonnant de la gauche des années 1970, la LRT est loin d’être la seule organisation à briguer le titre de parti de la révolution socialiste en Belgique. Elle tente à la fois de se démarquer des organisations qu’elle considère comme ses concurrentes directes à cet égard et d’instaurer des collaborations avec des organisations plus petites ou de poids égal afin d’affirmer sa place sur la scène politique.
74 Le maoïsme constitue alors le principal concurrent du courant trotskyste. En particulier, AMADA s’impose en Flandre, contraignant la LRT à une certaine « marginalité dans la marge ». Cela explique la lutte acharnée des militants trotskystes flamands pour garder le contrôle du mouvement de masse quand ils arrivent à s’en saisir, au prix même de l’affaiblissement de ce mouvement. Ainsi, en mars 1973, les lycéens anversois de la LRT font campagne parmi les « lycéens radicalisés » pour les convaincre de ne pas participer à une manifestation à laquelle AMADA a appelé contre le projet de loi sur les milices privées (cf. supra) [80]. Mais la myriade des autres groupes d’inspiration maoïste qui se développent principalement à Bruxelles et en Wallonie peut aussi venir contrecarrer les tentatives de développement de la LRT. Emmenée par Jacques Grippa, la scission pro-chinoise du PCB occupe le terrain dès 1963 sous le nom de Parti communiste de Belgique [81]. Dès 1967, cette formation se divise elle-même entre fidèles au maoïsme (qui fondent le Parti communiste marxiste-léniniste de Belgique - PCMLB) et pro-albanais (qui gardent l’enseigne du nouveau PCB « grippiste »). Du côté du mao-spontanéisme [82], le groupe Université-Usine-Union (UUU), issu du mouvement étudiant de Mai 68 à l’ULB, donne naissance à Parole au peuple (PAP) et à une tendance critique qui contribue à fonder l’Union communiste (marxiste-léniniste) de Belgique (UC(ML)B), l’un des groupes maoïstes les plus structurés en Belgique francophone [83].
75L’aspect de nouveauté que revêtent les théories maoïstes, surtout dans leur variante spontanéiste, et la rupture qu’elles opèrent avec le marxisme-léninisme des vieux partis communistes sont à même de trouver un écho favorable dans la jeunesse de cette période. Quant à lui, le trotskysme se revendique d’une continuité : celle de la Révolution d’Octobre et de la tradition bolchevique authentique. Le maoïsme a donc cet avantage d’avoir les atours d’un phénomène radicalement neuf, quand le trotskysme apparaît comme une tentative de restauration.
76 Par ailleurs, si elle est incontestablement l’organisation trotskyste belge la plus importante, la LRT doit compter avec d’autres formations plus petites, voire groupusculaires, qui se revendiquent également de cette tradition. Dans la région de Charleroi, un groupe ayant refusé la continuation de la tactique entriste après la grève de 1960-1961 et s’étant rapproché du dirigeant trotskyste latino-américain Juan Posadas s’est constitué en organisation autonome en juillet 1962 sous le nom de Parti ouvrier révolutionnaire (POR) puis de Parti ouvrier révolutionnaire trotskyste (PORT) [84]. Pour sa part, plutôt implantée dans la région liégeoise, la version lambertiste [85] du trotskysme dispose d’un noyau de militants dès 1974, qui s’organise sous le nom de Groupe trotskyste de Belgique pour la reconstruction de la Quatrième Internationale puis d’Organisation socialiste internationaliste (OSI) à partir de 1980. Enfin, un groupuscule émanant de la Revolutionary Socialist League (RSL) britannique s’implante à Ostende en 1974. Sous le nom de leur périodique, De Vonk, ses membres constituent une tendance au sein de l’aile flamande du PSB et de son organisation étudiante, Actief Linkse Studenten, à la VUB et à l’université de Gand [86] .
77Dans les entreprises, le maoïsme concurrence l’influence trotskyste par sa tactique précoce d’implantation en milieu ouvrier. Dès la grève des mineurs du Limbourg, la JGS est confrontée à des groupes d’« implantés » du SVB. Les militants trotskystes considèrent que l’« antisyndicalisme forcené » du SVB qui est « projeté sur la LRT » [87] constitue une gêne pour eux mais, en même temps, ils la voient comme une faiblesse pour les maoïstes puisque cela leur aliène souvent une partie des ouvriers (qu’ils affrontent parfois physiquement, comme, en 1973, lors de la grève des dockers [88] ou de celle de Caterpillar [89]).
78 La dénonciation des organisations maoïstes est omniprésente dans La Gauche. Leur « sectarisme » et leur volonté de récupérer les mouvements de masse sont régulièrement critiqués. Ainsi, dans le mouvement visant à contrer le plan de réforme de l’armée, La Gauche consacre un article à « un congrès national lycéen » convoqué par l’organisation lycéenne d’AMADA, Rebelle, le jour même où 15 000 élèves du secondaire défilent à Bruxelles [90]. Cependant, quelles que soient les difficultés que la LRT rencontre avec les organisations maoïstes, elle prend soin de leur apporter sa solidarité et son soutien quand elles sont victimes de la « répression de l’État bourgeois ». Ainsi, lorsque des militants syndicaux du PCB livrent des militants d’AMADA à la gendarmerie lors de la grève des dockers, la LRT dénonce publiquement cette utilisation de la « justice bourgeoise » comme « contraire aux traditions du mouvement ouvrier » [91].
79 La LRT porte aussi une attention à l’évolution du PCB, qu’elle estime être son principal concurrent (les maoïstes n’étant considérés, après tout, que comme un phénomène passager [92]). Adversaire historique du fait du stalinisme qui le caractérise encore à cette époque, le PCB est, au début de la décennie 1970’, une formation forte de presque 10 000 militants, d’une présence syndicale dans les grands bastions industriels et d’un impact électoral de 5 % à l’échelle nationale [93]. Les congrès du PCB sont régulièrement analysés dans La Gauche, qui qualifie la politique de ce parti de « néo-réformisme de type stalinien » [94]. Les positions du PCB y sont souvent violemment critiquées. Au niveau international, c’est sa soumission aux intérêts soviétiques, et notamment son silence à propos de la répression du Printemps de Prague de janvier-août 1968, qui est pointée du doigt [95]. En politique intérieure, La Gauche critique la volonté du PCB de se rapprocher du PSB par une stratégie de « rassemblement des progressistes » [96]. Sur le plan du travail syndical, la LRT reproche aux syndicalistes du PCB de privilégier la concertation et les liens avec la « bureaucratie syndicale » plutôt que de chercher à « étendre les luttes ». Le rôle du PCB dans la grève des dockers est particulièrement critiqué : la LRT accuse notamment le PCB d’avoir fait avorter un projet de manifestation nationale qu’elle avait convaincu le comité de grève anversois des dockers d’organiser [97]. Malgré ces critiques et les innombrables difficultés suscitées par la cohabitation dans des plateformes communes, c’est pour le PCB que la LRT appelle à voter lors des élections législatives de novembre 1971, elle-même renonçant à se présenter pour se concentrer sur sa structuration (cf. infra) [98].
80 La LRT réserve ses critiques les plus féroces au PSB, qui se transforme selon elle en un « parti de gestion du capitalisme » [99], notamment à partir de janvier 1973, lorsque le PSB est associé aux libéraux dans le cadre des gouvernements Leburton I et II [100]. La LRT recherche néanmoins le dialogue avec l’aile gauche du PSB, de façon à « provoquer des différenciations politiques au sein de la social-démocratie » [101]. Pour ce faire, elle intervient dans la lutte de tendances au PSB entre les « réformistes » et les « modernistes » qui veulent liquider le reste de l’héritage marxiste. De même, elle tend à se rapprocher des Jongsocialisten en Flandre, afin d’aider à leur « mûrissement politique » dans le cadre de la clarification politique qui doit découler de l’évolution du PSB. Ainsi, E. Mandel est invité en décembre 1972 par des sections locales des jeunes socialistes flamands à donner une conférence sur « la conception du socialisme révolutionnaire » [102].
81Enfin, l’attention des trotskystes ne se limite pas aux organisations du mouvement socialiste. Les débats qui animent la gauche chrétienne trouvent un écho dans les pages de La Gauche [103]. Dans sa propagande, la LRT appelle régulièrement les organisations du Mouvement ouvrier chrétien (MOC) à rompre avec le PSC, de façon à former un parti des ouvriers chrétiens qui pourrait constituer un front avec les organisations ouvrières socialistes [104]. Elle collabore d’ailleurs avec une série d’organisations chrétiennes de gauche dans des plateformes antimilitaristes ou de solidarité internationale. La Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), les Équipes populaires (EP), le Katholieke Werklieden Bond (KWB) et le Groupe politique des travailleurs chrétiens (GPTC) ainsi que, à une échelle plus locale, le groupe Rencontres ouvrières font partie des organisations avec lesquelles la LRT collabore régulièrement.
82Un rapprochement entre communistes et chrétiens de gauche s’opère à l’occasion des élections communales du 11 octobre 1970 et des élections législatives du 7 novembre 1971. Des listes, baptisées respectivement Union des progressistes (UP) et Rassemblement des progressistes (RP), sont créées à Mons sous l’impulsion du sénateur communiste René Noël [105]. Elles rassemblent, outre des candidats du PCB, des militants du GPTC ainsi que des militants syndicaux de la CSC et de la FGTB actifs dans le groupe Gauche boraine. Après les élections, elles continuent à être des lieux de convergence sous le nom d’Union démocratique et progressiste (UDP). La LRT y prête d’autant plus d’intérêt que la circonscription de Mons est la seule qui voit le PCB progresser lors des élections de 1971 [106]. Dès lors, les militants trotskystes de la région s’impliquent dans l’UDP et tentent d’y gagner une influence en « cherchant le clivage » avec le PCB [107]. Dans sa presse, la LRT tire parti de l’exemple montois pour exhorter le PCB à élargir cette stratégie à toutes ses fédérations et s’emparer, via les UDP, des « luttes d’entreprise » [108].
83 En tant que révolutionnaires, les trotskystes estiment que la prise du pouvoir ne s’opérera pas par les urnes. Cependant, ils considèrent aussi qu’il importe d’utiliser les « institutions bourgeoises » et les élections comme tribune pour l’agitation politique et comme moyen de construire l’organisation révolutionnaire. C’est d’ailleurs par faute de moyens et non par principe que la LRT renonce à se présenter aux élections de novembre 1971. En mars 1974, à la faveur d’élections législatives causées par la démission du gouvernement Leburton II et la dissolution des Chambres, elle voit une occasion de faire connaître largement ses positions anticapitalistes. En effet, le gouvernement démissionne à la suite de l’échec d’un projet d’initiative industrielle publique : l’établissement d’une raffinerie de pétrole dans la région liégeoise, voulue par le PSB [109]. Selon la LRT, c’est là l’occasion de faire campagne sur un programme de nationalisation de l’industrie sous contrôle ouvrier. Il s’agit aussi de « capitaliser » et d’apparaître comme un « pôle révolutionnaire » au moment où AMADA se lance aussi dans la course électorale, déposant des listes à Anvers, à Gand, à Alost et à Hasselt [110]. La LRT renonce néanmoins une nouvelle fois à se présenter, arguant de nouveau de l’impossibilité de mettre de l’énergie dans une telle campagne, et défend le « vote à gauche ». Tandis qu’AMADA récolte 0,66 % à l’échelle des cantons flamands [111], la LRT décide de centrer son activité sur les luttes d’entreprise, la solidarité internationale avec le Chili et la lutte contre le projet de loi relatif aux milices privées.
3.3. De la périphérie vers le centre : glissement du terrain d’action principal
84L’importante énergie dépensée par les trotskystes pour investir le champ des luttes de la jeunesse est caractéristique de cette tactique dont la LRT parle constamment dans les documents internes de cette période et qui est intitulée « de la périphérie vers le centre ». Considérant que la construction d’une base militante dans la classe ouvrière est temporairement hors de portée, la LRT se propose de tirer parti de la radicalisation de la jeunesse pour conquérir ensuite le cœur de la classe ouvrière. Il s’agit dès lors de construire une position dans la jeunesse et de démontrer la pertinence des options stratégiques de la LRT sur ses terrains de mobilisation spécifiques, mais aussi d’utiliser les militants lycéens et étudiants pour diffuser les propositions programmatiques et stratégiques de la LRT vers la classe ouvrière. En ce sens, la cible immédiate de la politique de recrutement devient de plus en plus fréquemment l’étudiant universitaire et de moins en moins l’ouvrier d’industrie ou le syndicaliste.
85 Le travail d’agitation dans les grèves et à la porte des usines prend visiblement le pas sur le travail de structuration d’une tendance de gauche au sein des syndicats. Quelques mois avant la fondation de la LRT encore, le congrès extraordinaire de la FGTB tenu du 23 au 31 janvier 1971 a notablement retenu l’attention des trotskystes. La SBQI a alors mobilisé ses forces, singulièrement au sein de la CGSP-Enseignement, pour tenter de défendre le sens anticapitaliste des réformes de structures, comme envisagé lors du congrès de 1954. Dorénavant, les congrès de la FGTB et de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) ne suscitent plus autant l’intérêt des trotskystes. Si ces congrès sont analysés dans les pages de La Gauche et de Rood, la possibilité de peser directement sur la ligne de ces deux syndicats n’est désormais plus évoquée.
86 Cependant, il serait erroné de considérer que le mouvement trotskyste abandonne à cette période le terrain syndical. D’une part, il entrevoit la possibilité, via l’activité de ses militants étudiants, de structurer, sous son influence, un courant « antibureaucratique » du fait de la « remontée des luttes ouvrières » autour des mots d’ordre de démocratie syndicale et de syndicalisme de combat. D’autre part, il bénéficie de quelques positions syndicales d’importance en Wallonie.
87 Parmi les syndicalistes de la LRT, A. Henry, militant syndical à l’usine Glaverbel à Gilly, est souvent mis en avant dans les publications comme figure de proue de cette tendance syndicale en devenir. Son action est présentée comme l’exemple concret de la stratégie du syndicalisme de lutte que la LRT défend. A. Henry anime une tendance syndicale combative autour du bulletin d’entreprise La Nouvelle Défense. En décembre 1971, cette tendance s’impose à la tête de la délégation syndicale de l’entreprise Glaverbel en dehors de la procédure normale d’élection sociale, par la mobilisation des travailleurs en sa faveur et un vote en assemblée générale. Elle contraint par ce biais la direction de Glaverbel et les directions syndicales à accepter la régularité des élections. Faisant vivre au sein de l’usine la revendication du contrôle ouvrier, A. Henry et ses camarades s’opposent régulièrement à la direction de l’entreprise sur les questions des cadences et de l’organisation du travail ou pour imposer des assemblées générales tenues durant le temps de travail. C’est un travail syndical qui fait grand cas de la démocratie, qui réunit régulièrement les travailleurs de l’entreprise, qui travaille à solidariser l’ensemble des secteurs et qui porte une attention à la formation politique des militants syndicaux. Dans La Nouvelle Défense, les ouvriers peuvent lire des articles traitant de la situation économique ou des problèmes internationaux. Dans la même optique, une bibliothèque à l’usage du personnel de l’usine est ouverte par la délégation dès 1972.
88 En 1973, A. Henry évite un licenciement grâce à la mobilisation des travailleurs de l’usine, qui organisent une grève et l’occupation de l’entreprise pendant dix jours. Cette grève victorieuse est l’occasion pour la LRT d’une tournée de meetings pour populariser la grève et ses méthodes. Elle est aussi l’objet d’une brochure éditée par la LRT et intitulée « La démocratie ouvrière et syndicale : une arme pour un syndicalisme de combat. L’exemple de Glaverbel-Gilly ». La délégation de Glaverbel est aussi à l’origine d’un travail de coordination des délégations d’entreprise du secteur verrier de la région de Charleroi, qui s’oppose à la restructuration du secteur à partir de 1972. Au sein d’un comité régional de coordination du verre et d’un comité pour la défense de l’emploi, les syndicalistes de La Nouvelle Défense revendiquent la nationalisation du secteur sous le contrôle des travailleurs, faisant écho à la revendication défendue par le mouvement trotskyste. Cette coordination régionale est à l’initiative d’une grève régionale du secteur du verre qui voit, durant trois semaines en avril et mai 1974, les verriers occuper leurs entreprises et s’organiser en comité de grève régional. Très offensifs, les grévistes parviennent à emporter des augmentations de salaire substantielles et l’uniformisation des barèmes, ainsi que l’avancement de l’âge de la pré-retraite.
89 L’exemple de Glaverbel, s’il est un exemple parfait de la stratégie syndicale de la LRT, reste cependant une exception dans le travail syndical de l’organisation trotskyste. Les contacts établis au sein des usines débouchent rarement sur des adhésions et l’existence de cellules d’entreprise de la LRT, pour autant qu’il soit possible d’en trouver la trace, semble éphémère. Bien plus, les positions syndicales de la LRT sont sous pression durant cette période. À Bruxelles, P. Le Grève et ses camarades du comité exécutif de la CGSP-Enseignement bruxelloise sont menacés d’exclusion en novembre 1972 pour avoir défendu des revendications barémiques supérieures à celles décidées par le comité national de la CGSP. Grâce à une campagne de soutien organisée par les enseignants de la LRT de la région de Liège, le comité exécutif bruxellois n’écope que de trois mois de suspension. Ses membres sont par ailleurs réélus « à une écrasante majorité » lors des élections statutaires suivantes [112].
90À Liège par contre, c’est cette position syndicale, « principal gain de la période entriste » [113], qui disparaît avec le licenciement de L. Goire et de ses six camarades délégués à l’usine Cockerill à Ougrée. Moins « politique » qu’A. Henry, moins intégré aussi, comme on l’a vu, à la LRT, L. Goire est une figure importante du syndicalisme d’action directe d’inspiration renardiste. C’est sous l’impulsion de sa délégation que la grève pour la « prime de vie chère » est conduite et gagnée à Cockerill en avril 1971. Cette grève est menée en mettant à l’arrêt les aciéries stratégiques « Thomas » et « LD » de l’usine Cockerill d’Ougrée, dans lesquelles l’influence de L. Goire est prédominante. En arrêtant le travail, les ouvriers de ces deux aciéries sont en mesure de paralyser l’ensemble de l’entreprise, un avantage que la délégation syndicale ne se prive pas d’utiliser, en veillant néanmoins à ne pas pénaliser l’ensemble des ouvriers au profit de revendications corporatistes des seuls sidérurgistes.
91 Le 10 septembre 1973, lorsque, contre l’avis des instances de la Fédération liégeoise des Métallurgistes (FLM, affiliée à la FGTB), le comité d’usine de Cockerill dépose un préavis de grève pour revendiquer l’intégration dans les salaires de la prime de haute conjoncture négociée en commission paritaire, la délégation des aciéries est parmi celles qui poussent à la grève [114]. Mais ce mouvement n’est pas suivi massivement. Un certain nombre de secteurs continuent le travail. Un référendum sur la grève demandé par la FLM donne, le 21 septembre, un résultat très partagé de 54,9 % des voix en faveur de la reprise du travail (sans compter le vote des travailleurs des aciéries, invalidé pour des raisons de procédure). Le comité d’usine décrète alors la fin de la grève, mais la délégation des aciéries veut réitérer sa stratégie de 1971 en forçant l’arrêt de l’usine par une action minoritaire de son secteur. C’est ainsi que les sidérurgistes de Cockerill occupent leur lieu de travail contre les avis du comité d’usine et de la FLM. Pour la FLM et son président, Robert Lambion, il s’agit là d’un cas d’indiscipline avéré qui est passible de sanction : le 28 septembre, les 22 délégués des aciéries (dont des militants de la LRT, du PSB ou du PCB) sont démis de leurs mandats. Malgré une demande de réintégration par le comité d’usine et malgré le fait que la grève aux aciéries se transforme en grève pour la réintégration des délégués démis, R. Lambion reste inflexible. La direction de Cockerill saisit cette occasion pour licencier sept des meneurs de la grève le 6 octobre, dont deux militants de la LRT : L. Goire et Armand Dams [115].
92 La LRT riposte par l’organisation d’une campagne de pétitionnement dans toutes les centrales de la FGTB pour réclamer la réintégration des « sept de Cockerill ». Des comités de soutien se créent rapidement, dès le mois de décembre 1973, à Bruxelles et Mons autour de la CGSP-Enseignement, un peu plus tard à Liège, en janvier 1974, en raison du veto de la FLM. Cette pétition recueille un certain succès en raison d’affaires du même type dans d’autres entreprises. À cette époque, en effet, des délégués combatifs sont licenciés dans une série d’entreprises (Caterpillar, Brassico, Banque Degroof ou Liedts Papiers-peints), élément du contexte que la LRT ne manque pas d’utiliser dans sa pétition. Le licenciement des « sept de Cockerill » est ainsi transformé en une attaque contre toute la tradition renardiste d’action directe. Il est présenté comme un licenciement « téléguidé par la Société générale » et qui constitue un « test pour le patronat » : « Demain, aucun militant ne sera plus protégé contre l’arbitraire patronal si la solidarité devait faiblir à l’égard du “bastion des métallos” » [116]. Une tournée de meetings accompagne cette campagne. L’action de la LRT dans le cadre de la réintégration ne peut s’émanciper d’une analyse politique qui freine quelque peu l’élargissement de la solidarité. Dans ses publications, la LRT insiste sur la « trahison » des directions syndicales et sur le manque d’enthousiasme du PCB à soutenir les grévistes [117]. Parmi les initiatives qui peuvent dissuader des militants syndicaux de soutenir L. Goire et ses compagnons, figure un chaulage sur la façade de La Wallonie (organe de la FLM) dans la nuit du 5 au 6 décembre ; il est effectué et revendiqué par de jeunes militants de la LRT exigeant qu’on ne « touche pas au syndicalisme de combat » [118]. La direction de la FLM a alors beau jeu de dénoncer les « pseudo-révolutionnaires » trotskystes [119].
93 Malgré cette campagne, les délégués licenciés ne sont pas réintégrés ; l’implantation de la LRT dans l’entreprise s’effiloche dès lors. Cependant, le comité pour la réintégration des « sept de Cockerill » subsistera de nombreuses années après le conflit et influencera parfois le travail syndical à Cockerill (la délégation syndicale qui prend la suite de l’équipe de L. Goire est ainsi membre de ce comité). Il se transformera en 1976 en un collectif, le Mouvement d’unité des travailleurs (MUT), animé principalement par des anciens de Cockerill (dont le vieux militant trotskyste Marcel Lorent). Il pérennisera dans l’entreprise des positions trotskysantes au moyen du bulletin Unité, mais sans permettre de reconstituer une cellule LRT active au sein de Cockerill. Le MUT disparaîtra au début des années 1980.
94 En définitive, le « travail ouvrier » de la LRT durant ses premières années d’existence se solde par une perte d’influence au sein de l’appareil syndical, ainsi que par un recrutement et une implantation quasi nuls, bien que la LRT se constitue un réseau de sympathisants et une certaine « reconnaissance » dans les milieux syndicaux les plus radicaux.
3.4. « De bons animateurs du mouvement de masse, de mauvais organisateurs du parti »
95Cette formule, que l’on trouve sous la plume de Micheline Nélisse (membre de la direction de la LRT à la fin des années 1970 et au début des années 1980) [120], parle d’elle-même : l’audience de masse que la LRT arrive à gagner dès les premières années de son existence ne se conclut pas par un renforcement du parti.
96 Si, au terme du mouvement contre le « Plan VDB », la LRT estime avoir gagné une « meilleure insertion dans le champ politique, une extension géographique dans la foulée du mouvement » et un « rayonnement général de l’organisation », elle souligne aussi les difficultés de « la centralisation politique interne, de la capitalisation et du recrutement » [121]. Pour tenter d’y remédier, la LRT entame une « campagne politico-organisationnelle » dans le courant de l’année 1973, couronnée par une journée nationale JGS le 13 mai 1973 portant sur les thèmes centraux de la LRT : révolution socialiste, solidarité internationale, résistance à l’État fort. Mais de nouveau, cette campagne ne se solde pas par une consolidation de la LRT.
97 Cette incapacité à cristalliser en son sein une nouvelle couche de « militants d’avant-garde » est génératrice de malaises précoces dans l’organisation. Si un certain nombre de vieux militants parmi les plus actifs dans les milieux syndicaux regardent avec circonspection l’orientation du parti vers les « nouvelles avant-gardes jeunes » au détriment de l’activité dans le mouvement ouvrier traditionnel, d’autres, de la même génération mais participant d’une frange plus intellectuelle, se montrent franchement réfractaires à la « bolchévisation » du parti voulue par la jeune direction. Ainsi, dès septembre 1971, un groupe de militants se forme autour de « Fernand » (Philip Polk) et de « Pascal » (Guy Desolre), l’un professeur à la faculté des Sciences de la VUB et l’autre chercheur à la faculté de Droit de la même université. Le groupe prend le nom de « Où allons-nous ? ». Les tensions entre ce groupe et le reste de l’organisation vont croissant, à tel point que les membres d’Où allons-nous ? remettent leur démission de la ligue un an plus tard, par un texte où la LRT est décrite comme « se repliant de plus en plus sur elle-même » et en proie à « un double phénomène de marginalisation » : marginalisation de ses membres « critiques et politiques » par rapport à l’organisation et marginalisation de l’organisation elle-même vis-à-vis des luttes sociales [122]. Cette première scission de la LRT prend le nom de Groupe marxiste internationaliste (GMI), qui restera actif jusqu’en 1978. Surtout centré à Bruxelles, il se limitera à diffuser un mensuel au ton très théorique intitulé La Brèche.
98 Conscient du malaise qui s’installe, le bureau politique de la LRT produit un bilan de ses premières années d’activités à l’occasion du congrès que le parti tient en juillet 1973. Il estime que le développement de l’organisation « accuse un incontestable retard par rapport aux possibilités objectives », estimant que « la cause fondamentale réside essentiellement dans le manque de centralisation interne », et il préconise un renforcement du sérieux, de la discipline militante et du contrôle du bureau politique sur le travail des sections [123]. Toutefois, les débats qui préparent ce congrès (et qui sont répertoriés dans les bulletins internes) indiquent que l’orientation du bureau politique en faveur d’un accroissement de la « centralisation du travail » ne fait pas l’unanimité. Deux critiques reviennent régulièrement dans les contributions au débat : d’une part, la LRT suivrait un cours « sectaire » et « gauchiste », faisant primer sa croissance et sa « percée politique » sur les intérêts du mouvement ; d’autre part, sa direction serait « autoritaire » voire « en voie de bureaucratisation ».
99 La direction de la LRT est critiquée à la fois, de façon prévisible, par la vieille garde, comme le groupe de la CGSP-Enseignement bruxelloise, mais aussi par une base de militants plus jeunes, relativement rétifs à la conception du « centralisme démocratique » tel qu’envisagé par la direction. Au cours du deuxième congrès de la LRT, qui se tient en mai 1974, elle admet un fonctionnement erratique, qu’elle explique par son inexpérience, par la « non-réalisation d’une réelle fusion de l’ancienne direction avec la jeune direction » et par une surcharge permanente de travail pour pallier le manque de cadres régionaux [124]. Néanmoins, elle parvient à imposer ses propres solutions : refonte du comité central, centralisation accrue du travail et effort de formation des membres.
4. Deuxième mouvement (1974-1978) : la refondation de la LRT comme parti des nouvelles avant-gardes
100Dans la seconde moitié des années 1970, la LRT s’écarte du modèle léniniste d’organisation et se dote d’un profil plus en phase avec l’air du temps pour tenter de se construire une base sociale. Sous l’impulsion de la génération post-soixante-huitarde, elle intègre le champ des « nouvelles luttes » ouvert par la contestation de 1968, s’intéresse aux thématiques environnementales et culturelles, et redouble d’intérêt pour les luttes féministes. Ceci l’amène à coopérer avec une série de groupes, organisations et personnalités [125] actives sur ces terrains. Cette transformation ne se déroule pas sans générer des frictions à l’intérieur de l’organisation. Sans surprise, les tensions épousent les frontières générationnelles, mais l’on aperçoit également un découpage en fonction de la place des militants dans l’organigramme du parti.
4.1. Les premières luttes de tendances et les discussions sur le profil de la LRT
101Le congrès de mai 1974 admet que la LRT doit rompre avec son « triomphalisme d’organisation ». Désormais, l’interaction avec les autres formations de gauche ne doit plus être recherchée pour affirmer l’authentique programme révolutionnaire, mais plutôt pour former des « fronts unis combinant débat stratégique, activités politiques communes, action et discussion ». Dans ce cadre, les « petites organisations et [les] courants faiblement structurés » sont privilégiés. Mais la LRT ne perd pas de vue qu’elle doit aussi tenter d’impliquer le PCB, ainsi que les « courants de gauche au sein du PSB et de la FGTB » [126].
102 La campagne de centralisation du travail et l’ouverture croissante aux autres acteurs de la gauche radicale belge donnent un nouvel élan à la LRT. Mais cette dynamique est rapidement enrayée à l’approche des discussions en vue du troisième congrès, qui montrent que les divergences au sein du parti n’ont pas été réglées par le congrès de 1974.
103 Le processus de démocratie interne des trotskystes est caractérisé par la possibilité pour les militants de se constituer en tendances afin de défendre un point de vue particulier. Les congrès, habituellement précédés d’une discussion autour d’un texte élaboré par la direction sortante, représentent les moments privilégiés de création de telles tendances : les différents points de vue sont exposés dans des textes publiés dans le bulletin interne de l’organisation, autour desquels peuvent se regrouper les membres de l’organisation. Au terme des discussions préliminaires, ils choisissent alors de se constituer (ou non) en courants structurés en vue de mener campagne et d’emporter la majorité des votes lors du congrès ; ce processus codifié est connu sous l’appellation de « droit de tendance ». En 1975, la discussion préalable au congrès est entamée dès le mois d’avril, moins d’un an donc après le précédent congrès, avec la publication d’un texte signé par le bureau politique et intitulé « La LRT doit se transformer en une organisation militante qui commence à s’implanter dans la classe ouvrière ». Selon le bureau politique, la LRT serait « en passe de conquérir l’hégémonie dans l’avant-garde large tant jeune qu’ouvrière ». Son texte est donc centré sur la réaffirmation de la nécessité de professionnaliser le parti dans la perspective de la « nouvelle période révolutionnaire » qui, selon l’analyse de la Quatrième Internationale, s’annonce en Europe [127].
104 Ce texte constitue une déclaration de tendance puisque, au terme de leur mandat, les membres du bureau politique doivent se mettre sur un pied d’égalité avec tous les autres membres de l’organisation. Il initie une dynamique de constitution de tendances contradictoires. La première d’entre elles se constitue autour des quelques militants qui se font les porte-parole d’un courant critique qui, parti de la section états-unienne de la Quatrième Internationale, le Socialist Workers Party (SWP), traverse toute la Quatrième Internationale. Très ouvriériste, ce courant conteste le tournant vers les nouvelles luttes observé dans une majorité de sections de la Quatrième Internationale. La tendance se réclamant de ce courant reste extrêmement minoritaire au sein de la LRT.
105 À côté de cette tendance et de celle de la direction sortante, les « cadres intermédiaires », animateurs des sections locales et des commissions nationales, constituent une troisième tendance. Ils souhaitent davantage de consultation de la part du bureau politique, qu’ils qualifient de « bloc monolithique », et sont nettement moins optimistes sur les perspectives de développement du parti. Une quatrième tendance se forme aussi, qui s’oppose de manière absolue au « tournant organisationnel » voulu par l’exécutif sortant, accusé de bureaucratisation galopante. Cette dernière tendance, animée par des militants étudiants de l’ULB, trouve un écho auprès des plus jeunes militants.
106 On retrouve ici sans surprise les clivages observés précédemment mais prenant une forme structurée. D’une part, les vieux cadres du parti, qui sont exaspérés par les déclarations ronflantes et le style flamboyant du jeune bureau politique. D’autre part, la plus jeune génération militante, qui est imbibée de la culture antiautoritaire post-soixante-huitarde. Ces deux groupes prennent en étau la génération intermédiaire aux commandes de la LRT depuis sa fondation.
107 Les appels à la discipline militante de la part du bureau politique sortant ne calment pas les choses. Les tensions s’enveniment à un point tel que la LRT semble paralysée plusieurs mois durant, avant que les discussions n’aboutissent à la présentation d’un projet commun. Au cours du troisième congrès du parti, qui se tient du 27 février au 2 mars 1976, la direction sortante finit par admettre son dirigisme, tandis que l’ensemble de l’organisation s’accorde pour en finir avec le « spontanéisme organisationnel ».
108 Un autre fait est plus significatif si l’on veut rendre compte des transformations à l’œuvre dans le profil du parti. Sur le plan du développement de la LRT, le congrès de 1976 met en avant la perspective de conquérir les « nouvelles avant-gardes culturelles ». En effet, la première moitié des années 1970 est caractérisée par l’inscription dans le paysage politique du phénomène de la « nouvelle gauche », qu’un contemporain définit comme « la multiplication de groupes politiques et d’animation culturelle, librairies, journaux, ateliers populaires, collectifs d’avocats, de médecins, etc. dessinant les contours d’une vie politique systématiquement contestataire et marginale » [128]. Ouvrant de nouveaux champs à la contestation, ce mouvement hétéroclite interroge, dans la foulée de Mai 68, les rapports des individus à la société, non plus seulement du strict point de vue des rapports de production mais dans tous les aspects de la vie, même si ce courant s’enthousiasme pour les expériences autogestionnaires tentées dans la foulée de l’aventure des ouvriers de l’usine horlogère Lip de Besançon, en France. C’est donc tout un potentiel subversif sur lequel les militants de la LRT espèrent capitaliser [129].
109 Dès lors, l’organisation trotskyste cesse de faire de la question sociale son enjeu central pour investir de nouveaux champs de lutte.
4.2. La prise en compte de toutes les oppressions
110Le troisième congrès déplace les priorités de la LRT. Dorénavant, les « fronts secondaires » ne le sont plus autant et, de la même façon que les militants révolutionnaires tentent d’influencer le mouvement ouvrier, ils vont également tenter de prendre pied dans les « nouvelles luttes » : féministes, homosexuelles, environnementalistes, culturelles, etc.
111 Adoptant une position unique dans l’éventail des organisations marxistes belges, les militants de la LRT se prononcent en faveur de l’organisation autonome des femmes, considérées comme les victimes d’une oppression spécifique irréductible à la seule lutte de classes. À partir de 1976, à la faveur de la reprise des mobilisations pour la dépénalisation de l’avortement, la commission Femmes de la LRT s’implique activement dans la préparation de la Journée des femmes du 11 novembre, qui a pour thème le droit à l’avortement. Les militantes de la LRT œuvrent également à la mise sur pied de comités régionaux pour la légalisation de l’avortement dans le cadre d’une campagne lancée par la plateforme de la Société belge pour la légalisation de l’avortement, dont les trotskystes sont partie prenante [130]. Cette campagne est même déclarée « prioritaire pour l’organisation » au début de l’année 1977 [131].
112 À une échelle plus modeste mais produisant des résultats similaires, la LRT entame, au milieu des années 1970, un travail en direction de la communauté homosexuelle, qu’elle considère, au même titre que les femmes, comme la victime d’une oppression spécifique au sein du système capitaliste. Fin 1976, ce travail se structure autour du groupe des Rooie Vlinders, qui publie un journal éponyme. Associant une critique sociale radicale avec la dénonciation de l’oppression des homosexuels, ce groupe constitue une première du genre en Flandre [132].
113 La LRT est moins rapide à prendre en compte les luttes environnementalistes, qui émergent par ailleurs tardivement en Belgique. Si elle participe aux mobilisations antinucléaires initiées par le Verenigde Aktiegroep voor Kernstop (VAKS) en Flandre à partir de 1974 et par Les Amis de la Terre en Wallonie à partir de 1977, la LRT ne commence à approfondir ses positions sur l’écologie qu’à la fin de l’année 1977, à l’occasion des débats préparatoires à son quatrième congrès. Cependant, la lutte antinucléaire est surtout appréhendée par les trotskystes comme une lutte contre l’État fort, le nucléaire civil étant vu comme « un instrument de l’État pour renforcer sa capacité de répression » à cause de la militarisation des sites nucléaires [133]. C’est en décembre 1977 seulement qu’est créé un groupe de travail Écologie au sein de la LRT, alors que les collectifs et organisations issus de la nouvelle gauche ont investi ce terrain bien plus précocement (par exemple, les groupes de soutien au journal Pour qui lancent en 1975 un « collectif Écologie » [134] et le groupe Démocratie nouvelle fondé par l’ex-militant wallon Paul Lannoye [135]).
114 S’inspirant du travail effectué par les militantes dans le mouvement des femmes, le groupe de travail de la LRT consacré à l’écologie propose de s’insérer sur le terrain des luttes environnementales en diffusant les positions anticapitalistes et révolutionnaires dans le mouvement écologiste par la structuration d’un courant « Ecosoc ». La proposition fait long feu devant le peu de répondant des militants environnementalistes. Les trotskystes s’intéressent également aux « luttes urbaines » qui se développent à Bruxelles dans les mêmes années, menées notamment contre les politiques d’aménagements urbains, considérés comme trop favorables à la voiture, et pour la promotion des transports en commun.
115 Sur le plan culturel, la LRT sait également capter la radicalisation des milieux artistiques, surtout en Flandre où les trotskystes occupent une partie de l’espace laissé à la nouvelle gauche en Wallonie et à Bruxelles. Une collaboration se noue notamment avec la compagnie théâtrale Het Trojaanse Paard de Marianne Van Kerkhoven, figure montante du théâtre flamand de la nouvelle vague. Cette collaboration aboutit au lancement d’une campagne spécifique de la LRT baptisée « culture de combat », qui vise à organiser les sympathisants de la LRT du secteur culturel.
4.3. La « fin du cours sectaire » : pour un front uni anticapitaliste
116Comme il a été dit, à partir de son deuxième congrès national, la LRT commence à associer systématiquement à ses activités une série d’organisations choisies.
117En 1974, la mise sur pied d’une campagne dans le cadre du premier anniversaire du coup d’État d’Augusto Pinochet au Chili constitue une première expérience positive en ce sens. Le « Comité national Chili » constitué dans ce cadre organise plusieurs manifestations et meetings sur ce thème [136]. Il bénéficie de la participation d’un large panel d’organisations, et les trotskystes se félicitent qu’il soit resté sous leur contrôle malgré une tentative des maoïstes pour s’emparer de sa direction. Le succès de cette campagne est surtout évalué au regard de la collaboration suivie que la LRT a pu entamer avec une série d’organisations issues de la radicalisation du mouvement social-chrétien en Flandre : le CVA, les Wereldscholen (WS), l’Elcker-Ik Centrum et Politiek Alternatief [137].
118 Cette collaboration se pérennise et s’élargit à l’occasion du congrès doctrinal du PSB de novembre 1974. Les Jongsocialisten et l’ancien pendant flamand de La Gauche, l’hebdomadaire Links (qui avait accepté de rentrer dans le rang au moment du congrès des incompatibilités, cf. supra), mènent à ce congrès une tendance de gauche qui connaît un certain succès. Ils diffusent à plusieurs milliers d’exemplaires une série d’amendements au texte de congrès compilés dans une brochure, le « Roodboek », qui suscite l’intérêt, au-delà des rangs socialistes, de ces organisations de la gauche chrétienne flamande avec lesquelles la LRT a entamé une collaboration.
119 En décembre 1974, un Front voor een Progressieve Beweging (FPB) se forme avec l’ensemble de ces organisations. Le PCB y collabore également. Pour la LRT, c’est la concrétisation de ce « front uni anticapitaliste » dont elle ambitionne de devenir le pivot : non seulement le FPB cherche à approfondir les convergences politiques par l’organisation d’une série de conférences communes, mais il lance également une campagne qui a toute l’adhésion de la LRT. En novembre 1974, le ministre de la Défense nationale du gouvernement Tindemans II, P. Vanden Boeynants, projette l’achat d’avions de chasse pour un montant de 30 milliards de francs belges. Ce projet suscite l’indignation des milieux pacifistes ; il est également dénoncé comme allant à rebours de la politique de modération des dépenses de l’État prônée par le gouvernement [138]. Une coordination d’organisations, dont celles participant au FPB, prend l’initiative d’une « Campagne contre les 30 milliards », que la LRT contribue à faire vivre dans des comités régionaux et à populariser en Wallonie. Cette campagne culmine avec l’organisation d’une manifestation le 12 janvier 1975, rassemblant 15 000 personnes. Au sein de cette campagne, la LRT peut également se réjouir de voir son rival isolé : TPO-AMADA quitte le FPB au motif que la plateforme n’insiste pas assez sur « le danger de troisième guerre mondiale constitué par l’impérialisme soviétique » [139]. À dater de cette période, la LRT tentera constamment de se démarquer de TPO-AMADA, en se profilant comme la championne de l’unité face au « sectarisme des maoïstes » [140].
120 Tout au long des années 1975 et 1976, l’influence politique de la LRT dans le FPB se renforce. La campagne de la commission ouvrière de la LRT sur la diminution du temps de travail et les nationalisations est reprise par le FPB. Un groupe d’autonomistes flamands de gauche, le Werkgroep Arbeid (WA), entame des discussions avec la direction de la LRT en vue d’une adhésion. La fusion de ce groupe au sein du parti ne sera cependant pas réalisée, en raison du peu d’importance accordée par les trotskystes à la question nationale. En revanche, on retrouve quelques années plus tard sept militants issus des WS parmi les adhérents de la LRT ; les membres de ce petit groupe, qui se désignent eux-mêmes comme « le groupe ex-Wereldscholen » sont, à notre connaissance, les seuls transfuges que la LRT ait gagnés par sa stratégie d’ouverture.
121 En Belgique francophone, les opportunités sont plus limitées pour la LRT. La section de Bruxelles est néanmoins active dans la mise en place des « vendredis de la Buanderie » (ainsi nommés en référence au local de la LRT, qui se situe rue de la Buanderie). Il s’agit d’un cycle de conférences et de ciné-clubs visant à « créer un lien entre la régionale et la très diversifiée periférie [sic] bruxelloise qui lutte sur différents fronts : chômage, syndicats, organisations culturelles, sociales, milieux lycéens et étudiants » [141]. L’initiative rencontre un certain succès, en dépit du fait que cet axe de conquête des nouvelles avant-gardes se heurte à un nouveau concurrent. En effet, le journal Pour, qui constitue un hebdomadaire de référence pour les militants de la nouvelle gauche que la LRT tente de rallier [142], donne naissance à une organisation politique en 1977 : Pour le socialisme (PLS), qui tente, elle aussi, de se faire une place dans les sphères des nouvelles avant-gardes et de la contre-culture dans les régions bruxelloise et liégeoise.
122 Durant la période allant de 1974 à 1978, la LRT se présente comme l’organisation politique de l’ensemble des mouvements sociaux, le point de ralliement de toutes les luttes. Ce profil transparaît dans sa presse. Un nouveau projet pour les journaux est discuté, qui doit « rompre avec la situation actuelle dans laquelle Rood et La Gauche sont uniquement les journaux de la LRT » [143]. Désormais, la rédaction des deux hebdomadaires ouvre régulièrement ses colonnes à d’autres organisations et rend compte de façon plus régulière de leur évolution. Au cours de la discussion sur ce nouveau projet, la proposition est même avancée de faire disparaître la mention « hebdomadaire de la LRT » en sous-titre. Loin d’être minoritaire, cette proposition divise le comité central à tel point que la discussion est portée devant les militants de base. Un compromis est finalement trouvé au terme des discussions : le sous-titre des périodiques devient « hebdomadaire socialiste-révolutionnaire » mais est accompagné du sigle de la LRT.
4.4. Les premières expériences électorales
123La tactique du front unique anticapitaliste s’incarne aussi sur le terrain des élections [144]. Jusqu’alors, la LRT a été plutôt réservée vis-à-vis du processus électoral. Si elle n’excluait pas sa participation, elle souhaitait attendre de s’être suffisamment développée pour mener une campagne efficace. Lors des élections législatives du 7 novembre 1971, dans le cadre d’une stratégie dont l’enjeu se situe dans la possibilité de tirer le PCB à gauche, la LRT soutient la liste dont découlera l’Union démocratique et progressiste (UDP) à Mons, où le PCB se présente en cartel avec des organisations chrétiennes de gauche (cf. supra) [145]. Lors des élections législatives du 10 mars 1974, la LRT hésite à présenter une liste. Elle y renonce finalement, au motif qu’elle doit donner la priorité à des campagnes d’agitation dans les entreprises en lutte et à la jeunesse (cf. supra). Elle se borne à défendre le « vote à gauche » au cours de plusieurs meetings que donne E. Mandel, tandis que La Gauche titre le 1er février 1974 : « Chômage, vie chère, les élections ne résoudront rien » [146].
124 Après les élections législatives de 1971 et le succès relatif de la liste UDP à Mons (elle a recueilli 13,6 % des voix dans l’arrondissement), le PCB est tiraillé entre deux stratégies. D’une part, l’appel au « rassemblement des progressistes » du président du PSB, L. Collard, bien qu’adressé pour l’essentiel au Mouvement ouvrier chrétien (MOC), a reçu un accueil favorable du bureau politique du PCB [147]. Mais, d’autre part, l’expérience réussie de l’UDP, qui recueille plus de 27 % des voix lors des élections communales organisées dans le grand Mons en novembre 1971, questionne la direction : le PCB ne pourrait-il pas amener à lui ces chrétiens de gauche que le PSB tente de rallier ? Un cran plus à gauche, la LRT estime devoir contribuer à dissuader le PCB de toute alliance avec le PSB, de façon à avancer dans la constitution de ce front anticapitaliste qu’elle souhaite. C’est pourquoi, lors des élections communales du 10 octobre 1976, elle soutient les listes du PCB et consent à y participer quand le PSB n’y est pas impliqué.
125 Mais c’est à Liège que la LRT s’approche le plus de sa version électorale du front uni anticapitaliste. Durant l’été 1976, la section liégeoise entre en discussion avec des organisations de la gauche chrétienne, dans la perspective de placer l’un de ses vieux militants, J. Roosen, délégué syndical CSC à l’ULg, sur une liste de cartel constituée par le Mouvement pour l’autogestion socialiste (MAS), le Groupe politique des travailleurs chrétiens (GPTC) et le Mouvement chrétien pour la paix (MCP). À la suite d’un désaccord entre le MAS et le GPTC portant sur le nom de la liste commune, la LRT propose au GPTC de reprendre la collaboration à quelques mois des élections. Elle enclenche une dynamique rejointe par des militantes féministes de la Maison des Femmes et des militants syndicaux ou d’associations de quartiers. La liste, qui prend le nom d’Union des progressistes (UP), adopte un programme prenant en compte les thématiques de la nouvelle gauche : féminisme, environnement, pédagogies alternatives. Ce profil pousse d’autres organisations de la gauche radicale liégeoise, dont PLS ou l’organisation mao-spontanéiste La Parole au peuple (PAP), à se prononcer favorablement pour l’UP, dont le score est néanmoins très faible (0,96 %).
126 Les élections législatives anticipées du 17 avril 1977, que l’instabilité du gouvernement Tindemans II rendait prévisibles, sont l’occasion pour la LRT de présenter son nouveau profil. L’image que l’organisation veut imposer est celle d’un parti qui est le champion de l’unité à gauche du PSB, qui est le porte-parole des luttes sociales et qui est « porteur du courant anticapitaliste large » [148]. Les thématiques des nouveaux mouvements sociaux sont de nouveau mises en avant : à côté des thèmes classiques du contrôle ouvrier, de la diminution du temps de travail ou de la défense des libertés syndicales, la campagne profile les militantes féministes de la LRT et fait de la formule « Vivre autrement » un de ses slogans de campagne. De la même façon, son projet politique général se traduit au cours de la campagne par le slogan du « socialisme autogestionnaire », de façon à se démarquer du PSB et du PCB et d’établir le lien avec la mouvance de la nouvelle gauche. La volonté de se faire le porte-parole de cette mouvance se marque dans la façon dont la LRT prend contact avec les « groupes d’action de base » qui sont des collaborateurs réguliers, afin de discuter avec eux du programme à défendre concernant leur terrain d’action spécifique. Cela permet d’aboutir à la présence sur ses listes de personnalités emblématiques de la contre-culture, tels le chanteur engagé André Bialek ou Marc Abramowicz, ancien secrétaire politique de l’Union nationale des étudiants communistes (UNEC) à l’ULB en 1968 et animateur du collectif Aimer à l’ULB.
127 La volonté d’imposer un nouveau profil à l’organisation est martelée dans les documents internes. « La campagne électorale est un moyen pour détruire l’ancien [sic] image du trotskysme : élitaire, sectaire… », lit-on par exemple dans une lettre adressée aux militants par le bureau politique [149]. Par ailleurs, le profil unitaire de la LRT est affirmé par le biais de la presse du parti, qui rend compte des propositions de cartels principalement avec le GPTC et surtout avec le PCB, qui constitue le « verrou à faire sauter » [150] dans le cadre de la stratégie de constitution du front uni anticapitaliste. La seule exclusive concerne TPO-AMADA, avec lequel toute collaboration semble impossible du point de vue des trotskystes en raison de sa « dégénérescence mao-stalinienne », illustrée par son sectarisme et son hostilité à l’égard de l’URSS [151]. Cependant, partout, sauf à Anvers où des candidats trotskystes sont présents sur la liste Kommunistische Partij (KP), le PCB refuse la collaboration avec la LRT.
128 Même si ses résultats électoraux sont modestes (le score des listes déposées par la LRT reste partout largement en dessous du pourcent), la LRT se réjouit d’avoir été l’organisation la plus active à l’extrême gauche, avec « plus de 250 meetings et prises de paroles dans les entreprises, dans les quartiers et sur les marchés » [152]. Son score électoral reste certes marginal mais, dans un contexte global de recul des listes à gauche du PSB, dont le PCB et TPO-AMADA, la LRT peut se féliciter de dépasser cette dernière organisation dans certains cantons flamands (même si, globalement, AMADA récolte deux fois plus de voix que la LRT en Flandre). En Wallonie par contre, elle s’étonne du résultat de l’aile francophone de l’organisation maoïste, TPO, qui fait quasiment jeu égal avec la LRT et lui dame le pion dans l’arrondissement de Charleroi avec « une liste composée de trois ex-étudiants flamands fraîchement débarqués et un pensionné », alors que la LRT y a présenté sa figure publique en Wallonie en la personne d’A. Henry [153]. Enfin, si la campagne « n’a pas donné lieu à une percée politique centrale », le progrès de la LRT dans « les nouveaux secteurs d’intervention » et particulièrement dans les milieux féministes est particulièrement souligné [154]. Ce succès d’estime ne s’accompagne cependant pas d’un renforcement numérique du parti.
4.5. La persistance de la question organisationnelle
129Entre le congrès national de mai 1974 et celui de février-mars 1976, la LRT continue de professionnaliser son travail. À cette époque, le parti est capable d’entourer les permanents politiques d’une équipe de permanents techniques, chargée notamment des tâches de secrétariat, ce qui permet aux permanents politiques de consacrer davantage de temps à la structuration politique de l’organisation. Surtout, une campagne financière est lancée, qui permet d’établir un centre national à Bruxelles baptisé le « Bastion rouge » et doté d’une imprimerie propre. L’animation des cellules fait l’objet d’une attention spécifique. Le rôle du secrétaire de cellule, qui doit veiller à la régularité des réunions et à la tenue des exposés politiques, est revalorisé. De manière générale, la direction entreprend une chasse au dilettantisme : les devoirs de présence aux réunions et de paiement de la cotisation sont particulièrement rappelés et il est demandé aux secrétaires de cellule de contrôler systématiquement ces éléments. La régularité dans le paiement des cotisations est d’autant plus importante que la situation financière de la LRT, qui n’a jamais brillé par sa stabilité, devient véritablement catastrophique à la fin de l’année 1974. Le développement des infrastructures du parti a évidemment un coût : en décembre 1974, il manque près de 100 000 francs belges pour terminer l’installation du Bastion rouge, et le fonds créé pour assurer le traitement des permanents est en déficit structurel de 20 000 francs belges. Quant aux deux hebdomadaires, ils cumulent une dette de près de 160 000 francs belges. Cet état de fait rend nécessaires des appels récurrents aux cotisations spéciales et aux dons des sympathisants et lecteurs de La Gauche et de Rood.
130La centralité de la question organisationnelle est prégnante dans tous les documents de cette période. L’organisation est désormais considérée comme « un secteur d’intervention » [155] à part entière, c’est-à-dire un champ où les idées révolutionnaires doivent être introduites. « Plus on prend conscience du problème, plus on est frappé par l’arriération organisationnelle de la LRT », souligne un permanent dans un compte rendu du comité central ; « Une série de règles et de conditions sont nécessaires pour faire fonctionner une organisation, quelle qu’en soit la ligne politique » [156]. Une attention spécifique de la direction sur cette question commence à voir ses effets dans le courant de l’année 1975 : la « meilleure intégration des sympathisants dans le travail » de la LRT est régulièrement saluée, et la parution des bulletins internes et des lettres aux membres se fait désormais plus régulière. Des rapports notent qu’une « première stabilisation politique et organisationnelle a été atteinte » [157].
131Des progrès sont à noter dans l’implantation de l’organisation, particulièrement en Flandre. Au moment de sa fondation, la LRT était présente dans les grandes villes industrielles de Belgique : Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège, ainsi qu’à Louvain, Mons et Mouscron. Désormais, des sections existent dans des villes secondaires comme Hasselt, Saint-Nicolas, Tournai, Verviers et, de façon assez éphémère, Arlon. En janvier 1976, la LRT revendique trente sections locales. Les progrès de la structuration sont aussi visibles au travers des locaux que l’organisation ouvre en province. En 1976, la LRT inaugure des locaux à Charleroi et à Liège. L’année suivante, c’est à Gand qu’un nouveau local est ouvert.
132 La stratégie d’ouverture et la professionnalisation du travail sont manifestement à l’origine de certains progrès de l’organisation trotskyste, ce qui entraîne pour celle-ci la nécessité de se doter d’une infrastructure plus conséquente. Après son troisième congrès et le lancement de son travail en direction des nouvelles avant-gardes, la LRT connaît une inflation importante de son appareil. Cela consiste en la modernisation de son imprimerie mais surtout en l’engagement de permanents de plus en plus nombreux. En 1976, les permanents politiques sont au nombre de cinq et sont assistés de cinq permanentes techniques (les premiers étant tous des hommes et les secondes toutes des femmes). À ces dernières, s’ajoutent les permanents ouvriers travaillant à l’imprimerie. Il est même envisagé, en septembre 1977, d’engager un nouveau permanent technique pour étendre le réseau de librairies.
133 Cependant, l’achat de matériel et le traitement des permanents représentent un coût pour la LRT. Or, si le parti a fait des progrès, sa situation financière est toujours loin d’être brillante. En novembre 1976, la moitié seulement de ses membres sont en ordre de cotisation. De plus, les ventes de la presse se révèlent insuffisantes pour rendre pérennes la nouvelle formule du journal et le passage à douze pages. Si Rood paraît avoir une situation stable, avec 2 000 exemplaires vendus par semaine en 1977, dont la moitié d’abonnements, ce n’est pas le cas de La Gauche. Un an après le lancement de sa nouvelle formule, les ventes militantes du journal francophone plafonnent à 287 exemplaires pour un objectif nécessaire de 600 et les abonnements se montent à 520 quand il en était espéré 800. Une nouvelle campagne de soutien financier est lancée par le journal en juin 1977, mais cela n’empêche pas l’organisation d’être en déficit structurel de 35 000 francs par mois.
134 Ces problèmes financiers sont le reflet d’une perte de dynamisme à la base de l’organisation. Si le centre national s’est renforcé et si la LRT est globalement sortie de son isolement, la direction est obligée de constater qu’une série de sections, surtout les petites sections wallonnes, marquent le pas.
135 Pour répondre à cette nouvelle crise de l’organisation, le premier réflexe de la direction est de mettre en œuvre un plan de transformation des structures. Les cellules sont réorganisées et dotées de responsables de la presse et des finances pour seconder le travail du secrétaire de cellule. Une nouvelle instance est créée pour faire vivre les initiatives de la direction à la base de l’organisation et contrôler le travail des responsables locaux. Il s’agit d’un secrétariat organisationnel, émanant du bureau politique. Par ailleurs, une commission financière est instaurée au sein du comité central, de façon à veiller régulièrement au respect des budgets votés.
136Mais il apparaît que l’apparition récurrente de problèmes organisationnels cache en réalité la persistance d’un désaccord sur le projet politique de la LRT et que les tensions qui paraissaient évacuées après le troisième congrès subsistent à l’état latent.
137 Une première expression de ces tensions présente une apparence organisationnelle pure, puisqu’il s’agit d’un problème de relations de travail entre les permanents techniques et les permanents politiques ; ces derniers sont jugés assis sur leurs privilèges, peu présents au centre national et prenant peu au sérieux les tâches quotidiennes. Cette première charge contre l’équipe dirigeante enclenche une discussion plus profonde sur les relations entre la direction et la base, ou plutôt entre la direction nationale et les directions régionales, c’est-à-dire les fameux « cadres intermédiaires » déjà à l’origine d’une tendance au congrès de 1976. Des critiques semblables à celles qui avaient été émises lors de ce troisième congrès sont réitérées. Elles insistent à nouveau sur l’autoritarisme dont ferait preuve le bureau politique, particulièrement les permanents politiques, sur le décalage qui existe entre « une direction nationale [qui] pense ces derniers temps d’avoir [sic] son mot à dire sur l’échiquier politique belge et croit pouvoir utiliser les régionales comme des pions » et des sections qui ne voient pas se profiler de « percée politique centrale » et luttent pour s’implanter localement [158].
138Pour la direction nationale au contraire, la base n’a pas assimilé la signification du troisième congrès et certaines directions régionales mènent « une politique d’obstruction systématique contre les initiatives de la direction nationale » [159]. Ainsi lors du bilan d’une campagne sur la diminution du temps de travail décidée par la direction nationale dans la foulée des élections législatives anticipées du 17 avril 1977, le bureau politique constate que cette campagne n’a pas été comprise par les directions régionales, qui l’ont trouvée « plaquée d’en haut » et ont refusé de l’appliquer sans assemblée générale pour en discuter [160]. On comprend dès lors pourquoi le bureau politique appelle en juillet 1977 à une transformation du comité central, afin qu’il ne soit plus « un ramassis des [exécutifs régionaux] et des commissions » mais une « fonction politique autonome qui transmet des impulsions à des structures intermédiaires » [161].
139Ces divergences paralysent encore l’organisation à l’occasion des discussions en vue du quatrième congrès, à un point tel que celui-ci est repoussé à deux reprises, d’abord à la mi-janvier 1978 puis à la mi-mars 1978. Une nouvelle négociation se tient alors entre le bureau politique et les exécutifs régionaux. En échange d’une gestion plus participative du parti et d’une prise en compte plus importante des difficultés locales par le bureau politique, celui-ci fait passer son nouveau projet : considérant les mouvements de grève tournante qui font tomber le gouvernement Tindemans II en mars 1977 [162] et qui consacrent le retour d’une combativité ouvrière, la direction estime qu’il est temps de mettre à profit le développement du rayonnement de la LRT pour achever sa transformation en parti ouvrier. Désormais, le travail dans les « fronts secondaires » doit être orienté de façon à faire vivre les thématiques dans le mouvement ouvrier organisé, principalement les organisations syndicales.
5. Troisième mouvement (1978-1984) : le retour à la centralité ouvrière
140À la fin des années 1970, les sections de la Quatrième Internationale, dont la LRT en Belgique, optent pour un retour à la construction d’un parti ouvrier au sens strict. Ce projet politique ne fait pas l’unanimité au sein de la LRT. En outre, même parmi ceux de ses militants qui s’accordent sur la nécessité de se tourner de nouveau vers le mouvement ouvrier, des divergences de vue se font jour quant à la mise en œuvre du projet. Le tout se joue sur un fond de crise économique et d’éclatement de luttes sociales défensives contre la rigueur budgétaire et les fermetures d’entreprise.
5.1. Le contexte socio-économique du tournant ouvrier
141Deux ans seulement après avoir affirmé vouloir intégrer le champ des nouvelles luttes, la LRT s’engage donc dans un projet de conquête du mouvement ouvrier organisé. Si ce projet paraît acceptable aux cadres intermédiaires, surtout soucieux de recevoir un appui pour le développement des sections locales, c’en est trop pour la frange anti-autoritariste de la LRT. Cette catégorie de militants avait adhéré au projet de fédérer les nouvelles avant-gardes sous le drapeau de la révolution socialiste. Largement minoritaire dans les organes de direction, elle se voit imposer ce changement de ligne, ce qui renforce sa perception d’une direction autoritaire et « bureaucratique ».
142 Dès lors, la LRT assiste au départ graduel de cette génération militante qui, du fait de l’importante rotation dans l’organisation, constitue une part importante de ses forces vives en 1978. Entre le retrait des militants historiques du trotskysme belge et l’éclipse de la jeune génération, les dirigeants de la LRT, tous issus de l’immédiat après-1968, semblent donc bien isolés [163]. De plus, cette décision de transformer la LRT « dans [les] deux à trois années qui viennent en un pôle politique du mouvement ouvrier » [164] et « d’imposer sa reconnaissance comme courant intégrant du mouvement ouvrier » [165] est prise dans un contexte socio-économique et politique difficile.
143Sur le plan politique institutionnel, les tensions communautaires s’accentuent et les difficiles négociations qui tentent d’y apporter des réponses accouchent péniblement d’une deuxième réforme de l’État. Parmi les points nodaux des tensions, figure la question du statut des Fourons, qui contribue à cliver les positions et oblige les organisations politiques, y compris à l’extrême gauche, à prendre position. Ces tensions communautaires provoquent de fréquents remaniements ministériels et démissions des gouvernements. Huit gouvernements, si l’on inclut les remaniements, se succèdent entre 1978 et 1984 (Tindemans IV, Vanden Boeynants II, Martens I à IV, Eyskens et Martens V) [166].
144Cette instabilité politico-communautaire se greffe sur une situation économique difficile, qui provoque à son tour de nouveaux changements politiques. En effet, dès 1977, il est désormais clair que la crise économique n’est ni accidentelle, ni conjoncturelle, ni passagère et qu’il s’agit bel et bien d’une crise structurelle et durable qui appelle des transformations importantes. Touchées par la récession au niveau mondial, nombre d’entreprises multinationales délocalisent leurs usines vers des pays aux conditions d’exploitation moins coûteuses. L’inflation des dépenses publiques, découlant notamment de l’augmentation des dépenses sociales, fait l’objet en 1978 d’un plan anticrise, dont les différentes mesures s’étalent au cours des années suivantes pour diminuer budgets publics et allocations sociales. Dans le même temps, les interventions de l’État au bénéfice des secteurs économiques en difficulté sont multipliées par cinq, sans parvenir cependant à endiguer les fermetures, restructurations et pertes d’emploi. Ce climat est propice à l’agitation sociale. De nombreuses grèves défensives éclatent, ayant souvent recours à des occupations d’entreprises (du moins jusqu’en 1980). Parallèlement, les mobilisations syndicales sectorielles ou nationales sont nombreuses, particulièrement dans les services publics, pour lutter contre les politiques gouvernementales.
145 Cependant, les bastions syndicaux de la LRT sont sous pression. L’industrie textile et l’industrie verrière, qui constituent les principales zones d’influence du parti dans le secteur secondaire, sont des secteurs en déclin, particulièrement touchés par les restructurations. Le changement de conjoncture et la menace qui pèse sur ses bastions traditionnels renforcent la volonté de la direction de la LRT de recentrer son activité sur les ouvriers d’industrie. De même, la progression de l’implantation de TPO-AMADA dans le monde ouvrier ne peut être ignorée par l’organisation. Alors que la LRT avait régulièrement fustigé la « dégénérescence des mao-staliniens » qui devait aboutir à la disparition de ce courant, l’organisation maoïste marque au contraire des points, ralliant à elle nombre de cadres d’autres organisations du même courant, toutes plus ou moins en crise terminale. C’est le cas par exemple de l’UC(ML)B, qui se scinde en 1976 et dont une partie de la direction rejoint TPO-AMADA [167], qui prend alors le nom de Parti du travail de Belgique (PTB, en néerlandais Partij van de Arbeid - PVDA) en mai 1979 [168].
146Pour autant, n’attribuer la décision du tournant ouvrier qu’au seul contexte national ou à la lutte pour l’hégémonie au sein de l’extrême gauche serait oublier que la LRT est la section belge d’une Internationale dont les analyses et les décisions pèsent sur la stratégie des trotskystes belges. Or, une discussion est en cours au sein de la Quatrième Internationale. Des tenants de l’ancienne « minorité internationale », la Fraction léniniste-trotskyste (FLT) [169] qui s’était dissoute après le dixième congrès mondial, avancent la nécessité de diriger l’effort militant vers les ouvriers d’industrie. La section états-unienne de la Quatrième Internationale, le SWP, est à ce moment engagée dans une voie similaire à celle des organisations maoïstes de la fin des années 1960, consistant à envoyer ses militants « s’établir » en usine, et la préconise pour l’ensemble des sections nationales.
147C’est cependant un tout autre projet qui pousse les militants trotskystes à devenir ouvriers d’usine, quelque dix ans après la vague d’établissement opérée par les maoïstes. Contrairement à ces derniers, pour lesquels l’entrée en usine était avant tout guidée par l’impératif de transformer les militants (souvent étudiants) au moyen d’une immersion en milieu ouvrier [170], « l’embauche » des militants trotskystes répond à un plan organisé visant à gagner de l’influence dans le milieu des ouvriers industriels, qu’il est considéré vital de conquérir pour réaliser le projet révolutionnaire. C’est donc une nouvelle stratégie de construction du parti révolutionnaire que le mouvement trotskyste cherche à mettre en œuvre : quand les maoïstes cherchaient à prolétariser leurs militants, les trotskystes cherchent à prolétariser une organisation [171].
148 Cette optique devient la tactique officielle de la Quatrième Internationale après son onzième congrès mondial, en novembre 1979. En outre, les perspectives de montée de la révolution mondiale et d’éclatement de crises révolutionnaires en Europe, qui avaient été celles de la Quatrième Internationale depuis le début de la décennie, s’estompent visiblement. Elles sont d’ailleurs de plus en plus fréquemment remises en question par les sections nationales. En Belgique aussi, la perspective d’un changement de société s’éloigne doucement. L’idée s’installe progressivement que l’heure n’est plus à un renforcement de l’organisation révolutionnaire dans le cours d’une intensification des luttes, mais plutôt dans un renforcement progressif avec en toile de fond une lutte de classes de basse intensité.
5.2. Un alignement sur le calendrier électoral
149Une autre caractéristique importante de la LRT à la fin des années 1970 et au début des années 1980 est son changement d’attitude vis-à-vis des élections. Alors que, durant ses premières années d’existence, la LRT s’était tenue à l’écart du processus électoral pour privilégier sa construction par le biais de sa participation aux luttes sociales, elle va, après sa première expérience électorale de 1977 et son congrès de 1978, systématiquement participer aux élections qui sont organisées aux différents niveaux de pouvoir et en faire un axe privilégié de sa construction. Cette évolution de la LRT face aux échéances électorales est remarquable à plusieurs titres.
150 D’une part, un déplacement des thèmes de campagne est à souligner. Le tournant ouvrier amorcé à partir du congrès de 1978 diminue progressivement la place accordée aux questions qui ne sont pas immédiatement liées à la problématique socio-économique. Si, en 1978, la LRT est encore capable de mettre en première page de sa brochure électorale la revendication de mémorandum sur l’énergie nucléaire [172] et si la campagne européenne de 1979 réserve encore une place notable aux revendications féministes et environnementalistes, celles-ci sont clairement reléguées au second plan au bénéfice de revendications socio-économiques classiques du mouvement ouvrier lors des élections législatives anticipées du 8 novembre 1981 et des élections communales du 10 octobre 1982. Il est évident que la dégradation de la situation économico-sociale joue un rôle dans cette évolution, mais il faut aussi y voir à l’évidence le choix de la LRT de se concentrer de nouveau vers le groupe social qu’elle considère comme central dans son projet politique.
151D’autre part, loin de la position extrêmement frileuse adoptée sur le processus électoral en 1971, la LRT automatise sa présentation aux élections dès 1978. En 1976, sa présentation aux élections dans quelques communes est d’abord décidée en fonction de l’opportunité de collaborer avec des organisations de la gauche chrétienne et d’ainsi renforcer le front uni anticapitaliste. En 1977, sa présentation aux élections procède de la suite du troisième congrès et de sa volonté de se positionner comme pivot des nouveaux mouvements sociaux.
152 Si un congrès extraordinaire est nécessaire pour acter la participation à la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 décembre 1978, la logique est déjà inversée puisqu’il est acquis que la participation s’imposerait s’il n’y avait l’état d’impréparation de la LRT face à une campagne imprévue, courte et dominée par un thème sur lequel elle est traditionnellement faible (la question communautaire). En 1979, la LRT s’engage dans les premières élections européennes sur décision du bureau européen de la Quatrième Internationale puis, aux élections législatives anticipées du 8 novembre 1981 et lors des élections communales du 10 octobre 1982, la participation est considérée comme allant de soi.
153 En définitive, ce parti, qui affirmait au début des années 1970 que les élections « ne changent rien » et « ramènent la classe et les luttes ouvrières dans le “carcan” des institutions établies » [173], participe à toutes les campagnes électorales qui se succèdent à un rythme rapide (quasiment une par an) entre 1976 et 1982. Et ce alors même que, dès 1979, la LRT fait le bilan de ce que lui ont coûté, notamment en termes de recrutement, les deux premières années de cette nouvelle ligne de conduite.
154 La décision consciente d’investir dans des campagnes électorales ses ressources militantes et financières – alors que celles-ci sont très limitées, ce qui implique donc une sensible diminution de la participation aux luttes sociales – est certes surprenante de la part d’une organisation qui se réclame de la stratégie révolutionnaire. Elle peut être expliquée, d’une part, par la volonté du parti de réaliser une « percée politique » et de rattraper son retard électoral sur TPO-AMADA et, d’autre part, par l’éloignement de la perspective révolutionnaire immédiate. Dès lors que la possibilité de renversement du capitalisme se réduit, la tâche principale des révolutionnaires devient, selon l’analyse de la LRT, le renforcement du parti dans l’attente de la prochaine crise systémique. Si ce renforcement peut être entrepris par le biais de la participation à des luttes partielles, la LRT considère dès le début des années 1980 que le terrain électoral devient incontournable.
5.3. La mise en œuvre du tournant ouvrier par le bureau politique de la LRT
155Durant les premiers mois qui suivent le quatrième congrès de la LRT, l’organisation trotskyste évolue à petits pas vers un profil plus ouvrier. « Ce “tournant ouvrier” ne doit pas être compris comme un tournant volontariste et ouvriériste, mais comme une attention soutenue de la part de la LRT aux problèmes qui traversent le mouvement ouvrier tant politique que syndical », précise la direction en janvier 1978 [174].
156 De fait, si La Gauche et Rood suivent les mobilisations contre les plans gouvernementaux de restructuration du secteur sidérurgique et de redressement économique, la presse de la LRT s’intéresse tout autant aux manifestations pour le désarmement ou aux luttes environnementalistes. Le numéro de La Gauche vendu dans les manifestations du 1er mai 1978 reste dans le ton de l’orientation du troisième congrès, avec un article de première page commémorant les dix ans de mai 1968 qui lie la revendication de la réduction du temps de travail avec « le refus de ce chantage à la consommation qui nous impose les cadences infernales, la pollution, les centrales nucléaires… » La nouvelle formule pour les hebdomadaires, qui est lancée en avril de la même année, semble même aller à rebours du quatrième congrès : la rubrique « Sur tous les fronts », qui est consacrée aux nouveaux mouvements sociaux, voit sa place multipliée par deux et la dernière page est entièrement consacrée à la culture. Les campagnes publiques de la LRT dans le courant de l’année 1978 reflètent la même tendance : si une campagne contre la « nouvelle loi unique » [175] se concrétise par l’impression d’un tract à plusieurs milliers d’exemplaires qui appelle à un congrès extraordinaire des deux principaux syndicats, CSC et FGTB, pour préparer une mobilisation contre la loi anticrise du gouvernement, la décision d’organiser une campagne unitaire contre l’envoi de troupes belges au Shaba [176] semble accaparer l’essentiel des énergies de la LRT [177].
157 La période qui suit, essentiellement consacrée aux campagnes pour les élections législatives anticipées du 17 décembre 1978 puis pour les élections européennes du 10 juin 1979 laisse finalement peu de temps aux militants de la LRT pour organiser la nouvelle orientation du parti.
158 Dès la rentrée 1979, quand la LRT peut enfin reporter son attention sur le tournant ouvrier, une campagne contre le chômage est lancée. Cette campagne est considérée comme centrale et présentée aux militants comme « une campagne de propagande, d’agitation et d’organisation contre le chômage, qui permet à toute l’organisation, à tous ses militants de militer sur les différents terrains d’intervention » [178]. Cependant, cette campagne doit servir avant tout à construire l’organisation et à renforcer son profil ouvrier : « La campagne de la LRT ne vise pas à faire percer une revendication précise à imposer au patronat et au gouvernement (les 36 heures, par exemple). Elle vise à populariser la nécessité des solutions ouvrières contre le chômage » et sa conclusion logique est qu’il faut renforcer la LRT, « qui est la seule organisation à défendre ce programme et qui a besoin d’aide pour le mettre en pratique » [179]. Ceci est encore exprimé plus clairement en janvier 1980 : « La campagne emploi est (…) un effort concentré pour discuter et militer pendant plusieurs mois avec quelques centaines de travailleurs d’avant-garde dans le pays, pour les convaincre de notre plan anticapitaliste et de nos propositions d’action » [180].
159 Cela signifie donc que la question de la façon de mobiliser la classe ouvrière afin de peser sur la situation et d’imposer les « solutions ouvrières à la crise » est reléguée à une formule purement propagandiste qui vise à convaincre des travailleurs de rejoindre la LRT. Quant à elle, la perspective de peser directement sur l’agenda des luttes n’est plus à l’ordre du jour. Dans les faits, la campagne se traduit, dans le courant du premier trimestre 1980, par l’organisation de « tables rondes » par secteur d’activité, auxquelles participent les contacts et sympathisants de la LRT et où sont discutées des revendications spécifiques sur l’emploi. Cette campagne est menée dans les secteurs où la LRT dispose d’une implantation et, de janvier à mars 1980, des petits meetings se succèdent sur le thème de l’emploi un peu partout en Belgique. L’initiative culmine le 1er mai 1980, avec une manifestation pour l’emploi, mobilisée par la LRT sur ses propres forces et qui sonne comme une façon pour le parti de s’affirmer dans le paysage politique.
5.4. La « prolétarisation » décidée par le congrès mondial de la Quatrième Internationale
160Durant cette séquence de l’existence de la LRT, qui va de son quatrième à son cinquième congrès, il semble donc que le parti évolue doucement vers un profil comparable à celui du PWT : un petit parti ouvrier radical jouant des coudes pour se faire une place au sein du mouvement ouvrier organisé. Mais la tenue du onzième congrès mondial de la Quatrième Internationale vient bouleverser cette dynamique. Sous l’impulsion de la section états-unienne, qui est engagée dans un processus de « prolétarisation » (cf. supra), la Quatrième Internationale décide d’adopter une résolution pour un « tournant vers l’industrie » afin d’augmenter de façon décisive son influence dans la classe ouvrière industrielle. Le tournant ouvrier de la LRT est ainsi avalisé, précisé, mais aussi transformé : plus que « d’accorder une attention soutenue aux problèmes qui traversent le mouvement ouvrier » [181], il s’agit désormais d’opérer « un tournant radical pour organiser immédiatement une large majorité [des] militants et de leurs dirigeants dans l’industrie et dans les syndicats de l’industrie » [182], de façon à transformer la composition sociale des sections de l’Internationale trotskyste.
161 Pour la très grande majorité des militants de la LRT, cette consigne implique évidemment un changement de style de vie radical. Le profil du militant LRT est encore à cette période celui d’un étudiant ou d’un travailleur du secteur tertiaire, même si les ouvriers d’industrie ne sont pas, comme on l’a vu, absents de la composition sociale du parti. Dès lors, lorsque la direction de la LRT annonce, immédiatement après le congrès mondial, que « le cinquième congrès [national] doit prendre la décision (…) de convaincre politiquement la majorité des militants actuels de l’organisation d’aller travailler comme ouvriers dans les grandes entreprises industrielles ou dans les autres secteurs décisifs (transports, communications) » [183], nombreux sont les militants qui expriment leur désaccord. Le bureau politique lui-même est divisé sur la question, puisqu’une minorité s’en dégage pour critiquer la tenue des discussions : « Le débat, (...) qui démarrait assez bien, se trouve tout à coup réduit : une série de camarades du [bureau politique] ont déjà tiré leur conclusion du débat (…) – la potion magique s’appelle “Tout le monde à l’usine”. Cette façon de discuter est irresponsable et destructrice » [184].
162 En conséquence, une tendance est créée autour d’une plateforme reprenant la conception du tournant ouvrier telle que votée au terme du quatrième congrès mais réinsistant également sur la nécessité de travailler à insérer les revendications des nouveaux mouvements sociaux dans le mouvement ouvrier et rejetant catégoriquement la « prolétarisation ». Appuyée par la minorité susmentionnée du bureau politique, cette plateforme de tendance l’est aussi par des militants de l’ensemble des grandes sections flamandes et par la majorité de l’exécutif régional de Liège. Comme lors des précédentes discussions de congrès, la formation d’une tendance provoque le clivage de l’ensemble de l’organisation et la formation d’autres tendances en réaction. C’est ainsi que l’on assiste de nouveau à l’apparition d’une tendance centrée sur les enjeux de démocratie interne et de respect du rythme de vie des militants (désignée dans les textes de congrès sous le sigle « T1 » pour « tendance 1 »), tandis que deux autres tendances sont centrées respectivement sur le rejet (T2) ou sur l’approbation (T3) du tournant vers l’industrie.
163Comme lors des congrès précédents également, les clivages se forment sur la base de la fonction qu’occupent les militants au sein de la LRT plutôt que sur celle de leur origine sociale : une tendance se forme autour de la majorité des membres du bureau politique (T3), une autre autour des cadres intermédiaires (T2), une troisième autour de membres périphériques, moins impliqués dans les structures de décision (T1). Bien que lancée par la minorité du bureau politique, la tendance opposée au tournant vers l’industrie (T2) est rapidement animée par des membres de l’exécutif régional de Liège. Elle centre ses contributions au débat de tendance sur l’équilibre entre travail dans le mouvement ouvrier organisé et sur le terrain des nouvelles luttes. Beaucoup des militantes qui animent la commission Femmes de la LRT sont membres de cette tendance. Enfin, la tendance T1 est animée par des membres actifs mais non membres des organes de direction, participant de loin au débat organisationnel et recevant les directives aux militants comme des perturbations de leur vie quotidienne. C’est le cas de Michel Capron, « expert » de la LRT dans le domaine économique et régulièrement sollicité à ce titre, mais qui ne siège plus au comité central depuis le congrès de 1976.
164Jusqu’alors, le processus qui a prévalu consistait à ignorer la tendance « vie quotidienne » pour se concentrer sur le débat entre direction et cadre intermédiaire, aboutissant à une promesse de la direction de mieux prendre en compte les avis de la « base » (cf. supra). Cette fois, la discussion se tend rapidement, au point que la T2 est accusée par la T3 de s’être « transformée en une tendance pour la conquête de la direction, c’est-à-dire une tendance organisationnelle » [185]. Le bilan de la direction sortante laisse peu de place à l’autocritique. Les militants de la LRT y sont décrits comme « peu politisés » et ayant des « difficultés à intégrer le schéma léniniste de l’organisation centralisée démocratiquement », la direction se trouvant dès lors en situation de « tirer l’organisation » [186]. Elle propose un effort de formation des membres et une ébauche de plan d’implantation dans l’industrie pour démontrer la faisabilité de son projet.
165Le cinquième congrès national se tient du 29 février au 2 mars 1980 dans des locaux de la VUB. Pour la première fois de son histoire, la LRT voit la direction sortante clairement désavouée : la T3 n’obtient que 33 % des voix, contre 47 % pour la T2 (pour sa part, la T1 en obtient 13 %). Une nouvelle direction se met donc en place. Son projet est centré sur le tournant ouvrier de la LRT, dans la lignée du quatrième congrès et au moyen d’un recrutement facilité par l’élaboration d’une « ligne de masse ». Mais il est loin de faire l’unanimité. Néanmoins, cette direction, y compris au niveau du bureau politique, comprend des membres de la direction précédente. Contrairement à ce qui s’était produit lors des précédents congrès, les tendances minoritaires refusent de se dissoudre après le vote. « Nous expérimentons une nouvelle situation dans l’organisation, dans laquelle la collaboration entre les différents courants autour d’un projet est couplée à une discussion permanente sur ce projet », lit-on quelques semaines plus tard dans La Gauche. L’article se veut optimiste : il parle d’« une situation difficile mais heureusement constructive qui peut conduire à l’approfondissement de l’apprentissage de la démocratie ouvrière » [187]. Mais il est clair que la LRT est plus divisée que jamais.
166 Une réalité vient également se rappeler à la nouvelle direction : la LRT est membre d’une organisation internationale soumise au principe léniniste du centralisme démocratique et, à ce titre, elle est tenue d’appliquer les décisions du congrès mondial. En mai 1980, une rencontre a lieu entre le nouveau bureau politique de la LRT et le secrétariat de la Quatrième Internationale. La teneur de cette rencontre est inconnue, mais on constate que, en juin 1980, le bureau politique élu sur la base de l’opposition à la prolétarisation a sérieusement infléchi sa position. Un rapport des décisions prises par le bureau européen est diffusé aux militants de la LRT. Il reprend l’orientation du onzième congrès mondial et précise : « Les décisions du congrès mondial définissent le tournant [vers l’industrie] comme universel. Il est bien sûr évident que chaque section doit définir les objectifs et les modalités les plus appropriés à sa situation spécifique. Mais la spécificité ne doit pas devenir alibi : il n’y a pas d’exception à la règle en Europe » [188]. Immédiatement après, un plan d’implantation dans le secteur industriel est soumis au comité central, qui l’avalise avec une majorité de 66 %. Ce revirement de la direction de la LRT, qui passe d’une opposition absolue à l’embauche à l’exact opposé en un peu plus de six mois, ne va pas sans provoquer quelques réactions au sein du parti. La section de Gand, considérant que le bureau politique réalise un projet différent de celui pour lequel il a été élu, réclame la tenue immédiate d’un nouveau congrès et appelle dans l’intervalle à voter contre le plan d’implantation proposé par la direction.
5.5. Une plongée dans le mouvement social comme antidote à la crise interne
167L’agitation sociale provoquée par le vote de la « mini-loi » de modération salariale [189] en décembre 1980 puis par le « plan de redressement » du gouvernement Martens IV (CVP/PS/SP/PSC) [190], comprenant des mesures d’augmentation des cotisations sociales pour les salariés et de réduction des dépenses d’assurance-chômage, va laisser peu de loisir à la LRT pour se consacrer à son plan d’implantation. Le parti intervient énergiquement dans les mobilisations syndicales, de manière à renforcer son profil ouvrier. Outre l’utilisation de la presse dans les manifestations, conçue comme de véritables tracts appelant à une action déterminée des organisations syndicales jusqu’au retrait du plan gouvernemental, la LRT tente d’influer sur la ligne stratégique des syndicats en faisant signer des motions appelant à la grève générale en front commun par les délégations d’entreprise. Durant le mois de janvier 1981, sa presse relaie aussi les grèves régionales et les mobilisations locales contre le plan gouvernemental. Le 24 janvier, au terme d’une manifestation massive mobilisée par la FGTB, la LRT convie les militants syndicaux à un colloque sur les leçons de la grève de 1960-1961 à Liège, en présence d’E. Mandel. Y défilent à la tribune les délégués d’entreprise les plus combatifs. Plus de 300 personnes assistent à ce colloque, qui est l’occasion de remettre en avant les options du syndicalisme de combat contre « l’impasse de la concertation » [191].
168L’activité sur les autres fronts n’est cependant pas oubliée. Outre l’investissement dans des comités de soutien au processus révolutionnaire en cours au Nicaragua, dans le cadre d’une campagne internationale lancée au congrès mondial, la commission Femmes de la LRT impulse, suivant l’orientation dictée par les quatrième et cinquième congrès nationaux, une campagne d’ampleur intitulée « Femmes contre la crise ». Cette campagne culmine avec une manifestation à Bruxelles le 7 mars 1981, qui rassemble 10 000 personnes et qui voit la participation active de centrales et de délégations d’entreprise de la FGTB, ce qui était un des objectifs principaux de la campagne. La convergence de l’ensemble des campagnes de la LRT vers le mouvement ouvrier organisé s’illustre également dans les campagnes internationales. En mars 1981, en soutien au syndicat polonais Solidarność, la LRT mène une campagne, par l’intermédiaire du Comité du 1er Mai [192] alors largement sous son influence, en faveur de jumelages entre délégations syndicales belges et polonaises. Cette campagne rencontre un certain écho au Syndicat des employés, techniciens et cadres (SETCA, affilié à la FGTB), grâce au travail de la cellule Hôpitaux de Bruxelles, et à la CGSP d’Anvers, qui envoie une délégation en Pologne.
169 Grâce à cette recrudescence de l’activité en direction des organisations syndicales, la LRT parvient effectivement à imposer son nouveau profil. La section de Bruxelles, par exemple, longtemps tancée pour son profil trop étudiant, se réjouit ainsi du succès d’un meeting « qui a vu la section bruxelloise faire surface avec un visage tout à fait différent » et avec un public composé d’une centaine de militants syndicaux [193].
170 À la fin du mois de juin 1981, la « commission nationale d’embauche » de la LRT, dont la création a été décidée lors du cinquième congrès, invite les militants à une première réunion pour y présenter le plan d’implantation et ses motifs, dans la mesure où le tournant vers l’industrie doit être « précédé d’un réarmement politique de l’organisation » [194]. Une trentaine de militants sont prêts à l’embauche et vingt acceptent de déménager afin d’apporter leur concours à une initiative jugée prioritaire dans le cadre du tournant. Dans le dernier trimestre de 1981, on constate que l’embauche a démarré sans que cela n’ait créé de crise au sein du parti : huit militants sont embauchés dans les chemins de fer, la métallurgie et la chimie et onze autres cherchent du travail dans ces secteurs.
171 Dès janvier 1982, dans le cadre de la reprise des mobilisations sociales, la commission Cheminots de la LRT est sur pied et active. Dès ce moment, elle publie une feuille d’entreprise, en néerlandais uniquement, Roodspoor, et diffuse dans son secteur le mot d’ordre de la LRT pour une grève générale de 24 heures en front commun contre le gouvernement Martens V (CVP/PRL/PVV/PSC). La mobilisation de la LRT est également visible dans d’autres secteurs du service public. Chez les enseignants à Bruxelles et chez les travailleurs communaux de Liège, des meetings sont organisés pour discuter de la stratégie de lutte contre les coupes budgétaires décidées par le gouvernement. On revoit également des militants de la LRT intervenir dans les congrès syndicaux afin d’y défendre leurs positions. Ainsi, Marcel Slangen dépose une motion en faveur de la grève générale illimitée au congrès de la FGTB Liège-Huy-Waremme.
172Dans le secteur privé en revanche, l’organisation de fractions syndicales semble prendre plus de temps. Alors que la métallurgie a été désignée « secteur prioritaire pour l’embauche » et que quelques militants sont déjà implantés dans cette branche d’activité, on n’y relève aucune feuille d’entreprise ni tract spécifique, alors même que 15 000 métallurgistes wallons défilent à Bruxelles le 16 mars 1982 pour protester contre les restructurations menées dans leur secteur. Les retards de l’implantation dans la métallurgie sont attribués à la difficulté d’y trouver un emploi stable sans une formation préalable. L’arrestation d’un militant de la LRT en compagnie de quatre métallurgistes affiliés à la CSC au cours de la manifestation du 16 mars donne par contre l’occasion à la LRT de se lancer dans une campagne de solidarité qui la profile parmi les militants syndicaux de la métallurgie.
173Durant les mois d’été et jusqu’à octobre 1982, l’essentiel de l’énergie est accaparé par les élections communales. Dès septembre toutefois, les discussions reprennent au comité central sur la restructuration de la LRT, destinée à améliorer l’intervention syndicale de l’organisation, et sur la relance du processus de construction du parti. L’importance des commissions et fractions syndicales est soulignée, et leur liaison avec le comité central est considérée comme capitale. Outre la centralisation du travail, l’objectif est également de « mobiliser une couche qualitativement plus large autour de la direction nationale » [195].
174 Cette orientation a l’intérêt d’unifier le travail syndical de la LRT autour de quelques mots d’ordre et de permettre de discuter des positions à prendre dans les instances en fonction des situations spécifiques de chaque secteur. Une réunion du « secteur national interprofessionnel », c’est-à-dire de toutes les fractions syndicales, est convoquée en novembre 1982 et est l’occasion de discuter de ces mots d’ordre et de la façon de les amener. Ceci est illustré par la popularisation des positions des secteurs les plus combatifs, qui se prononcent de façon intransigeante contre les mesures de modération salariale. Dans les secteurs où elle bénéficie d’une influence, la LRT est aussi capable de peser sur la ligne. Ainsi, la section mouscronnoise de la Centrale des ouvriers textiles de Belgique (COTB) prend position pour la nationalisation du secteur, tandis que la Centrale générale de la FGTB de Charleroi se prononce pour la grève générale et le rétablissement de l’indexation des salaires.
175 Les mouvements de grève dans les services publics reprennent en octobre 1982. Ils sont l’occasion pour les militants syndicaux de la LRT de diffuser les positions stratégiques du parti et de les appliquer. Bien que cela se fasse souvent dans des secteurs d’activité non prioritaires, le tournant ouvrier de la LRT trouve à cette époque une première expression pratique. En outre, pour la première fois de son histoire, la LRT semble agir de façon unifiée de l’intérieur du mouvement social. Durant la grève des cheminots, la feuille d’entreprise de la commission, Roodspoor, est également publiée en français sous le titre La Gauche des cheminots depuis l’embauche d’un militant carolorégien à la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV). Ce périodique propose des actions de grève tournante, qui sont « au cœur des discussions » des travailleurs en grève [196]. À Anvers, les militants enseignants de la LRT participent à faire débrayer leurs collègues et à organiser une manifestation de 4 000 enseignants contre les suppressions de postes.
176 En Wallonie, c’est surtout à Liège, parmi les employés communaux, que la progression est frappante. Les agents de la Ville et du Centre public d’aide sociale (CPAS) de Liège commencent par se mobiliser en réaction contre les cessations de paiement de leurs salaires par la Ville, qui se trouve alors en état de faillite virtuelle. Ensuite, en mai et juin 1983, ils mènent une grève de plusieurs semaines contre un plan censé apurer la dette communale et comprenant un gel des salaires et des promotions, la suppression de primes et indemnités, et le non-remplacement des travailleurs partants à la pension [197]. Bien que la direction des secteurs dépendants de la CGSP-Administrations locales et régionales (Ville de Liège, enseignement communal et CPAS) soit aux mains de militants du PCB, la LRT influence le comité des enseignants de la CGSP et le comité des ouvriers communaux. Ceux-ci soutiennent la revendication de lutte commune avec les travailleurs communaux d’Anvers et la traditionnelle revendication trotskyste de « marche sur Bruxelles », qui refait surface pour l’occasion dans la feuille d’entreprise de la LRT, Le Communard. Si la commission métallurgique de la LRT ne semble pas enregistrer de progrès importants, le parti s’implante néanmoins dans de nouvelles entreprises par recrutement. Ainsi, en avril 1983, un délégué CSC de l’usine Uniroyal à Herstal est recruté et une cellule est fondée dans cette même entreprise : elle intervient avec un bulletin d’entreprise intitulé L’Ouvrier d’Uniroyal.
177 Au-delà de la tactique d’embauche visant à prendre pied dans la sidérurgie, la LRT lance en janvier 1983 une « campagne de propagande et d’explication nationale sur [Cockerill-Sambre] ». Son but est de dénoncer la restructuration de la plus grande entreprise sidérurgique du pays, sa filialisation et son démantèlement à terme afin de privatiser les filiales les plus rentables. Dans cette perspective, M. Capron est chargé de rédiger, comme il l’avait fait lors du conflit social à Glaverbel en 1975, un dossier reprenant l’analyse de la LRT de façon détaillée et présentant l’alternative d’une nationalisation sous contrôle ouvrier imposée par l’occupation de l’usine [198]. Titré « La vérité sur Cockerill-Sambre », le document paraît en février 1983 et constitue le principal outil d’une campagne d’agitation autour de la nationalisation. Au terme de cette campagne menée dans toute la Belgique, la LRT peut se féliciter d’avoir consolidé son implantation dans le secteur sidérurgique à Liège et d’avoir relancé la section de Charleroi autour d’une activité d’envergure. Le projet de prolétarisation avance à un point tel que, en juin 1982, la direction annonce la réussite de sa première phase.
178 Par ailleurs, la direction de la LRT s’émeut à peine de perdre deux figures syndicales historiques, qui toutes deux doivent cesser leurs activités syndicales pour cause de perte de leur emploi. D’une part, Serge Viaene, militant trotskyste depuis les années 1960 et délégué syndical dans l’industrie textile à Mouscron (filature Motte et Cie), perd son emploi à la suite de la faillite de cette entreprise en décembre 1982 ; un repreneur réembauche 200 ouvriers, mais refuse les membres de l’ancienne délégation syndicale. D’autre part, A. Henry mène son dernier combat avec les verriers de Gilly : l’entreprise publique d’isolation-rénovation qui leur a été promise pour accueillir leur reconversion ne sera jamais véritablement mise sur pied ; dès lors, ils sont rayés des listes du personnel de Glaverbel, tandis que le fonds social qui garantissait le maintien de leur salaire est supprimé en juin 1983. Malgré quelques dernières actions d’occupation des bureaux de l’Office national de l’Emploi (ONEM), les « travailleurs excédentaires » de Gilly doivent se résoudre au chômage. Cette disparition de deux des principaux militants syndicaux trotskystes historiques ne semble pas freiner l’enthousiasme généré par le tournant, dont les plus jeunes générations de militants sont désormais les seules porteuses. En octobre 1983, la LRT est composée de plus d’un quart d’ouvriers, dont sept sont embauchés dans la métallurgie et onze à la SNCB. Une nouvelle vague d’embauche s’annonce à partir de jeunes militants recrutés à la JGS, dont la formation politique est particulièrement soignée avant de les laisser opérer leur prolétarisation.
179 La grève des services publics de la rentrée 1983 constitue une nouvelle occasion de démontrer le dynamisme retrouvé de la LRT. Durant trois semaines, du 9 au 26 septembre, une grève menée en protestation contre les coupes budgétaires, lancée par les cheminots mais rapidement rejointe par l’ensemble des fonctionnaires, paralyse le pays, contraignant le gouvernement Martens V à des concessions sur sa politique de réduction des dépenses publiques. Dès le début du mouvement, les militants de la LRT sont actifs dans l’extension de la grève, y compris dans le secteur privé, et sont capables d’impulser des dynamiques d’assemblées générales intersectorielles dans plusieurs villes du pays : Alost, Anvers, Ath, La Louvière, Louvain, Malines, etc. Partout, ils défendent le mot d’ordre d’une grève jusqu’à la chute du gouvernement [199].
180 Dans le secteur privé, la LRT tire les leçons de l’échec de ses précédentes interventions dans les luttes d’entreprises. Lorsque, à la fin de l’année 1983, le plan Gandois [200] est mis en œuvre, Valfil, une division de Cockerill à Seraing, est menacée de perdre la moitié de son personnel. La LRT concentre alors l’ensemble de ses forces et mène une campagne énergique pour l’élargissement de la grève à tout Cockerill-Sambre. Elle s’investit dans un congrès commun des sidérurgistes liégeois et carolorégiens visant à préparer la lutte d’ensemble contre le plan Gandois [201]. Un bulletin d’entreprise intitulé La vérité sur Cockerill-Sambre voit le jour et devient le journal de grève, vendu également dans les autres sièges de Cockerill. La LRT participe aussi à la collecte d’un fonds de soutien et visite régulièrement le comité de grève, notamment avec ses métallurgistes gantois [202]. À la même époque, une conférence ouvrière de la LRT connaît un petit succès de foule : 167 personnes y participent, dont près de la moitié ne sont pas membres du parti. Parmi les personnes présentes, figurent une moitié d’enseignants et plus d’un tiers d’ouvriers d’industrie [203].
181Le succès de l’orientation que la LRT a prise dans cette nouvelle période de « remontée des luttes » fait entrer l’organisation avec optimisme dans les discussions en vue du septième congrès : celui-ci doit être le congrès qui actera la sortie de la LRT de la marginalité et sa transformation en un parti révolutionnaire en construction [204]. Dans cet enthousiasme, les démissions des militants de la première heure et les départs sur la pointe des pieds passent relativement inaperçus [205].
182Alors que la LRT s’apprête à adopter un nouveau nom marquant sa transformation en un petit parti ouvrier révolutionnaire prêt à partir à la conquête de l’avant-garde syndicale, un ancien militant JGS recruté dans la foulée de Mai 68, Daniel Eskenazy, remet sa lettre de démission en jugeant, découragé, que « chaque tournant dans la construction du parti s’est fait en sacrifiant la génération précédente ». Et de conclure par cette phrase aux accents prémonitoires : « Et demain, quand la sidérurgie sera sacrifiée par le capitalisme international comme l’a [sic] été les charbonnages, vers qui se tournera-t-on pour construire le parti ? Et que deviendront les sidérurgistes si difficilement recrutés ? » [206]
183L’heure n’est bien entendu pas à ces considérations. Le septième congrès, qui se tient durant le mois de février 1984, transforme le nom de l’organisation en Parti ouvrier socialiste (POS, en néerlandais Socialistische Arbeiderspartij - SAP) en présence de 72 délégués [207].
184Le substantif « parti » a été proposé pour signifier les progrès numériques de l’organisation. L’adjectif « socialiste » remplace « révolutionnaire », qui a été considéré comme n’étant « pas du tout compris par la grande masse » et comme constituant un « handicap pour entrer en contact avec des milliers de travailleurs » [208]. Quant au terme « travailleurs », l’idée première avait été de le maintenir, afin de marquer l’identité de classe (« Parti socialiste des travailleurs »). Le comité central sortant a finalement proposé « ouvrier », de façon à composer le sigle « POS », jugé plus distinct de « PS » que la proposition initiale « PST » [209].
185L’examen de la composition générationnelle du nouveau bureau politique [210] montre que, de la génération qui a commencé son parcours militant à la JGS, il ne reste qu’un militant membre du premier bureau politique de la LRT : F. Vercammen. Celui-ci a participé, en tant que militant de la Quatrième Internationale, à l’ensemble du processus qui a vu l’exclusion des trotskystes du PSB, l’émergence d’une JGS autonome vis-à-vis du PSB puis son affirmation comme organisation de jeunesse révolutionnaire, et la création de la LRT. D’autres membres de cette génération – un peu plus « jeunes » politiquement, puisqu’ils sont entrés dans la politique révolutionnaire dans le feu de Mai 68, ont participé à la création de la LRT et ont joué un rôle dirigeant dans les années de fondation – figurent également dans le bureau politique de 1984 ; il s’agit de Frank Slegers, Ida Dequeecker, Éric Toussaint et Alain Tondeur. Un seul membre du bureau politique (« Lida ») a pris des fonctions dirigeantes dans la LRT à partir du tournant vers les nouvelles avant-gardes, et un seul autre (« Bob ») est issu de la toute dernière génération militante ayant intégré l’organe de direction. À cette époque, le bureau politique ne compte donc qu’un seul membre ayant commencé son parcours politique entre la fondation de la LRT et le précédent congrès. La pression militante et les tournants successifs semblent bien avoir eu raison du cadre que les militants de la première génération de la LRT ont tenté de former tout au long des années 1970.
Conclusion
186Les treize années d’existence qu’a connues la section belge de la Quatrième Internationale sous le nom de LRT (1971-1984) se situent à un moment charnière d’une vie entamée à la fin des années 1920 et qui se poursuit encore aujourd’hui sous le nom de LCR. En les reparcourant, une constatation s’impose d’emblée : le mouvement trotskyste est resté marginal en Belgique, non seulement dans le paysage politique général mais aussi dans la classe sociale qu’il envisage de conquérir. S’il a pu se renforcer dans les périodes de montée des luttes sociales, il s’est à chaque fois déconstruit dans les périodes de reflux. De ce point de vue, son développement suit les tendances déjà relevées par Marc Lorneau pour la période 1939-1964 [211].
187 Ainsi, les quelques centaines d’ouvriers renardistes gagnés par la SBQI dans la foulée de la grève de 1960-1961 et avec lesquels elle fonde le PWT ne sont pas préparés à constituer un parti ultra-minoritaire obligé de lutter pour sa survie en attendant la prochaine lutte sociale d’ampleur. Si cette perspective peut être supportée par les militants trotskystes rompus à l’isolement et à une progression pouce par pouce, la base ouvrière du PWT et de l’UGS ne résiste pas à la vague de démoralisation qui suit les premiers échecs électoraux en 1968, dans un contexte où la question communautaire commence à prendre le pas sur la question sociale. De la même manière, les militants de la JGS, devenus les principaux cadres de la LRT au moment de sa création, résistent mal au reflux de l’onde de Mai 68 qui commence avec la crise économique de 1974.
188 Participant de la même logique, l’éclatement du paysage de la gauche radicale se déploie de nouveau dans les moments de remontée des luttes (apparition du maoïsme en 1968, scission de la LRT au début des années 1970) pour diminuer de nouveau à l’orée des années 1980. Cependant, la vague de contestation qui se développe à l’aube des années 1970 donne un élan tel que, même ralentie par l’affaiblissement des luttes, la LRT trouve la possibilité de s’insérer dans le paysage des nouveaux mouvements sociaux et des luttes partielles. Sans que les militants de la LRT ne se rendent compte que cette période voit déjà s’estomper l’horizon révolutionnaire, le mouvement, qui s’est engagé pour « changer la vie », permet de donner un second souffle à la LRT mais ne lui offre pas de progresser de façon décisive. Ensuite, anticipant la résistance des travailleurs face à la réaction des milieux entrepreneuriaux à la crise (le tournant néolibéral), à partir du début des années 1980, la LRT est capable, en un temps très court, de changer son profil à travers le « tournant ouvrier » pour tenter de se réinsérer dans la sphère ouvrière. De cette façon, le glissement dans la composition sociale du parti, de l’ouvrier industriel vers les milieux intellectuels [212], est temporairement perturbé. De nouveau, ce changement de projet politique lui donne l’illusion d’une progression, bien qu’elle ne progresse de façon significative ni numériquement ni durablement en termes d’influence politique.
189 Enfin, dans un contexte où se sera évaporée la perspective immédiate d’un changement de société et où même les avancées sur les thèmes portés par les nouveaux mouvements sociaux se feront plus difficiles, le POS, successeur de la LRT, sera, au cours des années 1980, capable de se maintenir, réalisant même, à l’occasion des élections législatives du 13 décembre 1987, son plus haut score électoral avec 31 442 voix. Ce résultat retombe cependant à 5 242 voix dès les élections législatives du 24 novembre 1991 [213], traduisant le coup de massue idéologique que constitue la chute du modèle soviétique pour la gauche radicale. Parallèlement, la base militante s’étiole, puisque les effectifs du parti sont estimés à 200 membres au milieu des années 1990 [214].
190 En dépit de sa marginalité, ou peut-être à cause d’elle, la LRT est néanmoins capable de créer la surprise et de peser à l’occasion sur l’agenda politique à plusieurs reprises. La mobilisation contre la suppression du sursis militaire en 1973-1974, les luttes étudiantes contre la réforme de l’université et les augmentations du coût des études, les multiples campagnes de solidarité internationale sont autant d’exemples prouvant que le mouvement trotskyste peut faire l’actualité. Si c’est dans la jeunesse que ses succès sont les plus francs, la LRT est également en mesure de maintenir et de développer des pôles de référence locaux pour l’aile gauche de la FGTB et le syndicalisme d’action directe. Cette aisance dans la mobilisation sociale et cette capacité de plonger dans le mouvement de masse se doublent, à partir des années 1970, d’un certain art de la mise en scène, s’appropriant avec succès les anathèmes d’« agitateurs » et de « gauchistes » que lui lancent ses adversaires, organisant des actions d’éclat dans un but médiatique et faisant la publicité de ses militants arrêtés ou réprimés.
191 Si la LRT sait, à l’évidence, saisir les possibilités de peser sur le mouvement social, elle se montre en revanche beaucoup moins capable de les transformer en opportunités de développement. De ce point de vue, le mouvement trotskyste belge semble s’entraîner de lui-même dans une dynamique de fuite en avant, se servant de ses déséquilibres successifs pour gagner un nouvel élan. Cette dynamique est visible au travers des ruptures que la LRT opère tout au long de son existence : de l’entrisme dans le « parti centriste » que constitue le PWT à la fondation d’une organisation révolutionnaire de type léniniste, du mouvement ouvrier aux nouveaux mouvements sociaux puis au retour au mouvement ouvrier avec le tournant radical vers l’industrie. Il est symptomatique de constater que, huit ans après ce tournant, une nouvelle crise éclatera au sein du POS, qui aboutira à une nouvelle ouverture des trotskystes vers l’antimondialisme naissant.
192 Cette manière d’opérer par rupture brutale, de procéder par déséquilibre est particulièrement visible dans la façon dont la LRT gère ses ressources financières. Jusqu’en 1980, où elle est contrainte à une cure d’austérité drastique, la LRT procède par deficit spending, gonflant ses structures et investissant pour l’avenir dans une organisation de masse qui n’arrive jamais, plutôt que de se chercher une assise qui lui permette de progresser par étape. Ceci apparaît comme la conséquence du cadre mental dans lequel évoluent les militants qui restent aux commandes du parti tout au long des années 1970. Il ne faut pas perdre de vue le fait que, dans la vision des dirigeants de la LRT, et ce au moins jusqu’en 1978, la perspective est celle d’une crise révolutionnaire éclatant dans les quelques années à venir. Dès lors, ils sont engagés dans une course contre la montre afin de construire rapidement le parti qui pourra prendre la direction de cette crise révolutionnaire imminente. Cette disposition les pousse régulièrement à chercher « le » raccourci vers le parti révolutionnaire de masse, quitte à sacrifier une partie de la base militante existante. C’est ainsi que la position acquise dans la sphère de la « nouvelle gauche », surtout en Flandre où la LRT ne souffre d’aucun rival sur ce terrain, est liquidée peu à peu à la fin des années 1970 au profit de la construction d’un profil ouvrier. Ceci se marque également sur le terrain syndical : ainsi, un travail de longue haleine dans le secteur des travailleurs sociaux est abandonné au profit de la construction d’une hypothétique influence dans les chemins de fer [215].
193 Au début des années 1980, l’abandon de la perspective révolutionnaire à court terme, couplée à la perception du durcissement de l’attitude du patronat et du monde politique à la crise et des mouvements de lutte que celui-ci suscite dans le mouvement ouvrier, amène la direction de la LRT à radicaliser et à accélérer le « tournant ouvrier » décidé en 1978, via un mouvement d’embauche de militants « intellectuels » dans les entreprises. Le tournant vers l’industrie est envisagé comme une tentative de rattraper ce que la Quatrième Internationale considère désormais comme un retard, et de construire en peu de temps ce petit parti révolutionnaire qu’elle appelle de ses vœux et qui reste à ce moment à l’état de perspective. Il importe de souligner ici que les changements d’orientation rapides qu’opère la LRT ne sont pas de son seul fait : la direction internationale les entérine, voire les impose comme dans le cas du tournant vers l’industrie et de la prolétarisation.
194 Tout au long de ces années, ces changements brusques de projet politique ont deux effets significatifs sur la base militante de la LRT.
195 D’une part, régulièrement désorientée par les directives du bureau politique, la base a tendance à se constituer une certaine autonomie. La coupure entre le centre national et la vie des sections régionales est constante, ce que la base et la direction déplorent soit comme « une incapacité à diriger politiquement » [216] soit comme « une non-assimilation du projet politique » [217], regrettant que la LRT ne soit « qu’un regroupement de francs-tireurs » [218]. Il est donc permis de penser que le développement d’une certaine « décentralisation » au sein de la LRT constitue une façon, tant pour les militants que pour les sections régionales, de travailler à leur propre projet de construction, reléguant au second plan les injonctions contradictoires de la direction.
196 D’autre part, sur un plan strictement individuel, de nombreux militants de la LRT ne retrouvent pas dans l’organisation le projet politique auquel ils ont adhéré quelques années auparavant, ce qui provoque des démissions et des mises en retrait de l’organisation. Une autre forme de « départ » se développe aussi : des militants se tournent prioritairement vers un terrain spécifique sur lequel ils ont l’opportunité de mener leur travail avec une relative autonomie. C’est le cas, par exemple, de G. Dobbeleer, qui demande à être compté au nombre des sympathisants à partir de 1975 et s’engage davantage dans son activité syndicale à la CGSP. Cette vague de départs se retrouve à chaque tournant important : les vieux militants entristes peu après la fondation de la LRT, la génération des nouveaux mouvements sociaux à partir de 1976 (les étudiants de l’ULB formant la « tendance 4 » lors du troisième congrès de 1976), les départs s’étalant dans le temps jusque 1982-1984, lorsque le tournant vers l’industrie se précise en tant que choix personnel pour les militants. D’ailleurs, lors du congrès de 1992, lorsque sera déclarée la fin de la période du tournant vers l’industrie, une partie des tenants de cette ligne quitteront à leur tour l’organisation pour rejoindre des formations plus petites mais plus « ouvriéristes » (Organisation socialiste internationaliste - OSI, Mouvement pour une alternative socialiste - MAS) ou participer à une tentative de fondation d’une branche belge de l’organisation française Lutte ouvrière (LO) [219].
197 Sans oublier que l’ensemble des organisations de gauche souffrent de la « crise du militantisme » à mesure que faiblit l’onde de choc de Mai 68, il est néanmoins frappant de constater à quel point la question des relations interpersonnelles est prégnante au sein de la LRT. De l’« agressivité » des permanents politiques dénoncée par les permanentes techniques en 1978 aux « capitaines dictatoriaux » observés par les étudiants de l’ULB, les documents sont nombreux où les tensions sous-jacentes aux discussions se font sentir au sujet de la ligne politique. Cette âpreté dans les rapports humains peut constituer, à côté des considérations précédentes, un facteur explicatif de l’instabilité du cadre de la LRT. En effet, après chaque congrès, se produit un renouvellement important du personnel du comité central, qui concerne souvent plus de la moitié des membres de celui-ci. Sur les 115 militants membres du comité central entre 1971 et 1984, 21 seulement en restent membres entre trois congrès consécutifs, ce nombre étant porté à 38 si l’on prend en compte les militants qui y ont été élus deux fois consécutivement. Durant ses treize années de vie politique, la LRT ne peut compter que sur une équipe de cadres réduite. Encore faut-il rappeler que, à certaines périodes de crise, le bureau politique assume quasiment seul les tâches centrales du parti.
198 La pénurie de cadres face à l’ambition du projet porté par les trotskystes belges, ainsi que l’ampleur des tâches quotidiennes en comparaison du petit nombre de militants qui les portent, permettent de comprendre les multiples tentatives et appels à la discipline et au professionnalisme. Cependant, se heurtant à l’« impossibilité de la greffe du bolchévisme » [220], la direction de la LRT change progressivement le discours qu’elle tient envers les militants [221]. Si, en 1971, la teneur est à l’éducation des membres afin de faire d’eux de parfaits révolutionnaires, il est admis au milieu des années 1970 qu’une souplesse organisationnelle est nécessaire pour permettre à chaque membre d’assumer ses tâches militantes. Enfin, dans le cadre de la prolétarisation du parti, l’accent est mis sur l’attention que les structures doivent avoir pour les difficultés rencontrées par les militants ouvriers, y compris dans leur vie privée, et sur les réponses qu’il convient d’y apporter de façon à pouvoir intégrer chacun de ces militants. On passe donc d’une situation où le militant doit s’adapter à l’organisation à un relatif opposé treize ans plus tard, sans pour autant gagner en stabilité. Dès lors, les « mouvementistes » de Mai 68 semblent se transformer à leur tour en ces « gardiens du temple » dont ils ont pris la place en 1971, assurant la continuité de leur organisation en attendant l’extension du cadre. Ceux qui viennent prendre la relève sont cependant bien peu nombreux. La génération qui porte le tournant ouvrier s’épuise au bout de quelques années. Beaucoup quittent le parti « sur la pointe des pieds », d’autres avec plus de fracas après le congrès de 1992. Ceux qui resteront de cette génération s’investiront alors sur leur terrain de prédilection, syndical ou associatif, selon des stratégies de reconversions militantes mises en lumière par Florence Johsua [222].
199 Bien que la LRT fonctionne par ruptures successives, en refusant une partie de l’héritage des générations précédentes, elle ne doit pas être considérée comme dépourvue d’histoire. Bien au contraire, comme toute organisation trotskyste, la LRT est dépositaire d’une tradition politique incarnée par l’histoire de la Révolution d’Octobre 1917. Baignée de références au mouvement communiste, elle est réputée conserver les acquis du léninisme trahis par le stalinisme. Une partie de la contestation du leadership des anciens militants par la génération de Mai 68 se fait d’ailleurs au nom de cet héritage.
200 La tactique de l’entrisme est abandonnée à la fin des années 1960 au profit de la réaffirmation du projet marxiste-révolutionnaire, mais il est clair par ailleurs que la deuxième génération, celle des « mouvementistes », recueille une partie de l’héritage non seulement politique et idéologique mais aussi organisationnel de son aînée « entriste ». Si la plupart des organisations d’extrême gauche de cette époque sont tout entières tournées vers elles-mêmes et leur projet de construction, la LRT démontre une certaine capacité à la collaboration et au réseautage. Il s’agit là d’une caractéristique que présentait déjà la génération précédente, rompue, en raison de son travail clandestin en faveur de l’Algérie puis de son activité entriste, au tissage d’alliances avec d’autres individus et d’autres courants. Mais, en raison des mêmes activités, cette génération est également capable de manœuvres tactiques multiples, de façon à isoler des adversaires ou des concurrents ou à les pousser à la faute. La génération qui dirige la LRT à partir de 1971 intègre ces deux caractéristiques, qui se retrouvent dans l’activité du parti par la suite. Ainsi, si les trotskystes belges sont capables de nouer des alliances solides avec d’autres mouvements, partis ou groupes, ils sont capables également de tirer parti de ces collaborations de façon à circonscrire leurs concurrents. On le voit dans la lutte contre l’organisation étudiante d’AMADA, le MLB, au sein du VVS à partir de 1974, dans la stratégie d’isolement du PCB par la création d’une seconde plateforme de soutien à l’Indochine, ou encore dans la stratégie d’unité électorale qui doit démontrer le « sectarisme » de TPO-AMADA ou du PCB. De la même manière, la troisième génération militante, celle qui porte le tournant ouvrier, si elle rejette une certaine conception de l’organisation bolchevique, garde de la génération précédente cette capacité à plonger dans le mouvement de masse, à y prouver son utilité par l’apport de compétences organisationnelles, en se révélant un organisateur local efficace, comme les enseignants anversois ou les travailleurs communaux liégeois lors des luttes contre les mesures gouvernementales.
201 La volonté d’ouverture vers les nouveaux mouvements sociaux est par contre constitutive de l’identité des deuxième et troisième générations, qui reprennent à leur compte l’héritage organisationnel de la génération de l’entrisme pour construire des collaborations fortes et à long terme qui influencent durablement les nouveaux mouvements sociaux. La commission Femmes de la LRT en est un bon exemple. Le travail que continuera à mener l’organisation après 1984 – d’abord sous le nom de POS de 1984 à 2005 puis sous celui de Ligue communiste révolutionnaire (LCR, le nom et le sigle ne changeant pas en néerlandais : Socialistische Arbeiderspartij - SAP) à partir de 2006 – au sein des mouvements sociaux de l’immigration, des femmes ou de l’altermondialisme sera également à mettre au compte de cette génération militante toujours en activité à l’heure actuelle.
Annexe 1. Résultats électoraux de la LRT
1) Élections législatives (Chambre des représentants)
202 Si l’on excepte le soutien apporté à la liste de l’Union démocratique et progressiste (UDP) à Mons lors du scrutin du 7 novembre 1971 et l’appel à voter « à gauche du PSB » à l’occasion du scrutin du 10 mars 1974, la première participation de la LRT à des élections de la Chambre des représentants date du scrutin du 17 avril 1977. Le parti se présente alors dans 17 arrondissements électoraux, obtenant des scores compris entre 0,16 % (Courtrai) et 0,49 % des voix (Anvers et Gand-Eeklo). Le 17 décembre 1981, la LRT dépose des listes dans 15 arrondissements, où elle récolte entre 0,10 % (Liège) et 0,40 % des suffrages (Tournai–Ath–Mouscron et Anvers). Lors des élections du 8 novembre 1981, le parti se présente aux électeurs dans 20 arrondissements – en cartel avec la petite formation Pour le socialisme (PLS) en Wallonie – et recueille entre 0,12 % (Namur) et 0,40 % des voix (Anvers et Hasselt).
203Entre 1977 et 1981, le nombre d’arrondissements dans lesquels la LRT a systématiquement déposé une liste est de 6 en Wallonie (Charleroi, Liège, Mons, Nivelles, Soignies, Thuin) et de 7 en Flandre (Alost, Anvers, Bruges, Gand–Eeklo, Louvain, Malines, Saint-Nicolas). À l’inverse, elle n’a participé à aucun scrutin dans 2 arrondissements wallons (Dinant–Philippeville, Neufchateau–Virton) et dans 6 arrondissements flamands (Audenarde, Roulers–Tielt, Termonde, Tongres, Turnhout, Ypres). Les électeurs de l’arrondissement de Bruxelles n’ont eu la possibilité de voter pour cette formation politique qu’en 1977 et en 1981.
204Le tableau ci-après fournit également, à titre d’information, les résultats qu’obtiendra le parti – alors rebaptisé POS – à l’issue du scrutin du 13 octobre 1985. Il s’agira en effet de la première fois que le parti se présentera dans l’ensemble des 30 arrondissements pour une élection de la Chambre des représentants. Les scores obtenus varieront entre 0,12 % (Tournai–Ath–Mouscron, Courtrai, Roulers–Tielt) et 0,45 % des suffrages (Thuin).
205 À chacun de ces scrutins, le parti échoue à décrocher un siège de député.

2) Élections législatives (Sénat)
206La LRT dépose des listes pour l’élection du Sénat aux scrutins du 17 avril 1977 (dans le seul arrondissement de Tournai–Ath–Mouscron), du 17 décembre 1978 (dans 6 arrondisse-ments) et du 8 novembre 1981 (dans 16 arrondissements). Son meilleur score est de 0,61 % (dans l’arrondissement d’Hasselt, en 1981).
207 À chacun de ces scrutins, le parti échoue à décrocher un siège de sénateur.

3) Élections provinciales
208La LRT manifeste peu d’intérêt pour les élections provinciales. Le parti ne dépose de liste pour ce niveau de pouvoir pour la première – et seule – fois qu’en 1981 (en Wallonie, sous l’impulsion de son allié PLS). En 1985, le POS se présentera dans six provinces sur neuf.

4) Élections communales
209À l’occasion des élections communales du 10 octobre 1976, la LRT n’est présente qu’en deux endroits : à Mouscron, où le parti soutient la liste UDP, et à Quaregnon-Wasmuel, où il participe à la liste UDP. Six ans plus tard, les élections communales du 10 octobre 1982 voient la LRT se présenter dans 3 communes wallonnes, 5 communes bruxelloises et 7 communes flamandes. Dans aucune toutefois, le parti ne dépose de liste propre : il participe à des listes de coalition.
210C’est en 1976, à Quaregnon-Wasmuel, que la LRT remporte le seul siège de mandataire politique dont elle ait jamais disposé : élu sur la liste UDP, Willy Goval est conseiller communal de 1976 à 1982.

5) Élections européennes
211Une seule élection directe du Parlement européen est organisée à l’époque de la LRT : celle du 10 juin 1979. Le parti y prend part et recueille 0,30 % dans le collège électoral français et 0,32 % dans le collège électoral néerlandais. Ces scores sont bien insuffisants pour obtenir un siège d’eurodéputé.

Annexe 2. Composition du bureau politique de la LRT

212Dans un certain nombre de traditions trotskystes, dont celle dont relève la LRT, l’habitude est de se doter d’un « nom de guerre » lorsque l’on devient militant. Dès lors, dans l’ensemble des documents internes de la LRT, il est fait référence aux membres par leur pseudonyme. Cependant, cette habitude n’est pas absolument systématique (par exemple, des militants signent leurs articles de leur vrai nom dans des publications de la LRT). Par ailleurs, certains militants changent de pseudonyme au cours de leur engagement. Cette utilisation de pseudonymes est évidemment de nature à compliquer le travail d’identification du chercheur. Lorsque le nom véritable nous est connu, il suit le pseudonyme entre parenthèses.
Annexe 3. Organigramme de la LRT

Annexe 4. Évolution des effectifs de la LRT
213 Les formations politiques sont généralement discrètes sur le nombre de leurs adhérents ; quand elles existent, les listes de membres reflètent rarement la réalité. Dans le cas de la LRT, l’évaluation du nombre des membres est encore compliquée par une culture du secret solidement ancrée. Les effectifs ne sont guère qu’évoqués, au détour d’un texte politique ou organisationnel. Les chiffres ci-dessous relèvent donc d’estimations qu’il convient de regarder avec prudence.

Annexe 5. Notices biographiques
214Michel Capron : (1940-2013) Diplômé en sciences économiques des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP) de Namur en 1969, il est membre de la LRT dès la fondation de ce parti, au sein duquel il est l’un des responsables de la régionale du Centre et, surtout, le spécialiste des questions économiques belges. Militant syndical, il fonde une section de la Centrale nationale des employés (CNE, affiliée à la CSC) à l’UCL et en assure la présidence de 1981 à 1987. Il mène une carrière scientifique à l’Université catholique de Louvain (UCL), où il est responsable du centre de documentation de la Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES).
215 Guy Desolre : (1939-2016) Membre de la Section belge de la Quatrième Internationale (SBQI) au sein du PSB puis de la LRT, il mène, durant la période entriste, une lutte de tendance au sein du comité de rédaction de Links contre la signature d’un accord avec le bureau du PSB. Membre de la Confédération socialiste des travailleurs (CST), il est d’avis que celle-ci doit devenir une section sympathisante de la Quatrième Internationale le plus rapidement possible, mais il est mis en minorité sur cette question lors du comité central du 3 septembre 1967. Cofondateur de la LRT en 1971, il quitte celle-ci deux ans plus tard avec un petit groupe de militants pour former le Groupe marxiste internationaliste (GMI). Docteur en sciences politiques, il est chargé de cours à la VUB et chercheur au centre d’études sur les pays de l’Est à l’ULB. Après l’échec du GMI en 1978, il anime la revue Critique communiste. Il devient par la suite gouverneur adjoint du Brabant flamand, fonction qu’il occupe jusqu’en 2005.
216 Georges Dobbeleer : (1930- ) Un temps étudiant à l’ULB, il devient militant du mouvement Esprit puis, gagné à la Quatrième Internationale en 1953, il s’installe à Liège pour y fonder une section trotskyste. Il est l’un des principaux organisateurs du projet entriste au sein de la Jeune garde socialiste (JGS). Il est élu au bureau politique de la SBQI en 1956. Employé à la caisse coloniale des pensions puis enseignant à Huy, il est également militant syndical à la Centrale générale des services publics (CGSP, affiliée à la FGTB), dont il est le président du bureau syndical provincial de Liège en 1980 puis permanent. En 1976, il prend le statut de sympathisant de la LRT avant de redevenir un militant actif en 1995 au sein du POS. Il est l’auteur de la brochure de la JGS intitulée Un programme politique de la jeunesse (parue en 1965). Il a publié ses mémoires : Sur les traces de la révolution : itinéraire d’un trotskiste belge (Paris, Syllepses, 2006) et Sur les traces de la révolution : militer au XXe siècle (Bruxelles, Léon Lesoil, 2009).
217 André Henry : (1938- ) Ouvrier verrier, il milite dans la JGS, au sein de laquelle il prend part à la grève de 1960-1961. Il adhère à la SBQI en 1962. Au sein de son entreprise, Glaverbel, il lance une tendance syndicale combattive autour du bulletin La Nouvelle Défense. En 1968, il devient délégué FGTB. Membre fondateur de la LRT, il est membre du comité central de 1971 à 1982. Durant toutes les années 1970, il est la référence du syndicalisme de combat parmi les verriers de Charleroi, travaillant à unifier les luttes au-delà même de son secteur d’activité. Malgré une résistance acharnée de plusieurs années contre la fermeture de son entreprise, il est définitivement licencié en 1984. Il a retracé son combat syndical dans L’épopée des verriers du pays noir (Liège, Luc Pire, 2013).
218 Pierre Le Grève : (1916-2004) Enseignant et militant syndical de la CGSP à Bruxelles, il milite dans le mouvement trotskyste dès 1933. Il rejoint l’organisation Contre le courant, scission du Parti socialiste communiste-trotskyste (PSCT). Il est l’un des artisans de la réunification avec le Parti communiste révolutionnaire (PCR) en 1946, dont il devient un dirigeant la même année. Président du Comité pour la paix en Algérie de 1958 à 1962, il est l’objet d’une tentative d’assassinat dans le cadre de son activité en faveur de l’Algérie indépendante par l’organisation La Main rouge en 1960. Élu sur la liste de cartel PC–UGS, il est député de l’arrondissement de Bruxelles de 1965 à 1968 ; à ce jour, il est ainsi le seul député trotskyste de l’après-guerre. Membre fondateur de la LRT, il est surtout actif dans le champ syndical. Il est ainsi président de la régionale bruxelloise de la CGSP-Enseignement à partir de 1972. À partir du milieu des années 1970, il s’éloigne de la LRT. Il a rédigé ses mémoires : Souvenirs d’un marxiste anti-stalinien (Paris, La pensée universelle, 1996).
219 Ernest Mandel : (1923-1995) Entré comme militant au Parti socialiste révolutionnaire (PSR) en 1939, il devient l’un des cadres dirigeants de cette organisation trotskyste (rebaptisée Parti communiste révolutionnaire – PCR) sous l’occupation. Membre incontestablement le plus influent du bureau politique de la SBQI, il est le maître d’œuvre du tournant entriste au sein du PSB. Il est membre du bureau politique de la LRT jusqu’en 1980, année à partir de laquelle il s’adonne entièrement aux fonctions qu’il occupe au niveau international (il est membre du secrétariat européen de la Quatrième Internationale dès 1943 et du secrétariat international à partir de 1946). Économiste de renommée internationale, il mène en parallèle de ses activités politiques une carrière académique à la VUB, dont il dirige le centre de sciences politiques de 1985 à 1988. Parmi ses écrits politiques, signalons La conception marxiste de l’État (Bruxelles, Documents socialistes, 1965), Introduction au marxisme (Bruxelles, Léon Lesoil, 1975) et Le troisième âge du capitalisme (Paris, Union générale d’éditions, 1976).
220 Philip Polk : (1932-2014) Biologiste, assistant à l’université de Gand puis professeur à la faculté des sciences de la VUB, il est membre du comité central de la SBQI et l’un de ses principaux animateurs en Flandre. Il est l’un des dirigeants du Socialistische Beweging Vlaanderen (SBV) et est membre du comité confédéral de la Confédération socialiste des travailleurs (CST). Membre de la LRT à sa fondation, il participe avec G. Desolre à la scission qui donne naissance au GMI en 1973.
221 Jean Roosen : (1930-2008) Technicien à l’ULg et délégué permanent de la Centrale chrétienne des services publics (CCSP, affiliée à la CSC), il est membre de la SBQI et du comité central du Parti wallon des travailleurs (PWT) en 1965 et membre du comité central de la LRT de 1971 à 1978. Membre du comité fédéral interprofessionnel de la CSC de Liège, il devient vice-président du secteur national des ministères. En 1981, il est démis de ses mandats syndicaux.
222 Marcel Slangen : (1935- ) Enseignant et animateur du Mouvement populaire wallon (MPW), il est membre de la SBQI à partir de 1964. Il est candidat du PWT à Liège lors des élections législatives du 23 mai 1965. Il est secrétaire de rédaction de La Gauche à la fondation de la LRT et est régulièrement candidat aux élections sur les listes auxquelles participe la LRT (notamment lors des élections communales du 10 octobre 1976). Il est secrétaire régional de la CGSP-Enseignement de Liège de 1981 à 1983.
223 Émile Van Ceulen : (1916-1987) Ouvrier maroquinier, il est militant trotskyste à partir de 1933. Il est membre du bureau politique de la SBQI de 1947 à 1950 et membre de la direction de la JGS durant la période entriste dans le PSB (à ce titre, il est l’une des chevilles ouvrières du bureau national de la JGS de 1955 à 1959). Membre d’honneur du comité central de la LRT à partir de 1974, il est candidat au Sénat pour la liste LRT–PLS pour l’arrondissement de Bruxelles lors des élections anticipées du 8 novembre 1981.
224 François Vercammen : (1946-2015) Recruté par G. Desolre et É. Van Ceulen durant ses études, alors qu’il vient de fonder avec quelques autres étudiants le groupe des Marxistische Revolutionaire Studenten (MRS), il s’impose comme dirigeant de la SBQI puis de la LRT et du POS, dont il reste à la direction sans discontinuer. À partir de 1991, sur la requête d’E. Mandel, il devient permanent au service du bureau exécutif de la Quatrième Internationale. Il est notamment l’auteur de La remontée des luttes ouvrières en Belgique (Bruxelles, Les arts graphiques, 1971).
Annexe 6. Évolution du mouvement trotskyste en Belgique (1928-2017)

Notes
-
[1]
La Quatrième Internationale, fondée en 1938 par Léon Trotsky pour fédérer ses partisans sur le plan mondial, a rapidement connu un éclatement sous la double influence de son fondateur en 1939 puis du fait de la clandestinité imposée par le contexte de la Seconde Guerre mondiale. La variante du trotskysme à laquelle est affiliée la LCR est connue sous l’appellation de Secrétariat unifié de la Quatrième Internationale (SUQI) depuis une réunification (partielle) survenue à l’échelle internationale en 1963. Le SUQI représente la composante numériquement la plus importante du mouvement trotskyste international (cf. F. Moreau, Combats et débats de la IVe Internationale, Hull, Vent d’Ouest, 1993, p. 177).
-
[2]
Cf. notamment J.-M. Chauvier, « “Gauchisme” et nouvelle gauche en Belgique », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 600-601 et 602-603, 1973 ; N. De Beule, Le trotskisme belge : l’histoire d’un groupe de communistes oppositionnels (1925-1940), Bruxelles, Fondation Léon Lesoil, 1986 ; N. Latteur, La Gauche en mal de la gauche, Bruxelles, Pol-His, 2000 ; A. Colignon, « L’après-guerre des Jeunes Gardes socialistes : l’impossible réinsertion des anciens combattants de la révolution », Cahiers d’histoire du temps présent, n° 15, 2005, p. 415-433 ; A. Colignon, « Les Jeunes Gardes socialistes, ou la quête du Graal révolutionnaire, 1930-1935 », Cahiers d’Histoire du temps présent, n° 8, 2001, p. 181-224.
-
[3]
M. Lorneau, « Le mouvement trotskyste belge : septembre 1939-décembre 1964 », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1062-1063, 1984. Ce travail est extrait de M. Lorneau, Contribution à l’histoire du mouvement trotskyste belge (1939-1960), mémoire de licence en Histoire, ULg, 1983. Son auteur a été un militant trotskyste peu avant la réalisation de son étude ; notamment, il a été candidat aux élections européennes du 10 juin 1979 sur la liste LRT (cf. « La campagne européenne de la LRT. Internationaliste et ancrée dans les luttes », La Gauche, n° 11, 22 mars 1979, p. 6).
-
[4]
Cf. notamment M. Staszewski, Une tendance de gauche dans le Parti ouvrier belge : l’Action socialiste (1933-1936), mémoire de licence en Histoire, ULB, 1975 ; R. Lefebvre, Dauge et le daugisme, une page d’histoire du mouvement ouvrier dans le Borinage, mémoire de licence en Histoire, ULB, 1979 ; M. Nélisse, Évolution de l’extrême gauche en Belgique, 1968-1978, mémoire de licence en Sociologie, UCL, 1980 ; S. Bloemmaert, De socialistische Jonge Wacht tussen 1945 en 1969, van sociaal-demokratische tot revolutionnair-socialistische jeugdorganisatie, mémoire de licence en Histoire, VUB, 1980 ; C. Legein, Le Parti socialiste révolutionnaire, le mouvement trotskyste belge de 1936 à 1939, mémoire de licence en Histoire, UCL, 1982 ; I. Vrancken, De Belgische trotskistische beweging, 1964-1971, mémoire de licence en Histoire, VUB, 1987.
-
[5]
É. Toussaint, « Concernant l’étude de l’histoire du mouvement trotskyste en Belgique », Lutte de classe, n° 1, 1992, p. 64-68.
-
[6]
L. Mathieu, Les années 70, un âge d’or des luttes ?, Paris, Textuel, 2009, p. 13.
-
[7]
Cf. H. Hatzfeld, Faire de la politique autrement : les expériences inachevées des années 1970, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005.
-
[8]
Cf. A. Martens, V. Pulignano, « Faits de grèves en Belgique 1974-2007 : aspects macroéconomiques et sociologiques. Vers un autre militantisme ? », Actualités du dialogue social et du droit de la grève, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 19-41 ; J.-L. Degée, L’évolution des luttes ouvrières en Belgique, Liège, Fondation André Renard, 1980.
-
[9]
Pour un bel exemple du foisonnement, à l’échelon local, des luttes à caractère socio-économique, environnemental et culturel, de leurs entrecroisements et de leur porosité, cf. L. Bettens, É. Geerkens, « Des occupations d’usine à la médiatisation culturelle », in N. Delhalle, J. Dubois, J.-M. Klinkenberg (dir.), Le tournant des années 1970 : Liège en effervescence, Bruxelles, Impressions nouvelles, 2010, p. 63-82.
-
[10]
G. Mauger, « Gauchisme, contre-culture et néo-libéralisme : pour une histoire de la “génération de mai 68” », in J. Chevallier (dir.), L’identité politique, Paris, Presses universitaires de France, 1994, p. 206-226.
-
[11]
Cf. F. Johsua, « Les conditions de (re)production de la LCR », in F. Haegel (dir.), Partis politiques et système partisan en France, Paris, Presses de Sciences Po, 2007, p. 25-67.
-
[12]
Cf. P. Blavier, « La notion de génération en histoire », Regards croisés sur l’économie, n° 7, 2010, p. 44-46.
-
[13]
Cf. C. Attias-Donfut, Sociologie des générations : l’empreinte du temps, Paris, Presses universitaires de France, 1988, p. 189.
-
[14]
Ibidem, p. 170.
-
[15]
J.-F. Sirinelli, « Génération et histoire politique », Vingtième siècle, revue d’histoire, volume 22, n° 1, 1989, p. 70.
-
[16]
J. Ladrière, « La transition des générations », La Revue nouvelle, n° 8, 1973, p. 129.
-
[17]
S. Hupkens, La Ligue révolutionnaire des travailleurs (1971-1984), une organisation trotskyste belge durant “l’Âge d’or” des luttes, mémoire de maîtrise en Histoire, ULg, 2015.
-
[18]
Pour plus de précisions, cf. ibidem.
-
[19]
Sur l’histoire du PCB, cf. notamment J. Gotovitch, « Histoire du Parti communiste de Belgique », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1582, 1997 ; M. Liebman, « Les origines et la fondation du Parti communiste de Belgique », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 197, 1963 ; Collectif d’histoire et d’études marxistes (CHEMA), Le parti communiste de Belgique (1921-1944), Bruxelles, Fondation Joseph Jacquemotte, 1980 ; V. Scheltiens, « Breuk en continuïteit in doen en denken: het geval War Van Overstraeten (1910-1945) », Cahiers d’histoire du temps présent, n° 22, 2010, p. 15-53.
-
[20]
Cf. P. Broué, Communistes contre Staline : massacre d’une génération, Paris, Fayard, 2003, p. 85-107.
-
[21]
N. De Beule, Le trotskisme belge, op. cit., p. 40-73.
-
[22]
D. Durand, Opposants à Staline : l’opposition de gauche internationale et Trotsky (1929-1930), Aubenas, La Pensée sauvage, 1988.
-
[23]
Le moment ou le PCB manque de basculer du côté de la fraction bolchévique-léniniste est clairement établi. Le 27 novembre 1927, une discussion sur l’adoption des thèses défendues par l’opposition de gauche a lieu au comité central du PCB. Elle se clôture par un vote de 15 voix, contre 3 en faveur des partisans de L. Trotsky. Une intervention du délégué de l’Internationale communiste, Jules Humbert-Droz, et une réorganisation du comité central (afin d’y inclure les délégués des sections de militants communistes immigrés) sont nécessaires pour renverser cette tendance (cf. N. De Beule, Le trotskisme belge, op. cit., p. 49).
-
[24]
J.-J. Marie, Le trotskysme et les trotskystes, Paris, Armand Colin, 2004, p. 27.
-
[25]
Sur ces questions, cf. P. Frank, La Quatrième Internationale : contribution à l’histoire du mouvement trotskyste, Paris, Maspero, 1969 ; E. Mandel, La longue marche de la révolution, Paris, Galilée, 1976 ; F. Moreau, Combats et débats de la IVe Internationale, op. cit.
-
[26]
À ce sujet, cf. R. Lefebvre, Dauge et le daugisme, une page d’histoire du mouvement ouvrier dans le Borinage, op. cit. ; C. Legein, Le Parti socialiste révolutionnaire, le mouvement trotskyste belge de 1936 à 1939, op. cit.
-
[27]
Les avis ont longtemps divergé quant aux auteurs de cette exécution. Les historiens Jean Puissant et Martin Conway l’ont attribuée aux rexistes. Des travaux plus récents en rendent responsable le mouvement de résistance communiste des Partisans armés (cf. F. Maerten, « Du murmure au grondement : la résistance politique et idéologique dans la province de Hainaut pendant la Seconde Guerre mondiale (mai 1940-septembre 1944) », Analectes d’histoire du Hainaut, n° 7, 1999, p. 88 ; A. Colignon, « Dauge, Walter », Nouvelle biographie nationale, tome 5, Bruxelles, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1999, p. 87).
-
[28]
C. Prowizur-Szyper, Conte à rebours, une résistance juive sous l’occupation, Bruxelles, Louis Musin, 1979.
-
[29]
À ce sujet, cf. G. Desolre, « Contribution à l’histoire du trotskysme en Belgique. La question de l’entrisme (1948-1964) », Dissidences, n° 7, 2009, p. 65.
-
[30]
Cette manifestation avait été appelée séparément par la SFIO et le PCF, comme contrepoint à la manifestation organisée par les ligues d’extrême droite six jours auparavant.
-
[31]
Cité par J.-J. Marie, Le trotskysme et les trotskystes, op. cit., p. 41.
-
[32]
Cf. M. Staszewski, Une tendance de gauche dans le Parti ouvrier belge : l’Action socialiste (1933-1936), op. cit.
-
[33]
33 SBQI, « Projet de résolution : les tâches de l’organisation belge », document interne, 1954, p. 1 (cité par M. Lorneau, « Le mouvement trotskyste belge : septembre 1939-décembre 1964 », op. cit., p. 34).
-
[34]
Ainsi, le dirigeant syndical liégeois J. Yerna déclare être vexé du manque de confiance que lui témoignent des militants trotskystes avec lesquels il anime la tendance autour du journal La Gauche, raison pour laquelle il rompt la collaboration avec eux (J. Dohet, J. Jamin, La Belgique de Jacques Yerna : entretiens, Bruxelles/Seraing, Labor/IHOES, 2003, p. 131).
-
[35]
P. Le Grève, Souvenirs d’un marxiste anti-stalinien, Paris, La Pensée universelle, 1996, p. 43.
-
[36]
A. Colignon, « L’après-guerre des Jeunes Gardes socialistes », op. cit., p. 422-428.
-
[37]
Cf. R. Hemmerijckx, « Le Mouvement syndical unifié et la naissance du renardisme », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1119-1120, 1986 ; M. Alaluf (dir.), Changer la société sans prendre le pouvoir : syndicalisme d’action directe et renardisme, Bruxelles, Labor, 2005.
-
[38]
Adopté lors du congrès extraordinaire de la FGTB de 1954, cet ensemble de mesures principalement économiques est destiné à assurer l’expansion économique en vue de l’élévation des salaires et du plein emploi. Il prévoit la coordination des interventions de l’État dans le domaine économique pour donner un cadre aux initiatives privées (la « planification souple »), la nationalisation du secteur de l’énergie, le contrôle des holdings et l’établissement d’un système national de la santé. Il est complété par le texte « Holdings et démocratie économique », adopté au congrès de 1956. Co-écrit par J. Yerna, un proche d’A. Renard, et par le dirigeant de la Quatrième Internationale E. Mandel au sein d’une commission d’étude de la FGTB, ce texte précise la notion de démocratie économique et introduit celle de « contrôle ouvrier ». Il se prononce également pour la nationalisation des holdings. Ce programme de réformes de structures est teinté d’ambiguïté : il peut se lire comme un programme de réformes radicales dans le cadre du capitalisme ou comme une déclinaison belge du « programme de transition » de L. Trotsky. La première interprétation est celle des « centristes » rassemblés autour de La Gauche dont fait partie J. Yerna. La seconde est la lecture que tentent d’imposer E. Mandel et les militants trotskystes. En dépit de son caractère équivoque – ou, plus certainement, grâce à lui –, ce programme se révèle suffisant pour servir d’axe idéologique aux différentes composantes de l’aile gauche du PSB et leur permettre de peser sur la direction, sans toutefois emporter de bataille décisive (cf. N. Latteur, La Gauche en mal de la gauche, op. cit., p. 35).
-
[39]
Cf. « Le congrès extraordinaire du PSB les 19 et 20 septembre 1959 », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 33, 1959.
-
[40]
J. Yerna avait créé dans ce service une commission économique à l’origine des rapports « Réformes de structures » et « Holdings et démocratie économique » adoptés par la FGTB lors de ses congrès de 1954 et 1956 ; il avait ainsi contribué au renouvellement du programme doctrinal du syndicat (cf. P. Delforge, « Yerna Jacques », Encyclopédie du mouvement wallon, tome 3, Charleroi, 2001, p. 1685-1686).
-
[41]
À ce sujet, cf. N. Latteur, Le journal La Gauche, son origine et son évolution (1957-1964), mémoire de licence en Histoire, ULB, 1996, p. 71 ; P. Tilly, André Renard : biographie, Bruxelles, Le Cri, 2005, p. 595.
-
[42]
Loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, Moniteur belge, 15 février 1961. Cf. notamment « Les grèves “contre la loi unique” », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 91, 1961 ; « La grève générale en Belgique (décembre 1960-janvier 1961) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 113, 1961 ; J. Neuville, J. Yerna, Le choc de l’hiver 60-61 : les grèves contre la loi unique, Bruxelles, De Boeck, 1990.
-
[43]
Ces projets, que La Gauche dénonce comme des lois anti-grève, prévoient le renforcement du pouvoir central. Ils aggravent les peines encourues pour participation à des émeutes et renforcent la possibilité pour les gouverneurs de province de se substituer aux bourgmestres comme autorité des polices communales. Ils donnent aussi la possibilité au gouvernement d’agir par arrêté royal pour déclarer un secteur industriel « vital » et de se substituer aux commissions paritaires pour fixer les prestations vitales à effectuer et éventuellement de procéder à la réquisition de travailleurs en grève (cf. notamment « Les projets gouvernementaux sur le “maintien de l’ordre” », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 171, 177 et 190, 1962-1963 ; J. Dohet, « Lois sur le maintien de l’ordre ou limitation du “droit de grève” ? Un débat toujours actuel », in B. Francq, L. Courtois, P. Tilly (dir.), Mémoire de la grande grève de l’hiver 1960-1961 en Belgique, Bruxelles, Le Cri, 2001, p. 242-257).
-
[44]
Le MPW a été créé par A. Renard à l’issue de la grève de 1960-1961 avec un programme axé sur les réformes de structures et le fédéralisme. Il rencontre un immense succès dans les milieux socialistes à sa fondation mais entre rapidement en déclin à la mort de son fondateur, en juillet 1962. Le successeur d’A. Renard à la tête du MPW, André Genot, refuse la mue du MPW en parti politique, à la déception des militants trotskystes qui y voyaient une base de masse possible pour un nouveau parti « centriste ». Cf. « Le Mouvement populaire wallon, MPW », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 275, 1965.
-
[45]
Cf. « Le problème des incompatibilités soumis au congrès du Parti socialiste belge des 12 et 13 décembre 1964 et ses conséquences », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 271, 272 et 277, 1965.
-
[46]
Le « centrisme » est un concept utilisé par Lénine pour caractériser les courants socialistes critiquant le ralliement des partis de la Deuxième Internationale à la guerre impérialiste sans rompre avec eux dans les faits. Cette notion est réactualisée par L. Trotsky pour désigner les courants et organisations oscillant entre réforme et révolution et est utilisée par les courants trotskystes de l’après-guerre pour dénoncer une politique réformiste masquée par une phraséologie révolutionnaire (cf. E. Abrahamovici, « Sur le centrisme : recueil de textes », Cahiers rouges, n° 6, 1974, p. 6).
-
[47]
SBQI, « Mon cher ami », document interne, 14 décembre 1964 (cité par M. Lorneau, « Le mouvement trotskyste belge : septembre 1939-décembre 1964 », op. cit., p. 52).
-
[48]
SBQI, « Mon cher ami », document interne, 1er novembre 1964 (cité par M. Lorneau, « Le mouvement trotskyste belge : septembre 1939-décembre 1964 », op. cit., p. 52).
-
[49]
Il est à noter qu’Ernest Mandel et Guy Desolre font partie de l’équipe de rédaction de Links, comme membres de la SBQI.
-
[50]
I. Vrancken, De Belgische trotskistische beweging, 1964-1971, op. cit., p. 185.
-
[51]
Ibidem, p. 139.
-
[52]
A. Colignon, « L’après-guerre des Jeunes Gardes socialistes », op. cit., p. 432.
-
[53]
Cf. J.-L. Salmon, Des Jeunes Gardes socialistes au Mouvement des jeunes socialistes, Bruxelles, Secrétariat national du MJS, 1985, p. 79 ; J. Cordier, De la fédération nationale des Jeunes Gardes socialistes au Mouvement des jeunes socialistes, mémoire de licence en Histoire, ULB, 1990, p. 76.
-
[54]
La FESB suit le chemin de la JGS. Bien qu’il soit difficile d’identifier quel est l’investissement des militants de la Quatrième Internationale au sein de cette structure, il appert que la FESB suit les inflexions de la JGS : elle adopte les mêmes positions, sur le plan de la politique tant intérieure qu’étrangère, et constitue comme la JGS un courant d’opposition à l’intérieur du PSB. En 1965, la FESB se déclare indépendante du PSB lors d’un congrès national qui prend place une semaine après celui de la JGS et qui rassemble 330 militants. S’il s’agit d’une décision engageant l’ensemble de l’organisation étudiante du PSB, la branche flamande, le Socialistische Vlaamse Studentbeweging (SVSB), se prononce cependant momentanément pour la continuation de son action à l’intérieur du PSB. La SVSB se rallie à la position majoritaire de la FESB lors du congrès national de mars 1967. Ce congrès, qui voit la réunification des ailes francophone et flamande, opte également pour une collaboration intensive avec la JGS et pour une solidarité politique avec la CST. Cf. I. Vrancken, De Belgische trotskistische beweging, 1964-1971, op. cit., p. 144.
-
[55]
Le Mai 68 belge, plus encore que son grand frère français, constitue un moment particulier, permettant de faire un arrêt sur image sur une vague de contestation qui dépasse largement l’année 1968, en amont comme en aval. Pour circonscrire le phénomène et le réduire à ses particularités, on se bornera ici à le décrire comme l’émergence de la jeunesse en tant que catégorie sociale autonome, s’exprimant de façon originale au travers d’une série de thématiques, de revendications et de luttes (identité culturelle, liberté d’expression, droits égaux, solidarité avec les révolutions du monde colonial, avec une dimension internationale importante). Sans que cela signifie qu’il s’agisse de la seule lecture possible de l’événement, on peut reconnaître que, dans un premier temps au moins, ce sont les milieux étudiants, profondément transformés par la massification de l’enseignement, qui ont incarné cet esprit de contestation en Belgique. Contrairement à la France, le phénomène connaît en Belgique un décalage entre contestation étudiante et contestation ouvrière. Une autre caractéristique propre à la Belgique est que l’on peut faire remonter la contestation étudiante typique de Mai 68 bien avant cette année : 1966, avec les débuts de l’affaire de Louvain, paraît être une borne chronologique adéquate, ce qui en fait un phénomène plutôt précoce au regard des autres pays européens. Par ailleurs, les premières revendications ayant émergé ont été d’ordre principalement culturel, avec le mouvement « Leuven Vlaams », avant de glisser progressivement vers un mouvement de contestation plus global incluant des revendications de type démocratique, concernant notamment la sécularisation de la société flamande. Sur cette période, cf. notamment D. Bajomée, « Le mai 68 liégeois », in Delhalle, J. Dubois, J.-M. Klinkenberg (dir.), Le tournant des années 1970, op. cit., p. 13-20 ; S. Govaert, Mai 68, c’était le temps où Bruxelles contestait, Pol-His, Bruxelles, 1990 ; R. Hemmerijckx, « In de geest van mei 68. Arbeidersprotest en radicaal militantisme in België », Cahiers d’histoire du temps présent, n° 18, 2007, p. 165 ; R. Hemmerijckx, « Le mai ouvrier en Belgique », Dissidences, n° 7, 2009, p. 120 ; R. Paulissen, La contestation à l’Université de Liège, 1967-1971, mémoire de licence en Histoire, ULg, 1992 ; D. Vanbellinghen, De Gentse studentenbeweging, 1968-1978, mémoire de licence en Histoire, UGent, 1997 ; « Évolution et implications de l’affaire de Louvain (I) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 358, 1967 ; « Le mouvement de contestation à l’Université libre de Bruxelles », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 419-420, 1968.
-
[56]
J.-P. Salles, La Ligue communiste révolutionnaire, 1968-1981 : instrument du grand soir ou lieu d’apprentissage ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 49 ; A.-B. Haeghens, L’opposition à la guerre du Vietnam en Belgique (1965-1970) : politique extérieure, débats parlementaires, initiatives personnelles, comités de soutien et couverture médiatique, mémoire de master en Histoire, UCL, 2015.
-
[57]
La Gauche, 24 février 1968, p. 8 (cité par I. Vrancken, De Belgische trotskistische beweging, 1964-1971, op. cit., p. 153).
-
[58]
À ce sujet, cf. B. De Bakker, « La grève des mines du Limbourg (janvier-février 1970) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 499, 1970.
-
[59]
P. Delwit, PTB, nouvelle gauche, vieille recette, Liège, Luc Pire, 2014, p. 61.
-
[60]
Il est important de repréciser ici que la SBQI ne constitue pas à l’époque la seule organisation belge se revendiquant du trotskysme : elle en est simplement, mais de loin, l’expression majoritaire. Pour une vision précise des organisations et groupes trotskystes qui ont existé ou existent encore en Belgique, on se reportera à l’annexe n° 6 du présent Courrier hebdomadaire.
-
[61]
J. Birnbaum, « Transmission révolutionnaire et pédagogie de la jeunesse. L’exemple des trotskismes français », Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 4, 2008, p. 5.
-
[62]
J. L. Doneux, H. Le Paige, Le front du Nord : des Belges dans la guerre d’Algérie (1954-1962), Bruxelles, Pol-His, 1992, p. 88.
-
[63]
Les « groupes Esprit », constitués autour de la revue du même nom, se revendiquent de la pensée d’Emmanuel Mounier, philosophe français de l’entre-deux-guerres. Ce courant de pensée fonde sa doctrine sur le « personnalisme » qu’il définit comme une troisième voie, humaniste, rejetant le capitalisme et le marxisme. Il a exercé une certaine influence sur les intellectuels français jusque dans les années 1950 et a essaimé dans les pays limitrophes, dont la Belgique (cf. M. Winock, Histoire politique de la revue “Esprit” (1930-1950), Paris, Seuil, 1975, p. 139 ; D. Moury, Le groupe “Esprit” de Bruxelles (1945-1965), mémoire de licence en Histoire, UCL, 1985, p. 70-75 ; J.-L. Jadoulle, Chrétiens modernes ? Regard sur quelques milieux intellectuels catholiques “progressistes” en Belgique francophone (1945-1958), thèse de doctorat en Histoire, UCL, 1999). Pour une première approche de la pensée d’E. Mounier, cf. P. Grelley, « Redécouvrir le personnalisme », Informations sociales, n° 145, 2008, p. 51-52.
-
[64]
Selon la formule de P. Yonnet, Jeux, modes et masses, Paris, Gallimard, 1985 (cité par J.-P. Le Goff, « Mai 68 : la France entre deux mondes », Le Débat, n° 149, 2008, p. 86). Pour une approche spécifique à la Belgique, cf. G. Wintgens, Les adolescents belges des années 1960 : affirmation d’une catégorie sociale étudiée à travers la presse et les ouvrages de spécialistes de la jeunesse, mémoire de master en Histoire, ULg, 2015.
-
[65]
Cf. notamment D. Laureys, « 1971, la grève des appointés de la sidérurgie liégeoise », in M. Alaluf (dir.), Cols blancs, cœur rouge. Les combats des employés, techniciens et cadres du SETCA Liège-Huy-Waremme, Seraing/Liège, IHOES/SETCA Liège-Huy-Waremme, 2012, p. 147-153 ; J. Van de Kerckhove, « Grèves spontanées, phénomènes et symptômes de crise. Quelques constatations et réflexions sur la vague de grèves en Belgique de 1970 à 1972 », Recherches sociologiques, volume 4, n° 2, 1973, p. 335-356 ; F. Clavora, « Les grèves sauvages », La Revue nouvelle, volume 57, n° 3, 1973, p. 258-266.
-
[66]
Cf. « Le conflit social à l’usine Michelin (fin 1969 - mi 1970) dans le contexte des grèves sauvages », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 491, 1970 ; S. Dongkyu, « Main-d’œuvre immigrée et revendications “qualitatives”. La “grève sauvage” chez Michelin à Leeuw-Saint-Pierre en 1970 », Revue belge d’histoire contemporaine, volume 42, n° 1, 2012, p. 103-138.
-
[67]
Cf. notamment LRT, « Les travailleurs au pouvoir. Programme de fondation de la Ligue révolutionnaire des travailleurs, mai 1971 », Bruxelles, 1971.
-
[68]
Ce nombre se réduit rapidement, en raison de la défection d’anciens membres du PWT et de la majorité de la section des RS de Bruxelles (cf. I. Vrancken, De Belgische trotskistische beweging, 1964-1971, op. cit., p. 187) et, surtout, de la chute continue des effectifs de la JGS jusqu’à une centaine de membres à peine (cf. M. Lorneau, « Le mouvement trotskyste belge : septembre 1939-décembre 1964 », op. cit., p. 56).
-
[69]
Cf. R. Hemmerijckx, « Le mai ouvrier en Belgique », op. cit., p. 120.
-
[70]
La Libre Belgique, 31 janvier 1970 (cité par J.-L. Degée, L’évolution des luttes ouvrières en Belgique, op. cit., p. 38).
-
[71]
Chambre des représentants, Projet de loi interdisant les milices privées et les groupes qui tendent par leurs agissements à troubler l’ordre ou la sécurité publique, n° 430/1, 3 novembre 1972, p. 62. Cf. J.-M. Chauvier, « “Gauchisme” et nouvelle gauche en Belgique (II) », op. cit., p. 34.
-
[72]
Sur les différentes organisations maoïstes belges de cette époque, cf. M. Abramowicz, « Au cœur de la galaxie marxiste-léniniste de Belgique », Dissidences, n° 7, 2009, p. 104-115.
-
[73]
73 Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging [= AMSAB], Archief van de Belgische Trotskistische Beweging [= ABTB]. Politiek bureau, 42, Résolution du comité central, 21 novembre 1971.
-
[74]
Le comité de rédaction, d’abord commun aux deux journaux, est scindé sur une base linguistique en novembre 1971, avant d’être réunifié quelques mois plus tard (ibidem).
-
[75]
Chambre des représentants, Annales parlementaires, n° 20, 1er février 1973, p. 567.
-
[76]
Cf. L. Bouvier, Entre antimilitarisme et Guerre froide, les réactions en Belgique francophone au plan Vanden Boeynants de suppression du sursis pour les étudiants (1972-1973), mémoire de master en Histoire, ULg, 2014.
-
[77]
Loi du 15 juillet 1974 modifiant les lois sur la milice, coordonnée le 30 avril 1962, Moniteur belge, 15 septembre 1974.
-
[78]
B. Henkens, Van nationale overkoepeling naar klein-linkse vakbond: de Vereniging van Vlaamse Studenten (1974-1983), mémoire de licence en Histoire, KUL, 1993.
-
[79]
« Les directions syndicales craignent un nouveau 60-61. Elles sabotent », La Gauche, n° 48, 18 décembre 1975, p. 1.
-
[80]
AMSAB, ABTB. Centraal comité, 119, Lettre aux exécutifs régionaux, 10 mars 1973, p. 2.
-
[81]
À propos de cette formation, cf. M. Abramowicz, « Le parti prochinois de Belgique dans son contexte historique (1963-1989) », Dissidences, n° 7, 2009, p. 93-103.
-
[82]
Constituant une variante du maoïsme très en vogue dans l’après Mai 68, les mao-spontanéistes (ou mao-spontex) professent la « spontanéité révolutionnaire des masses » et se refusent à la construction de partis d’avant-garde au profit d’une immersion directe au sein du peuple. Cette tendance se caractérise par son anti-autoritarisme et son rejet virulent des organisations ouvrières traditionnelles, en ce compris les syndicats, jugés irrémédiablement bureaucratisés. Pour une première approche de ce courant, malgré une analyse discutable de ce qu’il a représenté, cf. C. Bourseiller, Les maoïstes : la folle histoire des gardes rouges français, Paris, Plon, 1996.
-
[83]
M. Abramowicz « Au cœur de la galaxie marxiste-léniniste de Belgique », op. cit., p. 109.
-
[84]
Pour une relation des débuts de ce groupe, cf. G. Dache, La grève générale insurrectionnelle et révolutionnaire de l’hiver 1960-1961, Bruxelles, Marxisme.be, 2010, p. 266.
-
[85]
Issu d’une scission de la Quatrième Internationale car opposé à l’entrisme, le courant lambertiste (appelé ainsi car le pseudonyme de son animateur principal, Pierre Boussel, est « Pierre Lambert ») s’est constitué en organisation indépendante dès 1952 sous le nom de Parti communiste internationaliste (PCI). Avec d’autres tendances en rupture avec la Quatrième Internationale (pabliste puis mandeliste), le PCI crée le Comité international de la Quatrième Internationale (CIQI) puis, en 1972, le Comité d’organisation et de reconstruction de la Quatrième Internationale (CORQI) dont le Groupe trotskyste de Belgique est la section belge. Sur les premières années du courant lambertiste, cf. J. Hentzgen, Agir au sein de la classe, les trotskystes français majoritaires de 1952 à 1955, mémoire de maîtrise en Histoire, université de Paris I, 2006.
-
[86]
Sur la genèse de ce groupe, cf. É. Byl, Le PTB et le PSL : leur histoire, leurs différences et les possibilités de collaboration, Bruxelles, Marxisme.be, 2016, p. 97-103.
-
[87]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 42, Rapport pour le comité central, 10 juillet 1971, p. 2.
-
[88]
K. Borms, « La grève des dockers (6 avril - 6 juin 1973) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 618-619, 1973, p. 40.
-
[89]
« Caterpillar : un test patronal », La Gauche, n° 16-17, 13 avril 1973, p. 1-2.
-
[90]
« Les maoïstes et la lutte anti-VDB », La Gauche, n° 6-7, 8 février 1973, p. 2.
-
[91]
« Lettre ouverte au président du Parti communiste de Belgique », La Gauche, n° 24, 8 juin 1973, p. 4.
-
[92]
Cf. par exemple cette citation : « Il faut prévoir que notre principal concurrent sera une organisation qui contrairement aux mao’s a une perspective stratégique : le Parti communiste » (AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 122, Rapport politique pour le comité central, s.d., p. 5).
-
[93]
J. Gotovitch, « Histoire du Parti communiste de Belgique », op. cit., p. 34-36.
-
[94]
« Le Parti communiste belge écartelé entre la social-démocratisation avancée et le retour au stalinisme », La Gauche, n° 7, 19 février 1971, p. 6.
-
[95]
« Où va le Parti communiste ? », La Gauche, n° 5, 5 février 1971, p. 7.
-
[96]
« L’unité ouvrière dans la perspective anticapitaliste », La Gauche, n° 16, 28 avril 1972, p. 4.
-
[97]
« Ouvriers, à l’offensive ! », La Gauche, n° 24, 8 juin 1973, p. 1-2.
-
[98]
AMSAB, ABTB. Centraal comité, 119, Résolution du comité central, 2 octobre 1971, p. 1.
-
[99]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 42, Rapport pour le comité central, 10 juillet 1971, p. 1.
-
[100]
Cf. par exemple cette citation : « Le PSB ne se cache même plus derrière le réformisme pour rejoindre un gouvernement impopulaire qui défend le capital » (« Ne faites confiance qu’à vos luttes », La Gauche, n° 18, 27 avril 1973, p. 8).
-
[101]
AMSAB, ABTB. Centraal comité, 119, « L’unité ouvrière dans la perspective anticapitaliste : le rassemblement des progressistes », Note introductive pour le comité central des 27 et 28 mai 1972, s.d., p. 3.
-
[102]
AMSAB, ABTB. Centraal comité, 119, Lettre aux exécutifs régionaux, 25 novembre 1972, p. 1.
-
[103]
« L’assemblée des chrétiens contestataires », La Gauche, n° 19, 14 mai 1971, p. 12.
-
[104]
« L’unité ouvrière dans la perspective anticapitaliste », La Gauche, n° 16, 28 avril 1972, p. 4.
-
[105]
Cf. F. Maerten, « René Noël et l’Union démocratique et progressiste, 1971-1982. À la recherche d’un autre communisme dans un Borinage en crises », Cahiers d’histoire du temps présent, n° 15, 2005, p. 435-459.
-
[106]
« Les élections législatives du 7 novembre 1971 (I) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 544, 1971, p. 14.
-
[107]
AMSAB, ABTB. Centraal comité, 119, « L’unité ouvrière dans la perspective anticapitaliste : le rassemblement des progressistes », Note introductive pour le comité central des 27 et 28 mai 1972, s.d., p. 4.
-
[108]
« UDR [sic] : un succès mais pour quoi faire ? », La Gauche, n° 49, 3 décembre 1971, p. 13.
-
[109]
H. Lemaître, Les gouvernements belges de 1968 à 1980 : processus de crise, Stavelot, Chauveheid, 1982, p. 131.
-
[110]
AMSAB, ABTB. Centraal comité, 119, « Pour une campagne intense et précise de la LRT par rapport aux élections », s.d., p. 1.
-
[111]
« Les élections législatives du 10 mars 1974 », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 638, 1974, p. 5.
-
[112]
P. Le Grève, Souvenirs d’un marxiste anti-stalinien, op. cit., p. 204.
-
[113]
LRT, « Les travailleurs au pouvoir », op. cit.
-
[114]
Cf. « La grève de septembre-octobre 1973 à Cockerill », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 656, 1974.
-
[115]
Sur cet épisode, cf. « La grève de septembre-octobre 1973 à Cockerill », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 656, 1974 ; F. Gomez, Rouge métal : 100 ans d’histoire des métallos liégeois de la FGTB, Seraing, IHOES, 2006, p. 157-160 ; L. Bettens, É. Geerkens, « Des occupations d’usine à la médiatisation culturelle », op. cit., p. 64.
-
[116]
Institut d’histoire ouvrière économique et sociale [= IHOES], Fonds de la Ligue révolutionnaire des travailleurs [= LRT], III-5-D, Texte d’une pétition pour la réintégration des sept ex-délégués syndicaux de Cockerill dans l’usine.
-
[117]
La Gauche, n° 39, 12 octobre 1973, p. 1.
-
[118]
G. Dobbeleer, Militer au XXe siècle : sur les traces de la révolution, Bruxelles, Léon Lesoil, 2009, p. 58.
-
[119]
Ibidem.
-
[120]
M. Nélisse, Évolution de l’extrême gauche en Belgique, 1968-1978, op. cit., p. 215.
-
[121]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 42, « Rapport du comité central du 11/3/73 », Bulletin intérieur, n° 5, mars 1973, p. 3.
-
[122]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 42, « La LRT et nous », 1er novembre 1972, p. 2.
-
[123]
AMSAB, ABTB. Congressen, 48, « Bulletin intérieur préparatoire au 2e congrès de la LRT », n° 1, 31 juillet 973, p. 4.
-
[124]
Archives personnelles de Jean Peltier, « RAL/LRT, Congrès 1974 », p. 31.
-
[125]
Parmi les personnalités avec lesquelles la collaboration se fait plus intense, on retiendra par exemple le professeur Marcel Liebman (ULB), compagnon de route des trotskystes depuis les débuts de La Gauche (cf. M. Abramowicz, La gauche radicale en Belgique francophone (1963-2004). Impact électoral, politique et social, mémoire FOPES, UCL, 2004, p. 233).
-
[126]
Archives personnelles de Jean Peltier, « RAL/LRT, Congrès 1974 », p. 3.
-
[127]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 51, « La LRT doit se transformer en une organisation militante qui commence à s’implanter dans la classe ouvrière », Lettre aux membres, n° 17, 21 juin 1975, non paginé.
-
[128]
J.-M. Chauvier, « “Gauchisme” et nouvelle gauche en Belgique (II) », op. cit.
-
[129]
Sur l’extension du champ des possibles provoquée par les expériences autogestionnaires (dont celles de Lip), cf. X. Vigna, L’insubordination ouvrière dans les années 68 : essai d’histoire politique des usines, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 107-111 ; P. Pasture, « Histoire et représentation d’une utopie : l’idée autogestionnaire en Belgique », in F. Georgi (dir.), Autogestion, la dernière utopie ?, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, p. 143-156.
-
[130]
Sur cette question particulière, cf. B. Marques-Pereira, L’avortement en Belgique : de la clandestinité au débat politique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1989.
-
[131]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 52, Lettre aux membres, 24 janvier 1977.
-
[132]
B. Hellinck, « Over integratie en confrontatie. Ontwikkelingen in de homo- en lesbiennebeweging », Cahiers d’histoire du temps présent, n° 18, 2007, p. 120.
-
[133]
La Gauche, n° 41, 26 octobre 1977, p. 8.
-
[134]
M. Abramowicz, La gauche radicale en Belgique francophone (1963-2004), op. cit., p. 69.
-
[135]
Cf. B. Lechat, Écolo, la démocratie comme projet, tome 1 : Du fédéralisme à l’écologie, Namur, Etopia, 2014.
-
[136]
Sur le mouvement de solidarité avec les militants chiliens exilés en Belgique après le coup d’État du général Pinochet, cf. T. Englebert, La fédération de mouvements de solidarité en Belgique francophone pour l’Amérique latine après le coup d’État au Chili, mémoire de master en Sociologie, ULg, 2010 ; L. Monard, De Belgische vakbonden en het Chili van Pinochet 1973-1989, mémoire de maîtrise en Histoire, KUL, 2009.
-
[137]
Concernant la radicalisation de la mouvance chrétienne en Flandre dans le sillage des nouveaux mouvements sociaux, cf. B. Latré, Strijd en inkeer: de kerk- en maatschappijkritische beweging in Vlaanderen, 1958-1990, Louvain, Leuven University Press, 2011.
-
[138]
« Le remplacement des avions de combat de la force aérienne belge », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 690, 1975, p. 6.
-
[139]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 51, Lettre aux membres, novembre 1974.
-
[140]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 51, Lettre aux membres (à titre d’information), 16 avril 1975.
-
[141]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 52, Lettre aux membres, 22 octobre 1976.
-
[142]
Cf. M. Beys, « Sous les pavés une presse libérée ! Trois tentatives de journalisme radical en Belgique après 1968 : Notre temps (1972-1977), Hebdo (1975-1977) et Pour (1973-1982) », in J. Gotovitch, A. Morelli (dir.), Presse communiste, presse radicale (1919-2000). Passé, présent, avenir ?, Bruxelles, Aden, 2007, p. 64-92.
-
[143]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 52, Lettre aux membres, 11 juin 1976.
-
[144]
Pour une comparaison détaillée du poids électoral de la LRT par rapport à celui d’autres formations politiques de la gauche radicale, cf. M. Abramowicz, La gauche radicale en Belgique francophone (1963-2004), op. cit.
-
[145]
Sur l’évolution de l’UDP dans la région montoise, cf. F. Maerten, « René Noël et l’Union démocratique et progressiste, 1971-1982 », op. cit.
-
[146]
G. Dobbeleer, Militer au XXe siècle, op. cit., p. 61.
-
[147]
Cf. F. Maerten, « René Noël et l’Union démocratique et progressiste, 1971-1982 », op. cit.
-
[148]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 52, Lettre aux membres, 9 décembre 1976.
-
[149]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 52, Lettre aux membres, 24 janvier 1977.
-
[150]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 52, Lettre aux membres, 9 décembre 1976.
-
[151]
Archives personnelles F. Arets, « Résolution pour la campagne électorale », s.d., p. 8.
-
[152]
La Gauche, n° 16, 20 avril 1977, p. 4-5.
-
[153]
La Gauche, n° 17, 27 avril 1977, p. 5.
-
[154]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 52, Lettre aux membres, 5 mai 1977.
-
[155]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 51, Lettre aux membres, février 1975, p. 10.
-
[156]
Ibidem, p. 3.
-
[157]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 51, Lettre aux membres, 14 mars 1975, p. 4.
-
[158]
Wout, « Le décalage entre la “direction” et la “base” », Info, n° 5, s.d., non paginé.
-
[159]
Ibidem.
-
[160]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 52, « La campagne emploi, quel bilan ? », Lettre aux membres, 9 janvier 1978, p. 9.
-
[161]
AMSAB, ABTB. Politiek bureau, 52, « Rapport du [comité central] des 2 et 3 juillet [1977] », Lettre aux membres, 15 juillet 1977.
-
[162]
X. Mabille, « Le gouvernement Tindemans (1974-1977) : évolution de sa composition et de son assise parlementaire », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 754, 1977, p. 17.
-
[163]
La génération de 1968 n’est pas épargnée par les départs. Ainsi, Frank Vandenbroucke, futur ministre fédéral et ministre flamand (SP puis SP.A), quitte la LRT peu après le quatrième congrès de celle-ci (cf. M. Abramowicz, La gauche radicale en Belgique francophone (1963-2004), op. cit., p. 120).
-
[164]
IHOES, Fonds Simon Hupkens [= SH], H145 (IV-3-B), Farde de presse du congrès national de la LRT de 1978.
-
[165]
Ibidem.
-
[166]
Cf. notamment X. Mabille, « Les facteurs d’instabilité gouvernementale (décembre 1978 - avril 1981) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 916, 1981.
-
[167]
M. Abramowicz « Au cœur de la galaxie marxiste-léniniste de Belgique », op. cit., p. 109.
-
[168]
Cf. D. Robert, Analyse de l’évolution idéologique et politique du Parti du travail de Belgique (PTB) entre 1979 et 1990, mémoire de licence en Histoire, UCL, 2000.
-
[169]
Généralement dénommée « minorité internationale » dans les textes internes, la FLT – dont le bastion est la section états-unienne de la Quatrième internationale, le SWP – est un courant interne à la Quatrième Internationale qui se constitue en 1973 autour d’un désaccord concernant le soutien que la Quatrième Internationale accorde aux guérillas en Amérique latine. Contestant les positions du secrétariat international, cette tendance anime l’opposition au niveau international entre 1973 et 1979. Opposée également au tournant vers la « nouvelle avant-garde jeune », elle se caractérise par une volonté de respecter une stricte orthodoxie des thèses trotskystes (cf. F. Moreau, Combats et débats de la IVe Internationale, op. cit., p. 208). En Belgique, cette tendance est extrêmement minoritaire, mais elle s’oppose par exemple au concept d’autogestion au motif qu’il s’agit selon elle d’une « abdication de notre programme pour conquérir la “nouvelle avant-garde”, pour être “dans le vent” » (Gaston, « Proposition de travail pour le secteur ouvrier », Info, n° 5, 21 septembre 1975, p. 20).
-
[170]
« Servir le peuple », répétaient alors les militants maoïstes. Reprise par les étudiants maoïstes, cette citation de Mao Tsé-Toung (peut-être inventée, cf. D. Reid, « Le grand récit des établis (et ses multiples entrées) », Les temps modernes, n° 684-685, 2015, p. 36) constituait la base théorique d’une pratique politique devant partir de la volonté de comprendre la classe ouvrière et de se fondre dans les masses (cf. J. Freyss, « Il faut rêver mais sérieusement », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 9, 1987, p. 30). Pour une histoire de l’établissement en usine par les étudiants maoïstes de 68, cf. également M. Dressen, De l’amphi à l’établi : les étudiants maoïstes à l’usine, 1967-1989, Paris, Belin, 2000.
-
[171]
Cf. Vigna, L’insubordination ouvrière dans les années 68, op. cit., p. 281-296.
-
[172]
IHOES, LRT, III-5-D, RES, 78-5/82, Lettres aux exécutifs régionaux, 17 novembre 1978.
-
[173]
Cf. par exemple IHOES, SH, H145 (IV-3-B), « Les élections ne changeront rien. La bourgeoisie prépare son état fort. Organisons nos luttes », Document LRT n° 1, 1973.
-
[174]
IHOES, LRT, III-5-D, RES, 78-5/82, « À propos des congrès régionaux d’application du 4e congrès national », Note interne du secrétariat national à destination des exécutifs régionaux, 3 avril 1978.
-
[175]
La Gauche, n° 21, 25 mai 1978, p. 4. Il s’agit là d’une référence à : Chambre des représentants, Projet de loi de réformes économiques et budgétaires, n° 450/1, 22 juin 1978.
-
[176]
En mai 1978, des rebelles du Front national pour la libération du Congo (FNLC), soutenus par l’URSS, tentent pour la seconde fois de prendre le contrôle de la province du Shaba (actuel Katanga, en République démocratique du Congo, alors dénommée Zaïre). La France et la Belgique envoient des troupes afin d’évacuer leurs ressortissants et de stabiliser la région (cf. N. Kinsey Powell, « La France, les États-Unis et la Force interafricaine au Zaïre (1978-1979) », Relations Internationales, n° 150, 2012, p. 74). Cette intervention est dénoncée par l’extrême gauche belge (à l’exception de TPO-AMADA), notamment par la LRT qui y voit une opération de soutien au président zaïrois Joseph-Désiré Mobutu.
-
[177]
IHOES, LRT, III-5-D, RES, 78-5/82, Lettre aux exécutifs régionaux, 7 juillet 1978, p. 2. La LRT, qui compte parmi les premières organisations à réagir à l’envoi de troupes au Shaba, contribue à la création d’une plateforme « de solidarité avec le peuple congolais » qui organise meetings et manifestations tout au long des années 1978 et 1979, dans un premier temps pour le retrait des militaires belges puis dans un second temps en faveur de la démocratisation du régime de Mobutu (cf. « Face aux événements du Shaba. Pour une réaction unitaire », La Gauche, n° 21, 25 mai 1978, p. 3 ; « Solidarité avec la lutte du peuple congolais », La Gauche, n° 9, 1er mars 1979, p. 4).
-
[178]
Archives personnelles de France Arets, « Campagne contre le chômage. Résolution du comité central des 1 et 2 septembre 1979 », Lettre aux membres, septembre 1979, p. 1.
-
[179]
Ibidem, p. 2.
-
[180]
Archives personnelles de F. Arets, « La campagne emploi de décembre au premier mai », Lettre aux membres, janvier 1980, p. 3.
-
[181]
IHOES, LRT, III-5-D 78-5/82, « À propos des congrès régionaux d’application du 4e congrès national », Note interne du secrétariat national à destination des exécutifs régionaux, 3 avril 1978, p. 1.
-
[182]
J. Barnes, « Le tournant vers l’industrie et les tâches de la IVe Internationale », Inprecor, numéro spécial : XIe congrès mondial de la IVe Internationale, novembre 1979, p. 53.
-
[183]
« Sur la prolétarisation ou le tournant vers l’industrie », Info, n° 4, 4 décembre 1979, p. 5.
-
[184]
Alfred, Galeano, Levi, Tantalus, « Pourquoi nous avons voté contre le texte sur la prolétarisation », Info, n° 4, 4 décembre 1979, p. 1.
-
[185]
Na, Flora, Julia, « La transformation de la LRT et le travail femme », Info, n° 8, 15 février 1980, non paginé.
-
[186]
Rivière, Rudi, « Bilan de la direction », Info, n° 11, 26 février 1980, p. 3.
-
[187]
La Gauche, n° 17, 24 avril 1980, p. 2.
-
[188]
« Rapport de synthèse après la réunion des bureaux politiques européens [sur le tournant vers l’industrie] », Lettre aux membres, juin 1980, p. 6.
-
[189]
Cf. Chambre des représentants, Projet de loi portant des mesures conservatoires et transitoires en matière de modération de tous les revenus, n° 699/1, 16 décembre 1980.
-
[190]
É. Arcq, M. Piraux, « L’accord interprofessionnel du 13 février 1981 », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 914, 1981, p. 10.
-
[191]
La Gauche, n° 4, 29 janvier 1981, p. 9.
-
[192]
Le Comité du 1er Mai pour les libertés démocratiques et les droits des travailleurs dans les pays de l’Est est le nom pris en 1977 par le Comité pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste (créé en 1973 par Jean-Marie Chauvier, journaliste et membre du PCB, en soutien aux militants du Printemps de Prague frappés par la répression). Il rassemble des personnalités de la gauche chrétienne ou socialiste, militants syndicaux ou intellectuels de gauche. Son animateur principal, Elie Gross, est membre de la LRT. Cf. J.-M. Chauvier, « “Gauches solidaires” : les comités belges solidaires des luttes pour les droits démocratiques à l’Est », communication lors du colloque international « L’Autre Printemps », Bruxelles, Centre des archives du communisme en Belgique (CARCOB), 22 novembre 2008, www.carcob.eu, p. 4 ; P. Dewandre, Initiatives de solidarité contre la répression en Tchécoslovaquie en Belgique francophone. Autour des dix ans du Printemps de Prague et de l’invasion soviétique (1977-1979), mémoire de master en Histoire, ULg, 2017.
-
[193]
La Gauche, n° 13, 2 avril 1981, p. 2.
-
[194]
IHOES, LRT, III-5-D, RES 78-5/82, Lettre aux exécutifs régionaux, 26 juin 1981, p. 1.
-
[195]
« Rapport du [comité central] du 19/9[/1982] », Lettre aux membres, 17 octobre 1982.
-
[196]
La Gauche, n° 38, 8 octobre 1982, p. 3.
-
[197]
C. Remacle, « Liège : laboratoire de dégraissage des services publics et des privatisations », Cahiers marxistes, n° 190, 1993, p. 80.
-
[198]
Par la suite, M. Capron suivra de près l’évolution du groupe Cockerill dans le cadre de sa carrière académique, comme en témoignent les nombreux travaux qu’il a consacrés à ce thème (cf. en particulier M. Capron, « Cockerill-Sambre, de la fusion à la “privatisation” 1981-1989 », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1253-1254, 1989).
-
[199]
A. Tondeur, « La LRT dans la grève des services public », La Gauche, n° 27, 7 octobre 1983, p. 6-7.
-
[200]
En crise depuis les années 1970, le secteur sidérurgique wallon est alors, d’une part, fusionné sous l’impulsion de l’homme d’affaires belge Albert Frère et, d’autre part, restructuré notamment sur la base des conseils du consultant Jean Gandois, futur président du Conseil national du patronat français (CNPF). Censé assurer la sauvegarde du secteur, le plan Gandois aboutit à la fermeture de quatre sites et à la suppression de quelque 8 000 emplois.
-
[201]
« Valfil pour tous, tous pour Valfil », La Gauche, n° 31, 2 décembre 1983, p. 4-5.
-
[202]
« Au delà de Valfil », La Gauche, n° 32, 16 décembre 1983, p. 1.
-
[203]
« Une conférence ouvrière pleine de vitamines », La Gauche, n° 31, 2 décembre 1983, p. 6-7.
-
[204]
« Construire le parti révolutionnaire des travailleurs, le parti de l’avant-garde ouvrière », Forum, n° 2, 23 octobre 1983, p. 18.
-
[205]
Galéano, Marie, « Aux membres de la LRT », Lettre aux membres, 13 novembre 1983, p. 4.
-
[206]
Sky, « Je démissionne de la LRT », Lettre aux membres, 13 novembre 1983, non paginé.
-
[207]
« PV du 7e congrès national », Lettre aux membres, 22 mars 1984, non paginé.
-
[208]
« 3 motions sur le changement de nom du parti », Forum, n° 5, 1er janvier 1984, non paginé.
-
[209]
« Nom du parti », Forum, n° 6, 19 janvier 1984, non paginé.
-
[210]
« PV du 7e congrès national », Lettre aux membres, 22 mars 1984, non paginé.
-
[211]
M. Lorneau, « Le mouvement trotskyste belge : septembre 1939-décembre 1964 », op. cit., p. 56.
-
[212]
Ibidem.
-
[213]
P. Delwit, J.-M. De Waele, Les partis politiques en Belgique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1997, p. 214.
-
[214]
Ibidem.
-
[215]
« Objectifs nationaux pour le plan d’implantation », Forum, n° 5, décembre 1980, p. 9.
-
[216]
« Le centralisme démocratique dans la LRT aujourd’hui », Info, n° 11, 3 février 1978, non paginé.
-
[217]
« La campagne emploi : quel bilan ? », Lettre aux membres, n° 27, 9 janvier 1978, p. 9.
-
[218]
« La IV ou la mort. Bilan de la campagne électorale de la cellule hôpitaux », Forum, n° 1, janvier 1982, p. 6.
-
[219]
Cf. M. Abramowicz, La gauche radicale en Belgique francophone (1963-2004), op. cit., p. 120.
-
[220]
J.-P. Salles, La Ligue communiste révolutionnaire, 1968-1981, op. cit., p. 317.
-
[221]
Confrontées à la « crise du militantisme » dont il a été question plus haut, les organisations de ce type réagissent différemment en fonction de leur degré d’intégration de la culture contestataire de Mai 68. Si l’on considère une organisation comme LO, qui y a été très réfractaire, on constate un modèle qui reste très crispé sur un modèle bolchévique souvent fantasmé (cf. C. Rougier, « La confrontation des habitus militants au sein de la LCR Gironde. Enjeux et luttes symboliques pour la légitimité des modes d’engagement », Dissidences, n° 6, 2009, p. 120-133).
-
[222]
F. Johsua, « Les conditions de (re)production de la LCR », op. cit., p. 33.